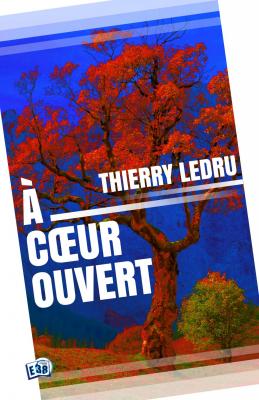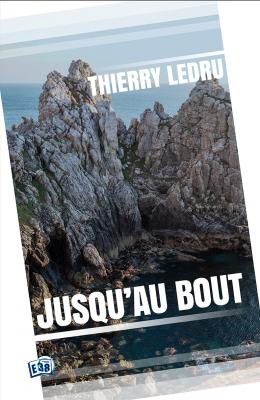Les lieux perdus
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/03/2020
- 2 commentaires
Dans une discussion sur les maisons isolées, perdues dans des lieux déserts, des vallées de montagnes, loin des masses et de leurs nuisances, j'ai réalisé à quel point, dans mes romans, ces lieux d'habitation trouvaient souvent une place...
Il n'est pas étonnant que ça soit aujourd'hui notre projet le plus intense : quitter cette vallée désormais trop urbanisée, trouver une maison sans aucun vis-à-vis, enveloppée dans un cocon de silence, hors de tous regards, au bout d'une piste en terre qui semble ne mener nulle part...
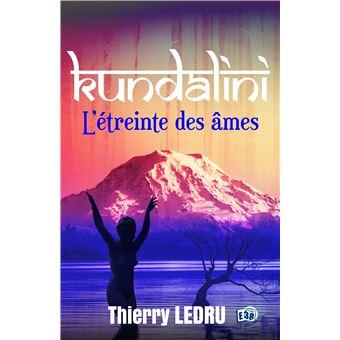
Piste forestière de l’aiglon. Un grand panneau en bois. Elle trouva étrange que la direction soit aussi bien signalée. Elle pensa à l’indication d’un restaurant d’altitude, une ferme auberge. Elle espérait se tromper.
Elle roula doucement en regardant dans le rétroviseur le nuage de poussières. Elle sourit en pensant que ces volutes retombaient sur sa vie passée, qu’elle montait vers la lumière.
Elle atteignit enfin un vaste replat encadré de végétation et parsemé d’arbres solitaires, la surface d’un terrain de football, un plan horizontal inséré dans la pente. Elle devinait au plus loin une rupture de pente, l’impression que le plateau basculait sur le vide. L’emplacement d’une citadelle isolée.
Une bâtisse en pierres à l’entrée du pré, comme une ancienne ferme d’alpage. Un plain-pied ramassé, trapu, un défi au temps.
Un hangar ouvert protégeant un véhicule.
Une vingtaine de mètres plus loin, un petit chalet rectangulaire avec un toit d’un seul pan. Couvert de panneaux solaires. Elle pensa à un bungalow de camping qui aurait été renforcé par des bardages. De grandes fenêtres, une étrange éolienne au sol, des pâles horizontales, courbées et qui tournaient régulièrement malgré l’absence totale de vent.
Des murs de pierres sèches qui délimitaient l’espace, un potager aussi vaste qu’un bassin olympique, des réservoirs d’eau disséminés. Des troncs entiers couchés au sol, empilés et débités. Des stères de bois rangés sous un appentis.
D’autres panneaux solaires inclinés sur des supports métalliques.
Et puis, cette immense cabane à mi-hauteur d’un feuillu. Une maison perchée qui la fascina.
Elle gara son véhicule sur le bas-côté de la piste. Une allée gravillonnée conduisait à la maison. Un toit récent. Pas de mousse sur les lauzes, des poutres brutes, pas encore traitées. Deux grandes baies vitrées sur la façade. Des rideaux opaques entièrement tirés.
Elle claqua la porte de la voiture pour signaler son arrivée.
Aucun mouvement. Des chants d’oiseaux, le murmure d’un cours d’eau qu’elle ne voyait pas.
Un lieu si étrange. Elle se moqua d’elle. Toujours ce mot qui revenait. Tout était étrange dès lors qu’il s’agissait de Sat. Elle ne se souvenait plus exactement des paroles de Carine.
« …il est connu pour tellement de choses… »
Des brides de phrases qui l’accompagnaient.
Le visage de la gérante resplendissait et cela avait suffi à la rassurer. Carine ne l’aurait pas guidée vers une personne dangereuse. Elle semblait plutôt amusée, presque heureuse pour elle, comme s’il s’agissait d’un privilège.
Elle observa le potager. Impressionnée par la taille et la diversité des plantes. Des tuteurs, des filets de protection, des murets séparateurs, des allées. Un travail qui relevait davantage du professionnel que du particulier. Une telle quantité de légumes, ça ne pouvait être pour sa consommation personnelle. De quoi nourrir tous les résidents du camping de Carine pendant un mois. Un lacis de rigoles parcourait l’étendue, un réseau minutieusement conçu pour apporter de l’eau d’un bout à l’autre de l’espace. Une serre avec de grandes toiles plastifiées à l’extrémité des plantations, un demi-tube d’une dizaine de mètres de long.
« Maud ! »
Elle se retourna en sursautant. Il venait de franchir l’angle de la maison. Il poussait une brouette.
Il était nu. Sans se l’expliquer, elle n’en fut même pas surprise. Comme s’il ne pouvait en être autrement.
Sat.
Elle le regarda s’approcher, figée, tremblante, émue, le cœur affolé.
Les bras et les pectoraux tendus par le chargement, les muscles saillants de ses cuisses, les sangles de son ventre qui descendaient en triangle vers son pubis imberbe.
Il s’arrêta à quelques mètres, s’assura de l’équilibre de la brouette et s’approcha. Il ouvrit les bras et déposa une bise sur une joue, puis l’autre.
Le contact de ses mains sur ses épaules, la proximité de son visage, la douceur de ses lèvres. Elle frissonna et se le reprocha. Sat percevait ce qui ne se voit pas. Elle le savait.
Un instant suspendu.
« Bonjour Maud, vous avez bien dormi ?
-Absolument pas. Des voisins beaucoup trop bruyants à mon goût.
-Eh bien, venez ici, ça n’est pas la place qui manque, » lança-t-il, joyeusement.
Un large sourire sur son visage.
« Je sais que vous êtes emplie d’interrogations, ajouta-t-il, mais c’est une invitation amicale, désintéressée, juste un moyen de vous reposer comme vous le souhaitez. C’est inutile de gâcher vos vacances alors que vous pouvez disposer ici d’un calme absolu. »
Une voix posée, un regard chaleureux. Elle sentait toute sa douceur, juste ce bonheur qu’il lui proposait. Elle n’aurait jamais imaginé une telle issue et elle en arrivait à remercier intérieurement ses voisins.
Elle avala sa salive et baissa les yeux.
L’impression de se lancer dans le vide et d’ouvrir les ailes. L’euphorie des grands espaces, le survol des jours sombres, comme si le soleil entrait en elle, parcourait son corps, cascadait en torrents scintillants.
« Je ne voudrais pas m’imposer mais puisque vous me le proposez, je suis très heureuse d’accepter.
-Très bien, alors, on ira chercher vos affaires ce soir mais dans l’immédiat, on part là-haut.
-Là-haut ?
-L’endroit que j’aimerais vous montrer ? Vous avez déjà marché nue, toute la journée, pas juste sur une plage ou au bord d’un lac, mais dans la montagne, en forêt, dans les alpages ?
-Non, jamais.
-Eh bien, ça vous dit de tenter l’expérience ? »
Il la regardait. Intensément. Un éclat pétillant dans ses yeux immenses.
« Je ne le ferais pas toute seule mais avec vous, je suis partante. De toute façon, je suis prête à tout vivre. »
Il la regarda en souriant et elle se rabroua intérieurement. Les mots avaient jailli sans qu’elle n’en juge la portée.
Elle le suivit sans un mot. Le cœur à tout rompre.
« C’est un bungalow que j’ai habillé de bois pour renforcer la structure et l’isolation. C’est mon habitation principale pour le moment.
-Et cette grande bâtisse alors ?
-Je la retape depuis mon arrivée ici, il y a onze ans. J’avais vingt-trois ans quand mes parents m’ont donné ce terrain. »
Trente-quatre ans. Elle s’était empressée de calculer son âge.
Ce mélange troublant entre ce corps d’éphèbe et la portée spirituelle de ses paroles, cette voix grave et apaisante qui la liquéfiait, la délicatesse de ce regard et cette plongée inexplicable, comme un périscope en elle. Elle se sentait si jeune à ses côtés.
« Mais je préfère vivre dans mon bungalow. »
Ils traversèrent une large terrasse en bois puis Sat ouvrit la porte.
« Et vous avez fait ça… tout seul ? »
Elle pensa subrepticement à une compagne. Ou à un compagnon. Puisqu’elle savait désormais que tout était possible.
« Non, il y a des amis qui m’aident. La cabane, là-haut, on était cinq à travailler dessus. On y a passé sept mois. Je vous la montrerai ce soir. Mais il faut y aller maintenant, on a du chemin et une longue journée à vivre. »
6
Il arriva à la Godivelle après vingt heures. Une lumière rasante sur les monts et les bois, des nuages blancs qui erraient comme des pensées disparates. Il imagina que les cieux observaient la terre et commentaient le spectacle. Un sourire intérieur en constatant que la paix en lui était revenue. Peut-être le retour à cette nature, l’éloignement de la ville…
À mesure qu’il prenait de l’altitude, il avait senti l’apaisement l’envahir. Lentement, comme s’il était sorti d’un mauvais rêve et qu’il s’était éveillé. Dans les derniers kilomètres, il n’avait croisé aucun véhicule. Chaque vallonnement révélait de nouveaux paysages : des houles de collines figées, des creux protégés des vents furibonds, des bois serrés comme des retranchements de silence.
Les traversées de villages s’étaient raréfiées.
Il ne restait parfois que les lignes électriques et cette route pour marquer l’empreinte des hommes.
Il aimait particulièrement la traversée d’un vallon totalement désert, un enchâssement surprenant de prairies et de collines, quelques bois impassibles, des crêtes arrondies comme des crânes antiques.
Toujours cette impression bienheureuse d’être observé par le monde, tel un passager inconnu qui attirerait les regards.
Il s’était arrêté la première fois et répétait la chose désormais.
Il coupait le moteur, sortait et écoutait le silence en laissant ses yeux dériver lentement.
Il n’y avait rien de particulier à voir finalement. Rien de sensationnel, rien de singulier. C’est pour ça que la paix ressentie était si profonde. Il avait pensé à l’amour des océans, à cette étendue mouvante qui comblait d’amour les marins. Rien de particulier. Juste l’immensité.
Lui, il aimait les collines et les palettes de couleurs.
La Nature comme un baume apaisant, un câlin maternel, la douceur de l’amour.
Il conduisit jusqu’au village et passa devant l’épicerie. Fermée. De la lumière dans la partie habitée. Il n’osa pas aller frapper. Une douleur au ventre. Il reprit la route jusqu’au hameau.
L’air était frais quand il sortit de la voiture. Un parfum d’espace, quelque chose d’inexplicable qui l’emplissait d'une joie profonde. Il prit une longue inspiration.
Il s’arrêta à l’entrée du terrain et regarda la maison. Ancrée comme un rocher, tassée comme un dolmen. Indéracinable. Combien d’humains ces pierres avaient-elles entendus, combien de pieds avaient foulé cette terre, combien de mains s’étaient posées sur ce grain millénaire ? Combien de temps resterait-il là ? Un doute qui s’insinuait. Comme si déjà, il appartenait à ce lieu, cette vie ancestrale qui coulait en lui, un flux séculaire… Il comprenait soudainement l’attachement des gens à une terre. Il se souvenait d’un Breton qui avait travaillé dans l’usine de son père. Il ne parlait que de sa terre natale. Il avait fini par y retourner. C’était plus fort que tout.
Il se fit un plat de légumes verts. Il avait posé le saucisson sur la table sans pouvoir y toucher. L’impression inattendue d’entendre la viande pleurer la vie perdue.
Il fit la vaisselle, l’essuya et la rangea dans le buffet.
La musique du blog de Diane. Parfois, il devait s’arrêter tant les émotions l’étourdissaient, des envolées symphoniques alternant avec des plages de ressac apaisé. Il finit par s’asseoir dans le fauteuil pour écouter, les yeux fermés. Ne plus s’agiter. Comment avait-il pu ignorer ce bonheur aussi longtemps ?
Il regretta ses reproches, ils étaient inutiles, tout comme il ne servait à rien de vouloir comprendre ce qui s’était produit. Puisque cela le projetait en arrière alors que le temps présent s’offrait à lui. Il devait rester réceptif et ne pas s’encombrer. Être là, simplement. Abandonner les quêtes temporelles, ne rien vouloir, laisser venir les réponses, comme des bêtes apaisées qui n’ont plus peur, tendre l’esprit comme une main ouverte, laisser les révélations s’approcher d’elles-mêmes, le respirer, s’habituer à lui, prendre confiance, s’asseoir dans le silence et s’abandonner au présent. C’est là que la vie prenait forme, tout le reste n’était qu’une litanie de commentaires, des couvertures sombres, épaisses, irritantes, il n’avait même pas à vouloir repousser ces masses invalidantes, c’était encore une volonté emplie de peur. Juste être là, réceptif, ouvert, apaisé. Cette idée qu’il avait constamment vécu avec un temps de retard, qu’il s’était contenté de commenter les évènements et de ne jamais les vivre en pleine conscience, qu’il avait couru après les heures en s’agitant pour combler le vide, que le présent en lui n’avait jamais été autre chose qu’un passé à corriger, qu’une accumulation de réactions entachées de la nausée du temps qui s’enfuit et de l’inquiétude du temps à venir.
Il avait vécu tout en espérant vivre mais sans jamais être là. "
Il rangea soigneusement les achats et reprit la route. Deux villages, des vieilles bâtisses en pierre, des collines, des murets encadrant des champs à l’herbe grasse. Il croisa une voiture. Et un vol de corneilles.
Direction « lac de Charpal. »
Il s’engagea sur la route étroite. Aucune habitation. Cinq kilomètres de longues courbes encadrées par des peuples de pins. La lumière matinale s’étendait comme une marée câline, sans vague, ni courant, juste une nappe gigantesque, tendue comme un tissu d’aquarelles. Elle rasait le sommet des épineux. Des paysages scandinaves. La palette de couleurs l’hypnotisait. Infiniment joueur, le soleil, comme un rouleau de peinture insatiable, nuançait les teintes, cendrait les crêtes, enflammait les fûts, des parcelles s’embrasaient, d’autres coulaient dans l’ombre. Ces changements incessants donnaient au paysage l’impression étrange de mouvance. Comme des risées sur l’océan.
Enfin, la pente s’atténua et il déboucha sur un immense parking. Un barrage à l’extrémité du lac. Des chemins suivaient le bord de l’eau, d’autres disparaissaient sous les arbres.
Il coupa le moteur mais dans son crâne l’écho mécanique perdura comme un écho qui s’épuise. Les mains sur le volant, il balaya le paysage, lentement, avec délectation, hésitant presque à sortir. Mettre un terme à la complicité qui l’avait uni à la cabine, au volant, à l’odeur chaude du moteur, au ronflement des pièces. Il éveilla dans ses muscles des contractions libératrices, des volontés de mouvements. Il attrapa la poignée de la porte et il descendit.
Plongeon dans le silence. Comme s’il était entré dans un bain. La paix qui coule sur la peau de son visage, se mêle à ses cheveux, glisse sous ses habits. Respiration suspendue.
Il s’appuya contre le pare-chocs avant et reprit son souffle. Rien. Il n’y avait absolument aucun bruit.
Bruit.
Le mot lui-même ici semblait privé de sens.
La limpide tranquillité ruissela en lui comme une divine liqueur et nettoya son corps de la fatigue de la route.
Il marcha vers la surface chatoyante du lac. Le crissement de ses pas sur le goudron gravillonné remplit l’espace comme un affront. Il essaya de se faire léger. Il rejoignit l’herbe avec soulagement. Comme tout promeneur au bord de l’eau, il eut envie de lancer une pierre mais il pensa aussitôt que le lac se briserait comme un miroir. Ce silence incroyable n’était que la peur terrible du lieu, que le souffle retenu de chaque plante devant l’ennemi absolu. Il imagina autour de lui des regards inquiets. Il s’assit délicatement sur une grosse roche lisse et ronde, caressant doucement le poli de la pierre. Devant lui, la surface immobile de l’eau. Une image arrêtée, un plan fixe suspendu dans le temps. Une paix indéfinissable.
Un sanctuaire. Les hommes s’étaient égarés en donnant ce rôle suprême à leurs dieux et à leurs églises. Oubliant que tout était là devant leurs yeux salis. On apprenait aux enfants à respecter un crucifix et on les laissait cueillir des fleurs. Mais sur chaque fleur arrachée, le grand corps de la nature était cloué. Et personne ne le pleurait.
Le silence du monde comme une tristesse, la détresse de la trahison.
Il retourna au fourgon et le rangea le long des arbres. Face au lac. Les mains posées sur le volant.
Le chant solitaire d’un oiseau, dans le secret des branches. Aucune réponse, aucun échange, absence de partenaire. Et pourtant cette ritournelle pétillante, cet amour de la vie. Sans intention. Un bonheur qui déborde.
La chaleur dans son ventre, un sourire qui se dessine, un flot d’émotions qui se déverse, une joie partagée.
Il avait délaissé le bonheur. La vibration dans la poitrine, cet embrasement irraisonné. Il avait associé la vie à des missions assumées, le sens de son existence à des défis achevés, comme si les actes humains offraient à la vie une raison d’être. L’oiseau n’avait pas ces tourments, il chantait simplement.
7h30.
Quand il enleva les rideaux isothermes des vitres, il vit le fourgon vert. Il avait dû arriver pendant la nuit. Il n’avait rien entendu.
Il s’habilla et sortit. Un grand sourire dans l’âme. La température était fraîche mais le bleu limpide du ciel annonçait une belle journée. Il avança vers le lac. L’eau qui se reflétait dans la passivité immobile du ciel n’esquissait aucun mouvement. Les couleurs, selon l’intensité de la lumière, éclataient de jaune ou sombraient dans le vert. Les parties terreuses et les zones rocheuses qui tapissaient les fonds dispensaient à la surface les teintes qui leur convenaient."
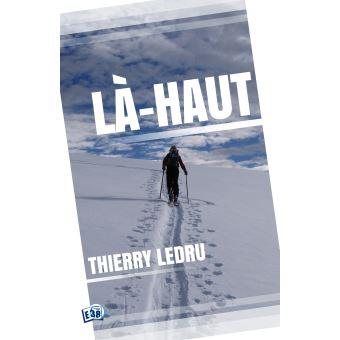
"Il a vu dans les yeux de Maud la montée des larmes. Ce sourire comme un paravent fragile. Il espère que là-bas, à Chamonix, avec Mathieu, le goût du bonheur lui reviendra, que le travail à la mairie étouffera les douleurs. À ses côtés, la joie est ignoble. Indécente. Un peu d’apaisement, à la rigueur. Mais pas davantage. Maud devait en sortir. La vie est si longue à reverdir. Il ne pourrait même pas dire si le rire renaîtra un jour et, si cela se fait, combien de temps ça prendra. Il ne voulait pas lui imposer cette attente.
La voiture a disparu. Il tourne lentement sur lui-même et balaie le paysage. Hameau de Beauvoir. Huit cents mètres d’altitude. Une route unique, étroite, qui par-delà les alpages se poursuit dans les forêts en simples pistes forestières empruntées par les bûcherons, les chasseurs, les cueilleurs de champignons ou les amoureux de la marche. Là-bas, tout au fond de la vallée, Chambéry étend ses constructions et ses brouillards opaques. Le vert sombre des pentes boisées redonne heureusement aux horizons des couleurs de vie puissante. La neige est en attente. Les nuages se remplissent, construisent en silence des avalanches floconneuses. Demain, le paysage sera transformé. Magie des montagnes qui s’habillent chaque saison des couleurs de leurs complices. La neige, douce et cristalline, offrira à la terre cet écrin de pureté où il a toujours aimé plonger. Le silence, alors, sera la note parfaite, celle de l’âme qui se repose dans l’immobilité immaculée. Il entend déjà ce silence. Il s’en est si souvent nourri. Il est en lui à tout jamais. Et il l’attend avec impatience. Pour s’y enfoncer encore plus profondément.
Il n’est pas assez habillé pour patienter dehors. Il retourne vers le chalet. Il aime cette maison. Son isolement et son architecture. Les troncs entiers qui font la structure, les baies vitrées mangeuses de lumières, le grand poêle à bois au milieu de la pièce principale, le plancher et toutes les boiseries, l’escalier en chêne, les lambris colorés, tous ces arbres transformés qui se parlent de forêts communes, qui exhalent des parfums de résine et de feuilles mordorées, s’échangent des secrets de racines, des légendes oubliées. Enfant, il aimait dormir dans un placard traversé par une poutre maîtresse. Il écoutait les chuchotements du bois, les fibres qui se racontent les saisons qui passent. Il caressait les nœuds apparents comme autant d’êtres vivants, leur demandait pardon et leur expliquait le pourquoi de leur présence.
Le chalet est de plain-pied. Pas d’escalier. Dans la région, c’est suffisamment rare pour l’avoir immédiatement enthousiasmé. Pas de cave, mais un très grand garage et l’abri pour le bois de chauffage. Un jardin très simple entoure la maison. Quelques résineux et de l’herbe. Une haie de lauriers ceinture l’ensemble.
Il entre dans le couloir et prend une veste dans la penderie. Il retourne dans le garage par une porte communicante. Il s’assoit sur un tabouret et entreprend d’enfiler une paire de bottes fourrées. Le système de laçage, très bas, a la particularité de permettre une large ouverture. Une solide bande velcro referme la partie haute. Il ne peut plus porter les chaussures qui lui plaisent, mais uniquement celles qui conviennent aux réglages de sa prothèse. Il sort.
L’air froid semble hypnotisé par la puissance des nuages qui s’accumulent. Rien ne bouge, le vent s’est enfui. Le ciel pourtant se charge continuellement de nouvelles masses sombres. C’est comme une marée opaque qui n’en finit pas de gonfler, un océan céleste qui laisserait suinter de ses profondeurs abyssales des noirceurs épaisses. Il regarde l’horizon comblé et sait qu’avant la nuit il neigera. Ce moment magique où l’humidité accrochée au vide s’abandonne à la chute et se déverse en trombes ou en bruines, en giboulées ou en neige. L’esquisse d’un sourire se dessine sur ses joues. Il n’a jamais vraiment observé le monde. Il projetait dans les horizons des intentions renouvelées, des désirs aveuglants, des projets flamboyants. Les paravents sont tombés. Ses regards sont plus larges.
Il traverse lentement le terre-plein gravillonné et se dirige vers la route. À l’angle de l’entrée, marquée par une barrière glissée sur un rail, un sapin semble monter la garde. Le tronc est déjà épais. La tête le domine. Sur le côté droit, il distingue une marque, une empreinte dans l’écorce, un trou dans l’étagement des branches. Il s’approche. Il y a longtemps, dans la jeunesse de l’arbre, une branche a été brisée. Tempête, poids de la neige ? La cicatrice est propre. C’est une tache jaune couverte de résine séchée. Il passe un doigt sur les fibres noueuses et respire le parfum puissant. Autour de la plaie refermée, les autres branches se sont espacées. À cet endroit, l’objectif de la guérison concentrait l’énergie de l’arbre. Refermer la plaie, éviter les infections et l’extension du mal, ne pas ralentir la croissance du tronc, guérir, mais ne pas se focaliser sur la perte d’un membre… Il s’amuse de la comparaison et se dit que sa tendance à l’anthropomorphisme est décidément exagérée.
« Frère de malheur », lance-t-il au sapin, avec un sourire triste et un salut de la main.
Il sort du jardin et s’engage sur la route. Le ruban de goudron est ancien, craquelé, délavé et les bas-côtés sont abandonnés aux herbes. Il a acheté une carte du secteur et a repéré une piste qui se dirige vers le col de Claran. Il aime bien ce nom. Sans trop savoir pourquoi. La ressemblance avec « clarté » peut-être. Il ne cherche pas davantage et commence à monter. Le chalet est le dernier du hameau, le plus haut et le plus isolé. Il sait qu’il a peu de risques de rencontrer du monde. Il n’a pas envie de parler ni même de croiser un regard. C’est le monde qui l’apaise, pas les humains. En cinq mois, il a côtoyé tant de personnes que les visages sont déjà mêlés les uns aux autres. C’est une glu poisseuse dont il veut s’extirper. Trop d’efforts à maintenir, d’ambiguïtés à éclaircir, trop de regards fuyants à oublier, de non-dits à deviner, trop de faux-semblants à déchiffrer, de compassions forcées à vomir… Trop d’humains à supporter.
Il marche. La montagne exhale des silences qui le revigorent. Il pose sa respiration sur le rythme de ses pas. La mélodie qui s’installe l’hypnotise et vide son esprit des tourments habituels. La brûlure de ses muscles a toujours éteint les incendies de son âme. Enfant, il aimait marcher dans les pas de Walter et écouter dans son corps la vie qui bouillonne. Il n’y mettait pas de nom, ne savait rien expliquer, c’était une joie immédiate, puissante, la remontée de forces profondes. Il trouvait dans le monde le terrain idéal pour user cette énergie qui l’étourdissait parfois, et suivre Walter représentait le premier objectif de son existence. Il se construisait sur ce repère. Le monde n’était qu’un exutoire. Walter disparu, il avait longtemps erré, abattu. L’effacement du modèle ne lui avait laissé que sa propre silhouette, juste une esquisse fragile qui ne savait plus comment se remplir.
Le monde, alors, avait pris le relais. Juste le monde. Et lui-même. C’est son image qu’il avait cherché à rattraper, à affiner, à établir solidement, à étendre surtout vers une connaissance toujours plus fine et profonde. Le monde était devenu le complice. Et le guide.
Peu à peu, avec les heures douloureuses des souvenirs ressassés, la passion de la montagne s’était nourrie de sa soif de vengeance. Elle en était même devenue la source de toutes ses forces. Dominer les sommets, atteindre des pointes reculées, escalader des parois aussi lisses que le bleu du ciel, c’était redonner vie à Walter, c’était marquer la montagne de l’empreinte de la famille, le fils usant des enseignements du père pour progresser et se dresser sur les plus hauts sommets. Ils étaient deux à grimper. Il n’avait plus voulu de compagnon de cordée. Walter l’accompagnait."

"TOUS, SAUF ELLE"
Dans ce roman, achevé mais non publié, j'ai poussé la réflexion à son extrême. Ce lieu représente tout ce qu'on cherche à atteindre.
CHAPITRE 39
Deux semaines qu’elle vivait à la ferme. Vibrait en elle la certitude qu’elle n’en partirait plus. L’intensité des jours passés et le bonheur de l’instant la comblaient au-delà du possible.
Toutes les émotions s’agitaient follement dans un maelstrom intemporel de souvenirs intenses.
La ferme de Théo. Un choc immense.
Il était venu la chercher. Le vendredi midi après un passage obligé à la brigade. Elle avait emporté des affaires pour plusieurs jours.
La première fois qu'elle abandonnait le foulard sur ses cheveux. Comme un rituel de passage, une autre vie, l'abandon des souvenirs. Une chevelure renaissante que Théo avait caressée tendrement.
Elle avait aimé le frisson dans son crâne, dans sa colonne, dans son ventre, elle avait fermé les yeux en posant la tête sur l'épaule de l'homme qui l'aimait.
L'homme qui l'aimait... Le cheminement de la vie était totalement imprévisible. L'idée lui fit ressentir une sorte d'étouffement, une onde de choc très profonde, comme un séisme à peine contenu. L'anticipation relevait-elle d'une illusion totale ? Là, maintenant, au regard de ce qu'elle avait connu ces derniers mois, pouvait-elle établir clairement et indubitablement la suite de son parcours ? Elle faillit en rire tellement l'idée était absurde. Elle pouvait imaginer une suite mais aucunement l'affirmer. Rien de ce qui était écrit en elle n'était accessible . La vie irait là où elle a besoin d'aller.
La conclusion l'avait apaisée et elle avait levé les yeux vers ceux de Théo.
« Je ne sais pas où la vie en moi souhaite aller et je ne demande pas à le savoir puisque l'instant contient tout ce qui me réjouit. »
Il n'avait rien répondu. Il l'avait embrassée.
Ils s’étaient arrêtés à la ferme des Balthuzar, le couple de retraités. Raymond et Yolande leur avait offert une bolée de jus de pommes.
« C’est du fait maison, ma jolie dame, » avait lancé joyeusement le vieil homme, en l’invitant à emporter la bouteille.
Elle l’avait remercié et Mme Balthuzar avait ajouté un panier de légumes.
« Ceux-là aussi, c’est du fait maison, que du bio, pour vous les jeunes. »
Ils avaient eu du mal à quitter le couple, l’un ou l’une, relançant inlassablement les discussions.
« Ils ne voient plus grand monde, avait expliqué Théo, en roulant sur la piste. Leurs deux filles ont quitté la région, mariées avec des gars des villes. La ferme leur reviendra à la mort des parents et ils la vendront le plus vite possible pour se partager le pognon, expliqua Théo. Et c’est pitoyable. »
Cinq cents mètres de piste en terre, de nombreuses ornières, des roches calcaires qu’il fallait éviter, puis la traversée d’un pré suivi d’un sous-bois de hêtres et de bouleaux.
« Et en hiver ? demanda-t-elle.
–Raymond a un tracteur avec une lame, ça fait déneigeuse quand ça tombe fort mais ça devient très rare. Je ne veux surtout pas améliorer la piste. C’est le garant de ma tranquillité. Et de toute façon, avec le réchauffement climatique, l’enneigement est de plus en plus faible.
–Je comprends mieux l’utilité d’un 4X4.
–L’avantage des vieux Toyota comme celui-là, lança-t-il en tapotant amicalement le tableau de bord, c’est l’absence d’électronique et je n’en veux surtout pas. Ensuite, ce sont des moteurs indestructibles et une mécanique assez simple.
–Pourquoi tu ne veux pas d’électronique ? C’est juste pour ne pas suivre la mode ou autre chose ?
–C’est très fragile l’électronique. Et le jour où toute l’électronique sera hors service, il n’y aura que des vieilles caisses rustiques qui pourront rouler. Une bombe à impulsion magnétique et plus rien ne fonctionne. Je t’en parlerai. Et je te montrerai les dégâts aussi de l'exploitation des terres rares dont l'industrie électronique se sert. Je ne veux pas participer à ça, en tout cas le moins possible et pas dans ma bagnole. »
Elle aimait l’écouter et elle se réjouissait de toutes les discussions qu’ils avaient eues en quelques jours tout autant que celles à venir. Elle aimait son calme tout autant que sa détermination, elle aimait ses secrets tout autant que les révélations sur lui-même, l’écartement progressif des rideaux intérieurs.
L’arrivée à la ferme. Tout était là, gravé dans sa mémoire. De ces instants de vie qui se logent au plus profond des fibres. Elle pouvait en revivre chaque minute comme un film qui tourne en boucle. Comme un instant présent dans un passé ineffaçable.
Le véhicule avait franchi le seuil d’un plateau. Un horizon découvert jusqu’à la lisière d’une forêt dense.
À quelques centaines de mètres, droit devant, elle aperçut les bâtiments.
Un pré encadré de bois, deux blocs rocheux monumentaux, cinq ou six mètres de haut, posés comme des sentinelles, une longue ceinture de barrières horizontales clouées sur des pieux massifs enserrant le terrain sans qu’elle n’en distingue intégralement l’étendue.
Elle scruta le corps de ferme. Elle y vit comme un fortin et ne parvint pas clairement à identifier une raison précise. Elle ressentit un ensemble énergétique, une aura qui semblait envelopper l'espace.
Elle entrait dans un lieu particulier et elle aima le frisson le long de sa colonne.
Théo arrêta le véhicule devant une barrière métallique posée sur deux poteaux en acier blanc. Il prit une clé dans le vide-poche et descendit. Il ouvrit un cadenas pour libérer une lourde chaîne puis il souleva le long tube fixé à un pivot. Il déposa la barre, reprit le volant et avança de quelques mètres.
Il s’arrêta de nouveau et referma l’entrée.
Elle pensa au franchissement d’un pont-levis.
Il roula jusqu’au seuil du bâtiment d’habitation.
Elle put alors en détailler l’architecture : une bâtisse en pierre, trapue, le corps soudé au sol, sur un seul niveau, le toit en lauzes, partiellement couvert de panneaux solaires. Une longère parfaitement entretenue, soignée, une rudesse ancestrale. Volets fermés, une cour gravillonnée en façade, trois grands troncs évidés, posés en ligne sur des socles en béton et garnis de plantes. Ils semblaient interdire l’entrée du lieu, comme trois gardiens empêchant l’avancée de véhicules ennemis.
Une grange fermée par deux lourds battants en bois massif se tenait sur le flanc ouest, un soubassement en grosses pierres brutes surmontées d’un bardage vertical, des planches couvertes d’une lasure sombre et parfaitement jointes. Un toit de tôles grises et un châssis supportant d’autres panneaux solaires. « Un hangar pour son matériel », avait-elle pensé. Elle nota également la présence d’une antenne très haute, bardée d’éléments horizontaux. Rien à voir avec une parabole. Plutôt l’installation caractéristique d’un radio amateur.
Une extension en pierre occupait le flanc est, comme un appartement contigu à l’habitation principale.
En arrière-plan, à une dizaine de mètres de la maison, elle devina un potager fermé par des filets tendus sur des pieux, à l’abri des sangliers, biches et chevreuils qui devaient fréquenter les lieux.
L’ensemble dégageait une force étrange, comme une obstination, un ancrage buté et indestructible. Une citadelle ou un fortin, c’était vraiment ça. Le positionnement des trois bâtiments constituait une muraille, elle imagina un convoi de chariots de cow-boys face à l’attaque des Indiens. Elle s’amusa de l’image enfantine. Elle aurait pu s’émerveiller des couleurs, de la lumière, de cette merveilleuse végétation, des panoramas magnifiques devant elle mais plus puissante que la beauté du lieu s’imposait cette idée qu’elle entrait dans un territoire réservé, une enclave militaire.
Rien de fragile, rien de vulnérable, chaque élément ayant été pensé, étudié, érigé, renforcé de toutes parts avec une volonté indéfectible. Voilà ce qu’elle ressentait.
Théo.
L’impression que l’homme devant elle se dénudait intégralement. Corps et âme.
Elle repensa à ce moment émouvant où elle avait serré sa main dans le parc de l’hôpital. Comme un territoire impénétrable en lui, un mystère qu’il avait pourtant eu envie de lui révéler.
Elle comprenait maintenant.
Elle entrait dans son secret.
Théo avait contourné la voiture, il avait ouvert la porte puis il lui avait pris la main.
« Bienvenue à la ferme, plus communément appelée dans ma tête, le désert des Tartares. »
Elle l’avait regardé, intriguée puis elle était descendue.
« C’est un film, ça, je crois bien.
–C’est surtout un roman de Dino Buzzati.
–Ils attendent dans une forteresse un ennemi qui n’arrive jamais, c’est ça ?
–Exactement. »
Elle le regarda déverrouiller deux serrures massives à la porte d’entrée, il en ouvrit grand le battant puis il l’invita d’un geste de la main.
Elle le suivit dans l’ombre de la pièce, le corps enveloppé par le rai de lumière dans son dos. Elle aima aussitôt l’odeur si particulière de ces maisons qui ont protégé des chapelets de vies humaines."
Commentaires
-

- 1. Thierry LEDRU Le 10/04/2023
Bonjour Pascal.
Mille mercis pour votre commentaire.
Je ne me souvenais plus de cet article. Il date de 2020 et notre projet est réalisé. ^^ Nous avons trouvé notre lieu de vie, celui dont nous rêvions.
Au plaisir de vous lire.
Thierry -

Ajouter un commentaire