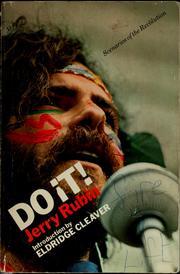blog
-
Contre la montre
- Par Thierry LEDRU
- Le 29/06/2025
- 0 commentaire
Au plus près de la réalité, seul le présent compte.
Je pense que j'en suis là. Mais il y a un paramètre personnel qui a joué un rôle considérable. Depuis plusieurs années, je ne devrais pouvoir me déplacer que très difficilement, voire avec une canne et surtout souffrir jours et nuits. Et puis, non, finalement. Et la médecine n'y comprend rien.
Donc, à travers cette épreuve quotidienne, je me suis retiré sans pour autant jamais cesser de lire et de m'informer mais avec cette distanciation liée à mon état. La priorité, c'était de continuer à pouvoir marcher et à monter sur les sommets. L'état du monde me devenait secondaire parce que de toute façon, si je mourais intérieurement, cloîtré dans mon lit, ce monde n'existerait plus du tout pour moi. Mais je marche encore et c'est ce qui contribue à ce que je continue à m'intéresser à cette humanité déliquescente.
Par contre, je n'ai aucune visée pour autrui, aucun désir d'apporter quoi que ce soit. J'écris et je partage mais sans aucune intention. Que chacun et chacune en fasse ce qu'il veut. Non pas que ça ne m'intéresse pas mais juste que je n'ai aucun droit sur personne.
J'ai bien assez à tenter de gagner le contre la montre dans lequel je suis engagé, tout en sachant que je ne le gagnerai pas. L'idée est contraire à celle d'un contre la montre où l'individu doit aller d'un point A à un point B le plus vite possible, en courant de toutes ses forces. Moi, je vise la durée la plus longue possible et je sais que pour mettre toutes les chances de mon côté, je dois rester serein, contemplatif de cette vie qui m'anime encore et me permet de bouger. Et d'user des forces disponibles sans les brûler. Il s'agit d'avancer, sans s'occuper du temps que ça me prend. Je peux me réveiller demain avec un mal de dos épouvantable, un blocage complet, l'impossibilité de lancer ma jambe gauche en avant. Et il faudrait que je concentre mon énergie à tenter de comprendre le chaos de ce monde humain, à tenter d'y apporter des pistes de résolution ?
Et d'ailleurs, comment pourrais-je envisager de pouvoir changer les choses alors que les forces destructrices en action existent depuis des millénaires et n'ont jamais cessé de se renforcer et d'étendre leur pouvoir ? Dois-je m'épuiser dans cette lutte commune alors que j'ai besoin de toute mon énergie intérieure pour rester valide ? Non, bien évidemment. Et quand la colère revient devant l'immense impéritie des gouvernants, j'éteins tout et je vais m'asseoir dans l'herbe pour l'écouter pousser où je monte lentement au sommet d'une montagne ou je m'allonge et je regarde les nuages. On pourrait penser que c'est une fuite quand c'est bien au contraire la concentration des forces vitales. Pour continuer à exister tout autant que de sonder le monde en marche.
-
Mutation des pouvoirs
- Par Thierry LEDRU
- Le 29/06/2025
- 0 commentaire
Une personne dont j'apprécie beaucoup les analyses.
Tchamé Dawa
oodpeSrsnt01ttut44i6g0fma1lhf05u i8f81amhmii43f68gg97l62ath1 ·
Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai demandé à quel moment notre société allait enfin toucher le fond. Je disais "enfin", comme si ce moment allait être le début d'une période où le bon sens et la justice reviendraient, comme si les causes de l'effondrement allaient produire autre chose. Comme si le monde, au terme d'une période de décadence initiatique allait se remettre à l'endroit, la conscience éclairée, et ne plus laisser place aux absurdités qui ont ravagé notre société.
Mais plus nous avançons, plus j'observe et plus je me rends compte que les temps actuels correspondent à une recomposition des pouvoirs, bien plus qu'à l'avènement d'une émancipation générale des forces du capital et de la souffrance qu'elles engendrent.
Je ne vois pas disparaître le pouvoir des élites économiques, technocratiques ou militaro-financières, bien au contraire. Ce que je vois c'est que ces pouvoirs mutent dangereusement vers des formes plus autoritaires, épaulées par des technologies révolutionnaires (il n'y a plus que les technologies qui sont révolutionnaires de nos jours). Ce à quoi nous assistons impuissants est une redistribution des rôles, en Europe, aux USA, au Moyen Orient, en Afrique, etc. dont les populations locales subissent les conséquences sans en tirer de bénéfices.
Les peuples sont les dindons de la farce, et je me demande comment on a pu imaginer qu'il y aurait "un monde d'après", ce "monde d'après" qui a tant fait fureur pendant la crise Covid, dont on disait qu'il allait nécessairement émerger car on saurait tirer les leçons du tragique épisode de 2020/2021. Mais que s'est-il passé ? Tout l'inverse du "monde d'après" fantasmé: recul de la démocratie, enrichissement honteux des plus grandes fortunes mondiales, mainmise de l'Europe sur les souverainetés nationales, piétinement du droit, invalidation d'élections ou même déni du résultat des urnes, comme en France.
La protection sociale et toutes les institutions d'état dédiées au bien public sont systématiquement détruites, la précarisation est généralisée, et le contrôle social s'étend dangereusement. Les opposants sont broyés, menacés, tandis que certains meurent dans d'étranges circonstances. Les pouvoirs en place mais aussi les partis, avec l'aide des médias, instrumentalisent les mécontentements populaires et les divisions sont telles, la haine croît à une telle vitesse, qu'on envisage mal comment nous allons éviter une guerre civile. Chaque fête populaire vire à l'émeute.
Comment sortir par le haut d'une situation pareille? On voit bien la spirale infernale: l'effondrement (économique, climatique, sécuritaire) est repris dans le narratif du pouvoir pour justifier des mesures qui respectent l'agenda des requins de la finance et provoquent encore plus de dégâts dans nos vies. Les politiques publiques servent avant tous les intérêts privés.
Car le pire de tout ceci est sans doute la perte complète de souveraineté du peuple. Les grandes décisions sont prises sans lui et ne font l'objet d'aucun débat public. la constitution est instrumentalisée, détournée de son esprit et la représentation nationale est pervertie par des logiques partisanes de conquête du pouvoir, de carrière, voire de soumission à des intérêts économiques spécifiques. Les syndicats sont moribonds et n'ont pas plus d'effet que des organisateurs de kermesse. Quant aux élections, elles ne sont plus qu'un rituel obligatoire pour entretenir l'illusion d'un changement possible. Elles ne servent qu'à la mobilisation de militants au service de partis qui ont besoin pour durer que le système perdure, et qui font mine de le combattre. Formidable arnaque du militantisme partisan qui a leurré un certain temps un très grand nombre d'entre-nous. Formidable perte d'énergie populaire que ce militantisme, réducteur de la pensée, adepte du spectacle et des slogans, et qui en tout contradicteur reconnaît un ennemi.
Tout ça pour dire que l'idée d'une issue positive à cet effondrement induit une sorte d'attente qui pourrait s'avérer extrêmement douloureuse. Car le gros des troupes en est là: tout le monde attend. Résister à cet effondrement, à l'oppression incessante que ce monde exerce sur chacun d'entre nous semble ainsi se limiter à "tenir le coup", c'est à dire à supporter l'impuissance, à étouffer les colères, à calmer les angoisses et gérer les coups de mou, bref, à tenir jusqu'au moment où... le "monde d'après" surgira ! Et cette attente d'un changement est paradoxale, en ce sens qu'elle doit à peu près tout à la paralysie qui naît de la peur du changement dans sa propre vie. Bouger, on voudrait bien, oui...mais c'est risqué ! Eternel dilemme.
Nous voici donc à tourner en rond dans notre impuissance consentie, car quoique nous fassions, quelles que soient nos victoires sur la pesanteur ambiante, vient toujours le moment où il nous faut nous confronter de manière récurrente, à une forme de l'oppression nouvelle. On refait alors le tour de la cage dans laquelle nous nous sommes retrouvés enfermés. Prison technologique car nous voilà livrés à l'œil des caméras de surveillance et aux lecteurs de QR codes, et aliénation mentale, due à un déferlement d'images, de slogans et d'injonctions qui conduisent à la perte de concentration et d'attention, à l'abrutissement progressif et généralisé.
Dans ces conditions, on le comprend, résister consiste évidemment en premier lieu à ne pas perdre la tête, ni le moral, à survivre économiquement, à comprendre ce qui se passe et à faire confiance au temps qui passe. D'autant plus qu'il y a au cœur de chacun d'entre-nous cette dangeureuse et irrationnelle conviction que le temps finira par jouer pour nous, parce que tout ceci est tellement absurde que cela ne peut pas durer éternellement et qu'ainsi, quelque chose DOIT et VA nécessairement arriver. Quoi ? Nul ne le sait. On lit des essais, on écoute les spécialistes auxquels on accorde un pouvoir visionnaire, mais force est de constater que certains voire la plupart se perdent en conjectures, et que ces brillants esprits n'ont pas eux-mêmes la moindre idée de ce qui vient. Pourtant, la certitude subsiste, un peu dingue, que quelque chose va se produire et qu'avec le temps, tout finira par passer: les salauds seront défaits, les guerres s'arrêteront et les mômes de Gaza ne seront plus mis en pièces ou abattus comme du gibier.
Mais vu d'aujourd'hui, le "monde d'après" a vraiment une sale gueule et tout semble réuni pour qu'il devienne encore plus laid. L'effondrement pourrait très bien accoucher du pire s’il n’est pas accompagné d’un véritable projet alternatif crédible et motivant, dont personne n'a encore imaginé les modalités ou le contenu. C'est urgent, car comme l'écrivait Walter Benjamin, « derrière chaque fascisme, il y a une révolution manquée ». J'ai malheureusement bien peur qu'avec les Gilets jaunes, nous ayons raté le coche." -
"Au fait, c’est quoi la biodiversité"?
- Par Thierry LEDRU
- Le 29/06/2025
- 0 commentaire
Au fait, c’est quoi la biodiversité (et pourquoi on devrait en parler plus) ?
https://bonpote.com/au-fait-cest-quoi-la-biodiversite-et-pourquoi-on-devrait-en-parler-plus/
Publication :
19/03/2025
Mis à jour :
19/03/2025

©Crédit Photographie : Epandage pesticides CC BY-SA 3.0 Wikipedia
Le mot biodiversité a dû être créé de toutes pièces en 1986, parce que nos sociétés n’avaient aucun concept de la diversité du vivant ni aucune dénomination vernaculaire de ce concept.
En effet, nos représentations culturelles occidentales sont très souvent incomplètes ou biaisées : certains concepts sont bien identifiés et définis tandis que d’autres sont plutôt méconnus ou incompris.
Ainsi, la notion de climat nous est plutôt familière : nous entendons très tôt ce mot dans notre cercle familial. Nous sommes donc conscients de sa signification, nous l’avons incorporé dans nos représentations, au point d’en user dans des métaphores comme par exemple lorsque nous évoquons un « climat social ».
Par conséquent, nous sommes en théorie capables de nous approprier ce que la science nous dit de l’évolution du climat et de son dérèglement sous les pressions humaines. Ce n’était pas le cas de la diversité du vivant il y a encore seulement 40 ans !
Sommaire
Pourquoi parle-t-on d’une crise de la biodiversité ?
La crise actuelle de la biodiversité est inédite
Quelles sont les cinq causes de l’effondrement de la biodiversité ?
Les risques liés à l’effondrement de la biodiversité
C’est quoi la biodiversité ?
Encore aujourd’hui, la plupart de nos enfants n’ont qu’une familiarité toute relative avec ce concept de biodiversité formulé trop récemment. Nous avons bien sûr des mots génériques pour désigner des groupes d’organismes, les oiseaux, les poissons, les plantes, les bactéries, etc.
Nous avons des mots vagues et chargés d’a priori, comme la « nature » de laquelle nous nous considérons généralement comme distanciés et à laquelle nous revenons donc éventuellement. Ou nous avons encore le mot générique « vivant », comme dans les « sciences du vivant », qui ne désigne que les points communs à tous les organismes vivants et se focalise surtout sur les organismes de laboratoire, rats blancs ou drosophiles.
Il nous manquait donc le mot biodiversité, qui désigne la diversité génétique des individus de la même espèce, la diversité des espèces issue de l’évolution, et enfin la diversité des assemblages d’espèces, autrement dit des écosystèmes.
Nos sociétés ne s’étaient donc pas approprié cette notion de manière globale. Il a ainsi fallu attendre le milieu du XIXe siècle voire le début du XXe siècle pour prendre enfin conscience de dimensions fondamentales de la biodiversité, comme par exemple l’existence des microbes, de l’évolution biologique et des interactions écologiques. Le mot écosystème, certes plus ancien que biodiversité, ne date en effet que de 1935.
On doit donc revenir sur chaque dimension d’observation de la biodiversité, pour bien comprendre quelles en sont les caractéristiques.
Importance de la diversité génétique
Une espèce n’est pas une collection fermée d’individus tous identiques. Les mécanismes moléculaires et cellulaires de la génétique font que les individus sont tous un peu différents. Les différences entre individus importent particulièrement car elles permettent parfois à certains d’entre eux de mieux survivre ou de mieux se reproduire face à des aléas environnementaux variés et de transmettre ces différences à des descendants ; c’est ce que l’on appelle l’adaptation. L’évolution biologique se produit de cette manière : à chaque génération, des individus un peu différents peuvent apparaître et se perpétuer … ou pas !
On observe là une propriété essentielle de la biodiversité, celle de ne pas se perpétuer à l’identique, et d’être donc capable de faire avec des situations environnementales assez variées.
Nos procédés de domestication ou de culture doivent respecter cette diversité génétique, au risque sinon de fabriquer des populations trop homogènes et donc très vulnérables à tout changement environnemental (aléa climatique, survenue d’un pathogène, etc.)
Importance de la diversité spécifique
La plupart du temps, nous oublions que les espèces sont innombrables, y compris dans notre environnement immédiat : le seul territoire français métropolitain abrite ainsi 40 000 espèces d’insectes, 6 000 espèces de plantes, 1 500 espèces de vertébrés dont nous n’avons guère connaissance ou conscience au quotidien.
Nous nous préoccupons ainsi beaucoup plus des espèces charismatiques qui nous fascinent parce qu’elles sont grandes, féroces ou mignonnes. Ces espèces charismatiques nous cachent l’essentiel de la biodiversité, invisible ou peu attractive.
Pire encore, nous méprisons des espèces discrètes ou qui nous déplaisent du fait de futiles critères d’apparence ou d’agacement immédiat, sans nous rendre qu’elles assument des fonctions souvent irremplaçables au sein des écosystèmes.

Les coléoptères bousiers recyclent les faeces de mammifères ; faute de bousiers ad hoc, l’Australie a dû en importer en regard de ses troupeaux de bovins domestiques, pour restaurer l’état de ses prairies. Photo Rafael Brix, CC BY 2.5
Importance de la diversité des écosystèmes
Un écosystème n’est pas juste une liste d’espèces présentes au même endroit, c’est un réseau d’interactions extraordinairement complexe et bien structuré. Aucune espèce ne vit sans interagir avec de nombreuses autres, avec lesquelles elle a évolué en établissant souvent des relations durables : nous pesons ainsi 2 kg d’indispensables bactéries intestinales, chaque arbre a des champignons mycorhiziens autour de ses racines, la plupart des plantes ont leurs pollinisateurs, etc.
Considérer une espèce en isolement parce qu’elle serait charismatique, n’a donc aucun sens. Nous nous vautrons dans la facilité avec des céréales pollinisées par le vent … mais nous oublions que la productivité de leur culture dépend quand même des bactéries, des champignons ou des vers de terre du sol ! Nous sous-estimons l’importance des relations entre espèces, comme si l’on pouvait suppléer à toute carence en la matière, qu’il s’agisse de pollinisation, de fertilité des sols ou de sylviculture.
Les écosystèmes sont en outre emboités les uns dans ou contre les autres : par exemple, forêts et prairies communiquent à travers leurs lisières, et les fonctions des uns (par exemple, génération d’un microclimat local) permettent bien souvent aux autres de se maintenir.
Toutes ces incompréhensions nous amènent à provoquer l’effondrement de la biodiversité en négligeant ces trois dimensions de la biodiversité. Qui plus est, nous prenons difficilement conscience de cet effondrement et de ses conséquences.
Pourquoi parle-t-on d’une crise de la biodiversité ?
L’effondrement de la biodiversité a été maintes fois constaté depuis le début du XXe siècle, mais il a cependant été caractérisé plus précisément à la fin du XXe siècle. Le rapport global du GIEC de la biodiversité, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques – l’IPBES – a fait la synthèse des milliers de publications scientifiques en 2019.
On a ainsi constaté que nombre de populations d’espèces s’effondrent : la natalité ne compense plus la mortalité causée par les pressions humaines. A l’extrême, quand les pressions sont trop fortes ou trop longues, les espèces s’éteignent et disparaissent complètement.
C’est la raison pour laquelle cette crise de l’effondrement de la biodiversité a été qualifiée de sixième crise d’extinction, en référence aux cinq grandes crises d’extinction des temps géologiques.
La crise actuelle de la biodiversité est inédite
Cette crise actuelle est cependant beaucoup plus rapide que les crises spontanées précédant l’humanité : les dinosaures ont ainsi mis un million d’années à disparaître lors de la crise Crétacé-Tertiaire et encore en est-il resté les oiseaux qui se sont rediversifiés a posteriori.
Actuellement, en l’espace de 30 ans, nous risquons de perdre un million d’espèces vivantes, 30% des vertébrés du monde entier (oiseaux, batraciens, poissons, mammifères), plus de 40% des arbres européens. Le constat est donc terrible.

source : IPBES, 2019
Rejoignez les 40000 abonné(e)s à notre newsletter
Chaque semaine, nous filtrons le superflu pour vous offrir l’essentiel, fiable et sourcé
Quelles sont les cinq causes de l’effondrement de la biodiversité ?
D’après l’ensemble des travaux scientifiques publiés, cette crise est causée par cinq grands types de pressions humaines globales : la suppression des habitats, les prélèvements excessifs au sein des populations, le changement climatique, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes.
Chacune de ces pressions est colossale : presque 4 millions d’hectares de forêt disparaissent chacune de ces dernières années, les trois quarts des zones humides ont été supprimées depuis le début de l’époque industrielle. Plus près de nous, 20 000 km linéaires de haies continuent à disparaître chaque année en France métropolitaine tandis que l’on en replante péniblement quelques milliers de km.
Les prélèvements sont également démesurés : la moitié des poissons pêchés débarqués dans les ports français sont toujours issus de la surpêche et ne respectent donc pas les stocks ; 500 millions d’animaux sont l’objet de trafics illégaux chaque année, l’extraction de bois des forêts a augmenté de 45% depuis 1970, etc.

Augmentation de la surpêche mondiale (Source FAO)
Le changement climatique n’est pas la première cause de disparition de la biodiversité
Le changement climatique dessèche ou inonde, tue la biodiversité, qu’il s’agisse des bourdons durant les étés trop secs en Europe, des feux dans les forêts humides desséchées en Australie, des plantes dont la floraison est déphasée avec leurs insectes pollinisateurs, des récifs coralliens blanchissant et mourant dans des eaux trop chaudes ou trop acides, etc.
L’importance des pollutions devient phénoménale : plus de quatre millions de tonnes de pesticides hyper-toxiques sont épandus chaque année dans le monde, 400 000 substances chimiques de synthèse ont été déjà déversées dans l’environnement, avec notamment 5 milliards de tonnes de déchets plastiques issus de la chimie pétrolière ; dans tous les environnements agricoles industriels, la biodiversité – insectes, oiseaux, faune du sol – s’effondre dramatiquement.

Rigal, S. et al., 2023. Farmland practices are driving bird population decline across Europe. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 120, e2216573120
On compte ainsi environ 30% d’individus d’oiseaux en moins dans les populations européennes depuis 30 ans et à peu près 70% de baisse d’effectifs pour les populations d’insectes. Les pesticides – insecticides, herbicides, fongicides – peuvent tuer immédiatement leurs cibles mais peuvent également nuire de manière chronique sur le long terme à de nombreux organismes, y compris ceux qui ne sont pas ciblés : des insecticides désorientent les abeilles butineuses, des herbicides détruisent le microbiote intestinal des vers de terre, des fongicides font un effet cocktail avec des insecticides multipliant leur toxicité par 100, etc.
Enfin, nos transports humains ont déplacé volontairement ou involontairement plus de 30 000 espèces, les emmenant dans des écosystèmes où elles n’auraient jamais pu se trouver spontanément. A leur arrivée, elles peuvent se retrouver sans antagonistes (prédateurs, parasites ou pathogènes) et affecter gravement les espèces locales.
C’est le cas d’au moins 3 000 d’entre elles à ce jour, que l’on qualifie donc d’envahissantes parce qu’elles pullulent dans leur zone d’introduction : des rats ou des chats vont ainsi prédater sans merci les oiseaux vulnérables qui nichent au sol dans les îles sans prédateurs terrestres, les frelons asiatiques vont tuer en masse des abeilles européennes « naïves », les moustiques tigres très nuisibles pour les humains vont se développer rapidement sur des substrats artificialisés et survivre aux hivers doux dans des espaces urbains avec peu de prédateurs, etc.
Des causes de déclin qui peuvent s’additionner ou se multiplier
Ces différents types de pressions agissent de concert ou successivement selon les endroits et il est assez vain de comparer leur importance, d’autant que leurs effets s’additionnent ou se multiplient à terme. Par exemple, un champignon pathogène exotique transmis aux chauves-souris de la côte Est aux USA les a décimées, provoquant une augmentation des populations d’insectes agresseurs des cultures et donc des traitements pesticides polluants, ces derniers amenant à une hausse conséquente de la mortalité infantile dans la région en question.
Il faut également sortir de la croyance selon laquelle la biodiversité ne souffrirait unilatéralement que du changement climatique.
Non seulement il existe ces cinq grands types de pressions sur la biodiversité mais en outre, l’effondrement de la biodiversité exerce des rétroactions sur le dérèglement climatique : des arbres stressés par la sécheresse ou détruit par l’exploitation forestière ou encore des planctons océaniques malportants ne font plus de photosynthèse et ne captent donc plus de gaz carbonique, ce qui aggrave dramatiquement un bilan déjà très mauvais en matière de gaz à effet de serre.
Les risques liés à l’effondrement de la biodiversité
Bien évidemment, nous ne devrions pas accepter de faire disparaître des espèces qui ne nous appartiennent pas et que nous ne pourrons même pas léguer à nos enfants.
Comment expliquer par exemple à des collégiens d’aujourd’hui que les lions, les éléphants et les girafes, espèces charismatiques et aujourd’hui omniprésentes dans nos médias ou dans nos représentations auront quasiment disparu des écosystèmes africains dans 40 ans et ne seront plus que des souvenirs désuets, au même titre que le loup de Tasmanie ou le dodo de l’île Maurice ?
Mais il serait très naïf également de ne considérer la crise de la biodiversité que sous l’angle de la perte éthique, alors que toutes les populations d’organismes qui s’effondrent assument des rôles cruciaux dans les écosystèmes dont nous dépendons !
On examinera successivement trois exemples de risques naturels considérablement aggravés ou causés par la crise de la biodiversité et par des effondrements de populations.
Effondrement et baisse de productivité agricole
Une des conséquences les plus évidentes du déclin de la biodiversité est la baisse de la productivité agricole.
Plusieurs facteurs sont en cause : suppression d’habitats et pesticides font fortement décliner les pollinisateurs et les autres auxiliaires ; pesticides et engrais nuisent à la faune du sol (vers de terre, bactéries, champignons) et diminuent fortement sa fertilité (25% des sols arables européens sont dégradés), la baisse de la diversité génétique et variétale diminue la rusticité des cultures, les cycles culturaux industriels et simplistes (sans assolement, sans associations de cultures entre parcelles adjacentes, etc.) sélectionnent pour des vulnérabilités et des agresseurs virulents.
En conséquence de quoi, on a des pertes de productivité allant de 5 à 80% selon les cultures, avec par exemple moins 30% sur de banales parcelles de culture européenne de colza conventionnel faute de pollinisateurs !
Ces pertes tentent d’être compensées par l’injection de coûteux intrants ou d’irrigations ou par des subventions publiques absurdes surtout lorsqu’elles concernent des cultures non vivrières (alimentation pour le bétail ou agrocarburants), peu compétitives ou aux terribles externalités environnementales (pollutions des nappes phréatiques, risques pour la santé humaine, etc.)

Perte de productivité dans le corn belt en Amérique du Nord, causée par la dégradation du sol
Trop souvent, notre amnésie environnementale nous empêche de nous rendre compte que les productivités actuelles sont parfois assez faibles, même si nous pensons par ailleurs étaler les risques d’autrefois liés aux agresseurs des cultures aujourd’hui brutalement maîtrisés.
Effondrement et perturbation du cycle de l’eau
Nous avons tellement supprimé la végétation terrestre, artificialisé et endommagé les sols arables que nous avons profondément altéré le cycle de l’eau. Ces pressions viennent s’ajouter au dérèglement climatique et déterminent un risque important auquel plus d’un quart de la population humaine sur le globe terrestre est maintenant soumis.
Il est étonnant de voir combien nous attribuons la présence de l’eau uniquement aux pluies, alors que plus de la moitié d’entre elle est stockée dans la végétation : quand cette dernière est dégradée, sécheresse ou ruissellement sont donc exacerbés.
On perçoit à quel point cet enjeu est incompris lorsque l’on entend les critiques de certains élus sur la loi française zéro artificialisation nette qui visait à baisser seulement de moitié l’artificialisation sur plusieurs décennies.
Ces critiques devraient tomber immédiatement, lorsque l’on constate les effets des pluies ou des fontes glaciaires qui se soldent de plus en plus souvent par des ruissellements torrentiels dramatiques détruisant des agglomérations entières.
Effondrement et émergence de maladies infectieuses
Malgré les progrès exceptionnels de la médecine, nous sommes toujours affectés par de nombreuses maladies infectieuses dont les réservoirs, les vecteurs ou les agents pathogènes sont des parties de biodiversité.
A cet égard et depuis le milieu du XXe siècle, une maladie infectieuse apparaît en moyenne tous les 14 à 16 mois. Ce sujet a été mis en avant puis remisé tour à tour sous l’influence de discours spéculatifs voire passablement complotistes suite à l’irruption de la covid-19, alors que l’émergence croissante de zoonoses est un sujet récurrent et connu dans l’histoire humaine récente et scientifiquement validé.
Le mécanisme sous-jacent de cette émergence est tout simplement le morcellement des milieux naturels (par exemple, des forêts tropicales), amenant à une plus grande promiscuité entre humains et animaux réservoirs de pathogènes.
Cette promiscuité permet de nombreux contacts entre pathogènes et humains, amenant à des passages fortuits de pathogènes malheureusement compatibles avec les organismes humains, ou à leur évolution progressive vers une compatibilité.

source : Allen, T., Murray, K.A., Zambrana-Torrelio, C., Morse, S.S., Rondinini, C., Di Marco, M., Breit, N., Olival, K.J., Daszak, P., 2017. Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases. Nature Communications 8, 1124.
Les milieux naturels morcelés sont en outre souvent nantis de réseaux trophiques simplifiés dans lesquels les réservoirs animaux peuvent proliférer ou voir leur santé se dégrader. On le constate par exemple actuellement avec l’emballement de la maladie de Lyme (borréliose) en France métropolitaine, avec 5 000 à 10 000 cas humains par an, du fait de la pullulation des hôtes (rongeurs, cervidés) et de l’agent pathogène faute de prédateurs (notamment les renards chassés sans merci du fait de leur mauvaise réputation).
De nombreuses émergences ont ainsi été constatées au XXe siècle – HIV, Nypah, SRAS, Ebola, etc. – du fait de ce mécanisme. Il a été quantifié que les risques les plus importants d’émergence sont situés géographiquement dans des régions riches en biodiversité, où le morcellement des milieux forestiers est le plus important et où les populations humaines sont en croissance forte.
Le risque est en outre accru du fait de la promiscuité et de l’abondance des animaux domestiques qui font relais ou sélectionnent pour compatibilité les pathogènes entre faune sauvage et humains.
Solutions et leviers d’action
Il peut sembler simple de préconiser une levée ou une diminution des cinq grands types de pressions exercées sur la biodiversité. Mais encore faut-il que de puissants leviers d’action soient mis en place face aux raisons d’être de ces pressions, agriculture industrielle, urbanisation et artificialisation des substrats, développement de circuits longs absurdes.
C’est la raison pour laquelle l’IPBES recommande de considérer des changements transformateurs, c’est à dire de forts changements structurels de production et d’organisation forts au sein de nos sociétés, en amont des pressions en question.
Les solutions fondées sur la nature
Fondamentalement, ce changement transformateur se produira avec la mise en œuvre systématique de solutions fondées sur la nature (SFN). On appelle ainsi des manières d’interagir avec l’environnement qui maximisent les bénéfices pour les humains ET pour le reste de la biodiversité.
Il s’agit donc de rompre par là avec la tragédie des communs, selon laquelle des espaces ou des fonctionnalités sans propriétaire particulier sont maltraités par des acteurs ne se souciant pas du bien commun. Les sols, les nappes phréatiques, l’atmosphère ou les fonctions écosystémiques d’une forêt ou d’une zone humide sont autant de biens communs, exploités sans vergogne, parce que personne ne les possède, eux ou leurs fonctionnalités.
En termes de SFN, il faut donc relocaliser une production agricole vivrière, agroécologique ou bio, avec une production de viande très fortement diminuée, en élevage extensif sur herbages ou associée à des cultures végétales locales, notamment pour leur fertilisation.
Le dernier rapport de l’IPBES explique en outre que ce type de transformation peut se mettre en marche grâce à la mobilisation de toutes les parties prenantes (par exemple, agences des eaux, villes et cantines scolaires) dans une stratégie de cobénéfices, avec diminution de la pollution des nappes et des émissions de gaz à effet de serre (circuits courts locaux), amélioration de la santé humaine (avec une alimentation saine) et de l’état de la biodiversité et de ses fonctions (pollinisation, fertilité des sols, etc.)
D’autres leviers d’action sont tout aussi importants, comme la végétalisation des villes et la désartificialisation des terres, avec là encore des cobénéfices importants en matière de santé humaine, d’atténuation climatique, de diminution des risques « naturels » et d’état de la biodiversité.
L’Accord de Kunming-Montréal et la mise en réserve de territoires
Ces leviers d’action complètent mais ne suppléent pas à la mise en réserve de territoires – une des SFN les plus connues – dans lesquelles on diminue réellement les pressions humaines et qui permettent à la biodiversité de perdurer dans des territoires qui lui sont plus dévolus.
L’accord de Kunming-Montréal et le cadre mondial pour la biodiversité (COP16 biodiversité, 2022) stipulait ainsi un objectif de 30% d’aires protégées sur terre et en mer, objectif coûteux financièrement et qui tarde à être atteint ou mis en place, y compris sur le territoire français qui comporte de nombreuses aires protégées … non protégées !
Il faut raison garder concernant les aires protégées qui doivent l’être réellement, sans pour autant en expulser ignominieusement des populations humaines, ce qui implique de résoudre des conflits d’usages éventuels. Ces aires sont un pendant obligatoire aux territoires exploités ou densément peuplés par les humains, dans lesquels la biodiversité sera soumise à plus de pressions, même dans le cadre d’une bonne gestion durable.
En finir avec les pratiques consuméristes
Bien évidemment, la mise en place de telles SFN – agroécologie, désartificialisation, mise en place d’aires protégées – suppose également une diminution des pratiques consuméristes stériles provoquant le développement incontrôlable de circuits longs dans toutes les productions qui nuisent à la biodiversité.
Qu’il s’agisse de vêtements, d’objets en bois, d’extraction minière y compris du sable ou du ciment, des transports de biens amenant des espèces exotiques, etc., tous ces procédés doivent être réduits et limités. Tous les écosystèmes du globe terrestre ne suffiront pas à produire le nécessaire pour les humains et à conserver 30% d’aires protégées si ces mêmes humains ont l’empreinte écologique des pays développés (Europe, Amérique du Nord, etc.)
Il est extrêmement important également que ces stratégies soient intégrées au plan territorial, national et international, de manière à réaliser les bons compromis en matière de transition énergétique et agroécologique ; on voit encore trop souvent des infrastructures productrices d’énergie « bas carbone » installées en détruisant des puits de carbone biologiques (par exemple, des forêts naturelles), ce qui n’a évidemment aucun sens en terme de bilan carbone, et moins encore en terme de bilan écosystémique complet.
Changer notre rapport à la biodiversité ne passera pas seulement par la compréhension de tous ces éléments au plan rationnel mais aussi par une envie de changement ! Cette envie sera donnée grâce à la promesse d’un bonheur et d’un équilibre, non pas seulement égoïste mais aussi collectif : bien manger de bons produits en circuits courts locaux de saison et bio, c’est se faire plaisir, se faire du bien et savoir que l’on fait aussi du bien à la biodiversité !
Cela sera possible d’en prendre conscience si notre familiarité avec la biodiversité est suffisante et si nous ne vivons pas dans un environnement entièrement artificialisé ! D’où l’importance de toutes les activités éducatives ou ludiques qui nous permettent de maintenir ou de retrouver cette familiarité.
Pour en savoir plus :
Grandcolas, P., Marc, C., 2023. Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité. CNRS Editions, Paris.
Grandcolas, P., 2024. Fake or not – Biodiversité. Tana Editions.
-
Fleur Breteau : "cancer colère"
- Par Thierry LEDRU
- Le 29/06/2025
- 0 commentaire
« Voter la loi Duplomb, c’est voter pour le cancer » : Fleur Breteau, malade et en colère

« En six mois, je suis devenue nonagénaire. » Fleur Breteau, 50 ans, est malade d’un cancer. Horrifiée par la proposition de loi Duplomb et le champ libre laissé aux pesticides, elle a fondé le collectif « Cancer Colère ».
À couvert sous une casquette Carhartt, un homme se hasarde à un timide coup d’œil. Juste une seconde. Peut-être moins encore. Une valse assez furtive pour assouvir sa curiosité, sans s’enliser dans une gênante intrusion. Raté. « Les passants me dévisagent en permanence, murmure Fleur Breteau. Mon corps a tellement changé que je peine à me reconnaître. » Malade d’un deuxième cancer du sein, la Parisienne porte sur son crâne l’absence de ce que la chimiothérapie lui a dérobé. Cette nudité, symptôme visible « d’un système en train de se retourner contre nous ».
« Prenons par ici plutôt. » Guidée par ses petits rituels, Fleur Breteau engloutit le kilomètre à pied la séparant de la gare de Lyon, et saute dans une rame de la ligne 14 du métro. Direction l’institut de cancérologie Gustave Roussy, à deux pas de la capitale, pour une onzième séance de chimiothérapie. Accroché à son tailleur de velours, un pin’s « Cancer Colère » évoque le collectif du même nom, fraîchement créé par la quinqua. Son dessein ? Politiser cette maladie, à l’heure où la proposition de loi Duplomb prévoit de réautoriser l’acétamipride — un pesticide interdit depuis 2018.
La littérature scientifique a déjà commencé à établir une corrélation claire entre l’exposition aux néonicotinoïdes et l’augmentation du risque de cancer. « Ces saloperies perturbent la duplication de nos cellules, métamorphosant des maladies en véritables phénomènes de société, s’insurge Fleur Breteau. Le scandale du cadmium est révélateur. Même nos tartines et céréales du petit dej’ sont devenues des cancérogènes notoires à cause des engrais. » Dépliant une ombrelle pour abriter son épiderme à la sensibilité décuplée, elle ajoute : « J’en ai marre de me taire. Les politiques parlent du cancer comme une notion abstraite. Alors que non, ça n’a rien d’abstrait. »
Strass et brouillard
Début janvier, quelques jours avant d’entamer son traitement médicamenteux, Fleur Breteau avait invité une poignée de proches à déguster la galette des rois. Une épiphanie singulière, où ses amis firent vrombir la tondeuse. À mesure que tombaient ses cheveux, comme des feuilles en automne, fleurissait dans ses pupilles la lueur d’une force neuve. « Une fois mon crâne rasé, ma nièce et ma filleule m’ont maquillée. Un make up de star, avec des strass, se réjouit-elle. Prendre ainsi les devants a été un moment fort. Désormais, mon neveu de 3 ans rit parce que j’ai de petits poils sur la tête. »
Au crépuscule du printemps, l’allant qu’elle affichait hier a fini par s’éroder. Injecté en intraveineuse, le Paclitaxel — molécule attaquant les cellules cancéreuses — grignote aussi ses nerfs, causant de douloureux fourmillements. À cela s’ajoutent les souffrances articulaires et musculaires, les saignements de nez, la perte de goût et d’odorat, les vertiges et les éruptions cutanées.

« Une fois mon crâne rasé, ma nièce et ma filleule m’ont maquillée. Un make up de star, avec des strass », un moment fort, raconte Fleur Breteau. © Cha Gonzalez / Reporterre
« Mes ongles noircissent et se décollent, d’où ce vernis violet, dit-elle encore en écartant les doigts. Mes rétines aussi sont affectées, et aucune paire de lunettes n’y peut rien. Je vois flou. Lire est devenu laborieux, et plus question de grimper sur un vélo. » L’inventaire n’est pas terminé que, pétrie d’humilité, elle corrige : « Je ne m’en sors pas si mal. Je n’ai pas de vomissements, ni d’aphtes. Certains patients en ont tellement que manger est pour eux un calvaire. »
À l’ouverture des portes du métro, la silhouette frêle de Fleur Breteau s’engouffre dans le dédale de verre et d’acier de la station Gustave Roussy, à Villejuif. Un labyrinthe de 32 escaliers et 16 ascenseurs, où elle s’est égarée plus d’une fois. « Ce brouillard permanent est le plus frustrant. Chaque seconde, j’ai le sentiment de me réveiller d’un sommeil profond. Comme si seul un sac plastique errait inlassablement dans mon cerveau. » Tantôt ne plus parvenir à envoyer un mail, tantôt mettre à chauffer une poêle sans savoir pourquoi, ou encore acheter deux billets de trains identiques à une demi-heure d’intervalle. Les lèvres ourlées d’un rictus amer, elle conclut : « En six mois, je suis devenue nonagénaire. »
Cancer comedy club
Née en 1975, Fleur Breteau a grandi à Paris et Levallois-Perret. Sûrement doit-elle à sa mère, figure de résistance à l’édile républicain Patrick Balkany, son âme opiniâtre. À son oncle François, qu’elle voyait débarquer au dîner de Noël accompagné de personnes sans-logis, son humanisme. Et à sa sœur puînée, sa fibre écologiste : « À cinq ans, elle plantait déjà les épluchures de légumes dans la jardinière de géraniums de maman », se remémore-t-elle, amusée. Son poignet tatoué porte aussi le souvenir indélébile d’un défunt cousin, amoureux des montagnes disparu dans les Alpes.
Fleur Breteau a tracé son chemin loin des lignes droites. Des études de lettres et de cinéma, vite délaissées pour plus d’autodidaxie, lui ont toutefois inculqué le goût des livres — King Kong Théorie de Virginie Despentes, et Rabalaïre d’Alain Guiraudie, notamment. La Parisienne a orchestré la campagne de communication de la PlayStation 2, lancée une marque de vêtements éthiques et travaillé dans un sex shop. Les confessions intimes de la clientèle, parfois embarrassantes, parfois émouvantes, lui ont inspiré un premier livre rock’n’roll, L’amour, accessoires (ed. Gallimard), applaudi par Les Inrocks.
Puis, ce fût le temps du « Cancer Comedy Club ». Des tumeurs à répétition dans son entourage. À commencer par sa sœur, et son meilleur ami, Nicolas Krameyer, historien des luttes et défenseur des droits à Amnesty International. Il y eut d’abord les courses-poursuites en fauteuils roulants dans les couloirs de l’hôpital, puis les adieux déchirant entre cet homme et sa fillette de 9 ans : « Ça a été la chose la plus terrible qu’il m’ait été donné de vivre, murmure Fleur Breteau. Il est décédé à 42 ans, le jour où mon oncologue m’a diagnostiqué un deuxième cancer du sein. C’est ça la réalité de ces maladies. »
Un « tsunami » de cancers à venir
D’un bout à l’autre de l’allée menant à l’institut, des autocollants « Cancer Colère » ont été placardés sur les pylônes métalliques. L’hôtesse d’accueil lui tend un bracelet blanc, que Fleur Breteau enfile aussitôt. Elle a croisé ici des dizaines de trombines chahutées par les traitements chimiques. Une mère isolée, atteinte d’un cancer du sein et dont le fils de 10 ans a contracté une tumeur au cerveau. « Et il n’est pas le seul, précise-t-elle. Dans son école de Seine-et-Marne, deux autres gamins en sont victimes. »
Trois hommes, tous âgés d’une cinquantaine d’années et boulangers dans ce même département, ont aussi côtoyé les bancs de cette salle d’attente. « Le 77, ce sont les terres d’Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, syndicat agricole à l’origine de cette loi Duplomb. Le cynisme n’est pas un mot assez fort pour qualifier une telle injustice. »
Le 27 janvier, l’adoption de la proposition de loi par les sénateurs a constitué l’ultime électrochoc. « Mon sang n’a fait qu’un tour, poursuit Fleur Breteau. C’était d’une violence terrible. » En pleine séance de chimio, l’ancienne artisane couturière a griffonné un logo sur un morceau de papier. Cancer Colère venait de naître.

Le collectif Cancer Colère a rapidement produit différents visuels, comme celui-ci à propos du scandale du chlordécone aux Antilles. © Cha Gonzalez / Reporterre
Le 3 février, le professeur Fabrice Barlesi, à la tête de l’institut Gustave Roussy, alertait du « tsunami » à venir de cancers chez les jeunes adultes. « Ce n’est plus une maladie, c’est une épidémie, se désole la quinqua. Et que se contente de déclarer Emmanuel Macron ? Qu’il n’a pas de leçon à recevoir sur l’écologie. Il y a cinq ans, il parlait de guerre à l’heure du Covid. Désormais, il se mure dans le silence pour mieux préserver les intérêts économiques des plus riches. »
Aux yeux de Fleur Breteau, se réfugier derrière l’espoir de meilleures guérisons à l’avenir est insultant. « Ça m’a glacé le sang d’entendre le président s’en réjouir. Il ignore les terribles épreuves que nous, malades, traversons. Il ignore l’enfer des rechutes. À quoi bon guérir si une autre tumeur apparaît l’année suivante ? »
Surtout, cette rhétorique constitue une échappatoire : « Il évite à tout prix de parler des coupables. La science est pourtant catégorique : les pesticides sont des cocktails d’hydrocarbures, d’antibiotiques et de métaux lourds, déversés partout par l’agrochimie. Certaines substances interdites depuis 40 ans sont encore détectées dans les cheveux des enfants. Comment croire une seconde que nos corps n’en sont pas affectés ? »
« Voter la loi Duplomb, c’est admettre que chaque pomme croquée sera une nouvelle intoxication »
Dans la chambre 158 de l’aile baptisée « Nouvelle-Calédonie », une femme termine son injection. Retirant les gants et chaussons réfrigérés — censés ralentir le décollement des ongles, elle commente d’un sourire complice : « Un véritable attirail de boxeuse. » Puis, sa perruque enfilée, elle disparaît. Vêtue d’une blouse blanche, Ruth, l’infirmière du jour, tend le même équipement à Fleur Breteau et lui enfonce une aiguille dans le thorax, à la hauteur d’un petit boîtier sous-cutané : « Ça s’appelle une chambre implantable, précise la patiente. Grâce à elle, le produit file directement vers l’artère. Si l’on procédait à une simple piqûre au bras, celui-ci brûlerait mes veines, moins robustes. »
Forte de son collectif naissant, Fleur Breteau cherche désormais à interpeller les législateurs. Céderont-ils à la pression des lobbies ? Voteront-ils pour que le cancer devienne « un rituel inévitable dans nos vies » ? Ces questions la hantent. « Voter la loi Duplomb, c’est voter pour le cancer. Ni plus, ni moins, enchaîne-t-elle, inépuisable dans l’art de convaincre. Voter la loi Duplomb, c’est admettre que chaque pomme croquée sera une nouvelle intoxication et qu’un grand nombre de nouveaux-nés naîtront avec de lourdes pathologies. »

« Certaines substances interdites depuis 40 ans sont encore détectées dans les cheveux des enfants. Comment croire une seconde que nos corps n’en sont pas affectés ? » © Cha Gonzalez / Reporterre
L’esprit égaré, la patiente effleure du bout des doigts le minuscule cétacé suspendu à son oreille. « Lorsque mon sein droit m’a été retiré, j’ai refusé la reconstruction, murmure-t-elle. Une soignante m’a demandé comment je comptais trouver un mari avec une telle poitrine. J’ai halluciné. » Douze ans plus tôt, au Groenland, Fleur Breteau avait croisé le regard d’une baleine à bosses entre les icebergs. Des larmes avaient gelé sur ses joues. « Les scientifiques les identifient à leurs cicatrices. J’ai décidé d’accepter les miennes. »
Goutte à goutte, le Paclitaxel continue de couler. Dès la chimio définitivement achevée, Fleur Breteau filera à Noirmoutier, marcher pieds nus dans la pinède et sentir l’eau de la mer caresser son corps. « Mon rêve ? Apprendre à bivouaquer et être réveillée à l’aube par le chant d’une grenouille, ourdit-elle. Seulement, avant ça, j’ai un moratoire sur les pesticides à obtenir. »
Puisque vous êtes là...
... nous avons un petit service à vous demander.
Entre la présence d’un climatosceptique à la tête de la première puissance mondiale, un gouvernement français qui flirte avec l’extrême-droite, et les catastrophes climatiques qui s’enchainent... Faire vivre l’écologie dans le débat public est un enjeu crucial.Personne ne modifie ce que nous publions. Média à but non lucratif, nous n’avons ni actionnaire, ni propriétaire milliardaire — seulement une équipe d’irréductibles journalistes, pleine de détermination.
Nous avons la conviction que l’urgence écologique est l’enjeu majeur de notre époque. Et comme plus de 2 millions de lectrices et lecteurs chaque mois, vous partagez sans doute cette conviction...
Depuis 12 ans, nous publions des articles de qualité sur l’écologie, en accès libre et sans publicité, pour tous.
Mais ce travail demande beaucoup de temps et de ressources.Alors, si vous en avez les moyens, sachez qu’un don, même d’1€, est un acte de soutien fort pour l’écologie et le journalisme indépendant.
(Et ça vous prendra moins de temps que la lecture de ce texte).Si vous en avez les moyens, choisissez un soutien mensuel. Merci.
-
Canicule et agriculture
- Par Thierry LEDRU
- Le 28/06/2025
- 0 commentaire
On demande aux agriculteurs de s'adapter. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement que le système productiviste ne ralentira jamais. A chacun d'en subir les conséquences et de chercher des solutions. Quand il y en a ...
Est-ce que les gens ont bien conscience que l'alimentation de base est en danger ? On ne parle pas de chaleurs intenses au travail, à l'extérieur ou dans les bureaux, dans les écoles, dans tous les logements qui sont des bouilloires. On parle de ce qui nous nourrit, on parle de survie alimentaire. Est-ce que les gens ont conscience que la hausse des prix depuis les dix dernières années n'est rien au regard de ce qui nous attend ? Est-ce que tous les urbains qui ont besoin d'acheter leur nourriture réalisent que ça va devenir très compliqué ? Quand je fais du vélo, je regarde parfois les jardins, tous ces jardins d'agrément dans lesquels il n'y a rien à manger. Est-ce que ces gens ont conscience du gâchis, est-ce qu'ils savent vers où on va ? Des pelouses tondues à ras et des fleurs que les propriétaires arrosent. Les fleurs sur un terrain, c'est pour attirer les pollinisateurs dont le potager et le verger ont besoin. Pas uniquement pour faire joli.
On a déménagé en mars, on a acheté un hectare de terrain. Entièrement clôturé. Je sais qu'un jour, il est possible que je sois obligé de "protéger" mes cultures et mes fruits. Et pas simplement avec un grillage.
CANICULE ET AGRICULTURE
Après un week-end caniculaire, les très fortes chaleurs reviennent, notamment dans le centre et le sud de la France, ce qui entraîne des conséquences directes sur les cultures, comme l’« avortement floral ». « 20 Minutes » vous explique
Canicule : Moins de tomates… C’est quoi l’avortement floral dont souffrent les végétaux ?
41
Propos recueillis par Elise Martin
Publié le 24/06/2025 à 07h37 • Mis à jour le 24/06/2025 à 18h20
L'essentiel
Les températures dépassant 40 °C deviennent de plus en plus fréquentes en France. Mardi, il fera jusqu’à 42 °C aux alentours de Perpignan.
En plus des conséquences sur l’être humain, ces fortes chaleurs ont des impacts sur les cultures et les écosystèmes.
Stress thermique fort, avortement floral… Le docteur en agrométéorologie Serge Zaka est revenu pour 20 Minutes sur les effets des canicules sur l’agriculture.
Les températures vont une nouvelle fois dépasser les 40 °C à certains endroits de la France ce mardi. A Perpignan ou Carcassonne, entre 42 et 43 °C sont prévus. « Ces prévisions sont franchement inquiétantes », alerte le docteur en agrométéorologie Serge Zaka.
Si pour l’être humain, les conséquences des canicules sont préoccupantes, elles le sont aussi pour « les cultures, les animaux d’élevage et les écosystèmes », souligne le fondateur d’Agroclimat 2050. Avortement floral, stress thermique et changement de variétés… Le spécialiste est revenu pour 20 Minutes sur les effets des fortes chaleurs sur nos cultures et les dangers pour l’agriculture à l’avenir.
Pourquoi les prévisions de mardi, avec 42 °C vers Perpignan, sont-elles inquiétantes pour vous ?
Les températures vont être très élevées vers Perpignan mais aussi dans la partie centrale de la France. On a déjà eu ces températures-là dans le siècle passé, en 1947 ou en 1983 par exemple. Mais depuis les années 2000, on dépasse régulièrement les 40 °C. C’est devenu banal. On a dix-neuf fois plus de stations qui enregistrent les 40 °C qu’avant. Et ça arrive également de dépasser cent fois les 40 °C en un an. C’est donc un phénomène qui devient récurrent, intense, qui touche presque tout le territoire et qui est de plus en plus précoce [il n’arrive pas qu’en juillet et août mais aussi en juin, ainsi qu’en septembre parfois]. On se retrouve donc avec tous les facteurs de stress pour les végétaux. Car historiquement, on plante et on réfléchit nos cultures pour qu’ils ne subissent pas de canicules.
Si jusqu’à présent, avec 38 °C, certains végétaux étaient en phase de « résistance », au-delà de 40 °C, on entre dans un seuil de « stress thermique fort » ce qui entraîne des dégâts.
Qu’est-ce que ces températures ont comme effets sur les cultures ?
Les végétaux ont une réponse à la température qui est différente en fonction des régions, c’est d’ailleurs pour ça à l’origine que chaque territoire produit en fonction de son climat. Ainsi, un noisetier ou un blé arrête sa croissance quand il fait 35 °C. Un olivier la stoppe plutôt au bout de 42 °C.
Mais avec les températures attendues ce mardi, on dépasse le seuil de résistance physiologique des végétaux, induit dans l’ADN de chaque espèce de plante, qui ne peut plus se défendre. C’est ce qu’on appelle le « stress thermique fort ». Autre risque de ces fortes chaleurs, la possibilité d’avortement floral pour tous les légumes du potager. A cause des températures hautes, la reproduction qui se passe à l’intérieur de la fleur pour faire un fruit est altérée. Sans fruit sur cette fleur, elle sera stérile et va tomber.
On se retrouve alors avec des écosystèmes qui sont fatigués par la sécheresse, par les gels tardifs, par la perte des feuilles en été, par des brûlures répétées, qui subissent un contexte de changement climatique induit par l’humain.
Quelles sont les conséquences d’un stress thermique ou d’un avortement floral ?
Les conséquences sont des défoliations pour un arbre, des brûlures qui apparaissent sur les fruits. Par exemple, en ce moment les tomates et les courgettes [et tous les légumes du soleil] sont en début de floraison. Or, à partir de 34 °C, la tomate commence à avoir des problématiques de reproduction parce qu’il fait trop chaud, à partir de 36 °C, on diminue de 70 % la capacité de la fleur à produire un fruit. A 38 °C, toutes les fleurs présentes vont subir un avortement floral et vont tomber en deux ou trois jours, parce qu’elles n’auront pas supporté ces températures-là.
Autre exemple : on a eu 36 à 40 °C pendant trois jours du côté du Poitou-Charentes, de Nantes, des Pays-de-la-Loire, du nord de l’Aquitaine. On a alors des problématiques de remplissage du grain sur l’orge de printemps et sur le blé d’hiver. En effet, sa croissance commence à ralentir vers 32 °C et à 38 °C. Ça veut dire que le grain - qui doit être récupéré pour être mangé derrière – va être plus petit parce qu’on a eu des vagues de chaleur pendant ce remplissage qui ont réduit la taille et le poids des grains. Au final, ces températures impactent aussi le rendement et donc le revenu des agriculteurs.
Et ce qui est vrai pour les végétaux, l’est aussi pour les animaux. La canicule peut entraîner une baisse de production de lait, une baisse de ponte, et une baisse de croissance. En résumé, on a vraiment tous les ingrédients pour passer un mauvais été.
Les prévisions du site agroclimatologie.fr qui permet de traduire les données météo des jours à venir, en impact économique sur les vergers, potagers, des cultures des particuliers et des agriculteurs. - Capture d'écran agroclimatologie.fr
Comment s’adapter face à cette situation ?
Pour s’adapter, on peut miser sur l’irrigation car on va avoir de plus en plus de problématiques d’eau. Cette option permet de sécuriser la production et d’éviter d’acheter à l’étranger. Mais il ne faut pas que les retenues soient la solution : il faut aussi retravailler les sols, reverdir le paysage et que ce soit accompagné de révolutions du système agricole.
Mais ça dépend des territoires. Quand dans la région de Carcassonne, on atteint les 40-42 °C, l'une des voies d’adaptation, ce n’est pas de l’ombrage ou de l’irrigation. On dépasse le seuil de résistance des espèces présentes sur le territoire, donc, si on veut rester dans l’agriculture, il faut changer d’espèces. Et ainsi passer à de l’olivier, à des agrumes, qui peuvent résister jusqu’à 45 °C avant d’avoir des brûlures sur leurs feuilles. Mais changer d’espèce induit un changement de filière, de toute son économie, d’AOC, d’IGP, de consommation sur le territoire, d’installations d’entreprises, de matériel de stockage, de séchage… Mais c’est un profond changement qui prend vingt ans minimum et qui doit être accompagné par de la pédagogie, de l’éducation sur les évolutions territoriales. Ce sont donc des réflexions qu’on aurait dû avoir il y a longtemps. Le changement climatique est beaucoup plus rapide que la réflexion sur l’évolution.
Dans le Nord, on peut encore travailler sur la même espèce mais on va changer de variété, ce qui permet de s’adapter à ces températures et à ces nouvelles conditions. C’est « plus simple » car on change « juste » de goût, le calibre. C’est acceptable à court terme.
Notre dossier sur le réchauffement climatique
Et à long terme ?
En 2050, avec le réchauffement climatique, les scénarios prédisent 45 à 50 °C plus fréquemment. Dans ce cas-là, on sera dans une impasse. Quand on atteint ces températures sur des territoires qui ne les ont jamais eues, il n’y a pas de solution. On ne peut que constater un dépérissement de nos arbres. Donc, après 2050, la principale solution, c’est de ne pas atteindre ces températures et de diminuer les gaz à effet de serre drastiquement à l’échelle mondiale.
-
Runaway train
- Par Thierry LEDRU
- Le 27/06/2025
- 0 commentaire
RUNAWAY TRAIN
Synopsis :
Manny et Buck parviennent à s'échapper de prison. Leur fuite est très compliquée et dangereuse car ils sont au beau milieu de l'Alaska, région aux conditions climatiques glaciales. Toutefois, ils rejoignent une gare et montent à bord d'un train. Malheureusement pour eux, le conducteur est victime d'une crise cardiaque et les freins du convoi ne répondent plus ! La vitesse ne cesse d'augmenter et personne ne semble capable de la faire redescendre...
Nous sommes les participants enthousiastes ou réfractaires d'un business planétaire et nous ne pouvons pas en sortir. Et c'est justement parce que nous n'avons plus la possibilité d'en sortir que ce business planétaire court à sa perte. Par épuisement des ressources, par une dévastation effrénée.
Ça prendra un certain temps mais c'est inéluctable. Personne, d'ailleurs, n'est en mesure d'identifier une date précise pour une raison toute simple : il y a trop de paramètres.
Il ne nous reste qu'à nous y préparer et en fait pas grand monde, actuellement, n'a idée de ce que ça signifie.
L'explication est très simple.
Le business. Nous sommes les proies du business et en même temps son moteur. Et c'est en cela que c'est effroyable. Car pour nous sauver, il faudrait que nous nous amputions de nous-mêmes tellement ce business est devenu une partie de nous. Ceux qui en profitent et ceux qui en rêvent, les pays "développés" et ceux qui luttent pour leur développement. Et ce terme est effroyable puisqu'il contient les raisons du désastre en cours. Un développement mortifère, celui sur lequel nous avons bâti notre prédominance, celui qui nous offre un confort que toutes les générations précédentes cherchaient à atteindre. Nous ne mourons pas de faim, nous bénéficions de soins médicaux qui ont su considérablement progresser, nous vivons dans des maisons avec l'eau courante et l'électricité, nous pouvons nous déplacer rapidement. Oui, je sais, un très grand nombre de personnes ne peuvent pas en dire autant, et même dans nos pays "développés". Les différences de niveau dans ce "confort", des plus nantis aux plus démunis, sont considérables. Mais c'est ainsi que nous vivons, dans cette quête de ce que nous considérons comme la seule qualité de vie possible.
Et moi aussi.
Même si nous avons un potager qui nous nourrit, que nous l'arrosons avec l'eau de pluie récupérée dans des citernes et désormais une source, que nous ne mangeons pas d'animaux, que nous ne prenons pas l'avion, que nous voyageons uniquement en France et sur des distances très faibles, que nous portons les mêmes vêtements depuis bien longtemps (sauf les chaussures de montagne que nous usons très, très rapidement), que nous n'allons pas en ville pour faire les magasins et que lorsque nous devons inévitablement y aller, c'est une journée gâchée, que nous cherchons à dépenser le moins possible, que nous recyclons, que je récupère plus de choses que je n'en jette ou donne etc... il n'en reste pas moins que je participe à un phénomène de masse considérablement puissant. Je me chauffe au bois, j'utilise l'électricité, je consomme de l'eau potable pour les wc, la vaisselle, la machine à laver, je brûle du pétrole avec la voiture ou le fourgon, je consomme l'essentiel mais je fais partie du système.
Il n'y a pas de solution. Nous allons donc poursuivre sur cette voie jusqu'à ce que la Nature vienne entraver le convoi.
Le problème, c'est que ce convoi ne supporte aucunement l'entravement. Il ne sait pas ralentir, il sait encore moins s'arrêter. Il a donc décidé d'aller jusqu'au déraillement. Coûte que coûte. Persuadé que le progrès contient en lui-même la résolution aux problèmes qu'il génère.
L'humanité vit hors sol et s'imagine que le convoi taille sa route dans une Nature qu'il dominera toujours, qu'il pourra indéfiniment l'exploiter, qu'il trouvera des solutions à tous les problèmes liés à "l'environnement". Ce fameux "environnement". Comme s'il y avait nous, les humains et puis le reste. Pure folie. Il n'y a qu'une réalité. C'est le Tout. Nous nous en sommes extraits, nourris par la puissance du business, nourris par le progrès.
La Nature n'a pas besoin de nous. Elle est un Tout mais elle peut se passer d'une partie. De nous.
Il faudrait nous alléger, réduire la vitesse de ce chaos en marche, nous retirer autant que possible, non seulement pour les générations à venir mais pour nous épargner aussi, ceux tout du moins qui ont une part de conscience, de crever de honte un jour prochain car nous serons tous responsables aux yeux de nos descendants.
Mais est-ce que ce retrait est envisageable à grande échelle ? Prenons la situation dans son ensemble : il y a deux problématiques. Celle qui me restent de ma formation en sophrologie, suivie il y a bien des années déjà.
Une personne peut souffrir intérieurement au regard de l'interprétation qu'elle a de la réalité, une interprétation liée à son histoire personnelle et bien entendu à son enfance. Nous portons ce que nous avons traversé et nous réagissons à travers des filtres multiples jusqu'à considérer, parfois, que les situations nous sont défavorables quand elles ne sont dans leur réalité intrinsèque que des interprétations. Il s'agit donc pour cette personne de parvenir à se relier à l'instant sans lui apporter le moindre "commentaire", c'est à dire à rester ancré dans la réalité sans l'alourdir.
Dans le cas de l'état de la planète, il n'y a aucune interprétation. Ce sont des faits, pas des interprétations. Il est donc inopportun de chercher à saisir la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité.
Deuxième situation. La personne souffre de la réalité, sans pour autant lui apporter des interprétations erronées, elle est lucide, clairvoyante, ses états d'âme sont justifiés. Elle n'a qu'une solution : quitter cette situation pour s'inscrire dans une autre réalité.
Dans le cas de l'état de la planète, c'est bien évidemment impossible puisque cette situation est planétaire. Qu'elle parte vivre au Canada ou en Australie, au Groenland ou en Patagonie, les effets du réchauffement climatique et du dépassement des limites écologiques seront les mêmes dans leur ampleur. Il n'y a pas d'autre réalité.
Nous avons choisi le développement matériel, technologique, scientifique, c'était un réel besoin, il y a un certain temps. La quête de l'avoir. Et nous nous sommes tellement investis dans cette quête que nous avons délaissé, jusqu'à en oublier la nécessité, la quête de l'être. L'éthique également, au regard de la planète. Nous sommes devenus les maîtres, c'est à dire en fait les prédateurs.
Nos gesticulations actuelles, notre recherche d'équilibre, de sobriété, d'économie dans le sens premier du terme, tout ce que nous pouvons tenter de faire désormais, il faut bien comprendre que c'est trop tard. Nous ne stopperons pas le train, et même si nous parvenons à le freiner, il continuera sa route. Et cette route sera de plus en plus chaotique.
Non, je ne suis pas défaitiste ou déprimé, ni même en colère. Tout ça est déjà consumé. Je suis dans le train et je regarde les paysages. Je n'écoute plus vraiment les paroles des autres passagers, tout ce fatras d'idées, ces opinions qui se combattent, je ne cherche plus à faire entendre ma voix et même ce texte que je partage, je l'ai d'abord écrit pour moi. Pour être au clair parce que j'ai besoin d'écrire pour saisir la réalité.
-
Carte IGN au 25/000 ème
- Par Thierry LEDRU
- Le 15/06/2025
- 0 commentaire
En mode exploration, voilà notre bonheur en montagne. Loin, très loin du tourisme de masse...
Prendre une carte au 25/000 ème, chercher un itinéraire avec les petits pointillés noirs, lire les courbes de niveau, repérer les reliefs, les vallons, les crêtes, les sommets, les prairies alpines, les forêts, les ruisseaux, une croix, une balise, une fontaine et puis chercher, chercher, suivre les sentes des animaux, trouver parfois une trace de peinture, des rochers usés, des marques de chaussures dans la terre, une faille, une brèche, un "pas", les fameux "pas" découverts par les Anciens. Des journées entières Là-Haut.









-
TOUS, SAUF ELLE : coma.
- Par Thierry LEDRU
- Le 09/06/2025
- 0 commentaire
Dans la rubrique THÈMES, il faudrait que je crée une page qui regrouperait tous les extraits de mes romans dans lesquels les personnages vivent une expérience de conscience modifiée.
De VERTIGES à JARWAL, ils contiennent tous cette dimension, cette exploration, cet espace que nous n'avons pas encore parcouru, cartographié, identifié et qui me fascine.
TOUS, SAUF ELLE
Hôpital sud de Grenoble, service de neurochirurgie.
« Lieutenant Bréchet. »
Théo montra sa carte au Docteur Flaurent auprès duquel il avait obtenu un bref échange.
« Docteur, vous pouvez me donner des nouvelles de madame Bonpierre ? Une enquête est en cours. »
Théo regretta immédiatement le ton de sa voix. Trop directe, autoritaire, trop intrusive. Toujours ce manque de diplomatie qu’on lui reprochait, la courtoisie qu’il était incapable d’adopter quand l’urgence l’emportait. Il se fustigeait régulièrement mais ne parvenait jamais à respecter ses promesses. Il avait même fini par réaliser que ses relations extra-professionnelles souffraient parfois de cette fâcheuse tendance à paraître présomptueux. Lui savait qu’il n’en était rien. Il ne s’expliquait cette rudesse relationnelle que par sa méfiance chronique envers l’humain.
Le docteur était plus petit que Théo et il releva légèrement la tête, pour plonger les yeux dans ceux du lieutenant. Il n’aimait pas cette attitude de cow-boy. Il n’aimait pas la police en général. Trop d’arrogance.
« Mademoiselle… lieutenant. Pas madame. Je sais que le terme est désuet mais pour un homme de mon âge, il a toujours la même valeur.
–Ah, désolé. »
Le chirurgien faillit dire qu’il ne lisait pas correctement ses fiches mais il se retint.
« Coma profond, continua-t-il, un hématome conséquent, il faut que je l’opère demain matin. Pour l’instant, il s’agit de la stabiliser et de la préparer. C’est une opération délicate, des zones cérébrales majeures.
–Il peut y avoir des séquelles ?
–Elle peut même mourir. Mademoiselle Bonpierre a certainement passé plusieurs heures dans cette voiture avant d'être secourue. C'est un paramètre inquiétant. Pourquoi y a-t-il une enquête ?
–Il y avait deux flics avec elle, deux collègues. Un est mort et l’autre est dans le coma, alors vous voyez, on aimerait être sûr qu’il s’agit bien d’un banal et tragique accident.
–Vous aimeriez donc que je vous prévienne lorsqu'elle se réveillera ? Et vous imaginez sans doute qu’elle sera en état de tout vous raconter. Alors, écoutez, lieutenant, Laure Bonpierre ne sera peut-être plus de ce monde dans quelques heures ou alors, elle sera dans un état végétatif, ou elle aura toutes ses capacités mais peut-être plus celle de la parole, ou elle sera totalement amnésique, ou frappée d’amnésie partielle et je pourrais continuer la liste des hypothèses encore un moment. Il s’agit de neurochirurgie pas d’une appendicite. »
Regards croisés. Tensions similaires.
« OK, Docteur, désolé si je me suis montré incorrect. Disons que j’ai l’impression qu’on pourrait apprendre quelque chose de capital. Et j’aimerais vraiment comprendre ce qui s’est passé pour mes deux collègues.
–Si je juge, qu'un jour, Mlle Bonpierre est apte à vous aider, je vous préviendrai.»
Théo salua le docteur en lâchant un « Merci » qu'il chercha à envelopper dans un sourire appuyé.
Laure Bonpierre.
Il rejoignit sa voiture en regrettant de n'avoir pas pu la voir.
La lumière dans son corps, un rayonnement d’une douceur infinie, comme une caresse d’ange. Elle n’avait aucune douleur puisque son corps n’était plus que lumière. Elle sentait en elle l’agitation des atomes, rien ne lui appartenait, la lumière l’avait désintégrée et ses molécules dansaient dans le flot. Elle ne comprenait pas comment il était possible de sentir quelque chose en soi quand on n’a plus de matière. À moins, qu’elle soit devenue de la lumière. Non, ça n’était pas elle, mais en elle, elle n’était pas la lumière mais la lumière lui permettait de rester là, de ne pas s’engager plus loin dans le canal des âmes. Oui, c’était ça.
Elle avait regardé la lumière investir le corps penché devant elle, elle l’avait vu tressauter, comme un mécanisme ranimé, une clé tournée pour relancer les engrenages. Elle se souvenait de l’allégresse de la vie dans les étincelles qui l’enveloppaient. Une intensité lumineuse sur la poitrine. Elle avait entendu le premier souffle ranimé, une longue inspiration et un profond relâchement, comme un soulagement merveilleux, un délice, une renaissance.
La tête du conducteur penchait par contre d’une façon incompatible avec la vie. La lumière ne l’avait même pas effleuré. Une intervention inutile.
Des crépitements, comme des sarabandes endiablées d'étoiles électriques. Elle avait été enveloppée.
Elle avait très clairement perçu le renforcement de l’intensité lumineuse à l'intérieur, le rayonnement qui parcourait les réseaux de son cerveau, elle avait vu les effluves comme des risées disparates à la surface de l’océan. Elle avait trouvé cela très beau. Comme un plongeur éclairant de sa lampe le plafond d'une grotte marine, elle avait parcouru l'intérieur de son crâne dans une apesanteur magique, fascinée par l'acuité étrange de son regard : elle ne voyait pas les choses, elle en ressentait l'énergie.
Elle était tombée en admiration devant cette complexité miraculeusement organisée à l'intérieur d'elle. Pouvoir contempler la vie en soi et se réjouir du miracle. Elle avait pensé qu'elle avait une chance inouïe.
Puis, son regard s’était tourné vers une paroi translucide, des mouvements rapides qui effaçaient des débris et elle avait croisé des yeux effarés, un visage penché comme à travers une lucarne. Elle avait perçu de l’effroi, un courant d’air glacé.
Et tout s’était éteint.
Maintenant, elle entendait les voix autour d’elle. Elles parlaient toutes d’un cerveau très abîmé. Elle aimait le parfum de fleurs qui accompagnait la voix d’une femme. Elle se souvenait d’un Indien. C’était étrange tout ce blanc à l’intérieur.
-
A travers le tunnel
- Par Thierry LEDRU
- Le 09/06/2025
- 0 commentaire
Radio France, aller à la page d'accueil
Les expériences de mort imminente
Publié le samedi 24 mai 2025
Des personnes dans un tunnel ©Getty
Provenant du podcast Carnets de santé
Steven Laureys est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du cerveau et du coma. Passionné par les expériences de mort imminente, il a cherché à comprendre ce qui se passait scientifiquement en se soumettant à des expérimentations.
Avec
Steven Laureys, neurologue, directeur de recherche au Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et fondateur du Coma science Group au centre de recherche de l’université de Liège
Que se passe-t-il dans le cerveau d’une personne dans le coma ? Que comprend-elle ? Qu’entend-elle ? Quel espoir de réveil, de récupération ? Peut-on d’emblée prédire ses possibilités et donc adapter la prise en charge du patient ? Bien sûr, les connaissances, notamment grâce aux nouvelles technologies d’imagerie cérébrale, ont progressé, mais cet état reste encore très mystérieux et continue à la fois d’inquiéter et de fasciner.
Les expériences de mort imminente sont-elles de pures hallucinations ?
Marina Carrère d'Encausse s'entretient avec Steven Laureys, qui, tout au long de sa carrière, a exploré l'esprit humain, nos pensées, nos perceptions et émotions. Ses travaux portent sur le coma, mais aussi sur les commotions cérébrales, l’anesthésie, le rêve, l’hypnose, la transe, la méditation.
La conscience reste un des grands mystères pour la science
D’une spécialité que certains considéraient comme ésotérique, les choses ont évolué et aujourd’hui, selon le neurologue : « on a une vision beaucoup plus dynamique avec la neuroplasticité (c’est-à-dire le fait de pouvoir développer de nouvelles connexions et de nouveaux réseaux pour que le cerveau continue de fonctionner, même si des zones ont été abîmées.) Il y a des patients, certainement les jeunes, traumatisés crâniens, où ces milliers de milliards de connexions arrivent, et cette plasticité, peut assurer une récupération fonctionnelle. De plus, la neuroimagerie nous a permis de mieux documenter et d'être plus précis dans le diagnostic et aussi dans le pronostic, et même de proposer de nouvelles pistes thérapeutiques. »
Mais malgré les avancées médicales, le directeur fondateur du Coma Science Group à l'Université de Liège reste prudent : « la conscience reste un des grands mystères pour la science. » […] Finalement, le cerveau, l’on dit que c'est une fonction émergente à travers ces connexions, cette dynamique entre le thalamus qui est profond et ces deux réseaux de la conscience. »
4 à 5% d’expérienceurs, c’est-à-dire de personnes qui ont vécu une EMI
Il y aurait dans le monde 4 à 5% d'expérienceurs, ces personnes qui ont vécu une EMI. Pour comprendre ces personnes, le spécialiste du cerveau et de la neurologie de la conscience, a tenté d'en vivre une : « Je me suis fait injecter de la psilocybine dans mes veines, lors d’une IRM à Londres. Je n'avais plus de corps, j'étais un avec l'univers. J’ai eu cette vision du tunnel, et j'ai perdu connaissance. Et entre-temps j’ai vécu toutes les caractéristiques, y compris la décorporation».
Que se passe t-il dans notre cerveau lorsque l'on fait une EMI ?
Cela fait 25 ans que l'on étudie ces états modifiés de conscience, le coma, ce qui se passe aux soins intensifs. 15% des personnes au CHU de Liège qui survivent ont une expérience de mort imminente. Mais l’EMI n'est pas la mort cérébrale car jamais une personne avec les critères de mort cérébrale n’est revenue pour dire ce qu'elle avait vécu. A l’avenir, le Professeur en est convaincu : « des médecins vont proposer une théorie de la conscience, des pensées, des perceptions, des émotions. Entre temps, on a une série de données expérimentales, d'hypothèses ». Et de conclure que : « Comprendre notre univers intérieur, cela nécessite des scientifiques un peu rebelles qui osent remettre en question les vérités d'aujourd'hui. »
L'EMI, est-ce la preuve de la vie après la mort ou une pure hallucination ? La conscience réside-t-elle uniquement dans le cerveau ? Steven Laureys a tenté de comprendre ces patients qui racontaient leur expérience et a tout fait pour en vivre une. Le neurologue explique la façon dont ses connaissances et ses hypothèses ont évolué au fil de ses travaux.
TOUS, SAUF ELLE
CHAPITRE 2
Des visages sans relief. Des peaux lisses qui l’observaient scrupuleusement, la détaillaient intérieurement. Elle sentait leurs regards sur son âme, comme des brises tièdes qui l’enveloppaient. Elle ne savait dire ce qu’elle était malgré le flot puissant de ressentis. Elle avançait sans aucun mouvement, elle n’était plus qu’un souffle d’air, un rayon de lune, l’éclat tremblotant d’une étoile naine et pourtant, chacune de ces âmes rencontrées la parcourait comme le flux sanguin de la vie. Elle les voyait et simultanément elle les sentait en elle.
Elle ne possédait pourtant plus aucune enveloppe. C’était une certitude. Mais tout était là. L’air sur sa peau, le son du silence, le toucher des parois circulaires qui crépitaient et tous ces visages lisses qu’elle croisait. Où que se pose son regard, elle ne discernait qu’une myriade de présences.
Elle avançait à des vitesses stupéfiantes dans une immobilité absolue. Une aimantation vers le fond de l’univers. Un plongeon intemporel vers les étoiles. Elle était subjuguée par ce puits vertical et elle aurait été incapable de préciser le sens de son déplacement. Comme s’il n’y avait plus d’espace, pas plus que de temps.
C’est là que Figueras s’était interposé et avait stoppé sa progression. Elle avait reconnu le sourire flamboyant de ses prunelles. Les mots avaient résonné quelque part en elle.
« Tu n’as pas fini ton parcours. Retourne d’où tu viens. Réintègre ta matière. Tu te souviendras de ce que tu es quand tu ne seras plus ce que tu crois être. »
Tout était là sans qu’elle n’y comprenne rien.
-
Sit around the fire
- Par Thierry LEDRU
- Le 04/06/2025
- 0 commentaire
Il est très rare que j'écoute de la musique chantée.
Mais là, cette voix ne chante pas, elle parle, elle enseigne, elle apaise.
Et la musique de Jon Hopkins, je l'aime depuis si longtemps que j'ai parfois l'impression qu'elle vit en moi, J'imagine que la partition de cet accompagnement est d'une lecture très simple pour un musicien et elle est pour moi d'une perfection absolue. Il ne manque rien et rien d'inutile ne s'impose. Tout est juste.
Pour ma part, j'aime l'écouter lorsque je décide de dormir. J'éteins la lampe de chevet, je mets mes écouteurs, je ferme les yeux. Et la paix se répand en moi, glisse dans toutes les fibres, ralentit le cours du sang, couvre mon coeur d'une chaleur bienfaisante.
Paroles de la chanson Sit Around The Fire (Traduction) par Jon Hopkins
Sit Around The Fire (Traduction) Paroles originales du titre
Chanson manquante pour "Jon Hopkins" ? Proposer les paroles
Proposer une correction des paroles de "Sit Around The Fire (Traduction)"Au-delà de toutes les polarités
Je suis
Que les jugements et les opinions de l'esprit
Soient des jugements et des opinions de l'esprit
Et tu existes derrière ça
Ah alors
Ah alors
Il est vraiment temps que tu voies à travers l'absurdité de ta propre situation
Tu n'es pas celui que tu croyais être
Tu n'es pas cette personne
Et dans cette vie
Tu peux le savoir
MaintenantLe vrai travail que tu dois faire
Se trouve dans l'intimité de ton cœur
Toutes les formes extérieures sont belles
Mais le vrai travail
Est ta connexion intérieure
Si tu es silencieux quand tu médites
Si tu ouvres vraiment ton cœur
Apaise ton esprit
Ouvre ton cœur
Apaise l'esprit, ouvre le cœur
Comment apaiser l'esprit ?
Tu médites
Comment ouvrir le cœur ?
Tu commences à aimer ce que tu peux aimer
Et tu continues de l'élargir
Tu aimes un arbres
Tu aimes une rivièreTu aimes une feuille
Tu aimes une fleur
Tu aimes un chat
Tu aimes un humain
Mais tu vas de plus en plus profondément
Jusqu'à ce que tu adores
Ce qui est la source de lumière derrière tout ça
Derrière tout ça
Tu ne vénères pas la porte
Tu pénètres dans le temple intérieur
Tout en toi
Ce dont tu n'as pas besoin
Tu peux le lâcher
Tu n'as pas besoin de solitude
Car tu ne pourrais pas être seul
Tu n'as pas besoin de cupiditéParce que tu as déjà tout
Tu n'as pas besoin de doute
Parce que tu sais déjà
La confusion dit
"Je ne sais pas"
Mais dès que tu es silencieux
Tu découvres que dans la vérité
Tu sais vraiment
Car en toi
Tu sais
Qu'un avion après l'autre s'ouvrira à toi
Je veux savoir qui je suis vraiment
Comme si en chacun de nous
Il y avait autrefois un feu
Et pour certains d'entre nous
Il semble qu'il n'y ait plus que des cendresMais quand on creuse dans les cendres
On trouve une braise
Et, très doucement, on évente cette braise
... on souffle dessus
... elle devient plus ardente
Et c'est à partir de cette braise que l'on reconstruit le feu
C'est ce que, toi et moi, nous sommes là pour célébrer
Ce, même si nous avons vécu notre vie impliqués dans le monde
Nous savons
Nous savons que nous sommes de l'esprit
La braise devient plus vive
La flamme commence à vaciller un peu
Et très vite, on comprend que tout ce que l'on va faire pour l'éternitéC'est s'asseoir autour du feu
-
Blatten
- Par Thierry LEDRU
- Le 04/06/2025
- 0 commentaire
Un village enseveli, une vallée transformée, une rivière bloquée qui devient un lac. L'anticipation des autorités a su éviter un drame humain. Les gens ont perdu leurs biens, leurs souvenirs, ils sont intérieurement dévastés mais ils sont en vie.
Les commentaires sur les réseaux sociaux, appelés également, défouloir à conneries, vont bon train.
"Rien à voir avec le réchauffement climatique, il y a toujours eu des phénomènes de ce type dans les montagnes. Les montagnes s'écroulent, c'est normal."
Bien évidemment, ces gens n'ont aucune formation géologique, ni climatologique, ni scientifique, ni rien du tout. Bon, il faut passer outre, pas le choix.
Par contre, il est nécessaire de lire les avis des gens de Là-Haut, ceux qui vivent et travaillent en montagne et qui ont les connaissances nécessaires;
Ludovic Ravanel: «La haute montagne connaît une véritable crise érosive»
Fonte des glaciers, déstabilisation des moraines, dégradation du permafrost et écroulements associés: depuis la canicule de 2003, les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles dans les Alpes. Pour en savoir plus sur l’avenir de la construction en altitude, TRACÉS est allé à la rencontre du glaciologue et géomorphologue Ludovic Ravanel sur les hauteurs de Chamonix (F).
Date de publication
14-12-2023
Rédacteur en chef adjoint, revue TRACÉS
Ludovic Ravanel est directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire Environnement et dynamique des territoires de montagne (EDYTEM) de l’ Université Savoie – Mont Blanc, à Chambéry (F).
On peut dire du belvédère du Montenvers (1913 m) qu’il est le «point zéro du tourisme alpin». En 1741, les voyageurs britanniques William Windham et Richard Pococke en reviennent impressionnés par la vue d’un glacier qu’ils décrivent comme «un lac agité d’une grosse bise et gelé d’un coup». La Mer de Glace était née. À l’instar des autres glaciers alpins au cours du Petit Âge Glaciaire1, sa langue descendait bien plus bas qu’actuellement, menaçant le hameau des Bois, à la sortie de Chamonix. Si, aujourd’hui, la Mer de Glace, plus long glacier des Alpes françaises (11 km), attire toujours les visiteurs venus du monde entier (850 000 en 2022), la gare du Montenvers ressemble toujours plus à un port de la mer d’Aral, déconnecté du rivage par l’évaporation du plan d’eau. Alors que le glacier s’étendait immédiatement en contrebas de la terrasse du Montenvers à la fin du 19e siècle, il faut aujourd’hui emprunter une télécabine et parcourir durant une vingtaine de minutes une suite de passerelles et d’escaliers (550 marches) pour atteindre la glace. C’est sur cette terrasse que, durant l’été, Ludovic Ravanel et d’autres chercheurs proposent aux visiteurs une médiation scientifique. Micro à la main, il mêle l’histoire de l’alpinisme à la géologie, la glaciologie et la géomorphologie pour expliquer aux touristes la spectaculaire évolution du paysage qui s’offre aux regards à la sortie des wagons.
TRACÉS: Monsieur Ravanel, vos publications et vos interventions font régulièrement référence à une « crise érosive » qui affecte la haute montagne. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là?
Ludovic Ravanel: L’érosion est un phénomène naturel dans les Alpes. Le relief est voué à évoluer au gré des intempéries, des séismes, etc. Géologie et topographie concourent à ces déstabilisations. Mais aujourd’hui, en contexte glaciaire et de permafrost, nous constatons une forte augmentation à la fois de la fréquence et des volumes des déstabilisations. Le retrait des glaciers, conjugué à la dégradation du permafrost, entraînent des taux d’érosion beaucoup plus élevés que ce qui était jusqu’à présent la norme. Aux crises climatiques et de la biodiversité s’ajoute donc une crise érosive en haute altitude.
La canicule de 2003 marque en quelque sorte l’entrée dans cette crise. Mais, en 20 ans, les choses ont encore accéléré, du fait notamment de la récurrence des épisodes caniculaires depuis 2015. Des capteurs de températures installés dans trois forages réalisés à la fin des années 2000 dans les faces nord-ouest, est et sud de l’Aiguille du Midi (3842 m) confirment cette tendance lourde: en une décennie, la température au cœur du massif rocheux a augmenté de 1 à 1.5° C, soit davantage que l’élévation de la température de l’air.
Comment cette crise se manifeste-t-elle concrètement dans le paysage autour de la Mer de la Glace?
Depuis le Montenvers, on voit très bien deux secteurs emblématiques de cette évolution. Le premier est la face ouest des Drus (3754 m). En juin 2005, le pilier Bonatti s’est écroulé d’un coup, laissant une gigantesque cicatrice de 700 m de haut encore très visible aujourd’hui. Avec un peu moins de 300 000 m3, cet écroulement est bien plus petit que celui du Cengalo en 2017 (3,1 mio m3)2, mais il a marqué les esprits car cette face, très élancée, est bien visible depuis la vallée. De plus, ce pilier, de par son histoire, constituait un véritable monument du patrimoine alpinistique3.
Mais aujourd’hui, la montagne de référence est l’Aiguille du Tacul (3444 m), qui domine la Mer de Glace, à la confluence des glaciers de Leschaux et du Géant. La zone est très fracturée et la répétition d’étés caniculaires a fortement dégradé le permafrost qui assurait la présence de glace dans les fissures et donc la stabilité du tout. Un écroulement d’un volume de plusieurs dizaines de milliers de m3 s’y est produit en deux phases en août 2015; la niche d’arrachement est encore bien visible. Les événements de plus petite taille y sont très fréquents dès que l’isotherme 0° C grimpe en altitude.
Quelle est l’influence de cette crise érosive sur les infrastructures situées en haute altitude?
En raison de l’accélération du réchauffement climatique, la construction en contexte de permafrost devient un grand défi. On ne peut plus construire aujourd’hui comme on le faisait dans les années 1970 à 1990. Tant les constructeurs que les gestionnaires en ont pris conscience. Construire sur le permafrost nécessite des études préalables sur l’ensemble de la cryosphère4 et d’en croiser les données avec la géologie propre à un lieu. Si l’on prend le massif du Mont-Blanc, le granite qui le constitue a plus de 300 millions d’années. Il a vécu de nombreux événements géologiques et géomorphologiques qui l’ont fracturé. Le contexte de base est donc déjà favorable aux déstabilisations. Un épisode de forte pluie ou une canicule, encore aidés par la décompression post-glaciaire, feront s’écrouler le château de cartes caractérisant certaines faces. Mais le temps de réponse peut se compter en jours, en semaines ou même en mois, le temps que le dégel se fasse en profondeur, si bien que de gros événements peuvent se produire encore jusqu’en début d’hiver. Si l’on arrive relativement bien à cerner les contextes topographique (orientation et altitude) et géologique favorables aux déstabilisations, prédire où et quand quel volume de roche sera déstabilisé demeure très difficile.
Les Alpes françaises comptent 947 éléments d’infrastructure, principalement des gares et des pylônes, construits en contexte de permafrost. Pour chacun d’entre eux, on a construit un indice de risque. Certains sont surveillés de près car situés dans des endroits très favorables aux déstabilisations. L’infrastructure la plus à risque est la gare supérieure du téléphérique des Grands Montets (3295 m), à 4 km au nord-est du Montenvers, en arrêt depuis un incendie en 2018, et dont la reconstruction a débuté à l’été 2023. Construire durablement dans ce secteur qui est extrêmement fracturé et autour duquel les glaciers se retirent avec un permafrost qui disparaît constitue un gros challenge: comment en garantir la stabilité durant 30 à 40 ans alors que le réchauffement et ses conséquences s’accélèrent?
Quelles sont les techniques utilisées actuellement pour construire sur le permafrost?
Dans le cas des Grands Montets, il a fallu décaisser la roche sur une profondeur de 25 à 30 mètres pour enlever la partie la plus fracturée. C’est également dans cette couche que se trouve la majeure partie de la glace du permafrost. Le soubassement rocheux va continuer à se réchauffer, mais cet assainissement l’aura rendu plus stable.
Une autre solution consiste à construire sur pilotis afin de favoriser les circulations d’air qui vont entraîner un refroidissement sous les bâtiments. Il est indispensable de dissocier l’infrastructure de la roche de manière à éviter que le bâtiment ne réchauffe le permafrost, ce qui peut se passer, par exemple, lors de la prise du béton, qui va relarguer de la chaleur. Dans le même ordre d’idée, il faut isoler les bâtiments pour éviter la conduction de chaleur dans la roche.
La gestion des eaux est tout aussi fondamentale. Il est nécessaire de les évacuer le plus possible des infrastructures et des zones sensibles. Le permafrost se dégrade tout d’abord par conduction de chaleur depuis la surface, causant l’approfondissement de la couche active. Mais l’advection de chaleur par l’air et par l’eau circulant dans les fractures de la roche est un phénomène plus insidieux, qui peut conduire à la formation de couloirs de dégel menant à une dégradation beaucoup plus profonde. L’écroulement des Drus s’explique d’ailleurs bien mieux par l’advection de chaleur le long des grandes fractures qui délimitaient l’arrière du pilier que par conduction depuis la surface. Durant le mois de juin 2005, il a beaucoup plu, et très haut en altitude, du fait de températures élevées.
Qu’en est-il plus spécifiquement des refuges de montagne?
En ce moment, les bivouacs suscitent beaucoup d’inquiétude. Dans les Alpes, ils ont tendance à tomber les uns après les autres, cinq ou six ont disparu ces dernières années. Cela a commencé en 2019 avec le bivouac des Périades (3421 m). Des cristalliers avaient observé un basculement de l’abri. L’ancienne structure, un objet à très forte valeur patrimoniale, a été héliportée dans la vallée de Chamonix; une nouvelle a été posée une vingtaine de mètres plus loin, sur un éperon plus solide que le tas de cailloux cimenté par la glace du permafrost de l’emplacement original. L’histoire s’est répétée en 2022 au bivouac Alberico-Borgna (3675 m), toujours dans le massif du Mont-Blanc. Des alpinistes y ont passé une très mauvaise nuit en juillet: le bâtiment craquait, il y avait des trous dans le sol. Un mois plus tard, les débris du bivouac jonchaient le glacier de la Brenva, plusieurs centaines de mètres en contrebas. Le problème tient au fait que ces structures ont été construites il y a assez longtemps, avec des températures nettement plus fraîches. Aujourd’hui, on réfléchirait autrement avant d’y construire un plus gros bâtiment.
Mais cette problématique concerne également les plus gros refuges, comme celui des Cosmiques (3613 m)5. Le 22 août 1998, alors que j’y travaillais en tant qu’aide-gardien, nous avons senti le bâtiment bouger en fin de journée. Nous avons pensé qu’une grosse avalanche de glace sur le glacier des Bossons en était la cause. Mais le lendemain, nous avons découvert qu’un écroulement de 600 m3 avait emporté une partie de la structure métallique soutenant le bâtiment. Il a évidemment été évacué immédiatement et n’a rouvert qu’un an plus tard, après de lourds travaux. Une centaine de clous ont été nécessaires à la stabilisation de son soubassement rocheux. Mais l’évolution n’est pas très bonne. Le bâtiment est posé sur une crête. Le permafrost, encore présent il y a 20 à 30 ans, a disparu en face sud, mais pas en face nord. Cela génère des contraintes, encore renforcées par le retrait du glacier du Géant. Cette combinaison entre fonte du permafrost et décompression post-glaciaire est très problématique.
Actuellement, dans le massif du Mont-Blanc, un refuge m’inquiète beaucoup : les Grands Mulets (3051 m), situé plus bas en altitude, près de la limite inférieure du permafrost. Les deux glaciers qui entourent l’arête des Grands Mulets ont beaucoup perdu en épaisseur ces deux dernières décennies. On constate déjà des blocs qui bougent et des fissures qui s’ouvrent autour du refuge, mais il n’y a pas encore de dommage sur le bâtiment.
L’accès au sommet du mont Blanc devient difficile: cette année, c’est du côté des Aiguilles Grises, sur la voie normale italienne, et du col Infranchissable qu’ont eu lieu les plus gros écroulements.
Pour rester sur l’accès au mont Blanc, qu’en est-il du refuge du Goûter?
Le refuge du Goûter (3817 m) est connu pour les chutes de pierres qui menacent son accès et en font un endroit très accidentogène. Le refuge lui-même repose sur une zone certes très fracturée mais peu favorable aux déstabilisations majeures. Au niveau du permafrost, sa construction sur pilotis améliore sa durabilité. Les concepteurs ont en quelque sorte anticipé la fonte du permafrost en installant ces pieux jusqu’à 16 m de profondeur, dont 5 correspondaient à une marge de sécurité envisagée de quelques dizaines d’années vis-à-vis de la dégradation du permafrost. Mais l’accélération du phénomène, depuis la construction du refuge en 2012-2013, a grignoté cette marge beaucoup plus vite qu’escompté.
Quelle est actuellement la zone la plus critique, sachant que la moitié des refuges du massif du Mont-Blanc est située au-dessus de 2900 m d’altitude?
On peut tout d’abord distinguer trois types de risques: un risque direct, in situ, de déstabilisation pour les bâtiments; un risque d’atteinte, par le haut, par des éboulements et des écroulements; et, enfin, un risque d’événements en cascade, où un écroulement peut déclencher à sa suite une avalanche, comme celle de la Brenva à Courmayeur (I) en 1997, ou une lave torrentielle, comme au Cengalo en 2017 ou au Fluchthorn (CH/Ö) en 2023, qui peuvent faire des dégâts très bas dans les vallées. À 2900 m, la situation est relativement sûre en ce qui concerne le permafrost, car il a déjà disparu. Restent les risques qui viennent de plus haut et qui dépendent essentiellement de l’emplacement du bâtiment.
Au-delà de 3000-3200 m, le permafrost situé sous les fondations constituera un sérieux problème jusqu’à l’atteinte d’un nouvel état d’équilibre, avec une nouvelle limite du permafrost qui se situera au-dessus de 4000 m en 2100. Pour l’essentiel des massifs situés entre 3000 et 4000 m, les prochaines décennies seront celles de la matérialisation et du paroxysme de la crise érosive, qui devrait ensuite décroître sur la fin du siècle. Le nouvel équilibre sera atteint une fois que les terrains devant se déstabiliser l’auront été.
On peut faire le parallèle avec le massif des Aiguilles Rouges voisin, ou encore les Pyrénées, où l’on ne retrouve quasi plus de permafrost en raison de leur plus faible altitude, et où les déstabilisations ont eu lieu à d’autres moments de l’Holocène, comme l’Optimum climatique du Moyen-Âge. En étudiant ces massifs et leur comportement lors de ces anciennes périodes chaudes, on peut avoir une idée de ce qui nous attend. Mais une différence majeure demeure: le réchauffement y a été beaucoup plus lent que ce que l’on observe actuellement dans les Alpes, d’où cette notion de crise.
À la question du permafrost s’ajoute aussi celle de l’évolution des masses glaciaires. Sous le sommet de l’Aiguille du Midi se trouve un glacier froid dont l’ablation, par définition, ne devrait se faire que par déstabilisation de séracs. En 2022, l’été de tous les records, un véritable torrent le dévalait, je n’avais encore jamais vu quelque chose de pareil. On en vient donc presque à devoir modifier les définitions fondamentales de la glaciologie! C’est d’autant plus inquiétant que la perte d’englacement et le ruissellement concourent à la dégradation du permafrost.
Chamonix et sa vallée sont indissociables de l’alpinisme. Quel est l’impact de l’évolution climatique sur sa pratique?
Les alpinistes ont l’habitude de s’adapter aux conditions du moment. On voit donc toute une série de modalités d’adaptation. La plus efficace est un changement de saisonnalité. L’alpinisme, qu’on pratiquait traditionnellement au cœur de l’été dans les années 1970 à 1990, se fait maintenant davantage au printemps, voire même en hiver, la saison devenant de moins en moins rigoureuse. Le métier de guide change aussi, avec des cordées moins nombreuses, une modification des itinéraires, des techniques de progression qui évoluent. Les guides sont également plus mobiles à l’échelle des Alpes, ou élargissent leur offre avec du canyoning ou de la via ferrata, des activités qui se pratiquent à plus basse altitude. Ces modalités d’adaptation sont efficaces aujourd’hui, mais qu’en sera-t-il dans 15 à 20 ans?
Quel est l’impact de ces changements sur la fréquentation des refuges?
Les refuges et leurs gardiens s’adaptent à ce décalage saisonnier, mais la fréquentation est difficile à évaluer, car, à part pour le Club Alpin Suisse, on dispose de peu de données avant l’an 2000. D’après une récente étude6 menée dans les Alpes valaisannes, on observerait une légère décroissance des nuitées, mais une croissance des visites à la journée, synonyme d’une évolution du type de visiteurs, de l’alpiniste vers le randonneur. A contrario, l’évolution du milieu péjore l’accès à de nombreux refuges, ce qui tend à les réserver aux alpinistes pour des questions de technique. Le maintien de l’accès aux cinq refuges de la Mer de Glace (Charpoua, Couvercle, Leschaux, Requin et Envers des Aiguilles) a ainsi nécessité la pose de pas moins de 800 m d’échelles depuis les années 1990 pour pallier la baisse du niveau du glacier7!
Notes
1 Période climatique froide principalement localisée sur l’Atlantique nord ayant approximativement eu lieu entre le début du 14e siècle et la fin du 19e siècle.
2 Philippe Morel, «Quand les montagnes s’effritent», TRACÉS 18/2017
3 Du 17 au 22 août 1955, le célèbre alpiniste italien Walter Bonatti ouvrit en solitaire un itinéraire majeur sur le pilier sud-ouest des Drus. Une réalisation magistrale qui marqua l’histoire de l’alpinisme. Walter Bonatti, À mes montagnes, Arthaud, 1962
4 On entend par cryosphère l’ensemble des constituants du système terrestre composés d’eau à l’état solide, notamment les glaces de mer, de lac et de rivière, les sols enneigés, les précipitations solides, les glaciers, les calottes glaciaires, les inlandsis et les sols gelés de façon permanente ou saisonnière.
5 Ce refuge a été construit dans les années 1930 pour étudier le rayonnement cosmique en altitude. Il a été géré jusqu’aux années 1990 par le CNRS.
6 Jacques Mourey, Christophe Clivaz et Philippe Bourdeau, «Analyser l’évolution des pratiques sportives en montagne peu aménagée à partir des données de fréquentation des cabanes. Applications aux Alpes valaisannes», Journal of Alpine Research/Revue de géographie alpine 111-1, 2023
7 Jacques Mourey and Ludovic Ravanel, «Evolution of Access Routes to High Mountain Refuges of the Mer de Glace Basin (Mont Blanc Massif, France). An Example of Adapting to Climate Change Effects in the Alpine High Mountains», Journal of Alpine Research/Revue de géographie alpine 105-4, 2017
À propos
Ludovic Ravanel est directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire Environnement et dynamique des territoires de montagne (EDYTEM) de l’Université Savoie – Mont Blanc, à Chambéry (F). Glaciologue et géomorphologue, il s’intéresse à l’évolution des reliefs terrestres, et en particulier à la déstabilisation des terrains situés au-dessus de 2000 m d’altitude. Son parcours de chercheur l’a, entre autres, mené à travailler dans les Universités de Lausanne et de Zurich ainsi qu’à l’ETH Zurich.Descendant d’une très longue lignée de guides de haute montagne, Ludovic Ravanel est lui-même membre de la Compagnie des Guides de Chamonix. Durant les étés 2000 à 2004, il a été le gardien du refuge de la Charpoua (2841 m), où il a vécu la canicule de 2003 et ses effets sur l’environnement alpin. Aujourd’hui, il ne fréquente la haute montagne presque plus que pour la recherche. Mais son passé d’alpiniste est un atout précieux quand il s’agit, par exemple, d’effectuer le carottage d’un tablier de glace dans la face nord des Grandes Jorasses, pour y prélever un échantillon de l’une des plus vieilles glaces des Alpes – 8000 à 10 000 ans –, avant qu’elles ne disparaissent définitivement.
-
Une lassitude mentale
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/06/2025
- 0 commentaire
J'ai eu un échange aujourd'hui, avec une personne que j'estime, Grégory Derville, professeur en université, adepte du jardin nourricier, passionné de musique, quelqu'un qui écrit des chroniques que je lis avec grand intérêt. On a parlé de la "lassitude mentale", celle que j'éprouve également.
Quand on arrive au stade de la lassitude mentale, je pense, par expérience, qu'il est bon de prendre du recul avant que cette lassitude, au regard de l'aggravation progressive de la situation, ne devienne de la désespérance.
"Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre.” Marc-Aurèle.
Je m'en tiens à ça. Au moment où j'écris, le compteur journalier de mon blog enregistre 1155 visites pour 2495 pages lues. D'où viennent ces gens ? Je n'en sais rien. Pourquoi sont-ils là ? Je n'en sais rien. Est-ce que mes écrits leur apportent quelque chose d'utile ? Je n'en sais rien.
Je partage mes écrits sur mon blog mais c'est aussi un moyen de ne pas perdre ces réflexions, comme une sorte d'archives. J'ai commencé en 2009 alors ça m'intéresse en fait de voir ce à quoi je pensais il y a plusieurs années, ce qui m'occupait l'esprit et si ces pensées ont évolué ou pas. Si des gens lisent, tant mieux, si personne ne lit, tant pis. Je n'y peux rien et à la limite, ça ne me regarde pas.
Je sais que sur Facebook, cet éloignement qui s'est tellement amplifié que je n'y publie plus rien, c'est une attitude que j'ai fini par adopter parce que c'était devenu douloureux de voir des "like" sans qu'aucun échange ne s'engage mais sur ce blog, il n'y a pas non plus beaucoup de commentaires. C'est peut-être représentatif d'un certain comportement "consumériste". On prend et on s'en va....
Oui, il y a de l'amertume dans ce que je viens d'écrire. Au regard de tous ces articles, au regard de mes romans. J'ai souvent posté ici ou sur Facebook des extraits de mes romans, j'avais des "like" mais combien ont acheté ces livres ? Trop cher ? Pas le temps de lire un roman ? Trop fatigué ? Je n'en sais rien mais au final, j'ai bien conscience que tous les "partages" sont quasiment inutiles. Et même ce soir, tous ces gens qui lisent ce blog vont finir par disparaître sans laisser le moindre commentaire parce qu'il y a un captcha et que c'est "saoulant".
On consomme (gratuitement) et on passe à autre chose.
Je n'ai pas écrit une ligne du roman en cours depuis plus de deux mois. Non pas par manque de motivation mais parce qu'un déménagement et un aménagement puis la mise en place d'un jardin-forêt, sur un hectare, ça prend du temps et que ça occupe bien l'esprit et le corps. Par contre, je sais que le jour où je finirai ce tome 4, il est bien possible que je le garde pour moi et les deux tomes précédents. Si les ventes de "Jarwal le lutin" ne dépassent pas quelques centaines, je ne me permettrai plus de proposer un roman à mon éditrice. Point final.
Voilà, je suis dans une lassitude mentale. Alors, je n'écris plus grand-chose.
Gaza est devenue un camp de concentration, la guerre en Ukraine est devenue un murmure lointain, les mega-feux au Canada reprennent de plus belle, les records de température tombent les uns après les autres, l'humanité poursuit sa course folle et je m'efforce d'éviter le courant.
Voilà ce qui sera sans doute le dernier article de Grégory avant un certain temps voire à tout jamais. J'adhère intégralement à ces propos :
"Dernier #punchpost sur cette page.
J'en ai publié beaucoup, et je ne crois pas que ça ait servi à grand chose, à part me défouler et permettre à celles et à ceux qui pensent à peu près comme moi de se défouler à leur tour en likant ou en commentant. Mais est-ce que j'ai joué un rôle d'information ou de sensibilisation, j'en n'en suis pas sûr…
Pendant des années, et même des décennies en fait (eh oui le temps passe), j'ai cru, j'ai voulu croire, que face à l'imminence d'un danger existentiel (la destruction de l'habitabilité de la planète), les humains finiraient par comprendre le caractère intrinsèquement prioritaire de la cause écologiste. Ils finiraient par comprendre, même ceux qui dans un premier temps étaient plongés dans le déni, n'en avaient rien à foutre, ricanaient même des alertes des militant·es écologistes, ils finiraient par comprendre, pensais-je, que sans une planète en état de marche à peu près correct, aucune activité humaine ne peut exister, ni les plus dégueulasses, ni les plus valables et les plus précieuses (plus de musique, plus de cinéma, plus d'école, plus de système de santé…). Je parlais souvent de la façon dont Yves Cochet cite le psychanalyste Lacan en disant que "le réel c'est quand on en prend plein la gueule", et donc que même les puissants et les anti-écolos finiraient par ouvrir les yeux le jour où ils seraient atteints dans leur chair (ou au moins dans leurs investissements…)
Mais depuis quelques années, avec une accélération foudroyante depuis la réélection de Donald Trump, j'y crois de moins en moins.
J'ai d'abord constaté que des gens passaient, presque sans transition, comme des transformistes de génie, de "Mais arrête de nous fatiguer avec ta crise écologique, le climat a toujours changé, on trouvera des solutions comme toujours, on va pas s'arrêter de vivre non plus, faut arrêter de se prendre la tête", à "De toutes façons c'est foutu [à cause des Chinois, des Africains, des zécolos], alors à quoi bon ?" À quoi bon s'empêcher de faire ce qui est écologiquement destructeur et s'obliger à faire ce qui est écologiquement vertueux? Tout ça est so boring… Et forts de cette nouvelle vision des choses, tous ces gens se sentaient donc à l'aise pour continuer à vivre comme avant, sans la moindre réflexion éthique sur l'impact de leur mode de vie sur les fragiles d'aujourd'hui, sur les générations futures et sur le reste du vivant, qui est la victime collatérale du modèle de développement occidental (capitaliste, extractiviste, productiviste, consumériste, colonial…), et que l'Humanité soit-disant "civilisée" détruit beaucoup plus rapidement que pendant les 5 premières extinctions de masse qui ont jalonné l'histoire de la Terre.
Parfois il y avait un semblant de prise de conscience, mais celui-ci s'abîmait bien vite dans les rêves délicieux du développement durable dans sa version dite "faible" – celle dans laquelle on considère que ce qui compte pour que le développement soit durable, c'est uniquement que les générations suivantes puissent créer au moins autant de valeur que les actuelles, et tant pis si c'est au prix du capital naturel, dès lors qu'on peut lui substituer du "capital construit" tout ira bien. Dès lors, pourquoi s'interdire de forer tout le pétrole qu'on peut ("Drill, baby drill"), puisque de toutes façons, si on met lézécolos au silence, on pourra stabiliser le climat grâce à la capture du carbone (spoiler : ça ne marche pas) ou à la géo-ingénierie (spoiler : ça ne va pas marcher). De même, pourquoi freiner le développement économique au nom de la défense des écosystèmes ou de la biodiversité puisque, comme l'a dit Trump avec sa franchise habituelle, c'est "inutile" ?
Mais depuis quelques temps, on voit les écologistes devenir les boucs émissaires de tout ce qui provoque la rage des Dupont-Lajoie. C'est à cause dézécolos que le nucléaire n'est pas assez développé, que Valence a été ravagée par les flots, que les beaux quartiers de Los Angeles ont été ravagés par le feu, que les prix de l'électricité montent, que les rendements agricoles baissent, etc. À croire que tout est de leur faute à ces sales écoterroristes.
Bien évidement, ces affirmations sont totalement fausses et grotesques, sans aucune exception. Ces imbéciles ne connaissent absolument rien au fonctionnement des écosystèmes, aux fragilités de l'agro-business ou à l'énergie, mais ils assènent leurs con.neries de façon de plus en plus péremptoire, au nom du bon sens, du "On ne peut plus rien faire" et du "On ne va quand même pas s'arrêter de vivre". Comme si le business as usual ou le technosolutionnisme n'étaient pas, justement, les deux voies les plus sûres pour que d'ici quelques décennies peut-être, aucun humain ne puisse vivre sur cette planète – en tous cas pas "de façon authentiquement humaine", selon la belle formule du philosophe Hans Jonas.
Depuis six mois, c'est une accumulation de nouvelles désastreuses, épouvantables, cauchemardesques, qui montrent que la fraction dominante de l'Humanité, la plus riche, la plus exploiteuse, fait résolument le choix de la fuite en avant, et tant pis pour les pauvres, tant pis pour les peuples insulaires, tant pis pour les jeunes, tant pis pour les vivants non humains.
D'abord, les nouvelles de la planète sont de plus en plus alarmantes, les records effroyables sont battus sur toutes les frontières planétaires (climat, biodiversité, pollution, cycle de l'eau, etc.)
Sur le plan politique, on a eu en novembre la réélection d'un président des États-Unis ouvertement climato-sceptique, qui a sorti à nouveau les USA de l'accord de Paris, qui dynamite la totalité de la réglementation environnementale américaine au nom de la sacro-sainte croissance économique, et qui est même acharné à détruire la science de l'environnement (et du reste…).
En Europe, le pacte vert européen subit de plus en plus reculs, alors qu'il n'était pourtant pas ambitieux sur le plan écologique (comme toutes les politiques de "croissance verte", il s'apparente en réalité à un plan de sauvetage du capitalisme, vise à faire de la transition énergétique un "relais de croissance", et il est presque entièrement focalisé sur le seul climat).
En France c'est plus feutré, moins assumé, mais les reculs sont dramatiques aussi. Rien que cette semaine, on a eu le vote d'une loi Duplomb qui, entre autres désastres, réintroduit un pesticide néonicotinoïde, on a eu l'assouplissement de l’objectif zéro artificialisation nette (c'est cool hein l'assouplissement, ça fait healthy), on a eu la suppression des ZFE pour des raisons purement démagogiques (avec le soutien de LFI, quelle misère), on a l'annonce de la reprise du chantier de l'A69 alors que ce projet foule aux pieds les engagements climatiques de la France… et la liste pourrait s'allonger interminablement.
Le pire peut-être, c'est qu'on dirait que tout le monde s'en bat les steaks. Lors de son interview sur TF1 le 13 mai, Emmanuel Macron, n’a été questionné sur aucun de ces sujets (!!!) Le monde brûle de plus en plus fort mais les élites politiques et économiques en place continuent à regarder ailleurs, avec acharnement, en appuyant même à fond sur l'accélérateur pour stimuler ce qui va rendre le désastre encore plus imparable (tout le monde ne jure que par l'IA…).
Ce quinquennat devait être écologique", Macron nous l'avait promis la main sur le cœur, mais il s'avère être celui de la destruction du peu de politiques environnementales que des associations, des scientifiques, des politiques et des fonctionnaires engagé·es avaient réussi à construire. Et quand le RN sera aux affaires ce sera bien pire, je n'en doute pas une seconde : la chasse aux "écoterroristes" sera ouverte.
"Don't look up" n'était pas une fiction, c'était un documentaire anticipé sur le suicide d'une espèce censée être sapiens sapiens.
Ce matin j'ai lu l'éditorial de la rubrique "Planète" du Monde dans lequel il est écrit que "les associations, les ONG et les cercles de réflexion spécialisés dans la défense de l’environnement encaissent déconvenue sur déconvenue". Le journaliste Matthieu Goar titre sur "le grand blues des défenseurs du climat et de l’environnement". Déconvenues ? Blues ? Ces mots sont bien trop mollassons. Pour ma part en tous cas, je parlerais plutôt d'écoeurement, d'accablement, de désespoir, de détresse, de rage…
Ce que fait l'administration Trump, ce que fait cette majorité de droite (avec le soutien de plus en plus évident du RN), c'est carrément criminel, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la politique du Rien à foutre : rien à foutre des générations futures, des peuples opprimés, de la nature, de la biodiversité, tous ce qui compte c'est de continuer à vivre selon notre bon plaisir, et après nous le déluge.
Au fond, j'ai toujours pensé, et j'ai souvent écrit, que l'Humanité ira jusqu'au bout du bout du bout du délire, et qu'elle détruira méthodiquement, avec passion, sa seule planète disponible. Je le crois plus que jamais.
Alors je vais peut-être continuer à écrire des punchposts, mais je les réserverai à mon site perso et à mon compte LinkedIn où j'ai ma petite notoriété, et surtout je crois que j'en écrirai moins souvent, puisque pour le coup, "à quoi bon ?" - à quoi bon alerter des gens qui sont déjà alertés, ou des gens qui ne veulent de toutes façons pas entendre ?
De toutes façons, il y a dans l'écosystème médiatique bien assez de gens qui alertent, et très souvent ces gens sont jeunes et extrêmement talentueux : je leur laisse le champ libre.
Pour ma part j'ai plus envie de me concentrer sur un type d'action pour lequel ça ne se bouscule pas trop au portillon : essayer de bâtir des alternatives, sans illusion, mais avec bonne volonté. Ce matin j'ai passé quatre heures dans mon jardin à arroser, à semer des haricots et des courges, à récolter… J'y ai vu un lézard vert qui se faufilait jusqu'à des framboisiers pour s'y cacher. J'ai été soulagé, car je craignais ces derniers temps que la couleuvre verte et jaune les ait mangés. Et j'ai même eu, malgré ma claire conscience de l'effondrement vers lequel nous fonçons, un petit moment fugace de joie et de fierté.
La vie a Duplomb dans l'aile, mais elle n'est pas encore morte. Je vais tâcher de continuer à la défendre sur le petit morceau de terre dont j'ai la responsabilité."
-
Continuer, malgré tout.
- Par Thierry LEDRU
- Le 22/05/2025
- 0 commentaire
Et malgré tout, je cours toujours.
20 km, 800 mètres de dénivelée.
En mode exploration du nouveau secteur. Des gorges aux plateaux, alternance de montées et de descentes, parfois, on sort la carte pour identifier le bon sentier, parfois on se perd, on marche, on court, on s'arrête et on contemple et toujours, toujours, à un moment survient ce moment surpuissant du bonheur d'être en vie. On n'arrête pas le sport parce qu'on devient vieux ou que quelque chose fonctionne moins bien, sinon là, immanquablement, on va vers le pire. Partir, même si le dos est raide, même si parfois, les mollets vont durcir jusqu'à la crampe. Remplir l'existence du goût de la vie pour ne pas qu'elle périsse. Ne pas laisser la vieillesse prendre le dessus, ne pas s'offrir en pâture, ne pas abandonner, rester debout et courir.



-
Discopathie dégénérative
- Par Thierry LEDRU
- Le 19/05/2025
- 0 commentaire

Voilà une photo de la sténose en bas de mon dos. L'excroissance n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut imaginer qu'à l'intérieur, c'est bien pire.
Je me suis inscrit à un groupe de discussions sur les discopathies dégénératives et je suis effaré, sidéré et profondément touché par le nombre conséquent de personnes qui viennent témoigner de leur calvaire. Tous les jours, de nouvelles personnes viennent témoigner...Tous les jours, deux, trois, quatre, cinq personnes, pour un problème qui vient de survenir ou pour un problème qui dure depuis longtemps ou pour une reprise de problème après une accalmie etc … Les situations varient d’une personne à l’autre mais ce qui reste identique, c’est la détresse.
Et ce qui me terrifie encore plus, c’est de voir l’âge de certaines victimes. Avoir des problèmes de dos à 60 ans, je veux bien l’admettre mais des jeunes de 20 ans qui se retrouvent dans des situations terriblement douloureuses et pour lesquels la chirurgie reste parfois sans autre solution que de se lancer dans des opérations très, très lourdes, aux conséquences incertaines, c’est déprimant et ça m’interpelle considérablement.
Je suis sur ce groupe depuis quelques semaines et certains témoignages sont vraiment dramatiques. J'en arrive à avoir une sensation d'oppression à les lire. Comme un ancien soldat qui écoute le récit des frères de combats...
Je sais ce que ces gens endurent. Même si chaque cas est différent, la douleur, elle, est commune et terriblement destructrice.
Je me suis inscrit sur ce groupe pour voir si d’autres personnes partageaient ce que je vis et comment ils géraient la situation et je réalise combien mon cas est « miraculeux » au regard de l’état de mon dos.
Depuis un mois et demi qu’on est sur le nouveau terrain, on travaille tous les jours. Le potager est en place avec sa pergola, une vingtaine de pieux plantés à quarante centimètres de profondeur, toutes les pannes et les tasseaux fixés, une quarantaine d’arbres plantés, des brouettes et des brouettes de pierres sorties du sol, deux stères de bois tronçonnées, fendues et rangées, etc etc.
Samedi, vingt km de trail, 700 m de dénivelée et dimanche 30 km de vélo 800 m de dénivelée, aujourd’hui, mise en place de citernes de récupération d’eau de pluie etc...Des parpaings, des dalles au sol, la pioche, la barre à mine pour sortir des pierres que je soulève et pose dans la brouette.
On n’arrête pas et c’est que du bonheur.
Alors que, pour la médecine, je devrais juste pouvoir marcher péniblement et surtout, surtout, ne faire aucun effort soutenu.
Je sais d’où je viens, je sais le « travail intérieur » que j’ai mené, l’attention que je porte à mon corps, son entretien, l’amour infini que j’ai pour lui.
Alors, je témoigne sur ce groupe, avec empathie, compassion, solidarité envers toutes ces personnes qui n’entrevoient plus du tout la sortie du tunnel. Je sais combien la noirceur de l'instant est celle d'un tombeau quand on n'a plus la force de se projeter au-delà, quand la douleur est si cruelle qu'on voudrait mourir pour qu'elle meure elle aussi.
Alors, je raconte un peu où j'en suis.
Il ne s’agit pas de me mettre en avant. Juste de dire que si ce « mal » est venu, il est possible aussi qu’il s’en aille.
Le nombre de personnes qui se plaignent du milieu médical est effrayant. Des gens qui ne sont pas écoutés, dont les propos sont niés, dont l’état de douleur n’est pas reconnu, des gens qui sont juste considérés comme des « cas à traiter » mais qui ne rencontrent plus l’humanité dont ils ont absolument besoin. Les difficultés pour avoir un rendez-vous, les attentes interminables, les avis contradictoires entre les rhumato, les neuro, les chirurgiens, l'incompréhension et le désarroi qui en résulte, des boîtes de médicaments aux effets secondaires redoutables, les nuits de calvaire...
Je suis consterné également par le nombre de gens qui ont été opérés une fois, deux fois, trois fois et dont les pathologies se répètent, de vertèbre en vertèbre, avec d’autres pathologies qui viennent s’ajouter, toutes plus invalidantes les unes que les autres.
Et là , je m’interroge et je reviens à mon histoire.
Je sais que j’aurais eu besoin d’une aide psychologique quand j’ai été opéré la première fois. J’avais 24 ans. Et je l’ai vécu comme une dévastation. J’aurais eu besoin qu’on m’explique que la douleur est inscrite dans les fibres, pas uniquement dans la mémoire cérébrale mais dans tout le corps et qu’il est absolument nécessaire, vital, d’entamer un travail spirituel pour se libérer de ce fardeau car sinon, à la moindre contraction, l’apparition d’une douleur, aussi infime soit-elle, c’est tout le mécanisme qui se réactive, toute la machinerie émotionnelle, mémorielle, la peur. Et la peur favorise la contraction, la contraction amplifie la douleur qui s’est réveillée. L’individu se donne au mal, comme une victime consentante. La pensée mortifère est un poison.
La méditation, la respiration consciente, les étirements, les massages, la marche, la nature, il faut ériger les défenses, s’accrocher au bonheur comme à une bouée, ne pas sombrer.
Le travail est long, fastidieux, acharné. Il m’aura fallu quarante ans pour apprendre à vivre sereinement avec ce dos détruit. Quarante ans pour identifier clairement les raisons de ce désastre, la folie de ma jeunesse, le sport comme une rage de vivre, des milliers d'heures à courir, à pédaler, à grimper sur les sommets, à courir dans les descentes avec le sac à dos, la corde, tout le matériel d'escalade, parfois des réveils difficiles, mal au dos et j'y retournais, comme un furieux. Oui, j'étais furieux, j'avais mes raisons. Au-delà de la raison. Je vidais ma rage en usant de mon corps et je l'ai usé. La rage, c'était d'avoir été confronté à la mort par personne interposée et d'en avoir retiré un goût immodéré pour la vie, la vie qu'on étreint, la vie comme une lutte, une succession de défis. Mon corps était un outil et par manque de lucidité, j'étais incapable d'indentifier les raisons de cette colère. Je portais un fardeau. Celui de mon histoire et celle de mon frère et un jour, le sac émotionnel s'est révélé beaucoup trop lourd.
Je pense que les gens sur ce groupe de discussions gagneraient à être accompagnées, spirituellement. Qu'il s'agisse d'un psychologue, d'un sophrologue, d'un enseignant en méditation de pleine conscience. Il faut chercher en soi. Il y a peut-être une explication. Les chirurgiens ne le feront pas. Ils ne s'intéressent pas aux tourments de l'âme. J'aimerais dire à tous ces gens que la médecine peut les aider mais qu'elle ne cherchera jamais les raisons profondes, les raisons spirituelles et qu'elle ne les aidera pas non plus à vivre "l'après", non pas la rééducation physique mais la rééducation spirituelle.
Croire qu'on peut oublier le mal, c'est comme continuer à l'arroser alors qu'il faut aller le déterrer et le broyer et le mettre au compost. Car de ce mal décortiqué naîtra la paix.
Je ne pouvais pas mettre de côté mon âme. Elle était en souffrance. Et mon corps en a payé le prix.
Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même.
Je sais malgré tout que l’évolution ne peut pas m’être favorable. Le mécanisme est enclenché et les rouages sont trop abîmés. Irrémédiablement, je vais vers des jours compliqués. Je porte en moi un mal patient qui progresse. Mais je peux retarder son invasion.
Mon mollet gauche s’atrophie, certaines nuits il se bloque, une crampe qui peut survenir dans le sommeil le plus profond, c’est un réveil brutal, je dois me lever, étirer le muscle puis ensuite le masser. La sténose ronge les terminaisons nerveuses. C’est ainsi que je l’imagine. Le mollet droit a pris le même chemin depuis quelques mois.
Mais j’arrive toujours à courir, à marcher, à pédaler, à travailler sur le terrain, à planter des arbres et à les regarder pousser. Et c’est ce qui me sauve.
Être dehors pour être en moi.
-
Inviter les oiseaux
- Par Thierry LEDRU
- Le 14/05/2025
- 0 commentaire
« Créons partout des jardins refuges pour les oiseaux ! »

Planter des haies variées, débitumer les sols... L’ornithologue Daniel Gérard nous guide pour renaturer nos jardins, tout en les embellissant, et ainsi attirer les oiseaux.
Daniel Gérard est enseignant en aménagement paysager à l’Eplefpa Naturapolis (Indre), membre actif de l’association Les Arbusticulteurs et ornithologue de terrain et guide ornithologique au parc naturel régional de la Brenne. Créer un beau jardin-refuge pour les oiseaux (éd. Ulmer) est son premier livre publié.
Reporterre — Dans la préface à votre livre, un chiffre retient l’attention : en France, la superficie globale des jardins particuliers représenterait 2 % de la surface totale du pays, soit le quadruple de la surface des réserves naturelles. Faire de son jardin un refuge pour les oiseaux est donc loin d’être anecdotique ?
Daniel Gérard — Absolument, c’est conséquent. Chaque espace végétalisé, même de faible surface, revêt une importance bien plus grande qu’on ne l’imagine pour les oiseaux, qui fuient de plus en plus la ville, sa pollution, ses canicules et pénuries alimentaires, pour la campagne et ses jardins.
Il est donc de notre responsabilité de prendre conscience du rôle que nous pouvons jouer pour aider la « biodiversité ordinaire » à survivre, de l’adoption de quelques gestes simples au réaménagement de l’ensemble des espaces végétalisés et du jardin.

Un étourneau sansonnet prend un bain, soucieux de conserver son plumage en bon état (abîmé, il pourrait entraver sa capacité à fuir). © Didier Plouchard
J’ai récemment aperçu un chardonneret qui avait les deux pattes si abîmées, déformées même, qu’il avait du mal à se tenir debout. Un handicap typique des pathologies qui se transmettent sur des mangeoires ou abreuvoirs trop peu nettoyés. C’est un exemple parmi d’autres — la pollution lumineuse la nuit, l’absence de « baignoires » à l’abri des prédateurs… —, mais il est révélateur : si seulement certains jardiniers amateurs revoyaient une partie de leurs pratiques, ce serait déjà un effort considérable en faveur des oiseaux.
Comment s’est déclenchée chez vous l’envie de revoir vos pratiques de jardinier pour accueillir davantage d’oiseaux dans votre jardin ?
J’ai toujours beaucoup aimé les oiseaux — leur liberté, la subtilité de leurs chants, leurs fascinantes capacités d’adaptation — et n’ai pas cessé de les observer depuis l’enfance, jusqu’à me former à l’ornithologie, et devenir guide et formateur au parc naturel régional de la Brenne.
Lorsque j’ai réalisé qu’ils étaient menacés par les atteintes humaines à leurs milieux de vie (un cinquième d’entre eux auraient disparu en trente ans en Europe, soit 420 millions !), j’ai décidé de réfléchir à mes pratiques jardinières pour inverser, à mon petit niveau, le déclin de leurs populations.
Quelles pratiques sont-elles à repenser ?
Des pratiques nocives, ancrées dans une culture de domination du vivant : de l’usage de la bouillie bordelaise contre le mildiou à la taille au taille-haie des massifs et arbustes. Dans les deux cas, on choisit une solution prétendument rapide et efficace, mais qui va entamer, pour la première, la richesse des sols en détruisant les champignons ; pour la seconde, limiter l’abondance de fleurs, de fruits, de baies appréciées des oiseaux.
La taille dite raisonnée, au sécateur, serait pourtant plus respectueuse du végétal et plus écologique, en réduisant les déchets verts, l’utilisation d’hydrocarbures… voire la fatigue du jardinier.
« Tant pis si votre voisin s’offusque de votre part de gazon transformée en prairie fleurie »
Il faudrait aussi accepter de remettre en question nos projections esthétiques issues du classicisme, avec sa recherche de régularité, d’uniformité, sa chasse aux herbes sauvages, etc., pour faire une place aux besoins fondamentaux des oiseaux (et du vivant en général), qui sont très variés.
Prenons la nidification : le pouillot véloce, par exemple, chante dans la canopée, mais niche très près du sol, quand le bouvreuil pivoine ou le gobemouche gris ont besoin d’une végétation arbustive plus dense. Et cette diversité devrait être prise en compte pour l’ensemble de leurs besoins physiologiques : faire un nid pour se reproduire, mais aussi s’alimenter, boire, se laver, trouver de la quiétude, de l’obscurité la nuit…

Le troglodyte mignon parcourt sans relâche les tas de bois en quête de nourriture. Il y trouve aussi la mousse nécessaire à la confection de son nid. © Daniel Gérard
Un jardin riche en biodiversité sera donc un jardin avec beaucoup de « diversité » : diversité de hauteurs, de densités, de périodes de floraison et de fructification des végétaux, arbres, haies, etc.
Y compris en ce qui concerne la flore, même spontanée, et la faune, depuis les minuscules collemboles de la litière jusqu’aux petits insectivores comme le hérisson d’Europe. Car vous ne pourrez favoriser l’installation des oiseaux dans votre jardin que si vous l’appréhendez comme un ensemble dynamique : quelques passages à faune, en bas des clôtures par exemple, et des parcelles d’herbe non tondue sont donc fortement conseillés.
Pour développer votre jardin dans cet esprit, il vous faudra aussi vous détourner un peu du désir de « propre et sans entretien », comme on l’entend souvent formulé dans les jardineries.
N’est-il pas légitime de désirer peu d’entretien quand le temps est compté ?
Si, mais cela peut nous aveugler. Dans ma jeunesse, j’ai bêché avec mon père, qui était jardinier, autour des massifs arbustifs : l’idée était alors d’en faire un massif « propre », bien bêché au pied. Cette culture du « sol propre » n’a pas disparu : elle a juste été supplantée par la mode des couvre-sols organiques (écorces de pin, copeaux de bois…) et des paillages minéraux (comme les paillettes d’ardoise), censés être aussi « sans entretien ».

Des strates végétales nombreuses permettent d’accueillir des oiseaux aux niches écologiques variées. © Anne Jamati
Mais c’est une illusion. La nature ayant horreur du vide, elle colonisera d’elle-même avec le temps les interstices laissés vacants entre les paillettes d’ardoise, et avec des espèces pas forcément souhaitables, comme le bouleau (allergène) ou l’arbre à papillon (invasif). Pour éviter le désherbage, il suffirait pourtant de garnir le pourtour des arbres et des massifs de plantes couvre-sols, herbacées (lamier, nivéole d’été, etc.) ou arbustives (chèvrefeuillle cupule, millepertuis à grandes fleurs, etc.).
Elles favoriseraient en même temps l’infiltration de l’eau et abriteraient toute une faune appréciée des oiseaux nichant près du sol. Et celui-ci n’en serait pas moins « propre et sans entretien », juste plus vivant.
Plantation de haies variées, d’arbustes « cultivars », de plantes grimpantes herbacées, débitumage des sols… Par quoi commencer ?
La première chose à faire, c’est le diagnostic : où est-ce que j’en suis avec mon jardin ? Est-ce que je lui trouve une valeur écologique satisfaisante ? Si non, que puis-je changer ? Pour le renaturer, avec quel aménagement puis-je remplacer cette dalle en béton, par exemple, pour laisser passer l’eau ?
Les branches que j’avais l’habitude d’évacuer, pourquoi ne pas les accumuler là-bas, dans un coin, pour accueillir des troglodytes ? Et si je rajoutais quelques plantes mellifères, pour le bonheur des abeilles et des guêpiers d’Europe, qui les aiment tant ?

Dans son livre, Daniel Gérard décrit 48 oiseaux susceptibles d’être observés dans les jardins du nord de la France, sur le modèle de ce tarin des aulnes. © Éditions Ulmer
Le mieux sera de travailler par secteur, en douceur. De définir des zones de modification et d’aller vers leur « gestion différenciée » : près de la terrasse, mon intervention pourra être plus importante pour dégager la vue, mais, un peu plus loin, pourquoi ne pas se permettre de l’herbe un peu plus haute, qui attirera la linotte mélodieuse et la grive musicienne ?
Pour faire un jardin écologique, faut-il mettre de côté ses goûts esthétiques ?
Pas du tout. On peut réfléchir ses choix de végétaux en fonction d’objectifs aussi bien esthétiques qu’écologiques. C’est une idée que je défends. Les 115 plantes répertoriées dans mon livre joignent d’ailleurs à leurs joliesse et parfum des caractéristiques recherchées par les oiseaux (richesse en fruits, baies, insectes, notamment) et ne sont pas trop gourmandes en eau.
Il est aussi important de ne pas faire d’erreurs de casting. Il n’y a rien de pire que de se dire : « Ça me plaît, j’achète ; et si ça grandit trop, je taille ! », puis d’entrer dans une lutte contre la plante parce qu’elle dépasse la hauteur souhaitée. Il existe une gamme de végétaux d’une telle richesse que l’on trouvera forcément une plante qui nous plaît et correspond à nos attentes en termes d’entretien et de taille. Prenez du temps pour lire, interroger des pépiniéristes, vous en gagnerez ensuite.
Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite à se lancer ?
Osez ! Avril-mai, avec toute la vie végétale, biologique qui se remet en mouvement, est la saison idéale pour commencer un diagnostic de son espace vert. Devenez un écocitoyen résolu sans crainte : faites des essais, rien n’est irréversible au jardin !
Donnez-vous aussi du temps pour assister à la lente, mais certaine aggradation de votre espace vert. Quelle joie de sentir ses perceptions du monde vivant alentour s’affiner, et de se sentir davantage relié à lui ! Et tant pis si votre voisin s’offusque, pour un temps, de votre part de gazon transformée en prairie fleurie… Les gazouillis des oiseaux vous le feront vite oublier.

-
Les 50 ans d'un chef d'oeuvre : The Köln concert
- Par Thierry LEDRU
- Le 10/05/2025
- 0 commentaire
Un disque qui a pour moi une importance considérable : LES ÉGARÉS : L'Ange et la mort (12)
Les cinquante ans du Köln Concert : Keith Jarrett à l’opéra
Publié le vendredi 24 janvier 2025 (première diffusion le mardi 24 janvier 2023)
The Köln Concert, un succès colossal. - Oliver Berg/picture alliance via Getty Images
Provenant du podcast MAXXI Classique
Ce n'est ni un opéra, ni un récital lyrique et pourtant il a été enregistré à l'Opéra de Cologne il y a 50 ans, le 24 janvier 1975. Une chronique dans les coulisses du "Köln Concert" de pianiste Keith Jarrett, un disque légendaire.
Sol ré do sol la. Cinq notes. Cinq notes et des sourires. Dans la salle, tout le monde reconnait dans ce motif musical la sonnerie annonçant le début de chaque concert donné à l’Opéra de Cologne. Du parterre aux balcons où il ne reste plus aucune place de libre, personne en revanche ne peut imaginer que ces cinq notes vont être le point de départ d’une improvisation qui durera une soirée entière.
Quand il monte sur la scène de l’opéra, Keith Jarrett n'est pas dans une très grande forme. Cela fait plusieurs jours qu’il enchaîne les concerts et il est épuisé. La veille, il était à Lausanne et il n’a pas dormi depuis vingt-quatre heures. Une fois arrivé à Cologne, après dix heures de route, il découvre que le piano que l’opéra lui a réservé est un vieux Bösendorfer qui n’a pas été révisé depuis très longtemps et qui sonne, selon l’aveu-même de Jarrett « comme un mauvais clavecin ou un piano dans lequel on aurait mis des punaises. »
Il parait que l’art naît de contraintes. Ce qui est sûr, c’est que ces difficultés matérielles et l’état de fatigue dans lequel se trouve Keith Jarrett ont eu des conséquences sur son concert. Parce que ce piano possède des aigus qui ne lui plaisent pas et une sonorité peu intéressante, le pianiste décide de solliciter au maximum le registre grave et médium du piano. Dans cette grande improvisation structurée, il privilégie également un jeu plutôt rythmique, composé de petits motifs et d’accords aérés.
Un jeu épuré donc, parfois à la limite de la musique minimaliste ou d’une chanson sans paroles. Une esthétique qui explique certainement la popularité jamais démentie de cet album. Mais ce n’est pas tout. Quand on entend, les rumeurs du public, Keith Jarrett chanter par-dessus la ligne mélodique du piano et métamorphoser progressivement un thème et son accompagnement hypnotique, on a l’impression d’être dans la salle de concert mais aussi dans la tête du pianiste. On assiste à la naissance d’une œuvre, on effleure du doigt le mystère de la création.
Avec environ quatre millions de ventes à ce jour, le Köln Concert est l’album du label ECM, de Keith Jarret et de piano jazz le plus vendu de tous les temps. Un concert qui a donné lieu à une transcription, une partition écrite et éditée. Mais cet objet ne nous aide pas à percer le mystère du jeu de Jarrett. Aussi précise soit-elle, la partition ne pourra jamais nous aider à comprendre ce qui s’est passé ce soir-là dans la tête de Keith Jarrett. Reste le disque, la photographie la plus fidèle d’une œuvre sans lendemain et immortelle.
-
"Do it" de Jerry Rubin
- Par Thierry LEDRU
- Le 08/05/2025
- 0 commentaire
EAN : 9782020006798
271 pages
Seuil (01/05/1973)3.99/5 42 notes
Résumé :
À travers les luttes de ces dernières années, sur les campus, contre le Pentagone, à Chicago en 1968, Jerry Rubin (jadis jeune Américain sage) est à l'origine de cette synthèse entre le courant hippie et le gauchisme des jeunes révolutionnaires blancs américains : le mouvement "yippie" dont ces pages sont à la fois le Manifeste, l'épopée, le manuel et la bande dessinée.
"Le mythe devient réel quand il offre aux gens une scène sur laquelle ils viennent jouer leurs rêves et leurs désirs... Les gens essayent de réaliser le mythe ; c'est là qu'ils tirent le meilleur d'eux-mêmes.
Invente tes propres slogans. Proteste contre ce que tu voudras. Chacun est son propre yippie.
Notre message, c'est : ne grandissez pas. Grandir, c'est abandonner ses rêves.
Source : Points, SeuilJ’ai lu ce livre quand j’étais jeune et c’était réjouissant.
La rébellion, la contestation, l’engagement, les convictions, des idées fortes mises en actes. J’aurais aimé connaître Woodstock, pour l’ambiance, le partage, la libération, la foi en l’avenir, un monde meilleur.
Rubin n’était pas hippie mais yuppie. Pour moi, la distinction essentielle, c’est que la lutte physique s’alliait aux luttes morales. Rubin était ami avec Eldridge Cleaver, figure incontournable des Black Panters. Attention, ça ne rigolait pas…
J’ai connu une période quelque peu agitée dans ma jeunesse, la contestation contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff. J’ai beaucoup tiré au lance-pierres, des billes de plomb qui faisaient très mal, j’ai beaucoup couru, j’étais au tribunal à Quimper quand les CRS ont chargé dans l’enceinte, c’était violent, vraiment violent.
Les manifestations avec les agriculteurs à la préfecture de Quimper, les manifestations contre les subventions accordées à l’école privée. J’ai pulvérisé la vitre arrière de la voiture d’Alliot-Marie, secrétaire d’état à l’enseignement. Et j’ai couru.
Je n’avais pas peur de la violence, du combat.
Mais un jour, je me suis fait peur. J’ai envoyé à l’hôpital deux « copains » de mon grand frère qui était revenu du royaume des morts. J’étais passé dans leur bistrot pour leur demander de passer voir mon frère. Ils ont rigolé en disant qu’ils préféraient attendre qu’il vienne leur payer un coup. Je les ai défoncés avec un pied de chaise que j’avais d’abord fracassée sur eux.
Là, j’ai réalisé à quel point la rage pouvait me mener au drame. Et j’ai tout arrêté.
Je raconte ça pour expliquer pourquoi je ne participe plus aux luttes communes. Je ne supporte pas la vue des « forces de l’ordre », les megabassines, il ne faut pas que j’y aille, ni dans aucune manifestation de ce type. Et je n’ai rien fait pendant la crise des gilets jaunes.
Maintenant, je reviens à Jerry Rubin. Lui et ses amis n’avaient peur de rien. La marijuana tournait à plein régime et les idées fusaient dans tous les sens mais tout ça avait du sens. C’était l’époque du Vietnam. Les universités représentaient soit la contestation, soit l’adhésion au « rêve américain ». Rubin, Hoffman et d’autres luttaient, physiquement, contre l’enrôlement des jeunes, contre le racisme envers les noirs, contre la société de consommation, contre l’embrigadement des enfants, contre le matérialisme, contre la politique corrompue (époque de Nixon), contre le capitalisme. Ils ont fait de la prison, inculpés pour atteinte à la sécurité de l’état, pour incitation à la révolte. Dans les tribunaux, ils venaient déguisés, portant l’uniforme des soldats de la guerre d’indépendance, ils ont présenté un cochon comme candidat aux élections présidentielles. Ils se couchaient sur les rails de chemin de fer pour arrêter les trains qui convoyaient les jeunes qui devaient partir au Vietnam. Des flics sont morts dans les manifestations, des manifestants sont morts sous les coups des flics. Non, ça ne rigolait pas.
Ça ne rigole toujours pas d’ailleurs chez les cowboys. Encore moins en ce moment.
Ce livre est décousu, d’une qualité d’écriture très faible, avec des informations difficiles à saisir pour un non Américain, une flopée de personnages, des idées qui ne sont pas suffisamment étayées, approfondies. Ils étaient « défoncés » à longueur de journée, Rubin le répète sans cesse. Mais c’est l’époque qui importe, le fond et non la forme, cette contestation puissante qui allait mener à Woodstock. L’histoire des USA, on le sait, se projette toujours bien au-delà de ses frontières.
Aujourd’hui, avec le recul, la relecture de ce livre génère chez moi un profond dépit. Parce que le constat est sans appel : toutes les contestations ont échoué, toutes les révoltes, les révolutions, les tentatives de changement de paradigme, rien n’a abouti. Le capitalisme reste le maître absolu.
Il faut savoir que Jerry Rubin est devenu un chef d’entreprise, un des premiers investisseurs d’Apple et les propos qu’il a tenus alors en paraissent risibles, voire pitoyables au regard de son passé… Il est mort renversé par une voiture. Hoffman est mort d’une overdose. Le parcours de Cleaver mériterait un film hollywoodien. Des retournements de veste d’une ampleur saisissante. A croire que la cocaïne et tous les autres cocktails qu’ils ont ont avalés leur ont cramé les fils.
A lire toutes ces histoires, on se demande ce que signifie le terme d’engagement…
J’en retire là aussi que la lute contre le système, que ça soit une lutte armée ou intellectuelle, c’est dangereux. Vraiment dangereux. Qu’il est risqué de vouloir confronter ses convictions au système. Parce que le système n’est pas humain, il a sa propre inertie, sa propre existence et que les hommes et les femmes qui le maintiennent en état et qui pensent avoir une certaine importance ne sont que des rouages d’une machinerie qui peut les broyer au jour où ils ne sont plus utiles. D’autres hommes ou femmes s’en chargeront. Pour le système.
Rubin s’est fait avoir, Cleaver tout autant, Hoffman a lâché l’affaire dans un dernier trip. Et combien d’autres. Les anciens de Woodstock qui ont fini patron d’un McDo.
Ce livre plaide de nouveau pour le choix que j’ai fait. Me retirer au maximum. Parce que j’ai conscience de la violence dont je suis capable et parce que je ne crois aucunement aux mouvements de masse.
Aucun humain n’arrêtera le système, il se détruira de lui-même par épuisement des ressources, par épuisement de la nature, par le dérèglement général que le système a engendré et entretient. Jusqu’ici, ça va encore, à peu près.
Voyons la suite.
On ne lutte pas contre le système, on en sort. Au mieux, ou au moins pire.
Se souvenir de Nietzsche : "Quand tes yeux plongent dans l'abîme, l'abîme aussi plonge en toi."
-
Une guerre haut perchée.
- Par Thierry LEDRU
- Le 07/05/2025
- 0 commentaire
Au vu de l'actualité entre ces deux pays, il est intéressant de remonter dans l'histoire et je trouve cet article passionnant. Quand il s'agit de démontrer les raisons d'un conflit qui date des années 1990...Dans un cadre rude et magnifique, des hommes s'entretuent. Rien de nouveau. Quand on voit l'importance funeste du traçage des frontières dans un labyrinthe de montagnes et de glaciers, on peut en conclure que les humains parviendront toujours à trouver des prétextes pour la guerre. Pour la paix, c'est plus compliqué.
Reportage au Cachemire, sur le champ de bataille le plus haut du monde
Un minuscule correctif apporté à une carte par un organisme américain a mis l'Inde et le Pakistan sur le pied de guerre, sur le champ de bataille le plus haut du monde, au Cachemire. Mais qui a décidé ce changement ? Et pourquoi ?
De Freddie Wilkinson, National Geographic
Photographies de Cory Richards
Publication 11 mars 2021, 12:20 CET

Des soldats affectés à la 62e brigade de l’armée pakistanaise font une pause au pied des Tours de Trango, au bout du glacier du Baltoro. «C’est un terrain accidenté, explique l’un d’entre eux. Mais nous devons défendre chaque pouce de notre patrie. »
PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards
Le major Abdul Bilal, des services spéciaux de l’armée pakistanaise, se blottit avec son escouade sous un affleurement rocheux, au cœur de la chaîne du Karakorum. Ce 30 avril 1989, en fin d’après-midi, des bourrasques de neige enveloppent les onze hommes, qui portent de vestes de camouflage blanches et des armes automatiques en bandoulière. Ils respirent avec difficulté un air raréfié, à plus de 6 500 m d’altitude.
Le K2, le deuxième point le plus élevé de la Terre, se dresse à 80 km au nord-ouest. Mais la plupart des sommets alentour n’ont jamais été escaladés. Ils ne sont identifiés sur les cartes que par des chiffres indiquant leur hauteur.
Cette montagne-ci s’appelle 22158 – son altitude, en pieds. Pour grimper jusqu’à la position des soldats, il aurait fallu escalader un versant de roches et de glace sujet aux avalanches. Quatre hommes sont morts en s’y essayant.
Mais Abdul Bilal et ses soldats ont été amenés par hélicoptère et déposés à 450 m sous le sommet. Puis, pendant une semaine, ils ont fixé des cordes et reconnu le terrain en surplomb, afin de se préparer à ce moment décisif.
Quelques hommes suggérèrent de s’encorder. « Si vous vous attachez et que l’un de nous est touché, nous allons tous dévisser, répond Bilal. Mettez des crampons, mais pas de cordes. »
Chacun vérifie que les pièces mobiles de son arme n’ont pas gelé. Le vent hurle. Et alors, juste avant le crépuscule, Bilal mène sa petite colonne, qui gravit une crête en direction du sommet.
Soudain, les visages brûlés par le soleil de deux sentinelles indiennes les fixent, du haut d’un mur de neige servant de poste d’observation. Bilal leur crie, en ourdou : « Vous êtes cernés par des soldats de l’armée pakistanaise! Posez vos armes ! »
Les deux Indiens se baissent derrière le mur de neige. « L’armée indienne va vous faire tuer en vous envoyant ici ! », crie encore le major. Il perçoit le cliquetis de kalachnikovs que l’on arme.
C’est Bilal qui raconte l’histoire, trois décennies plus tard, chez lui, à Rawalpindi. « Nous n’étions pas des tueurs aveugles, assure-t-il. Nous voulions simplement protéger notre territoire. Nous étions prêts à le défendre à tout prix. [...] C’était notre devoir patriotique. »
Une chose est sûre : les Indiens ont tiré les premiers. L’escouade de Bilal a riposté. Un Indien est tombé. Les Pakistanais ont cessé le feu.
Bilal a appelé l’autre Indien : « Fiche le camp d’ici. [...] Nous ne te ferons pas prisonnier et nous ne te tirerons pas dans le dos. » Le soldat indien s’est levé. Bilal l’a regardé s’éloigner péniblement, jusqu’à ce que le brouillard l’engloutisse.
La «bataille du pic 22158» est le combat mortel à la plus haute altitude de toute l’histoire.

Les équipes s’assurent avec des cordes pour traverser certains reliefs. Des soldats pakistanais de la 323e brigade sont attachés afin de réduire le risque de disparaître dans un gouffre, lors de la traversée du glacier du Gyong, à 5 300 m d’altitude. Nombre de crevasses portent le nom de soldats morts dans leurs profondeurs.
PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards
Vingt-huit ans après, le photographe Cory Richards et moi nous traînons sur la neige d’un héliport, à 7 km environ de là où l’Indien est mort.
Tous deux alpinistes, nous avons gravi des sommets du Karakorum. Nous savons ce que survivre ici exige d’efforts et de compétences.
Depuis plus de trente ans, l’Inde et le Pakistan envoient là de jeunes soldats, qui restent pendant des mois d’affilée à surveiller une région sauvage, isolée et inhabitée, aux confins de l’Inde, du Pakistan et de la Chine. On appelle cet affrontement le conflit du glacier Siachen.
Les deux camps déplorent des milliers de victimes depuis 1984. Un cessez-le-feu a été conclu en 2003. Mais des dizaines de soldats meurent encore ici chaque année – glissements de terrain, avalanches, accidents d’hélicoptère, mal de l’altitude, embolies... Néanmoins, tous les ans, des soldats indiens et pakistanais se portent volontaires pour servir ici. « C’est considéré comme une grande marque d’honneur », me déclare un responsable pakistanais.
Les multiples écrits sur le conflit soulignent souvent l’absurdité de se battre pour un territoire aussi inutile et décrivent deux ennemis aveuglés par la haine. Ce que Stephen P. Cohen, analyste à la Brookings Institution, résume ainsi : «une dispute entre deux chauves pour un peigne ».
Or les circonstances qui ont mené à ce conflit n’ont jamais été entièrement élucidées. Depuis quatre ans, je consultais des documents déclassifiés, interrogeais des responsables, des universitaires et des militaires en Inde, au Pakistan et aux États-Unis. Cory et moi étions au Pakistan pour constater de nos propres yeux les conséquences pouvant résulter de cet acte a priori simple : tracer une ligne sur une carte.
LE GÉOGRAPHE
Le 27 juin 1968, le courrier diplomatique confidentiel A-1245 a été expédié par avion au Bureau du géographe, une unité peu connue du département d’État américain, à Washington. Il a atterri sur la table de Robert D. Hodgson, le géographe adjoint, âgé de 45 ans.
Signée par le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis à New Delhi, la lettre commençait ainsi : « À diverses occasions [...], le gouvernement indien a protesté officiellement auprès de l’ambassade au sujet des cartes du gouvernement américain qui ont été distribuées en Inde, cartes montrant le statut du Cachemire comme “en litige” ou distinct, en quelque sorte, du reste de l’Inde. » Elle se terminait en demandant conseil quant à la façon de représenter les frontières de l’Inde sur les cartes américaines.
Pour l’Inde et le Pakistan, pays nés de l’effusion de sang qui accompagna la partition de l’Inde britannique, ces cartes étaient une question d’identité nationale. Pour le Bureau du géographe, c’était une question professionnelle.
Le gouvernement américain publiait des milliers de cartes par an. La responsabilité du marquage des frontières politiques internationales incombait au Bureau du géographe. Celui-ci détenait l’autorité ultime pour figurer le tracé des frontières politiques du monde d’après la politique officielle des États-Unis – ce qui influait aussi sur la façon dont les autres pays les voyaient.

Des soldats de l’armée pakistanaise déchargent un hélicoptère Mi-17 au poste administratif du pic Paiju. Les provisions essentielles vont des fûts de kérosène aux barres d’armature de construction et aux œufs frais.
PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards
Les États-Unis reconnaissaient 325 frontières terrestres de pays à pays environ. Les questions cartographiques les plus épineuses revenaient à Hodgson et à ses collègues géographes. Ces casse-tête exigeaient la précision d’un arpenteur et une approche de spécialiste de la recherche.
« Nous ne dessinons pas des lignes à partir de rien, souligne Dave Linthicum, récent retraité, qui a travaillé pendant plus de trente ans comme cartographe pour le Bureau du géographe et la CIA. Nous tentons de retrouver où les limites se situaient en 1870 ou 1910, ou à un autre moment, à l’aide de vieilles cartes, de vieux traités. »
Aujourd’hui, Dave Linthicum et ses confrères consacrent une bonne part de leur travail à scruter des images satellitaires en haute définition. À titre de comparaison, Hodgson avait entamé sa carrière de « récupérateur de cartes » pour le département d’État alors qu’il était stationné en Allemagne, de 1951 à 1957. L’activité impliquait alors de fouiller dans des archives abritant des cartes sur du papier moisi et de vérifier physiquement l’emplacement des villes et des points de repère géographiques à travers le pays. Au début de la guerre froide, une erreur cartographique risquait d’avoir des conséquences cataclysmiques : en cas de conflit, des avions américains pouvaient être envoyés pour bombarder la mauvaise ville, voire le mauvais pays, si une carte présentait une erreur de quelques kilomètres ou si l’on avait donné à un nom de lieu une orthographe légèrement différente.
Linthicum ne sait que trop bien à quel point se tromper est facile. Il y a dix ans, on l’a chargé de tracer la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, qui suit le fleuve San Juan jusqu’à la mer des Caraïbes. Mais la frontière qu’il a tracée longeait un ancien cours au lieu du lit actuel du fleuve, attribuant à tort au Nicaragua une île de quelques kilomètres carrés. Google Maps a adopté le tracé de Linthicum, et le Nicaragua a bientôt envoyé des soldats occuper l’île.
« Parfois, au travail, avec mes collègues, on se demande pourquoi passer autant de temps sur tel petit [segment de frontière], explique Linthicum, et puis, deux semaines plus tard, voilà que cet endroit minuscule se révèle être tout à fait décisif ou extrêmement important. »
Hélas pour Hodgson, l’ensemble de problèmes géopolitiques et frontaliers qui ont atterri sur son bureau par le courrier A-1245 constituait l’un des plus insolubles du monde : le différend sur le Cachemire. Un «cauchemar cartographique», selon l’expression d’un géographe.
Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Britanniques perdirent le contrôle du sous-continent indien, ils décidèrent à la hâte de diviser la région en deux États, fondés sur les deux religions dominantes : l’Inde pour les hindous, le Pakistan pour les musulmans.
Des commissions nommées par le vice-roi britannique, Lord Louis Mountbatten, et composées de représentants des deux partis politiques les plus influents, le Congrès national indien et la Ligue musulmane, furent convoquées pour décider des nouvelles frontières.
Mais la tâche était impossible. Depuis des millénaires, des cultures et des empires s’étaient imbriqués en Asie du Sud, brassant des populations d’hindous, de musulmans et de sikhs.
Le 15 août 1947, à minuit, l’Inde et le Pakistan obtinrent l’indépendance. Des violences éclatèrent tandis que des millions d’habitants, terrifiés, tentaient de franchir les nouvelles frontières pour rejoindre leurs coreligionnaires. Le conflit fut extrêmement sanglant au Pendjab, le cœur agricole du sous-continent. Pas moins de 2 millions de personnes périrent dans ce chaos.

Au champ de tir de Sarfaranga, non loin de Skardu, des soldats pakistanais nettoient leurs fusils G3A3 et mangent des bananes, lors d’un entraînement.
PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards
Au nord du Pendjab, un royaume montagneux, appelé officiellement l’État princier de Jammu-et-Cachemire, fit face à un dilemme particulier. Le Cachemire, en grande majorité musulman, était gouverné par un maharaja hindou. Et il avait le droit de choisir à quel pays il se joindrait.
Plusieurs semaines après l’indépendance, des milices des tribus pachtounes, appuyées par l’armée pakistanaise, commencèrent à se diriger vers le palais du maharaja, à Srinagar, réclamant le rattachement du Cachemire au Pakistan. Pris de panique, le maharaja signa un document d’adhésion à l’Inde. L’Inde mit en place un pont aérien militaire et arrêta les milices. En quelques semaines, les nouveaux pays étaient en guerre.
Une fois l’effervescence retombée, les armées adverses se retrouvèrent face à face, le long d’une ligne de cessez-le-feu vallonnée serpentant au milieu du Cachemire. En 1949, un traité fut négocié sous l’égide des Nations unies. Des équipes d’arpenteurs militaires indiens et pakistanais, sous supervision onusienne, entreprirent alors de déterminer la ligne de cessez-le-feu.
Les deux parties convinrent qu’il s’agirait d’un espace réservé jusqu’à ce que de nouvelles négociations fixent une frontière permanente. Mais les années s’écoulèrent, sans aucun progrès. Et, en 1962, la Chine s’empara de l’Aksai Chin, une zone désertique, à la pointe est du Cachemire. Ce qui embrouilla davantage la situation.
Lorsque le courrier diplomatique lui parvint, en 1968, Hodgson fut confronté à une question complexe : comment les États-Unis devraient-ils traduire sur leurs cartes cet état de fait déconcertant ? S’il en croyait les autorités indiennes, le Cachemire tout entier appartenait légalement à l’Inde, grâce au document d’adhésion signé par le maharaja. S’il suivait la résolution 47 des Nations unies – et l’avis du Pakistan, le Cachemire était une entité distincte, encore en attente d’un référendum populaire pour décider à quel pays adhérer. Et si Hodgson représentait la situation réelle sur le terrain, le Cachemire serait coupé en deux, avec un petit coin contrôlé par la Chine.
Tout au long des années 1960, des diplomates indiens protestèrent contre la façon dont les cartes américaines indiquaient le Cachemire : un territoire occupé ou séparé du reste de l’Inde.
Après la partition de l’Inde, les États-Unis et le Pakistan étaient devenus alliés dans la guerre froide. Aussi pouvait-on avoir l’impression que les États-Unis favorisaient le Pakistan dans le différend. Mais aucun document retrouvé à ce jour ne montre que de telles considérations politiques aient influencé le Bureau du géographe.
En 1968, Hodgson avait déjà traité nombre de problèmes de délimitation délicats. « Il avait sa réputation, dit Bob Smith, recruté par Hodgson en 1975. Il pouvait parler aux Grecs et leur dire en toute honnêteté que leur position était intenable, puis dire la même chose aux Turcs. »
Cependant, la ligne de cessez-le-feu passant à travers le Cachemire présentait un autre problème crucial. Elle ne séparait pas totalement l’Inde et le Pakistan. À un point de coordonnées (appelé NJ9842 lors du processus de démarcation), la ligne s’interrompait d’un coup, à près de 60 km de la frontière chinoise – un cul-de-sac unique dans toute la géographie mondiale.
L’équipe d’arpentage ne l’avait pas prolongée, car ces derniers 60 km traversaient le cœur accidenté du Karakorum. Il ne se trouvait là ni population permanente à protéger, ni ressource naturelle connue, ni accès aisé. Les documents finaux du traité n’offraient qu’une vague indication pour la portion située au-delà de NJ9842 : « [...] de là vers le nord jusqu’aux glaciers. »
Mais les glaciers étaient nombreux au nord de NJ9842. Le plus vaste et le plus important sur le plan stratégique était l’immense et sinueux Siachen, qui traverse l’est du Karakorum.
« À l’époque, il y avait une sorte d’espace vide sur la carte, se rappelle Linthicum. En 1949, toutes les parties auraient trouvé absurde l’idée qu’on puisse se battre pour cette zone. »
À l’été 1968, Hodgson consulta d’autres services du département d’État pour savoir comment faire apparaître la ligne de cessez-le-feu, ainsi que cet épineux vide de 60 km.
Le 17 septembre, près de trois mois après avoir reçu le courrier diplomatique, Hodgson rédigea sa réponse – restée classifiée jusqu’en 2014. Elle commence ainsi : « Le département d’État a depuis longtemps reconnu les difficultés liées à la réalisation d’une carte des frontières internationales indiennes qui ne froisserait pas le gouvernement hôte sans toutefois compromettre les positions américaines établies. »
Puis Hodgson expose ses conseils sur la façon de figurer la ligne de cessez-le-feu de 1948 sur toutes les cartes officielles américaines. Il ajoute cependant : « Enfin, la ligne de cessez-le-feu devrait être étendue au col du Karakorum afin que les deux États soient “fermés”. »
En une phrase, Hodgson avait créé une ligne droite vers le nord-est, à travers des montagnes et un désert d’altitude, pour relier NJ9842 au col du Karakorum, un ancien itinéraire secondaire de la route de la Soie, à la frontière avec la Chine.
Pourquoi Hodgson a-t-il agi ainsi ? Nul ne le sait. Sa lettre ne livre pas d’explication. Aucune note relative à sa décision n’a été retrouvée. Mais il devait avoir des raisons pratiques évidentes.

Une partie de cricket offre un peu d’exercice et d’insouciance aux hommes du régiment du Pendjab de l’armée pakistanaise, au poste administratif Gora I, situé à près de 4200 m, le long du glacier du Baltoro. Le Masherbrum, un sommet de 7821 m, qui fait partie de la chaîne du Karakorum, scintille sous un couvert de neige et de glace.
PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards
En 1963, le Pakistan et la Chine avaient signé un accord bilatéral. Celui-ci faisait du col du Karakorum l’extrémité sud-est de leur frontière commune au Cachemire. Nombre d’observateurs supposaient donc que ce serait aussi le point final logique d’une frontière indo-pakistanaise. Mais, comme l’Inde n’avait rien à voir avec ce traité, souligne Linthicum, «il était sans valeur».
Il se peut que le désir pointilleux d’un cartographe de dissiper l’ambiguïté ait joué un rôle, estime Linthicum : « Certaines personnes ont le syndrome – voire l’obsession – de l’exactitude, de sorte qu’elles éprouvent le besoin de combler les lacunes. » S’il fallait que les deux pays fussent « fermés » par la ligne de cessez-le-feu, comme l’écrivait Hodgson, cette ligne devrait aller jusqu’à la Chine. Elle formerait ainsi une frontière complète. Et le col du Karakorum était le point le plus identifiable sur la séparation.
Hodgson n’ignorait pas que ses ajustements susciteraient des controverses. Dans une lettre à la CIA, il recommande la plus grande discrétion : « Nous préférerions que le changement se fasse progressivement, afin de réduire au minimum les complications internationales possibles. »
L’espoir de Hodgson de dissimuler les changements de politique était peut-être un vœu pieux. « Après tout, il aurait dû se rendre à l’évidence, déclare Dave Linthicum, à savoir que les cartes seraient bientôt publiées les unes après les autres, et beaucoup d’entre elles rendues publiques, avec précisément la preuve visuelle complète du texte de la nouvelle politique. »
L’ÉMINENT ALPINISTE
C’est un copain d’alpinisme qui m’a parlé pour la première fois du glacier Siachen. Selon lui, les lieux abritaient certains des sommets non encore escaladés les plus fascinants du monde. « Ça se situe près de la frontière avec le Pakistan, m’a-t-il dit. Ils ne laisseront personne y monter. »
L’été après mon mariage, nous nous sommes rendus en Inde, en quête de premières ascensions à réaliser dans la vallée de Nubra – juste à côté de la zone occupée par l’armée indienne autour du Siachen. Comme tous les alpinistes venus dans cette région depuis quatre décennies, nous marchions sur les traces de Bull Kumar.
Narinder «Bull» Kumar, 1,65 m environ, sourcils gris plongeants et rire guttural, a vécu bien des aventures au fil d’une carrière militaire chargée d’histoire. Malgré la perte de quatre orteils à cause d’engelures, il a dirigé plusieurs expéditions d’alpinisme audacieuses tout au long des années 1960 et 1970, dont une sur l’Everest. Au passage, il a obtenu le grade de colonel de l’armée indienne et est devenu relativement célèbre.
Avant le décès de Kumar, en décembre dernier, j’ai pu le rencontrer chez lui, à Delhi, pour évoquer sa rencontre avec deux aventuriers allemands. Ces derniers l’avaient contacté en 1977, car ils projetaient de réaliser la première descente de la rivière Nubra, qui émane du glacier Siachen. L’un des Allemands déplia une carte pour expliquer leur plan. « J’ai regardé la carte, a écrit Kumar dans ses mémoires, et mes yeux se sont soudain figés. » Il demanda à l’Allemand où il s’était procuré sa carte, et celui-ci lui répondit qu’il s’agissait d’une carte américaine, en usage dans le monde entier.
Kumar ne dit rien, mais s’aperçut vite d’un problème criant : « La ligne de contrôle, qui s’appelait alors la ligne de cessez-le-feu et se terminait au point NJ9842, avait été [modifiée] par malice, ou par inadvertance, ou délibérément. »
Voilà comment Bull Kumar découvrit la ligne de Hodgson. Il en informa le lieutenant-général M. L. Chibber, alors directeur des opérations militaires indiennes. Le Pakistan occupe de sa propre initiative 4 000 km2 de terres, « et nous n’en savons rien ! », tonna-t-il.
Kumar et Chibber apprirent bientôt qu’une équipe japonaise d’alpinisme, accompagnée d’un capitaine de l’armée pakistanaise, s’était rendue dans le haut Siachen deux étés plus tôt. Kumar proposa de diriger une patrouille, sous couvert d’une expédition d’alpinisme, afin de recueillir des renseignements.

À Gora I, un chemin bien entretenu mène à une terrasse rocheuse dédiée à la prière. «Nous ne parlons jamais des difficultés à nos familles, raconte un soldat. Nous disons seulement que nous sommes contents et profitons de la vie. »
PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards
D’autres patrouilles indiennes suivirent, à la fin des années 1970 et au début des années 1980. À la même période, le Pakistan autorisa plusieurs autres expéditions d’escalade au glacier.
En août 1983, le chef de l’armée pakistanaise envoya une note officielle de protestation à son homologue indien : « Demandez à vos troupes de se retirer sans délai au-delà de la ligne de contrôle, au sud de la ligne joignant le point NJ9842 au col du Karakorum NE 7410. J’ai ordonné à mes troupes de faire preuve du maximum de retenue. Mais tout retard dans la libération de notre territoire créerait une situation grave. »
L’armée pakistanaise revendiquait à présent la ligne de Hodgson comme frontière. Cette ligne avait alors été incluse dans des dizaines de cartes imprimées par de nombreux services, tous sous la houlette du gouvernement américain. Des éditeurs commerciaux en avaient repris le tracé. À partir de 1981, elle apparut sous la forme d’une Lorsque nous nous sommes assis pour notre première réunion, au cours de notre visite de quelques bases, il était évident que l’armée pakistanaise disposait d’un scénario bien rodé à raconter aux visiteurs.
« Contre toute attente, les Défenseurs du K2 occupent les positions militaires les plus hautes du monde, nous a déclaré un capitaine de la 62e brigade. Ce serait un élément fort à insérer dans votre reportage. »
La ligne de ravitaillement de la 62e brigade part de son quartier général, dans la ville de Skardu. Elle serpente ensuite à travers la vallée de la Braldu et jusqu’au col Conway, à près de 6 000 m d’altitude. La seconde moitié du trajet ne peut s’effectuer qu’à pied ou en hélicoptère. Pour nous permettre de nous acclimater, l’armée a décidé de nous faire marcher.
Sur la carte, le sentier semble facile – une large vallée, presque sans arbres, parsemée de blocs rocheux et de cascades. « Pour vous, c’est un plaisir, mais nous, nous faisons ça tous les jours », m’a confié un soldat lors de notre première matinée de marche. Lorsque nous sommes arrivés au camp appelé Paiju, nos articulations étaient raides et nos pieds endoloris.
Les conditions de vie à Paiju sont relativement confortables. Un générateur et des paraboles fournissent une connexion – peu fiable – avec le monde extérieur. Dans les quartiers des officiers, un lacis de fils reliés de façon précaire à une petite télévision permet de se distraire en soirée. « Nous l’utilisons pour regarder des films motivants, nous a expliqué un homme.
— Comme Rambo ?, a plaisanté Cory.
— Oui, exactement », lui a répondu le soldat, le visage impassible.
D’autres camps n’ont pas la vie aussi facile. Urdukas, un minuscule avant-poste formé de trois igloos en polystyrène, est installé sur un perchoir spectaculaire, à 4 000 m. Seulement quatre recrues le tiennent.
« C’est vraiment rasoir, chuchote un soldat au-dessus d’un ragoût de poulet. Il n’y a pas de téléphone portable, pas de films. »
En hiver, Urdukas ne reçoit que quatre heures et demie de soleil par jour. Le camp est entouré de centaines de jerricans de kérosène – l’élément vital du soldat, qui fournit le combustible pour la cuisine et le chauffage.
À l’intérieur de chaque abri, tout est couvert de suie. Ici, les seuls luxes sont le naswar, une variété grossière de tabac à chiquer, et le ludo, la version pakistanaise du pachisi indien. Le jeu, cousin des petits chevaux, se dispute sur un plateau bricolé sur place. « Quand il y a des officiers, c’est plus confortable », observe un homme.
Le lendemain, nous rencontrons une dizaine de soldats revenant d’une patrouille de trois semaines. Ils ont l’air à la fête. Je bavarde avec un sympathique capitaine, un médecin, tandis qu’il fume une cigarette.
« Ça a été, avec cette patrouille, dit-il. Il nous a fallu évacuer trois hommes pour des œdèmes cérébraux de haute altitude, mais c’est normal. » Jusqu’en 2003, les deux camps échangeaient régulièrement des barrages d’artillerie et des tirs de snipers. Le cessez-le-feu conclu cette même année n’a laissé aux soldats rien d’autre à faire que de se surveiller mutuellement et de survivre aux conditions météorologiques.
« C’est comme un match de football, m’a raconté un autre capitaine, à propos de la vie en première ligne. En général, nous prévenons [les soldats indiens] en levant un drapeau rouge. Ce qui signifie : “Veuillez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Nos armes sont prêtes à tirer.” En guise de réponse, ils lèvent le drapeau blanc pour dire : “D’accord, nous arrêtons.” »
Autrement, chaque jour s’égrène au fil des cigarettes et tasses de thé, parties de volley-ball ou de cricket, prières et corvées quotidiennes.
En trente-cinq années de guerre en montagne, l’Inde et le Pakistan ont appris comment prendre soin de leurs soldats dans cet environnement. Les médecins ont observé que des soldats sédentaires passant trop de temps dans des postes enneigés souffrent souvent d’empoisonnement au monoxyde de carbone et d’embolies.
Les hommes doivent maintenant faire de l’exercice tous les jours. « Chaque PON [procédure opératoire normalisée] est inscrite dans le sang », affirme un colonel.
Avant de venir ici, de nombreux soldats que nous avons rencontrés avaient pris part à des combats dans les zones tribales du Pakistan proches de la frontière afghane, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique menée par le gouvernement pakistanais.
« Ici, nous devons combattre la nature, et la nature est imprévisible, remarque le médecin sur un ton de regret. Les êtres humains, c’est plus simple. »
À l’automne 1985, plus d’un an après que l’Inde se fut emparée du Siachen (et dix-sept ans après la publication de la ligne de Hodgson), un diplomate indien a envoyé une requête officielle. Celle-ci a fini par parvenir au Bureau du géographe du département d’État, qui était alors tenu par George Demko – qui, comme Hodgson, était un ancien marine et avait servi en Corée. Plus d’un an après, Demko a publié une mise à jour des orientations cartographiques. Il indiquait que le Bureau du géographe avait examiné le tracé de la frontière indo-pakistanaise sur les cartes américaines et constaté «une incohérence dans la représentation et la catégorisation du découpage réalisé par les différents organismes de production [de cartes]. »
Pour corriger cette représentation, écrivait Demko, « la ligne de cessez-le-feu ne sera pas étendue au col du Karakorum, comme le voulait la pratique cartographique précédente ».
La ligne de Hodgson venait d’être effacée. Bien qu’elle ait été supprimée des cartes américaines, le Bureau du géographe n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle elle y était apparue en premier lieu.

Quatre recrues tiennent le poste d’Urdukas, en surplomb du glacier du Baltoro, à 4 000 m. Les soldats s’ennuient, mais l’armée pakistanaise est fière de sa discipline. Les postes administratifs se situent le long des lignes de ravitaillement, et les postes d’observation sur les lignes de front, ou tout près, avec vue sur l’ennemi.
PHOTOGRAPHIE DE Cory Richards
Robert Wirsing, de l’université de Caroline du Sud, avait suivi de près le conflit du Siachen. Quelques années après la correction de Demko, il s’est mis à enquêter sur cette ligne qui était apparue sur les cartes américaines, puis en avait disparu. Ayant appris d’un général indien que le gouvernement de l’Inde avait demandé en vain des éclaircissements, Wirsing a envoyé des courriers au département d’État et à l’Agence de cartographie de la Défense, afin de connaître l’origine de ce changement.
En 1992, William Wood, le successeur de George Demko, lui a répondu. « La politique américaine n’a jamais été de tracer une frontière de quelque nature que ce soit pour combler le vide entre le NJ9842 et la frontière chinoise », écrivait Wood. Robert Wirsing n’a pas creusé plus loin la question.
LES SUITES
Les responsables pakistanais refuseront toujours de nous emmener, Cory et moi, près de la ligne de front, là où nous aurions pu obtenir un aperçu du point NJ9842. J’ignore ce à quoi je m’attendais au juste, et qu’un zoom sur Google Earth ne m’aurait pas permis de distinguer. NJ9842 n’est qu’une appellation inventée par l’homme –un point isolé sur une crête glaciaire, avec, non loin, un cantonnement de l’armée indienne.
À la place, on nous propose de nous montrer un autre endroit. Nous embarquons dans des jeeps et bringuebalons sur un chemin de terre vers la profonde vallée de Bilafond. Au-dessus de nous, des sommets de granite brillent dans le soleil matinal, bien que d’épaisses ombres obscurcissent encore le fond de la vallée. Nous nous arrêtons au bord d’un vaste champ de moraines.
Là, peu avant 2h30 du matin, le 7 avril 2012, l’armée pakistanaise a subi son pire revers dans le conflit du Siachen. Et les Indiens n’y ont pris aucune part. Un énorme glissement de terrain a eu lieu au-dessus d’un camp servant de quartier général de bataillon, celui-là même à partir duquel Abdul Bilal avait planifié son assaut. Les soldats d’une base d’artillerie située à 2,5 km de là ont signalé un fort grondement, une grande quantité de particules de neige dans l’air et un chien solitaire aboyant désespérément.
« Cela dépassait l’imagination», raconte le major général Saqib Mehmood Malik. Cent quarante hommes logés dans une douzaine de bâtiments ont été ensevelis sous plus de 30 m de roche, de glace et de neige. Le premier corps n’a pas été découvert avant plusieurs mois.
Cory et moi nous frayons un chemin à traversle champ de débris encore dangereusement instable. De rudimentaires pancartes façonnées en tôle ondulée marquent les emplacements où se dressaient les bâtiments de la caserne. Sur chacune d’elles, le nombre de corps retrouvés là est inscrit à la peinture. « C’est une sensation étrange, mais une source de grande fierté que de venir ici », nous assure un officier. Mais je me pose la question: est-ce que ces gens sont morts à cause de l’erreur d’un géographe ?
La ligne de Hodgson « a certainement joué un rôle dans ce qui a conduit à la guerre. Elle ne l’a pas provoquée, mais a sûrement été un facteur, déclare Dave Linthicum. L’expression “pistolet fumant” a été utilisée», poursuit-il – allusion au moment où il a découvert le courrier diplomatique de Hodgson enfoui dans les archives du département d’État. Linthicum a gardé pendant des années une photo de Robert Hodgson collée au-dessus de son espace de travail, « pour me souvenir de ne pas déc...ner et d’être responsable ».
Robert Wirsing admet que la ligne a joué un rôle dans le conflit, mais ajoute : « Je n’ai aucune raison de penser que quelqu’un ait décidé sciemment de céder ce territoire au Pakistan. »
Il n’a pas non plus de motif de croire que des accords de paix pourront être négociés sous peu. « J’ai des amis pour qui il faudrait convertir [le glacier Siachen] en parc international de la paix. » Mais les événements récents, note Wirsing, notamment la poursuite des violences au Cachemire et les tensions frontalières entre l’Inde et la Chine, font que la résolution du problème paraît improbable dans un proche avenir.
Wirsing n’adhère pas forcément à l’analogie de la « dispute entre deux chauves pour un peigne » : « “Irrationnel” est un mot que j’ai rencontré si souvent dans les débats et écrits universitaires sur les relations indo-pakistanaises.
Je n’attribue pas grand-chose de ce qui se passe entre l’Inde et le Pakistan à leurs émotions. [...] À mon avis, s’ils sont là, c’est pour de très bonnes raisons, y compris stratégiques, [...] étant donné la fragilité des frontières dans la région. »
De fait, tant que l’humanité s’ingéniera à diviser notre planète en polygones réguliers, certains de ces tracés seront voués à contestation, et l’on enverra des hommes comme Abdul Bilal et Bull Kumar se battre à cause d’eux. La géographie dicte ses propres règles.
-
Il s'agira d'un épuisement
- Par Thierry LEDRU
- Le 06/05/2025
- 0 commentaire

Je ne crois pas au hasard.
Le damier sera renversé par l'impossiblilité naturelle que la partie continue. Et nous serons responsables de la survenue de cette impossibilité par épuisement de la nature.
-
L'imaginaire de l'impuissance
- Par Thierry LEDRU
- Le 05/05/2025
- 0 commentaire
Lorsque l'imaginaire est cadenassé, limité, filtré, sciemment, consciemment, avec une intention cachée, c'est tout le collectif qui en subit les effets. Jusqu'à en oublier tout ce que le collectif a pourtant réussi à acquérir, à travers son engagement. C'est toute la problématique de "l'impuissance apprise".
JUSQU'AU BOUT : l'impuissance apprise
L'impuissance apprise et ses effets
Par Aurore Nerrinck
"Le « on ne peut rien faire », ou l’imaginaire organisé de l’impuissance ?
Il y a dans l’époque une lassitude particulière. Pas seulement de la fatigue, mais une forme d’épuisement politique, une résignation profonde qui prend l’apparence du bon sens. On dit : « voter ne sert à rien », « les décisions sont prises ailleurs », « les puissants font ce qu’ils veulent ». Ce désespoir tranquille, ce scepticisme généralisé, ne sont pas des réactions naturelles. Ce sont les produits d’une fabrique active : la fabrique de l’impuissance.
Comme l’écrivait David Graeber, le pouvoir moderne ne se contente pas de contraindre nos corps ; il réduit aussi nos imaginaires. Ainsi, il restreint notre capacité à penser d’autres mondes, à croire en d’autres formes de vie collective, à concevoir le changement comme possible. Il ne dit pas seulement : « ne fais pas » ; il dit : « tu peux essayer, mais ça ne changera rien ». Ce glissement est redoutable : on ne nous interdit pas d’agir - pas toujours -, on nous pousse à y renoncer nous-mêmes.
Cela commence dès l’école, où l’on apprend à se conformer bien plus qu’à créer. Cela se poursuit dans l’information, où l’avalanche de crises et de débats creux nous donne l’illusion de la participation, alors qu’elle sature l’espace mental jusqu’à la paralysie. Cela culmine dans l’organisation matérielle de nos vies : surcharge, précarité, isolement, dépendance. Le système fabrique des citoyens épuisés, découragés, atomisés — qui n’ont plus l’énergie ni le cadre pour résister.
Et pendant que l’on désactive les affects politiques, on falsifie le récit historique. Dans les manuels scolaires comme dans les discours institutionnels, on nous apprend que les droits ont été conquis par la raison d’État, dans un mouvement progressif, civilisé, presque naturel. On parle de la fin de l’esclavage comme d’un humanisme soudain, du droit de vote comme d’une évidence républicaine, des congés payés comme d’un progrès social voulu par le politique. Mais c’est un mensonge organisé. Quelques exemples.
• L’abolition de l’esclavage ? Promulguée une première fois en 1794, rétablie par Napoléon, puis arrachée de nouveau en 1848 — non pas par grandeur morale de l’État, mais sous pression des révoltes, des résistances dans les colonies et des mouvements abolitionnistes portés par les personnes racisées elles-mêmes.
• Le droit de vote universel masculin ? 1848, à la suite d’une insurrection républicaine.
• Suppression du travail de nuit dans les boulangeries, écoles laïques pour filles, égalité des enfants légitimes et illégitimes, réquisition des ateliers abandonnés au profit des ouvriers ? 1871, la Commune de Paris, moment unique d’auto-organisation populaire, où furent mises en place des mesures sociales radicales — avant que tout ne soit écrasé dans le sang par la répression versaillaise.
• Le suffrage féminin ? Obtenu très tardivement en 1944, après des décennies de luttes féministes, de mépris et de relégation.
• Les congés payés ? 1936, conquis par les grèves massives du Front populaire.
• La sécurité sociale ? 1945, construite dans l’après-guerre par un rapport de force issu de la Résistance et des mouvements ouvriers.
• Le droit à l’IVG ? 1975, fruit d’une mobilisation longue et souvent violente, de femmes criminalisées, insultées, persécutées.
• Le mariage pour tous ? 2013, acquis dans un climat d’hostilité, au terme de mobilisations massives et d’une stigmatisation persistante.
Rien n’a jamais été donné. Tout a été exigé, imposé, parfois au prix de la mort. Et toujours contre les institutions d’alors, qui qualifiaient les luttes de « subversives », « irresponsables », « dangereuses pour l’ordre ».
Mais dès que la victoire est inévitable, le pouvoir absorbe la lutte, la commémore, la vide. On sanctifie ceux qu’on criminalisait la veille. On célèbre l’émancipation comme un choix éclairé des gouvernants. On efface la rue, la base, la colère.
Cette réécriture a un objectif : nous faire croire que l’histoire avance toute seule, que le progrès est linéaire, que l’État est notre allié naturel. Mais ce récit a toujours été un mensonge. Car l’État n’a jamais été un moteur de l’émancipation populaire : il n’a agi que contraint, sous pression, pour préserver l’ordre établi. S’il y a eu des lois sociales, ce fut pour contenir la contestation, pas pour libérer. Les droits n’ont jamais été concédés par grandeur d’âme : ils ont été extorqués.
Et aujourd’hui, ce masque tombe plus vite, plus brutalement. Ce que l’on voit désormais, ce ne sont pas des lois d’émancipation, mais des lois de contrôle. Réformes sécuritaires, lois contre les libertés syndicales, lois sur les retraites votées en force, criminalisation du militantisme, surveillance algorithmique, répression des mouvements sociaux — mais aussi, lois qui ciblent explicitement les populations musulmanes, sous couvert de « neutralité » ou de « lutte contre le séparatisme ». Ces lois restreignent les libertés associatives, interdisent certains signes religieux, placent des lieux de culte sous surveillance, ferment des écoles, créent un climat de suspicion permanente.
Ce n’est pas la République qui est défendue, c’est un ordre identitaire qui s’impose. L’État ne progresse pas vers l’égalité : il revient ici à sa fonction première — maintenir l’ordre au service des dominants, au prix de la stigmatisation des plus vulnérables.
À force de vider la politique de son sens, on laisse place à une colère sans boussole. Et c’est là que se joue une autre facette de l’impuissance : son retournement en pulsion autoritaire.
Quand plus rien ne semble possible, quand les institutions déçoivent, quand les promesses ne tiennent plus, alors certains finissent par vouloir que « quelqu’un » décide à leur place. Ce n’est pas seulement la peur ou la haine qui pousse vers l’extrême droite — c’est aussi l’épuisement. Le désespoir organisé devient le terreau du fascisme doux : un désir d’ordre, de verticalité, de fin de la complexité.
Le système fabrique alors un cercle vicieux : il désarme, décourage, puis désigne de nouveaux ennemis à haïr quand la frustration explose. Pour ne pas rendre visibles les véritables rapports de pouvoir, il propose des boucs émissaires. Les migrants, les chômeurs, les militants, les pauvres, les minorités, deviennent la cible. La lutte des classes est effacée, remplacée par une guerre de voisinage.
Mais des failles apparaissent. Le système craque. On voit réapparaître des solidarités souterraines, des résistances locales, des communautés de soin et de lutte, des formes de récits alternatifs. Des gens recommencent à désobéir, à expérimenter, à imaginer. Ce n’est pas spectaculaire, pas médiatisé, mais c’est là. L’impuissance, si elle est construite, peut aussi être déconstruite.
Il faut pour cela rappeler que l’histoire n’est pas écrite d’avance, et qu’elle ne vient jamais d’en haut. Il faut redonner du poids au conflit, à l’affrontement politique, à la mémoire des désobéissances fécondes. Il faut rappeler que tout ce que nous avons, nous l’avons arraché. Et que tout cela nous est repris, peu à peu. Parce que : quelle vie voulons-nous ? Et quelle société voulons-nous pour les prochaines générations ?
Alors, ravivons la mémoire de ce que l’on nous a fait oublier. Reprenons ce que l’on nous a pris. Osons imaginer ce que l’on nous a fait croire impossible."