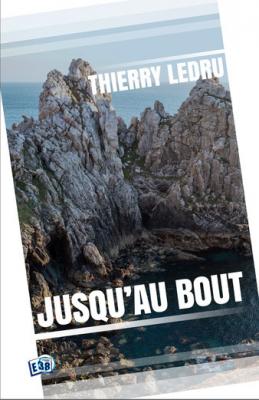Une étrange similitude
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/09/2014
- 0 commentaire
Pierre, instituteur révolté, le personnage principal de "Jusqu'au bout".
Le retournement vers soi. Il ne s’agissait pas de se contenter d’un regard humain mais d’instaurer un regard différent, neuf, épuré, jusqu’à l’effacement de cet humain. Qu’il ne reste qu’une forme de vie en symbiose avec d’autres formes de vie. L’oubli de soi, quand il ne s’agit que d’une forme aiguë de prétention, était la clé nécessaire à cette ouverture vers le monde. Il tenait la solution et la joie qui le gonflait aurait pu le faire voler au-dessus de la cime des arbres.
Ce fut comme une naissance. Et l’accession à une nouvelle lumière.
Pas, cette fois, la lumière artificielle d’une salle d’hôpital mais la lumière de l’univers. Un rayonnement d’étoile, un embrasement au cœur de ses fibres, un noyau en fusion, une âme libérée, un envol. Des vagues de frissons qui cascadent.
Un autre état de conscience, différent de celui prôné par l’esprit humain. Un état naturel. Un état de connivence avec le monde. Nous serions donc en dehors de la vie, attachés comme du bétail à tirer dans une fuite aveugle des fardeaux imposés, à nous abrutir jour et nuit de drogues licites, à nous interdire, par tous les moyens, de nous observer. Il pensa à ses journées de travail, à ses six heures en classe, à ses deux heures au bureau, à l’entretien de son logement et de son fourgon, de son vélo et de toutes ses petites affaires, aux courses, à la télévision et à la radio, à ces informations d’un monde en débâcle, aux discussions sur le mauvais temps et le prix de l’essence, et à tous les passe-temps dérisoires pour occuper les dernières minutes de cette mort camouflée dans une journée quotidienne. Toutes nos activités nous tournaient irrémédiablement vers un extérieur artificiel, à des distances considérables de nous-mêmes et du monde. De notre complicité avec ce monde. Nous étions tous dans un état de non vie.
Il s’assit au sommet d’une butte. Il dominait la cime des arbres. Le paysage devant lui s’étendait jusqu’à l’horizon. Il eut peur brutalement de ce qu’il découvrait.
Il eut peur du moment où il redescendrait parmi les morts.
Il eut envie de leur parler. Il eut pitié d’eux. Pour la première fois, il aima l’humanité. Pendant quelques secondes. Pourquoi cette humanité avait-elle abandonné ce bonheur ?
Il chercha… Et comprit qu’il ne devait pas le faire. Chercher, c’était encore faire appel à l’esprit humain pour répondre à une question qui concernait un ordre planétaire, une harmonie universelle d’où l’homme s’était retiré.
Il déposa son sac, sortit sa serviette et l’étala. Il se déshabilla et s’allongea au soleil. Les yeux fermés.
Une brise légère mais régulière coiffait le sommet dégagé et repoussait les insectes. Il pensa aux rennes de Scandinavie qui progressent sur les crêtes ventées pour se protéger des taons. Il suivit leurs longues marches. Vaste troupeau obéissant à des migrations séculaires, chaque individu posant ses pas dans les pas de ses ancêtres, acceptant la loi du groupe sans même y penser, perpétuant sereinement un ordre naturel. Un faucon survolait les troupeaux. La danse suspendue de l’oiseau le conduisit au bord de l’océan. Jonathan Livingstone l’accueillit. Le goéland avait acquis la liberté à travers le vol, il avait brisé les règles établies et choisi de développer des qualités extraordinaires pour éveiller sa propre connaissance. Mais s’il avait atteint une liberté sublime, il ne le devait qu’à une volonté farouche. Ce n’était pas un exemple accessible à tous. Le développement de cette connaissance hors du commun n’avait été rendu possible qu’à travers l’extrême perception et l’absolue maîtrise de son essence. Il avait retrouvé enfoui sous de misérables comportements quotidiens toutes les possibilités de son corps et de son esprit. De son être unifié. Aujourd’hui, le culte de la personnalité qui servait de référence ne représentait en fait que la consolidation d’un système pervers, nullement l’accession à cette connaissance supérieure. Ce n’était pas l’homme qui était promu mais sa totale participation à une vie de masse. Et les quelques individus parvenant à s’extirper de cette foule anonyme cautionnaient par cette fausse réussite un esclavage doré, totalement éloigné de toute essence. Rien ne s’éveillerait. Ce n’était pas l’homme libre qui pouvait jaillir mais juste l’homme privilégié, profitant avidement de l’opulence sordide des plaisirs offerts par ce système, l’embellissement frénétique des murs de la prison. Et celui qui y parvenait apparaissait comme le plus heureux et le meilleur des hommes. Et la foule envieuse continuait à rêver avec le même enthousiasme aveugle, la même convoitise. Se nourrissant d’espoirs de gloire et de fortune quand la paix de l’âme restait à portée de main, accessible à tous, sans distinction sociale, raciale ou d’intelligence. C’est l’esprit seul, sa sensibilité et sa capacité à goûter pleinement l’importance d’un brin d’herbe comme celle d’une étoile qui ouvrait les portes du monde.
Il s’étonna de la fluidité de son raisonnement. Il ne se souvenait pas avoir connu auparavant des éveils aussi flamboyants. Il ne pouvait certifier qu’il parviendrait à échanger de telles idées mais ce bonheur était déjà si inattendu qu’il lui suffisait amplement. Il douta d’ailleurs d’une possible transmission de tels raisonnements. N’était-ce pas à chacun de constituer sa propre théorie ? Sa propre vérité…Opposée à cette vacuité terrible qui nous étouffait. Soudainement, encore une fois, le vide de l’existence telle qu’elle était instituée, lui brûla la gorge. Physiquement. Il s’assit, prit la gourde et avala plusieurs goulées d’eau fraîche. L’angoisse disparût mais la tension dans laquelle l’esprit s’était maintenu céda d’un coup. Les larmes coulèrent, librement, sur les joues. Il fallait pleurer, il le sentait, c’était une délivrance nécessaire, pas une fuite ou un abandon mais un lien avec ce monde oublié et battu. La rencontre triste de deux consciences esseulées, la complicité fabuleuse de deux esprits en sursis, deux êtres condamnés à plus ou moins brève échéance, sentant au-dessus de leurs consciences effrayées la menace permanente d’un sabre que l’espèce humaine tenait fièrement.
Il refusa de sombrer dans les noirceurs et se releva. Il reprit son sac et s’engagea sur une sente. Il força son pas durant de longues minutes, crachant des bouffées de déprime dans les souffles jaillis de ses poumons, dans les brûlures de ses muscles, les gouttes de sueur qui voilaient ses yeux. Il sentit combien la peur pouvait étouffer les plus beaux sentiments, les plus intenses émotions. Il avait entrevu son retour parmi les hommes et la terreur qui s’était dressée l’avait tétanisé. Comment supporter ce mensonge immonde ? Ça ne lui semblait plus possible.
Il marcha comme un forcené, évadé d’une prison morale et qui court, qui court, sentant dans son dos la rage haineuse des morts.
Il serpenta entre les arbres, hors de tout objectif et de toute conscience réelle. Ce fut une fuite sans but. La douleur était en lui, les terreurs l’habitaient. Et il souffrait davantage encore de ne pas maîtriser ces assauts morbides, de ne pas parvenir au contrôle de soi et de devoir, pour trouver une certaine paix, consumer ses forces dans des défis déraisonnés.
Il atteignit un nouveau sommet, simple colline déboisée, ouverte sur les horizons. Dans la dernière montée, un vertige l’avait ébloui. Il décida de manger. Espérant surtout y trouver l’absence de pensées dont il avait besoin.
Face à lui s’étendaient des pentes boisées, vastes mers de couleurs superbes sur lesquelles les rayons solaires, variant leurs inclinaisons et leurs intensités, jouaient pendant des heures. Il devina, sous le secret des frondaisons, les itinéraires répétés des animaux, leurs parcours ancestraux, incessamment agressés par des hommes envahisseurs. Il sentit l’angoisse pesante des espèces encerclées, les cris suppliants des arbres abattus, les râles étouffés d’une terre labourée, toutes ces souffrances quotidiennes qui resserraient impitoyablement sur des êtres fragiles leurs étreintes mortelles. Il aperçut au loin une brume étrange, surplombant une vallée invisible. Etait-ce une vapeur échappée d’un lac ou la pollution d’une ville ? Embryon de pluie ou haleine putride. C’est de nos âmes que s’élevait ce poison. L’empreinte des hommes sur la Terre. Le cerf, au fond des bois, percevait le parfum pestilentiel des fumées d’usine, le ronflement des moteurs, le vacarme des avions, le hurlement aigu des tronçonneuses, les appels des chasseurs vers les meutes excitées des chiens. Même le parfum âcre de sa sueur agressait les narines des animaux aux abois. L’homme n’était toujours qu’une menace, que le complice cynique de la mort. Le dégoût. Il n’était qu’un humain. Les fumées de son fourgon, les routes dont il profitait, les champs sulfatés pour les récoltes forcées dont il se nourrissait, les bétails engraissés pour des populations obèses, les mers vidées par les filets dérivants, les centrales nucléaires pour des électricités gaspillées, les forêts vierges rasées pour des meubles coûteux, les fleuves agonisants sous les rejets nitratés, les décharges sauvages et les dépotoirs engorgés. On immergeait dans les fosses marines des containers de déchets radioactifs comme on jetait par les fenêtres des voitures un paquet de cigarettes. Le geste était le même. C’est la mort qu’on propageait.
Le dégoût.
Il ne voyait pas d’issue et sentait combien ses réflexions le conduisaient à une impasse. Si les animaux vivaient dans la peur permanente, la planète elle-même ressentait-elle cette angoisse ? Représentions-nous désormais le mal absolu ?
Sa simple présence éveillait dans les arbres des frissons inquiets. Et les gens incrédules mettaient cela sur le compte du vent. Un pigeon passa devant lui. Son vol était puissant et rapide. Etait-ce une fuite, la recherche désespérée d’un dernier refuge ? On trouvait jusque dans les mers australes des traces de dérivés chimiques. Où pouvait-il aller ? Les feuilles des arbres, autour de lui, le regardaient avec des yeux terrifiés. Des hordes d’insectes affolés fuyaient devant ses pas aveugles. Les nuages empoisonnés pleuraient des larmes acides.
Les hommes avaient propagé la mort. Ils étaient son plus fidèle allié. L’humanité comme l’étendard de la grande faucheuse.
Le dégoût.
La violence du dégoût.
Il se leva et prit le chemin du retour. Un court instant, des désirs de suicide. Il en gardait sur les lèvres un goût sucré, presque bon. L’anéantissement salvateur de la culpabilité. Et l’impression d’un geste enfin à soi.
Il ne devait pas rester seul. Il en mourrait. C’était certain.
Tête baissée, il parcourut les bois, la mort aux trousses. Et c’est ce sentiment effroyable de la fin à venir que les hommes étouffaient sous des agitations frénétiques. Ne pas savoir, ne pas écouter ni sentir. Rien. Vivre dans l’aveuglement, juste pour se supporter. Nous étions la mort et nous le savions. Mais nous maintenions avec obstination l’interdiction de le dire.
Il finit par courir espérant que la violence de l’effort empêcherait toute intrusion raisonnée.
Arrêter de penser et ne penser qu’à cela.
C’était donc cela le rôle du sport. Juste le complice d’une dictature complexe. L’opium du peuple, un de plus.
Ne pas penser. Courir. Etouffer le dégoût sous des épuisements musculaires.
« Arrête de penser ! » cria-t-il dans le silence craintif des bois. Des sanglots échappés bloquaient ses souffles dans la gorge serrée.
« Arrête de penser, gémit-il, arrête, c’est plus supportable. »
A l’orée d’une clairière, il s’arrêta. Il ne se souvenait pas de cet espace dégagé. Il regarda autour de lui et ne reconnut rien. Au premier instant, il se dit qu’il était perdu mais l’absurdité de cette conclusion le frappa. Parmi les hommes il était perdu. C’est ici qu’il était quelque part. Mais il n’y trouvait pas les repères inculqués. Et se sentait totalement égaré.
Avant de s’effondrer, il fonça, droit devant.
Ce n’est pas le temps qui s’égrena mais la répétition mécanique de ses foulées, la force de ses respirations, l’usure de ses muscles, le choc dans son crâne des pas retombés, les crachats de salive qui suintaient aux coins des lèvres. Et les larmes salées qui coulaient de son corps comme un pus honteux.
Honteux.
C’est ainsi qu’il déboucha sur une route. Il reconnut l’accès au lac. Il était descendu trop bas. Il remonta le ruban goudronné et songea à ces milliards de kilomètres balafrant la planète, cicatrices sans cesse entretenues, élargies, renforcées, reliées entre elles par des réseaux de plus en plus étendus. Il crut devenir fou et comprit qu’il découvrait la vraie raison. Les fous, de leurs côtés, traçaient de nouvelles routes pour rejoindre plus rapidement leurs semblables.
Le parking, le fourgon. Il courut encore, s’engouffra, ferma la porte et sauta fébrilement sur la boîte de cannabis. Anesthésier les flots de pensées sous des brouillards parfumés, étouffer fébrilement des consciences insupportables.
Ajouter un commentaire