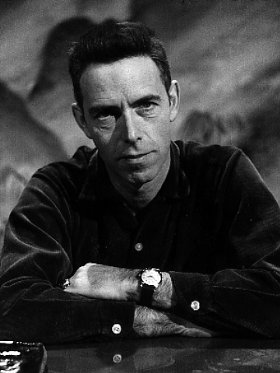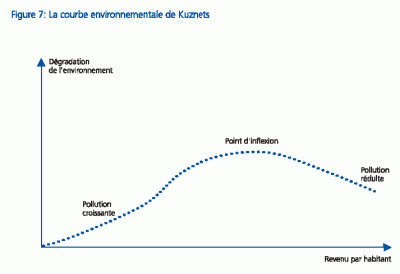Blog
-
François Couplan, ethnobotaniste
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/03/2021
"Sans les plantes, nous n’existerions pas !" - François Couplan, ethnobotaniste
par Nadja Viet publié le 28 mai 2020 à 18h31
Voici une vérité essentielle qu’il est utile de conscientiser, pour développer une nouvelle relation au végétal, une meilleure approche d’un monde qui se révèle fascinant et généreux. Pour partager avec nous sa passion des plantes, François Couplan était l’invité de l’émission « Grand Bien vous fasse ».

Les plantes communiquent entre elles et aussi avec nous, humains ! © Getty / Muhammad Purnomo / EyeEm
Dans son émission Grand Bien vous fasse du lundi 25 mai 2020, Daniel Fiévet reçoit François Couplan, auteur de nombreux ouvrages sur les plantes et en particulier, son dernier opus : Ce que les plantes ont à nous dire, publié aux éditions Les Liens qui libèrent.
Sillonnant la planète, cet ethnobotaniste de renom se trouve à l’origine du renouveau de l’intérêt porté aux plantes comestibles et médicinales en France et de par le Monde.
Avec pédagogie et enthousiasme, François Couplan nous exhorte à redéfinir notre rapport à la Nature et, en particulier, aux plantes qui, selon lui, ont subi un rejet socio-historique, désaffection non fondée puisque le végétal est tout de même à la base de l’alimentation et du vivant, que l’on soit végétarien ou pas, avec, entre autres, la fonction chlorophyllienne génératrice d’oxygène.
Vous connaissez certainement la soupe d'orties ou la salade de pissenlits, mais peut-être aurez-vous plaisir et intérêt à découvrir quelques autres des 1 600 espèces que François Couplan s’est plu à dénombrer dans toute l'Europe.
L'essayiste, philosophe et poète, Ralph Waldo Emerson, ami de Henry David Thoreau, disait :
Il n’y a pas de mauvaises herbes, il y a des plantes dont on ne connaît pas les propriétés.
… et François Couplan, d’ajouter à cette sage appréciation : « … dont on ne connaît PLUS les propriétés ! »
Consommer des plantes sauvages
François Couplan apporte un éclairage intéressant sur cette lacune de notre mémoire patrimoniale. En effet, il semblerait que pour des raisons socio-historiques, dès le Moyen-Âge, « les plantes sauvages aient été dévalorisées et ne fassent plus partie de la nourriture habituelle ».
Avant tout, on se nourrit de symboles.
Le clivage de la société, d’une part les riches et d’autre part, les pauvres, a scindé également les ressources alimentaires : les riches pouvaient se payer les services d’un jardinier et cultiver ainsi des espèces transformées par le génie humain.
Les populations de condition modeste, vivant à la campagne aussi pour des raisons économiques, continuaient de se nourrir d’orties, de pissenlit ou autres plantes sauvages, mais, petit à petit, toute cette culture populaire attachée aux vertus des plantes a sombré dans l'oubli.

Gravure d’un livre de botanique illustrée (1886) © Getty / Bauhaus 1000
"Pourtant, se nourrir de végétaux cultivés et d’animaux élevés pour cela est très récent dans l’Histoire humaine" rappelle François Couplan, qui donne quelques chiffres à l’appui : "90 % de la production agricole mondiale concerne seulement une vingtaine d’espèces végétales, et si nous connaissons une trentaine de fruits et légumes, ce sont des dizaines et des dizaines d’espèces qui nous entourent dans la Nature, et qui sont tellement plus intéressantes en micronutriments".
L’Organisation Mondiale de la Santé alerte depuis longtemps sur le fait que la plupart des humains sont carencés en vitamine C, en fer, en sels minéraux, en oligo-éléments, en flavonoïdes et en antioxydants. L’ethnobotaniste précise que : « Nous, Occidentaux, même si nous mangeons des produits biologiques, sommes carencés ».
Spécialiste de l’alimentation par les plantes, François Couplan précise qu’effectivement, les plantes à l’état sauvage, sont extrêmement riches en micronutriments, ces substances que nous ne pouvons pas synthétiser et qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de notre organisme.
Pour exemple, l’ortie est très riche en protéines, elle est équilibrée en acides aminés et ses feuilles sont riches en provitamine A et en vitamine C (huit fois plus que le citron !). Sur la chaîne YouTube du Chemin de la Nature, vous pouvez consulter cette courte vidéo très instructive en ce qui concerne cette plante, hélas, très mal considérée :
Les plantes sauvages constituent une source extraordinaire de micronutriments, mais elles permettent aussi, en situation d’épidémie, d'augmenter la capacité de notre corps à s'adapter aux différents stress, quelles que soient leurs origines. On parle de plantes adaptogènes, et François Couplan d’ajouter que, selon lui :
Nous, humains, sommes faits pour manger des plantes sauvages.
Tisanes, infusions ou décoctions, alcools ou apéritifs, assaisonnements, plats cuits ou salades, sirop ou confits, glaces ou sorbets, confitures ou gelées, il existe mille façons d’accommoder les plantes sauvages, qu’il est important, préalablement, de bien identifier.
Certaines plantes sont des versions sauvages de légumes courants comme les poireaux et les asperges sauvages. Beaucoup de plantes sauvages s'utilisent comme des légumes, comme les feuilles de bourrache ou de pissenlit.
À la rencontre des plantes sauvages
Au-delà de la consommation de plantes sauvages, et de l’encouragement à nous soigner grâce aux plantes médicinales, François Couplan nous exhorte à nous interroger sur notre rapport au monde végétal, à reconsidérer cet anthropocentrisme qui gâche notre relation avec le vivant et les plantes :
Le monde végétal est fascinant, je l’explore depuis toute une vie sans cesser un instant de m’en émerveiller.
Le botaniste nous encourage à développer notre connaissance des plantes, décrites dans les herbiers ou les livres de botanique, mais aussi à les regarder, les contempler au fil des saisons, à les sentir, les toucher et à les ressentir, en un mot, à les fréquenter comme des êtres vivants, ce qu’elles sont !
N’hésitant pas à parler de "relation amoureuse" avec les plantes, François Couplan nous propose " de découvrir les extraordinaires secrets des plantes et la longue et tumultueuse relation que nous entretenons avec elles, une aventure commune qui façonne son histoire depuis la nuit des temps", pour peu que nous soyons capables de garder cet émerveillement, cette soif de découverte et cette humilité devant tant d’ingéniosité d'une Nature si généreuse.
L’idée simple, que développe l’ethnobotaniste dans son dernier livre au titre très explicite, Ce que les plantes ont à nous dire, est que nous avons tout à gagner, pour notre santé, mais aussi pour notre sensibilité et notre bonheur, à rencontrer vraiment les plantes qui communiquent avec nous depuis toujours.
Une riche bibliographie
Outre son dernier ouvrage, Ce que les plantes ont à nous dire, évoqué dans l'émission, François Couplan, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages et cultivées, qu'il a étudiées sur les cinq continents, a énormément publié.
Son ouvrage remarquable, Guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées, publié chez Delachaux & Niestlé, dans la collection Les Guides du Naturaliste, est une bible, tant pour les amateurs de botanique mais aussi pour tous ceux qui souhaitent connaître la valeur nutritive des plantes !
La collaboration entre François Couplan et le cuisinier étoilé Marc Veyrat a donné naissance à L'Herbier Gourmand, un plaisir pour les yeux et les papilles, et tous les moyens de reconnaître 50 plantes et de les utiliser dans 100 recettes étonnantes. Un véritable herbier à emporter en balade nature.
En presque 40 ans, l'ethnobotaniste a publié 85 ouvrages différents sur les plantes sauvages comestibles, la cuisine sauvage, la nature et d'autres aspects liés aux relations entre l'homme et les végétaux.
À la rencontre des plantes sauvages
Pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages, il existe de nombreux sites, en voici une courte sélection :
Vous pouvez suivre la chaîne YouTube Le Chemin de la Nature, d’un autre botaniste de terrain, Christophe de Hody, qui propose une série de courtes vidéos pour vous permettre d’identifier les plantes sauvages, les arbres, mais aussi les champignons et vous apprendre à les consommer en toute sécurité.
Vous pouvez rejoindre la communauté virtuelle Tela Botanica. Cette plateforme MOOC compte plus de 50 000 botanistes en herbe, si je puis dire, et assure aussi des cours en ligne très accessibles et gratuits.
Réécouter l’émission Grand Bien vous fasse, du lundi 25 mai 2020, animée par Daniel Fiévet et avec, comme invité, François Couplan.
-
L'ego encapsulé (3)
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/03/2021
"Korzybski, le père de la sémantique générale, a qualifié l’humanité de lieuse de temps, parce qu’elle a le sens de l’avenir. Apparemment, les animaux ne le possèdent pas, car ils ne prévoient pas. Les sciences sont, en effet, une forme de prédiction. Mais notre pouvoir de prédiction constitue à la fois un avantage et un désavantage. D’une part, à partir du moment où il peut prévoir, l’homme possède un pouvoir sur l’avenir. D’autre part, il est troublé parce qu’il sait qu’il mourra et qu’il n’a pas d’avenir véritable. C’est un atout déprimant. Alors il se donne dix ans ou un peu plus. Il se décharge des responsabilités plus lointaines sur ses enfants."
Allan Watts
Il est évident que la conscience de notre mort en temps qu'individu est à la source de notre course en avant, de ce "toujours plus" qui caractérise les sociétés occidentales et même désormais les sociétés orientales. Il nous faut acquérir le pouvoir de jouir de cette vie avant qu'elle ne s'arrête. Et c'est une véritable angoisse qui ne trouve son apaisement que dans cette euphorie, cet activisme, cette frénésie à faire. Je ne vais pas tenter de faire ici un résumé des milliers de livres qui ont été écrits sur le sujet.
Tout cela n'aurait pas été problématique si ça n'avait pas engendré toutes les exagérations dont nous vivons désormais les effets. Car, à se penser individuel, à se voir comme une identité séparée du tout, nous n'avons plus conscience de la portée universelle et intemporelle de nos actes.
Encore une fois, j'entends les critiques fuser, comme je les lis bien souvent sur les forums ou blogs qui abordent les thèmes de "survivalisme", de "décroissance", de "changement de paradigme". Les adversaires de ces idées qui ricanent en imaginant la vie de ces "suvivalistes" dans leurs grottes, à la lumière de la bougie, à faire cuire quelques racines dans une vieille marmite, sur un feu de bois et à collectionner les reliques d'un monde moderne écroulé.
C'est juste pitoyable et j'en ai encore été le spectateur aujourd'hui sur un forum économique. Je n'ai même pas essayé de participer aux échanges. J'en suis fatigué.
C'est si facile de réduire celui qui pense autrement à un déglingué du bulbe.
Mais bon, comme le dit le dicton populaire, "c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses."
Nous ne sommes pas des identités séparées de tout. Cette idée, c'est celle que Allan Watts a appelé "l'ego encapsulé".
Et c'est à la source de toutes les dérives de l'humanité.
Dans le concept de "croissance verte", de "développement durable", ou dans "l'écomodernisme", il n'est aucunement question de remettre en question ce fonctionnement de l'ego encapsulé. Il s'agit avant tout de le péréniser au mieux. Et c'est bien pour cela que ça n'a pas de sens. Nous continuons à marcher dans la même direction, avec les mêmes objectifs, avec la même "philosophie".
Il n'y aucun changement dans tout ça. Il ne faut donc y espérer aucune solution durable. C'est juste une façon de prendre le problème et de le rejeter un peu plus loin.
Beaucoup répondront que ça n'est pas bien grave. Ils seront morts avant que le véhicule ne bascule dans le fossé. Une preuve supplémentaire de la puissance mortifère de l'ego encapsulé.
-
Allan Watts : Eloge de l'insécurité
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/03/2021
Tout comme Gurdjieff ou bien Ouspensky ou encore René Daumal, Alan Watts fait partie des auteurs qui m'ont considérablement "remué", agité intérieurement, invité à explorer des espaces inconnus, qui m'ont amené à bousculer les certitudes insérées, les enseignements ingurgités comme d'inévitables connaissances quant ils ne sont qu'une soupe commune.
Je reviens à ces lectures de temps en temps, comme une espèce de pélerinage.
Rien chez Alan Watts ne se lit facilement car tout ce qu'il écrit relève de l'inattendu. Soit la curiosité l'emporte et on continue le chemin, soit on s'arrête. Mais il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas cheminer avec lui tout en étant ailleurs.
Cet article de présentation représente une belle page de découverte.
https://revolution-lente.coerrance.org/eloge-de-l-insecurite-alan-watts.php
Éloge de l’insécurité - Alan Watts
« Essayer de tout comprendre en fonction de la mémoire, du passé et des écrits, c’est comme avoir vécu l’essentiel de sa vie, le nez dans un guide touristique, sans jamais regarder le paysage. »
« Chercher l’éveil, c’est comme utiliser ses lunettes pour les chercher. »
Le livre Éloge de l’insécurité
Éditions Petite Bibliothèque Payot, février 2005. Titre original : The Wisdom of Insecurity (Vintage Books) (1951) Traduit de l'anglais (États-Unis) par Benjamin Guérif
Quatrième de couverture
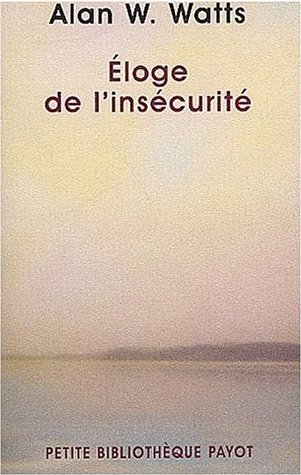
QUATRIEME DE COUVERURE
"J'ai toujours été fasciné par la loi de l'effort inverse : quand vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez ; mais quand vous essayez de couler, vous flottez. Mon livre explore cette loi en l'appliquant à la recherche par l'homme de la sécurité psychologique, et à ses efforts pour trouver des certitudes spirituelles et intellectuelles dans la religion et la philosophie. Écrit avec la conviction qu'aucun thème ne pourrait être mieux approprié à une époque où la vie humaine semble particulièrement précaire et aléatoire, il soutient que pareille insécurité résulte de la volonté d'atteindre cette sécurité, et que, a contrario, salut et bon sens consistent à reconnaître le plus radicalement possible que nous n'avons aucun moyen d'assurer notre propre salut." — Alan Watts.
Un livre revigorant, par l'un des "pères" de la contre-culture aux États-Unis, qui figure en bonne place dans Les Livres de ma vie de Henry Miller.
Éloge de l’insécurité montre comment cette loi régit notre quête d’une sécurité psychologique et les efforts que nous déployons pour trouver des certitudes spirituelles et intellectuelles dans la religion et la philosophie. Ce livre est écrit avec la conviction qu’aucun thème ne pourrait être mieux approprié à une époque où la vie humaine semble particulièrement précaire et aléatoire. Il soutient que cette insécurité résulte de la volonté d’atteindre la sécurité et que, a contrario, salut et bon sens consistent à reconnaître le plus radicalement possible que nous n’avons aucun moyen d’assurer notre propre salut.
Voilà qui commence à ressembler à un extrait de Alice au Pays des Merveilles, dont ce livre est une sorte d’équivalent philosophique. Car le lecteur se trouvera fréquemment dans un monde sens dessus dessous, où l’ordre normal des choses paraît complètement inversé. Ceux qui ont lu certains de mes livres trouveront ici des éléments qui semblent en contradiction totale avec bien des choses que j’ai dites précédemment. Ce n’est cependant vrai que sur des points mineurs. Car j’ai découvert que l’essence même de ce que j’essayais de dire dans ces livres était rarement comprise, l’ossature et le contexte de ma pensée en cachant souvent la signification. Mon intention ici est d’approcher cette même signification à partir de prémices entièrement différents, et en des termes qui ne confondraient pas la pensée avec les multiples associations non pertinentes que le temps et la tradition leur ont attaché.
Dans ces livres, j’avais le souci de défendre certains principes de religion, philosophie et métaphysique en les réinterprétant. C’était, je pense, superflu, inutile et propre à semer la confusion, car seules les vérités douteuses ont besoin d’être défendues. Ce livre, quoi qu’il en soit, est dans l’esprit du sage chinois Lao-Tseu, maître de la loi de l’effort inverse, qui a déclaré que ceux qui se justifient ne convainquent pas, que pour connaître la vérité on doit se débarrasser de la connaissance, et que rien n’est plus puissant et créatif que le vide, qui suscite l’aversion de l’homme. Ainsi, mon but est de montrer ici, à la mode du rebours, que ces réalités essentielles de la religion et de la métaphysique sont défendues lorsqu’on les ignore, et démontrées quand elles sont détruites.
Je suis heureux de reconnaître que le projet de ce livre a pu être mené à bien grâce à la générosité de la fondation créée par le New-Yorkais Franklin J. Matchette à la fin de sa vie, un homme qui consacra une grande partie de son existence à la science et à la métaphysique, un de ces rares hommes d’affaires qui n’a pas complètement été absorbé dans le cercle vicieux consistant à faire de l’argent pour faire de l’argent pour faire de l’argent. C’est pour cette raison que la Fondation Matchette est dévolue au développement des études métaphysiques, et, inutile de le dire, c’est pour moi un signe de perspicacité et d’imagination de la part de ses dirigeants qu’ils aient bien voulu s’intéresser à une approche si "contraire" de la connaissance métaphysique.Alan W. Watts
Interview par Jacques Mousseau, septembre 1968
Source : chronophonix.blogspot.com
Le Nouveau Planète
Initialement publié dans le numéro 2 de la revue "Le nouveau planète" en septembre 1968, voici un entretien avec Alan Watts par Jacques Mousseau, qui nous montre que les préoccupations socio-spirituelles d’il y a 40 ans n’ont pas tellement changé…
À travers l’œuvre d’Alan Watts court la préoccupation de jeter un pont entre pensée occidentale et pensée orientale.
En Amérique, Alan Watts est devenu l’un des maîtres à penser de la jeunesse, non seulement des hippies de San Francisco et de New York, mais des étudiants des campus. Watts n’est pas allé au devant des consciences révoltées ou inquiètes. Depuis près de 30 ans, il poursuit la même quête. Soudain, sa vision du monde et de l’homme a rencontré la sourde interrogation qui s’élève de la jeunesse des deux continents.
Quantité d’étudiants viennent frapper à la porte du vieux ferry-boat dont il a fait sa demeure dans la baie de Sausalito. Ils assistent à ses séminaires de philosophie comparée. Ils l’accueillent dans leurs journaux et périodiques. The Oracle a organisé un débat entre le philosophe et Hermann Kahn, l’homme qui calcule des modèles de sociétés technologiques futures.
Alan Watts a passé le printemps et le début de l’été à se déplacer de campus en campus, où il parlait plus d’une philosophie de la vie, d’un art de vivre, qu’il ne faisait d’exposés dogmatiques sur tel ou tel système de pensée. Alan Watts, né le 6 janvier 1915, à Chislehurt (Grande-Bretagne), est docteur en philosophie et docteur en théologie. Avant d’émigrer d’Angleterre aux États-Unis, peu avant la guerre, il était pasteur de l’Église anglicane. Après avoir abandonné son ministère, il a passé plusieurs années au Japon où il a étudié le bouddhisme zen. Depuis la guerre, il a enseigné dans les universités américaines de Harvard, Cornell, Hawaii. Des millions d’auditeurs suivent ses conférences à la radio. Enfin, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la philosophie et la religion comparées.
PLANÈTE — Vous vous êtes consacré à l’étude des philosophies et des religions orientales. Par curiosité ?
 Alan Watts — Mon intérêt pour la philosophie orientale ne tient pas à l’exotisme. Il tient au fait qu’il ne s’agit pas d’une philosophie au sens où nous l’entendons en Occident. La philosophie occidentale est spéculative. C’est un échafaudage de théories concernant la nature de l’être et la nature de la connaissance, uniquement basées sur des mots. La philosophie orientale, en revanche, est empirique. C’est une expérience. Son but fondamental est de modifier la conscience de telle sorte que l’individu puisse connaître une expérience de lui-même différente de celle qu’on appelle normale. L’expérience normale de nous-même est déterminée par la culture dans laquelle nous vivons. Chaque culture est comme un jeu par lequel nous jouons la vie de diverses manières : il y a le jeu de la girafe, le jeu de l’hippopotame, le jeu du kangourou, et il existe différents jeux humains. Certains de ces jeux ne vont pas : leurs règles sont en contradiction avec elles-mêmes. Lorsqu’un jeu humain se trouve placé sur ce que j’appelle une trajectoire à collision, il risque de détruire la planète. Ce jeu est mauvais. Alors nous avons besoin de sentiments nouveaux, de règles nouvelles, de concepts nouveaux pour définir ce que signifie être en vie, ce que signifie être un homme. En d’autres termes, nous avons besoin de cesser de nous considérer, ici, comme des étrangers dans un monde étranger. Telle est mon idée de base.
Alan Watts — Mon intérêt pour la philosophie orientale ne tient pas à l’exotisme. Il tient au fait qu’il ne s’agit pas d’une philosophie au sens où nous l’entendons en Occident. La philosophie occidentale est spéculative. C’est un échafaudage de théories concernant la nature de l’être et la nature de la connaissance, uniquement basées sur des mots. La philosophie orientale, en revanche, est empirique. C’est une expérience. Son but fondamental est de modifier la conscience de telle sorte que l’individu puisse connaître une expérience de lui-même différente de celle qu’on appelle normale. L’expérience normale de nous-même est déterminée par la culture dans laquelle nous vivons. Chaque culture est comme un jeu par lequel nous jouons la vie de diverses manières : il y a le jeu de la girafe, le jeu de l’hippopotame, le jeu du kangourou, et il existe différents jeux humains. Certains de ces jeux ne vont pas : leurs règles sont en contradiction avec elles-mêmes. Lorsqu’un jeu humain se trouve placé sur ce que j’appelle une trajectoire à collision, il risque de détruire la planète. Ce jeu est mauvais. Alors nous avons besoin de sentiments nouveaux, de règles nouvelles, de concepts nouveaux pour définir ce que signifie être en vie, ce que signifie être un homme. En d’autres termes, nous avons besoin de cesser de nous considérer, ici, comme des étrangers dans un monde étranger. Telle est mon idée de base.
P. — Pourquoi pensez-vous que le mode de penser et d’agir de l’Occident constitue une menace pour la planète ?
A.W. — L’Occidental parle de son action dans l’univers en termes d’agression ou de conquête. Il escalade une montagne : il dit qu’il la conquiert. Il guérit une maladie : il dit qu’il la vainc. Alors qu’au contraire il faut, pour guérir une maladie, non la maîtriser avec violence, mais apprendre à coopérer avec elle. Il faut apprendre à aimer ces bactéries dont nous avons besoin lorsqu’elles ne sont pas destructrices. Nous ne comprenons pas cet aspect du réel. Le résultat c’est qu’au lieu de civiliser le monde, nous sommes en train de le « losangéliser », car Los Angeles est l’un des exemples les plus terrifiants de perversion technologique.
P. — Losangéliser, c’est un fameux néologisme ! Vous pensez avoir trouvé dans la philosophie orientale les recettes d’une attitude meilleure ?
A.W. — Je le crois. Vous allez me demander pourquoi les Orientaux ne l’utilisent pas eux-mêmes ?
P. — Naturellement.
A.W. — Parce que notre civilisation leur a tourné la tête. Le pays d’Orient que je -connais le mieux est le Japon. C’est un curieux endroit : dans les restaurants, on peut voir tous les Américains manger de la cuisine japonaise et tous les Japonais manger de la cuisine européenne. Les Américains aiment s’intégrer au cadre japonais et les Japonais idéalisent tout ce qui vient d’Amérique. Les hommes d’affaires japonais s’habillent exactement comme les directeurs d’IBM : complets noirs, cravates noires. Ils oublient qu’ils ont inventé le seul costume masculin confortable : le kimono. Il est agréable et reposant à porter. Seulement, un Japonais m’a dit un jour que pour rien au monde il ne sortirait dans Tokyo en kimono. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas courir après un autobus en kimono. Et c’est vrai. En kimono, on est obligé de traîner les pieds paisiblement, ce qui est excellent non seulement pour le corps, mais pour l’esprit. Si nous étions moins obsédés par le temps, par les rendez-vous à prendre, nous aurions une culture au rythme plus lent qui entrerait moins en conflit avec les autres et serait moins impérialiste, moins dominatrice.
P. — Et qu’est ce qui s’est "cassé", selon vous, en Occident ?
A.W. — Le problème est très compliqué. Assurer pour tout le monde nourriture, confort et soins médicaux et fondamentalement une question de technologie.
Jusqu’à la moitié du ’axe siècle, l’Orient et l’Occident en étaient au même point : pas d’égouts, pas de sécurité sociale, des lois et des institutions également barbares.
C’est au milieu du me siècle, avec la révolution industrielle, que nous avons découvert qu’il était possible de donner une chance de survie égale à tous. Cette découverte essentielle, l’Orient ne l’a pas faite pour bon nombre de raisons très complexes. Quant aux raisons pour lesquelles c’est en Occident qu’elle s’est faite en premier, elles n’ont aucun rapport ni avec le christianisme ni avec nos institutions.
P. — Ce que vous dites est singulier ! On pense généralement que c’est la pensée spécifique de l’Occident chrétien qui a permis le progrès et la démocratisation.
A.W. — Le christianisme n’y est pour rien. Avant le XIXe siècle, on chantait dans les églises un cantique qui disait : « Le Seigneur Dieu a créé toutes choses belles et harmonieuses, il a fait les créatures grandes ou petites, le riche dans son château et le pauvre à sa porte, riches ou humbles selon l’ordre qu’il a établi. » Le christianisme a toujours considéré la pauvreté comme allant de soi, au même titre que le Soleil ou la Lune. L’idée d’y changer quelque chose n’a pas germé avant le ’axe siècle et la révolution industrielle, au moment où il est devenu possible d’y remédier. C’est seulement à partir de ce point dans le temps que l’on a pu imaginer un monde d’où la pauvreté aurait disparu.
La difficulté à laquelle on se heurte ensuite n’est pas technique, mais psychologique. Elle naît de ce que les gens ne comprennent pas que l’argent est une fiction. L’idée que l’or est une richesse est une superstition aussi archaïque que la saignée. L’argent n’est qu’un instrument de comptabilité. Chaque nation devrait être une sorte de banque en société anonyme qui ouvrirait à sa population un crédit suffisant pour permettre la circulation de la production. Sinon, comme elle économise du travail, l’automation créera de plus en plus de chômage. Qu’attendait-on des machines, sinon qu’elles travaillent à notre place et qu’elles gagnent notre argent pendant que nous resterions assis au soleil à fumer et à boire du vin ? Mais si la communauté ne distribue pas les richesses à l’homme qui se repose pendant que la machine travaille pour lui, le producteur ne peut plus écouler ses produits. Les machines sont nos esclaves communs, elles ne sentent rien et ne se plaignent pas.
P. — À quoi attribuez-vous le fait que l’Occident ait inventé et fait la révolution industrielle ?
A.W. — Le moteur de l’évolution a été la géographie. Regardez la carte de l’Europe : c’est un colossal système de ports; la Méditerranée à elle toute seule est un port. Les Européens sont des navigateurs, et parce qu’ils voyageaient ils ont pu amalgamer les connaissances qu’ils recueillaient à droite et à gauche. C’est la synthèse de cette diversité de connaissances qui a donné naissance à la technologie. Les Chinois possédaient une foule de connaissances technologiques qu’ils n’ont jamais utilisées. Ils avaient découvert la poudre, mais au lieu de l’employer pour la guerre, ils en ont fait des feux d’artifices; en un sens, on pourrait dire que cela prouve qu’ils étaient plus civilisés que nous. Je suis profondément convaincu que c’est cette qualité de navigateurs propre aux Européens qui leur a permis de faire la révolution industrielle du XIXe siècle.
P. — L’Occident a eu un jour l’audace de prendre le cours des choses naturelles en charge.
A.W. — Oui. C’est le grand saut psychologique. En Asie, on a toujours considéré qu’intervenir dans l’ordre de la nature peut paraître profitable dans l’immédiat, mais que les conséquences lointaines sont menaçantes. Guérir les maladies, c’est parfait, mais que faire si la Terre devient surpeuplée ? Alors l’Orient a adopté une attitude détachée : suivre le cours des choses, mais ne pas tenter de le modifier. Actuellement, en Inde, en Chine, on cherche à copier l’Occident; l’Inde et la Chine veulent s’industrialiser et devenir des états farouchement modernes.
P. — Vous estimez que le revers de médaille de notre civilisation technique est son incapacité à promouvoir une pensée et une action à long terme ?
A.W. — Absolument ! Ce problème est fondamental. Korzybski, le père de la sémantique générale, a qualifié l’humanité de lieuse de temps, parce qu’elle a le sens de l’avenir. Apparemment, les animaux ne le possèdent pas, car ils ne prévoient pas. Les sciences sont, en effet, une forme de prédiction. Mais notre pouvoir de prédiction constitue à la fois un avantage et un désavantage. D’une part, à partir du moment où il peut prévoir, l’homme possède un pouvoir sur l’avenir. D’autre part, il est troublé parce qu’il sait qu’il mourra et qu’il n’a pas d’avenir véritable. C’est un atout déprimant. Alors il se donne dix ans ou un peu plus. Il se décharge des responsabilités plus lointaines sur ses enfants. Ici, par exemple, en Californie, la technologie et l’industrie sont en train de détruire complètement les ressources naturelles du pays. Cette région, que je connais bien, deviendra peut-être un désert, simplement parce que l’être humain n’est pas conscient de ce qu’il n’est pas une chose individuelle enfermée dans un sac de peau. Le remous dans la rivière est un événement isolé qui se produit dans la rivière, mais le remous et la rivière sont inséparables. Il en va de même en ce qui concerne l’être humain. C’est l’une des formes prises par l’énergie, et il est inséparable de son milieu. En écologie, qui est la science des relations entre les organismes et leur milieu environnant, l’organisme s’appelle milieu-organisme, avec un tiret pour bien montrer qu’il n’y a qu’un seul champ de comportement. L’organisme a le comportement de son milieu et le milieu a le comportement de tous les organismes qui y vivent. Mais l’individu n’en est pas conscient. Il se ressent comme un ego isolé dans un sac de peau, à mi-chemin derrière les oreilles et un peu en arrière des yeux. Même son corps ne lui appartient pas. Si vous dites à une fille qu’elle est ravissante, elle vous répondra que c’est bien masculin de ne s’attacher qu’au corps, que ce sont ses parents qui lui ont donné ce corps et qu’elle veut être admirée pour elle-même et non pour son chassis. En quoi elle se définit comme chauffeur ! Elle désavoue son corps, tout le monde désavoue son corps lorsqu’il dit j’ai, et non pas je suis un corps. À partir du moment où l’on est, et non plus où l’on a un corps, il se produit quelque chose d’extraordinaire, parce que le corps, lui, sait qu’il est relié à tout l’univers. Un échange d’énergie se fait continuellement entre ce qu’il y a au dehors et moi qui suis assis ici. Lorsqu’on commence à l’éprouver physiquement, on sait immédiatement qu’il n’existe pas de discontinuité, non seulement entre soi et la montagne que l’on voit par la fenêtre, mais entre soi et le système solaire tout entier, la galaxie dont fait partie le système solaire, toutes les galaxies, et tout à coup on comprend qu’on est ce qui est.
On ne peut pas se soulever de terre en tirant ses lacets de chaussures
P. — D’accord, mais d’où est venue cette attitude de séparation ? N’était-elle pas nécessaire à la connaissance objective ?
A.W. — L’attitude générale de l’Occidental à l’égard de l’univers a pour modèle une structure politique. C’est Dieu le maître, comme dans les sociétés monarchiques le roi est le grand tyran devant qui tous s’inclinent. Même la hiérarchie de l’Église est à l’image d’une cour royale : l’officiant tourne le dos au mur de crainte d’être attaqué, il est entouré de gardes, et l’assistance a le dos courbé, est agenouillée, parce que c’est une position dans laquelle on ne peut pas attaquer. Dieu, donc, a peur. Et cette image politique de Dieu est l’une des maladies dont souffre la culture occidentale. Imaginez. qu’un homme fasse une expérience mystique, soit spontanément, soit avec l’aide du LSD par exemple, qu’il réalise tout à coup qu’il est un avec Dieu, et qu’ensuite il aille dire qu’il est Dieu. Le fait paraîtra intolérable : comment oser prétendre qu’on est Dieu, puisque c’est Dieu le maître de l’univers ? Comment pourrait-on reconnaître un homme comme maître de l’univers entier, s’incliner devant lui et l’adorer ? Alors qu’aux Indes, lorsque quelqu’un vient de découvrir qu’il est Dieu et qu’il l’annonce, on le félicite, au contraire, d’avoir enfin fait cette découverte ! Pour les Orientaux, Dieu n’est pas un maître dominateur, un meneur de jeu politique, au contraire, c’est le danseur, l’acteur du monde, le grand comédien qui joue tous les rôles. L’image de Dieu, dans la culture indienne, étant différente, un individu peut dire qu’il est Dieu.
P. — Seulement, chez nous autres Occidentaux, la conscience la plus vive, c’est la conscience de la mort de Dieu.
A.W. — Je crois qu’il s’agit surtout de la mort d’une certaine idée de Dieu, de ce Dieu chrétien qui est un Dieu politique à l’image des antiques législateurs. C’est la découverte de l’idée orientale du dieu qui me paraît personnellement la seule valable. Je suis émerveillé par la vie, je voudrais pénétrer le mystère de ma propre existence, connaître les racines de ma conscience. Plus je suis convaincu que je suis moi aussi Dieu — mais certes pas le Dieu-Maître — plus cette découverte me paraît dépendre entièrement de l’abandon des images traditionnelles de Dieu. La foi, la vraie, est une ouverture au vrai quel qu’il soit. S’attacher à une image d’un Dieu qui protège l’univers, prend soin de lui, me semble précisément un manque de foi total. On ne peut pas se raccrocher à l’eau pour nager : il faut lui faire confiance. De la même manière, les images mentales de Dieu sont encore plus sournoisement dangereuses que les idoles de bois ou de pierre. Ce qui est mort, ce sont nos anciennes images, nos anciens symboles, nos concepts de Dieu. Dès que nous en serons débarrassés, dès que nos vitres intérieures auront été lavées, nous pourrons enfin voir le vrai ciel et le vrai soleil. Dès le moment où l’on accepte l’idée qu’il n’existe rien derrière quoi s’abriter, ni sécurité, ni certitude, ni compte en banque, ni assurance sur la vie pour tromper sa peur, toute l’énergie mobilisée à se protéger redevient immédiatement disponible pour les choses constructives. Après tout, on ne peut pas se soulever de terre en tirant sur les lacets de ses chaussures.
P. — La conscience occidentale est aussi une conscience individuelle : Mao veut « tuer le moi ». C’est le chemin pour vous ?
A.W. — Les rapports entre boudhisme et révolution culturelle restent à étudier. Mais le message du "non-moi oriental" est pour l’Occident le plus important. Étant donné notre maîtrise dans le domaine technologique et afin que nous puissions utiliser la technologie d’une manière non destructrice, il faut que nous sentions que nous faisons partie d’un courant. Je pense que la plupart des Occidentaux qui sont pris dans l’engrenage de notre civilisation ont un besoin urgent de découvrir qui ils sont, de découvrir que ce qu’ils appellent moi est en continuité avec l’univers physique tout entier. D’où l’intérêt actuel de l’Occident pour l’Orient, et les choses de l’Orient comme le yoga.
P. — Notre culture nous a enfermés dans une contradiction. D’un côté, elle met l’accent sur l’individu. De l’autre, elle fait que, par ses modes de vie collectifs, cet individu se sent écrasé. Nous peinons pour nous adapter à la civilisation que nous-mêmes avons bâtie.
A.W. — Il existe une raison à cela : c’est que notre conception de l’individu est une erreur. Nous nous débattons entre deux notions qui sont en conflit. D’un côté l’homme qui affronte seul les éléments : c’est le pionnier, celui qui a colonisé le Far West. De l’autre côté, l’homme au service de l’État et de la collectivité : c’est l’homme-fourmi. Dans les deux cas, on ignore le fait que l’individu et le monde appartiennent à un même processus. Les doigts de la main peuvent bouger séparément, mais uniquement parce qu’ils font partie de l’organisme. De la même façon, nous sommes, vous et moi, deux personnalités complètement différentes et uniques, mais plus nous faisons partie de l’ensemble, plus nous sommes uniques. Nous appartenons au même organisme, et plus nous le réalisons plus le fait que nous sommes des fonctions du monde devient pour nous une réalité, plus nous devenons capables d’être uniques, différents, individuels.
P. — Pour résoudre nos conflits et d’autres, nous disposons des sciences humaines. Mais est-ce que les psychologues, les psychanalystes et les sociologues sont convenablement outillés pour faire évoluer favorablement l’homme et la société ?
A.W. — Non. Pourtant, je souhaiterais qu’ils le soient. La psychanalyse est devenue une religion, une religion établie, orthodoxe. Tout y est : elle a ses successions apostoliques, ses rites, ses hérétiques et ses hérésies. Jung est à Freud ce qu’Arius est à la tradition chrétienne. On a cherché des preuves statistiques de l’efficacité de la psychanalyse. Selon les statistiques existantes, il faudrait plus de temps pour guérir une névrose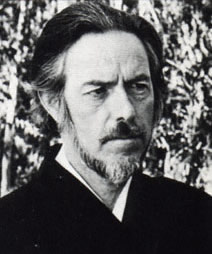 par l’analyse qu’en lui laissant suivre son cours toute seule. La guérison demande trois ans sans analyse et cinq ans avec analyse. Qui plus est, il existe un danger sérieux, du moins aux États-Unis, que la psychanalyse devienne une sorte de centrale fasciste. Les psychiatres détiennent le pouvoir. J’en connais un, un Anglais très brillant qui s’appelle Ronald Laing, qui pense que la schizophrénie est une réaction contre cette culture en folie dans l’engrenage de laquelle nous sommes pris. Voici comment il l’illustre : imaginons qu’un vol d’oiseaux traverse le ciel, que l’un quitte le groupe pour prendre une autre direction. On se posera alors la question : qui va dans la bonne direction ? Et vraiment on ne peut pas le savoir. Ce peut être le groupe aussi bien que l’oiseau qui l’a quitté. De la même manière, Laing estime que le schizophrène est quelqu’un qui, tout simplement, n’est pas en état de supporter la démence de notre culture et qui se trouve condamné à subir des symptômes extrêmement douloureux parce qu’il n’a pas pu s’intégrer. Généralement, lorsqu’un schizophrène entre dans un hôpital psychiatrique, il est étiqueté comme malade et les gens en blouse blanche qui l’approchent lui disent qu’il est un pauvre malheureux. Cependant, au fond de lui-même, il sait bien qu’il n’est pas malade, qu’il est en voie de guérison, tout comme lorsqu’on a de la fièvre.
par l’analyse qu’en lui laissant suivre son cours toute seule. La guérison demande trois ans sans analyse et cinq ans avec analyse. Qui plus est, il existe un danger sérieux, du moins aux États-Unis, que la psychanalyse devienne une sorte de centrale fasciste. Les psychiatres détiennent le pouvoir. J’en connais un, un Anglais très brillant qui s’appelle Ronald Laing, qui pense que la schizophrénie est une réaction contre cette culture en folie dans l’engrenage de laquelle nous sommes pris. Voici comment il l’illustre : imaginons qu’un vol d’oiseaux traverse le ciel, que l’un quitte le groupe pour prendre une autre direction. On se posera alors la question : qui va dans la bonne direction ? Et vraiment on ne peut pas le savoir. Ce peut être le groupe aussi bien que l’oiseau qui l’a quitté. De la même manière, Laing estime que le schizophrène est quelqu’un qui, tout simplement, n’est pas en état de supporter la démence de notre culture et qui se trouve condamné à subir des symptômes extrêmement douloureux parce qu’il n’a pas pu s’intégrer. Généralement, lorsqu’un schizophrène entre dans un hôpital psychiatrique, il est étiqueté comme malade et les gens en blouse blanche qui l’approchent lui disent qu’il est un pauvre malheureux. Cependant, au fond de lui-même, il sait bien qu’il n’est pas malade, qu’il est en voie de guérison, tout comme lorsqu’on a de la fièvre.
Car la fièvre non plus n’est pas une maladie mais un processus de guérison. Laing suggère de remplacer les hôpitaux psychiatriques par des institutions d’un genre totalement différent où, au lieu de porter des blouses blanches et de considérer le malade comme un individu socialement déchu, les médecins et les infirmières lui diraient : « Toutes nos félicitations : soyez le bienvenu. Vous êtes actuellement en train de subir un processus pénible, mais il conduit vers un état de meilleure santé mentale et nous sommes ici pour vous y aider.» Ronald Laing dirige un petit hôpital privé dans ce genre à Londres. Mais ses rapports avec les autres psychiatres sont négatifs. On peut, à présent, se permettre d’être un hérétique en religion, car on n’attache plus beaucoup d’importance aux hérésies religieuses, mais en psychiatrie, c’est grave et dangereux.
P. — La civilisation occidentale est à vocation hégémonique. Elle est devenue si puissante que nous pouvons très bientôt n’avoir plus au monde qu’une unique culture. D’accord ? C’est un péril ou une chance planétaire ?
A.W. — Un penseur prophétisait, il y a quelques années, qu’en 1968 — c’est-à-dire maintenant — le monde ne serait plus qu’une ville unique, ce qui est presque vrai. Les moyens de communication — radio, transports aériens — tendent à abolir les distances, et les villes les plus éloignées se ressemblent de plus en plus. Londres, Paris, San Francisco, New York, Tokyo et Hong-Kong possèdent chacune leur Hilton. Les langues mêmes se mélangent au point de donner du franglais, du japlish, et ainsi naît une culture uniformisée de la technologie industrielle.
Quant au danger que peut comporter une telle civilisation, la question vaut en effet la peine d’être posée… Il n’y a pas si longtemps, un groupe de généticiens de l’université de Californie avaient soulevé une question parallèle : si nous parvenons à fabriquer des individus de série comme nous fabriquons des avions de série, nous aurons trouvé la meilleure manière de répondre à nos besoins, c’est-à-dire que nous aurions, en fonction du modèle considéré, l’individu le mieux adapté. Mais adapté à quoi ? Pionnier pour défricher le Far West, ou travailleur d’équipe capable de s’intégrer dans le contexte moderne des grandes villes industrielles ? Car, avant tout, nous ignorons de quel type d’individu nous aurons besoin, parce que les conditions se modifient très vite et très brusquement. D’où la nécessité de préserver la variété des cultures existantes.
Le touriste cherche le dépaysement. Il cherche l’inconnu et la couleur locale et, lorsqu’il voyage, veut savoir si le lieu où il se rend est déjà « abîmé », c’est-à-dire s’il ressemble à ce qu’il quitte. Les Japonais conservent quelques réserves de couleur locale à l’intention des touristes, alors qu’eux- mêmes ne rêvent que de vie à l’américaine. Cependant, ces touristes ne sont plus convaincus, ni par les geishas ni par les maisons de thé. Ils savent qu’ils assistent à un spectacle, à une mise en scène et que la véritable tradition s’est coupée de ses racines. Il ne reste plus qu’un décor préservé à leur usage. Le tourisme est un exemple de ces mécanismes d’auto-neutralisation. Il y perd sa raison d’être.
P. — Seulement, à ce durcissement généralisé peut correspondre le désir d’un nouvel enracinement dans la vie spirituelle. Et c’est peut-être dans nos pays, déjà vaccinés contre les enthousiasmes de la modernisation, que ce désir se manifestera.
A.W. — D’ici quelques années, des autoroutes immenses sillonneront l’Asie, on y roulera en Ford, vêtu à l’européenne, on y trouvera des hot-dogs. Mais, au même moment, aux États-Unis, apparaîtront des lamaseries, des moines, des ashrams, dont les hippies sont les annonciateurs…
L’argent n’est rien, ce n’est pas la richesse,
P. — Les hippies : vous croyez à leur avenir ?
A.W. Oui. Ils ont vu ce que la civilisation de l’Occident a apporté à leurs parents. Ils n’en veulent pas. Cela ira loin. Le problème de l’Occident est la confusion du symbole avec la réalité. Le pain par exemple, qui est le symbole de la vie même, n’est qu’une sorte de matière plastique à base de blé, additionnée de vitamines.
Nos maisons mêmes sont mal construites parce que le travail n’est pas fait honnêtement — et ne peut l’être. Il est impossible dans ce système pour un ouvrier ou un artisan qui connaît et aime son métier de gagner sa vie, car on attend et exige de lui du travail bâclé. De même, il s’est créé une confusion entre argent et richesse, alors qu’en réalité l’argent sert à mesurer la richesse, exactement comme les centimètres servent à mesurer le bois ou le métal. Cette confusion a d’ailleurs considérablement freiné l’évolution technologique. Le but de la technologie, je l’ai dit, est en effet de faire exécuter par les machines les travaux ennuyeux qui sont actuellement le gagne-pain de la plupart des gens — ce qui est effectivement devenu possible. Quoi faire alors des gens ? Si on identifie argent et richesse, la question de payer les hommes pour le travail exécuté par les machines ne peut pas se poser. Si d’autre part on accepte de les payer tout de même, on va inévitablement se demander d’où viendra désormais l’argent. En fait c’est une question absurde, car l’argent, pas plus que les centimètres, n’est jamais venu de nulle part, au contraire du bois, de l’énergie hydro-électrique ou du minerai de fer. Mais l’argent n’est qu’une comptabilité sur papier des richesses d’une communauté, d’un territoire ou d’une nation. S’il n’existe plus de salaires, c’est-à-dire en fin de compte si le pays ne se paie plus à lui- même le travail fait par ses machines, il ne pourra plus écouler ses produits faute de pouvoir d’achat. C’est une chose extrêmement difficile à faire comprendre aux gens et pourtant c’est le seul système qui puisse fonctionner. Si chaque représentant de la race humaine recevait un revenu national garanti correspondant au travail accompli par les machines, immédiatement se poserait un problème d’inflation, car les prix ne cesseraient de monter pour capter le nouvel argent — alors qu’en réalité la hausse des prix ne fait que réduire la valeur de l’unité monétaire — et nous entrerions dans le cercle vicieux : hausse des prix, revendications syndicales, augmentations de salaires, nouvelle hausse des prix, etc. Quant aux gens très riches, le profit qu’ils peuvent en tirer est purement illusoire, parce qu’il ne leur est pas vraiment possible de jouir de leur richesse. Comment vivre dans six maisons à la fois, ou manger douze rôtis à un seul repas ? Il y a des limites à la capacité de consommation. En revanche, dès le moment où l’on confond argent et richesse, il n’existe plus de limites et l’on devient insatiable, bien que la possession d’une énorme quantité d’argent n’apporte strictement rien.
P. — Vos hippies, selon Toynbee, sont quelque chose comme les premiers chrétiens dans l’Empire romain. Ils sont, en gros, pour le jardinier contre l’ingénieur, c’est-à-dire pour l’homme vrai, qui n’est pas nécessairement un intellectuel ou un technicien utile au rendement. C’est ainsi que vous les voyez ? Et surgis du pays le plus fortement technologique !
A.W. — Aux États-Unis, je vais beaucoup dans les universités et dans les collèges. Il existe encore, bien sûr, une proportion importante de conformistes parmi les jeunes, mais j’ai néanmoins le sentiment qu’il s’est produit une mutation, et une mutation qui est l’avènement d’une nouvelle race, supérieurement intelligente, extrêmement cultivée, très avertie, et qui sait exactement comment employer son savoir. Aux États-Unis, les hippies sont parmi ce qu’il y a de plus doué. Cette jeunesse devrait le mieux réussir dans le monde académique, sauf qu’apparemment ce monde n’est pas à sa hauteur parce qu’il n’est organisé que pour approvisionner l’industrie en personnel de qualité. Nos hippies ne veulent ni de cela ni de la vie de famille telle qu’ils l’ont vécue chez leurs parents, où les individus sont isolés sans liens entre eux, sans relations. Jadis, la famille vivait autour d’une réalité — ferme ou boutique — où chacun avait sa place et son rôle, y compris les enfants, où le fils était apprenti chez son père. Cette tradition appartient au passé de la civilisation. On va à l’école pour recevoir une éducation superficielle et livresque qui peut tout au plus — et pourquoi pas — donner à un fils d’ouvrier l’ambition de devenir un intellectuel, mais qui enlève le sens des vrais métiers utiles (utiles à l’homme), comme s’il était indigne d’un humain d’être autre chose qu’un intellectuel, de faire le moindre travail non cérébral. Le résultat est que des métiers comme ceux de cuisinier, de coiffeur, de masseur, de chauffeur sont de plus en plus abandonnés aux machines qui, pourtant, ne possèdent ni discernement ni sensibilité. Le sens, le goût, l’habileté de l’artisanat disparaissent avec les petits métiers. Il existe cinq façons de communiquer avec le monde : cultiver la terre, cuisiner, travailler pour se vêtir, avoir un toit où s’abriter et faire l’amour. Autant dire que dans notre univers technologique, nous sommes loin de ces moyens de communication avec le monde matériel.
P. — On parlera de cet amour à refaire )) une autre fois. De l’amour physique comme extase, relation et connaissance. C’est un de vos sujets favoris. Mais voilà que vous écrivez un bouquin : le Philosophe dans la cuisine. La cuisine est à réhabiliter, comme l’amour ?
A.W. — Oui. Toute relation à la chair doit être réhabilitée, parce qu’elle est le chemin de la relation à l’univers entier. Les Chinois sont de vrais matérialistes, depuis des centaines d’années, les Français aussi d’ailleurs, bien que venant loin derrière : ils aiment la terre, ils en sont très proches : ce sont de merveilleux cuisiniers. Le fourneau qui sert à cuire les aliments est l’autel où s’accomplit la transformation d’une forme de vie en une autre. Le philosophe moderne Lin U Tan disait qu’un poisson mal préparé avait donné sa vie en vain. Si l’on est obligé de tuer pour vivre (et nous voici devant l’alternative : meurtre ou suicide), alors il faut le faire avec un immense respect. Ici, en Occident, on se nourrit à toute vitesse — bientôt les repas seront composés de comprimés - pour satisfaire les besoins fondamentaux en hydrocarbones, en protéines et en vitamines, mais on ne mange plus.
P. — Le grand sens du soulèvement de la jeunesse, c’est le passage d’une connaissance quantitative à la volonté d’une expérience de soi qualitative. C’est bien cela pour vous ?
A.W. — Oui. Le moment où les gens seront payés pour ne pas travailler approche très vite. Le marché du travail est saturé. Par la force des choses, l’école revient à son antique rôle : n’ayant pas besoin de travailler pour vivre, on peut se mettre en quête du savoir. À l’heure actuelle, ce qu’on intitule « recherche » consiste surtout à couper les cheveux en quatre. Mais les étudiants ont compris qu’ils perdent leur temps à accumuler des connaissances. Ils veulent vivre la complexité de l’expérience. D’où leur attirance pour les hallucinogènes, les religions orientales, les techniques de méditation, tout ce qui ouvre de nouveaux champs de conscience, de modes de perception. D’où aussi ce besoin de faire à plein l’expérience sexuelle. En musique, ce sont des gens comme les Beatles qui succèdent à Bach, Mozart et Stravinsky, et non pas les compositeurs professionnels et traditionnels. La poésie a été retrouvée grâce à Bob Dylan, Donovan : cette poésie qui se desséchait a maintenant des millions d’auditeurs. Des vieux métiers comme celui de luthier redeviennent actuels. J’ai vu récemment des guitares incrustées d’ivoire, comme on n’en avait plus vu depuis la Renaissance italienne, fabriquées par des hippies. C’est d’ailleurs ce qui est fascinant dans l’art de cette jeunesse : le retour au raffinement de l’artisanat véritable. On redécouvre la couleur, l’exubérance, la précision et le sens du détail, comme du temps des miniatures persanes ou celtiques, des œuvres monastiques du Moyen Age français, des émaux de Limoges et des vitraux de Chartres.
P. — Dernière question : vous vous considérez comme un philosophe, un homme religieux ou un gourou occidental ?
A.W. — Je suis philosophe, mais un philosophe qui ne construit pas un système intellectuel, un philosophe qui vit sa philosophie. Je ne suis pas prédicateur : je ne veux ni convertir ni changer personne. Je ne philosophe pas pour la gloire de la philosophie mais parce que je suis émerveillé par le monde et que j’ai envie de faire partager cet émerveillement.
Alan Watts
Biographie d’Alan Watts, par Jean-Claude St-Louis, 28 août 2005
Source : albertportail.info
Auteur et conférencier fécond, Alan Watts est connu pour ses nombreux ouvrages sur le christianisme, le zen, l’hindouisme et le taoïsme, dont "Le Bouddhisme zen", devenu un classique. Originaire de Grande-Bretagne, Watts fut chapelain de la Northwestern University durant la seconde guerre mondiale. À la suite de la publication, en 1947, de son livre "Face à Dieu", il quitta l’Angleterre pour se rendre en Californie, où il enseigna à l’Académie d’études asiatiques de San Francisco, aux côtés du dr. Frederick Spiegelberg.
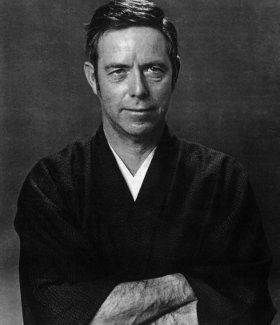
Trois ans plus tard, à Berkeley, débutait sur les ondes de la KPFA, la série d’émissions "Au-delà de l’Occident". Ces chroniques radiophoniques d’Alan Watts connurent un tel succès dans le quartier de Bay Area, à San Francisco, que la KPFA en poursuivit la diffusion durant trente ans. D’autres stations de Pacifica accueillirent régulièrement ce programme dominical, soit à Los Angeles, New York et Boston. Vers la fin des années soixante et à l’orée des années soixante-dix, ce programme reçut le surnom d’"Antidote à la gueule de bois". Pendant cette période, les ouvrages de Watts attirèrent maintes fois l’attention du Los Angeles Times qui, dans ses pages littéraires, qualifia l’auteur en ces termes : "Alan Watts est sans doute l’interprète le plus éminent de la pensée orientale que nous ayons en Occident".
Dans le pays tout entier, universités, centres de séminaire et mouvements religieux d’avant-garde, accueillirent régulièrement le conférencier. À cette époque, les émissions dominicales, précédemment enregistrées aux studios de la KPFA, étaient désormais diffusées en direct et le présentateur de radio se transforma en un orateur plein d’entrain, ce qui valut à Watts, une réputation de philosophe amuseur. Lorsqu’il s’éteignit dans son sommeil en 1973, Alan Watts était attelé à l’écriture d’un ouvrage sur le taoïsme. Selon Watts, le monde n’est pas l’œuvre d’une entité suprême à visage humain, mais une réalité "qui va de soi". Telle était la conception de l’univers qu’il privilégiait. La sagesse qui consiste à ne pas contrarier le "cours des choses", afin de remédier au désordre écologique, avait trouvé chez lui, un écho profond. Watts se référait d’ailleurs à un "organisme-environnement", plus proche du "nous" que du "je".
Dans son livre "La Philosophie du Tao", paru en juillet 1953, Alan Watts démontre dans son introduction "De la synthèse philosophique", que le ton n’est plus le même et ce changement est révélateur de son évolution. En effet, Watts s’éloigna du cadre académique dans lequel il avait abordé ces questions, pour aboutir à l’expérience vécue, ce qui lui permit d’y répondre. Ainsi que l’écrivait la poétesse Elisa Gidlow, pour rendre compte du cheminement d’Alan Watts dans l’esprit du Tao : "il s’en imprégna jusqu’à la métamorphose ; à l’âge mûr, le jeune anglais réservé, un peu collet monté et confiné dans son univers intellectuel, était devenu un sage joyeux, un penseur universel, qui se distinguait par son ouverture d’esprit et sa spontanéité-espiègle". Alan Watts espérait que le Tao, administré à doses massives, parviendrait peut-être, dans sa profonde sagesse, à faire évoluer l’Occident, comme lui-même avait évolué.
Alan Watts reste, dans le monde anglo-saxon, un des penseurs et interprètes les plus respectés de la pensée orientale. À travers une vingtaine de livres, deux séries d’émissions de télévision, ainsi que de nombreuses conférences, il aura contribué à lever le voile sur les philosophies liées à l’hindouisme, au bouddhisme, au taoïsme et au zen. Pour Alan Watts, le zen est une fusion de l’être humain avec l’univers. La vie est la Voie et la Voie est la vie ! Le secret du zen est une transmission spéciale en dehors des Écritures, ne dépendant ni des mots, ni des lettres, destinée directement à l’esprit de l’homme.
Alan Watts, héraut de la contre-culture
Article sur Nouvelles-Clés Par Gilles Farcet : Nouvelles-Clés
Alan Watts fut l’un des papes de la contre culture-américaine dans les années soixante et son œuvre était très lue en Europe. Puis, précocement disparu à cinquante-huit ans, il entra dans une sorte d’oubli, ce qu’on appelle "l’enfer" des écrivains. On redécouvre aujourd’hui peu à peu son message de philosophe spirituel et libertaire.
Alan Wilson Watts était un drôle de bonhomme : un homme du paradoxe, à bien des égards. Jouisseur et ascète, érudit et communiquant de masse, l’âme chrétienne et le regard bouddhiste, contestataire icône de la contre-culture et connaisseur des traditions, Britannique de naissance, d’accent et de style en même temps que Californien invétéré... Et, à l’instar de bien des hommes du paradoxe, Watts était un visionnaire, précurseur et révolutionnaire de la conscience.
C’est en 1915 qu’il voit le jour à Chislehurst, un village du Kent. La campagne anglaise dans toute sa splendeur et, surtout, partie intégrante de la maison familiale, un jardin potager qui décidera de sa position d’écologiste avant la lettre. Il demeurera toute sa vie un grand amateur de nature et de jardinage. Entré en 1928 à la King’s School de Canterbury, il y reçoit une éducation censée faire de lui un parfait gentleman britannique. Aux sermons des ecclésiastiques anglicans chargés de l’éclairer sur son salut, il préfère les leçons pratiques du père d’un de ses camarades de classe, qui entreprend de l’initier aux plaisirs de la gastronomie lors d’un voyage sur le continent. Là aussi, la leçon sera déterminante. Watts affichera jusqu’à sa mort un goût prononcé pour la bonne chère, les vins et alcools fins, les cigares, plaisirs sensuels qui, pour lui, non seulement n’entrent pas en conflit avec la quête mystique, mais en constituent un aspect. Pour Watts, la spiritualité est amour de la vie et la vie se goûte à travers les sens associés à l’esprit et non uniquement par l’esprit.
Autre initiation majeure dispensée par ce père, décidément fort éclairé, la découverte du bouddhisme. Rappelons qu’en ce début des années trente, s’intéresser au bouddhisme est tout à fait inhabituel et incongru. Il n’existe que fort peu d’ouvrages accessibles sur cette religion exotique et les roshis ou rimpochés sont alors inconnus au bataillon de la culture anglaise, sinon de quelques poussiéreux orientalistes. Il existe néanmoins à Londres une « Société bouddhiste », à laquelle l’adolescent s’empresse d’adhérer et qui lui permettra de découvrir les textes fondateurs.
Avant ses dix-huit ans, Alan Watts est déjà ce qu’il demeurera toute sa vie : un bouddhiste épicurien.
Un esprit éclectique
Ne pouvant espérer entrer à Oxford du fait des modestes moyens de sa famille et de son peu de chance d’obtenir une bourse, compte tenu de son excentricité peu appréciée à King’s School, il prend un emploi de gratte-papier et poursuit son éducation au gré des rencontres, assistant à des conférences de Carl Gustav Jung et fréquentant assidûment l’une des rares librairies ésotériques de Londres. En 1936, il fait la découverte capitale des livres de D.T. Suzuki, qu’il rencontre même lors du Congrès mondial des religions. C’est dans l’émerveillement de cette initiation théorique au zen, qu’avec précocité il rédige son premier ouvrage, L’Esprit du zen, résumé des célèbres Essais sur le bouddhisme zen de Suzuki. Il assiste également à cette époque à des conférences de Krishnamurti dont il deviendra plus tard un proche en Californie. C’est cette même année qu’il fait la connaissance d’une jeune Américaine, Eleonore Everett, de retour du Japon, où elle a visité plusieurs monastères zen en compagnie de sa mère.
Mariés en 1937, ils traversent l’océan pour s’établir à New York avec le soutien financier de la belle-mère, alors épouse d’un riche avocat. La belle-mère en question sera bientôt l’une des premières pratiquantes sérieuses du zen Rinzaï en Amérique. À la mort de son premier mari, elle épousera son maître, Sokeï-an Sasaki, devenant ainsi Ruth Fuller Sasaki et, en tant que seule prêtresse rinzaï américaine dûment ordonnée au Japon, jouera un rôle déterminant pour la propagation du zen dans le Nouveau Monde. Par sa belle-mère, Watts rencontre Sasaki dont il sera très proche trois années durant, jusqu’à ce que la guerre et l’emprisonnement par le gouvernement américain des Japonais vivant aux États-Unis interrompe cette éducation.
En 1940, à la surprise, pour ne pas dire la consternation de son cercle d’amis, Watts entre dans l’église Episcopalienne, très puissante aux USA, qui admet les prêtres mariés. Il sera ordonné en 1945. « La plupart pensaient - écrira-t-il dans ses mémoires - que j’avais perdu le nord. Je dirais plutôt que j’essayais désespérément de le trouver. »
Une conversion pragmatique
Si surprenante qu’elle paraisse, cette « conversion » aboutissant au sacerdoce participe d’une logique : dépourvu de diplômes, bien que doté d’une culture déjà encyclopédique, ne s’intéressant qu’à la religion au sens le plus vaste du terme, Watts est un jeune homme qui cherche une manière acceptable de s’insérer dans la société. Son svadharma, comme diraient les hindous, sa vocation véritable, est bien celle d’un « prêtre », d’un homme voué à témoigner de l’essentiel. Convaincu par ailleurs de l’importance et de la valeur de ses racines chrétiennes, il voit à l’époque dans la prêtrise la possibilité concrète de jouer le rôle qui lui correspond au sein de la communauté. C’est aussi en 1940 que paraît son premier livre écrit et publié aux États-Unis, La Signification du bonheur, dans lequel il se livre avec brio à une étude comparée des sagesses orientales et de la psychologie contemporaine.
Aumonier de l’université Northwestem, près de Chicago, il fascine nombre d’étudiants par son ministère peu conventionnel, mais s’attire dans le même temps, comme on pouvait le prévoir, la suspicion appuyée des autorités de son Église, qui ne reconnaissent pas leur dogme dans le « panthéisme » du père Watts. Il fait ainsi quelques années le grand écart entre ses convictions et leur version socialement correcte. Cette position finit cependant par devenir intenable, si bien qu’en 1950, cinq ans après son ordination, il se « défroque » et quitte à jamais le sein de mère Église. Dans une longue lettre adressée à ses étudiants et amis, il admet y être entré pour « fuir la confusion de notre époque en cherchant refuge dans une sorte de nostalgie »,et met en garde quiconque prétendrait l’imiter : « Vous ne pouvez pas agir correctement en imitant les actions de quelqu’un d’autre. »
Le voici donc électron libre, retiré quelques mois à la campagne où il pratique le noble art de la cuisine et écrit Bienheureuse Insécurité, en compagnie d’Antonietta, qui deviendra sa seconde femme. Le message essentiel - et, à l’époque, révolutionnaire - de cet ouvrage est la nécessité de l’abandon à l’instant présent, unique porte du paradis, et la récusation de toute prétention à figer Dieu en un concept. En 1951, il trouve refuge au sein d’une institution comme seule en crée l’Amérique, l’Académie des études asiatiques, en Californie, qui lui confère un statut de professeur sans qu’il en possède les diplômes.
Désormais et jusqu’à sa mort, Californien, établi à Mill Valley, il se trouve aux premières loges pour assister à la mutation des consciences qui couve déjà, et bientôt y participer en tant qu’inspirateur de premier plan. En 1953, il publie l’un de ses ouvrages majeurs, Mythe et Rituel dans le christianisme. Fort de sa grande connaissance de la liturgie combinée à son esprit zen, Watts dresse un réquisitoire d’une religion dégénérée trop imprégnée de l’idée moderne de « progrès », et chante la beauté d’une version primitive et écologique du christianisme.
À l’Académie, sous couvert de cours portant sur le ch’an chinois, il partage surtout sa quête et sa pratique de la reliance à ce qui est, invitant D.T. Suzuki, ou emmenant ses élèves écouter Krishnamurti.
Il a pour étudiant et admirateur le futur poète beat et moine zen Gary Snyder, dont son ami Jack Kerouac fera, sous le pseudonyme transparent de Japhy Rider, le protagoniste des Clochards célestes. Watts apparaît aussi dans ce roman sous le nom d’Arthur Wane. Déconcertée par ces contestataires beat qui parlent de dharma, de tao et de satori, l’Amérique se tourne vers le vulgarisateur de génie qu’est Watts pour tenter d’y comprendre quelque chose. Si bien que notre homme est à la fois inspirateur de la contre-culture et son ambassadeur auprès du grand public, publiant des articles dans Playboy et participant à des émissions télévisées. Vulgarisateur au sens le plus noble du terme, celui qui fait comprendre à la masse, oui ; vulgaire ou bon marché, jamais. Le Bouddhisme zen, publié en 1957, est à la fois une remarquable présentation du zen en tant que courant spirituel et un témoignage de cet esprit zen qu’il incarne avec brio. Soucieux de rigueur, il met les choses au point dans un fameux article intitulé : « Le zen beat le zen square et le Zen , ». II y explique que, pour lui, ni le zen square, celui de l’orthodoxie et des institutions japonaises, ni le zen beat, trop souvent fumeux prétexte à suivre sa fantaisie, ne sont réellement le Zen, qui procède d’un lâcher-prise radical.
En 1957, désormais célèbre et apte à « vivre de ses dons », ainsi qu’il l’écrira lui-même, il quitte l’Académie des études asiatiques. Dans Amour et Connaissance, publié en 1958, il développe des thèmes écologiques aujourd’hui évidents, mais alors tout à fait précurseurs, et établit un lien entre la domination de la nature par l’homme avide et l’asservissement de la femme. C’est à cette époque qu’il rencontre celle qui deviendra sa troisième et dernière épouse, Mary Jane.
La période psychédélique
II fraie avec l’antipsychiatrie, dirige le premier séminaire de l’institut Esalen à Big Sur et s’intéresse, notamment sous l’influence de son ami Aldous Huxley, à la mescaline et au LSD qui fait alors son apparition. Ayant tenté l’expérience, il se prononce sans ambages : si les drogues peuvent conduire à de pénétrantes intuitions, leurs effets ne doivent pas se confondre avec une authentique expérience mystique intégrée. Bien qu’ami et soutien de Timothy Leary, le grand propagateur du LSD, il fustige son côté « grand prêtre », et dénonce « cette mégalomanie messianique qui naît d’une mauvaise interprétation de l’expérience de l’union à Dieu, ». II l’écrit dans Joyeuse Cosmologie, où il médite sur les modifications d’états de conscience dues à l’usage des produits psychédéliques. Installé en 1961 sur un gros bateau vapeur à roues à Sausalito, dans la baie de San Francisco, Watts est un homme public qui sait préserver sa liberté de parole et de pensée. Être Dieu, publié en 1963, réaffirme la vocation mystique de l’homme. Dans Le Livre de la sagesse (1966), il s’attaque à la conception d’un je existant indépendamment du tout, autrement dit l’ego.
De 1966 à 1972, il ne publie pas, mais voyage en Europe et au Japon, écrit de nombreux articles et enregistre des séries de conférences télévisées aujourd’hui disponibles en vidéo. Ses Mémoires, parues en 1972, seront le dernier ouvrage publié de son vivant. Avec humour et profondeur, il y revient sur son étonnant parcours et montre comment un petit campagnard britannique se mue en grand prêtre de la contre-culture californienne et surtout en homme du paradoxe, à la fois pleinement occidental et habité par l’esprit du zen. Grand buveur et jouisseur, il s’éteint dans son sommeille 17 novembre 1973. « Certes, Alan avait une vie sentimentale très compliquée et il aimait boire, me dira Gary Snyder lorsqu’en 1988 je l’interrogerai sur son mentor.
Mais ce que sa biographe [Monica Furlong, auteur de Zen Efficts : The Life of Alan Watts] ne restitue pas, c’est la grâce avec laquelle il passait à travers tout cela. . . Alan était toujours très joyeux, il ne se plaignait jamais, faisait en toutes circonstances preuve d’une grande générosité. . . » Et Arnaud Desjardins se souvient du rire tonitruant de Watts - rencontré à Paris vers la fin des années soixante -, de l’impression de liberté qui émanait de lui et de ce que lui confia ensuite un ami tibétain, interprète du Dalaï- Lama, présent à cette soirée : « Voici le premier Occidental qui ait vraiment compris l’essentiel du bouddhisme mahâyâna.. Lui, il sait de quoi il parle...
Il a vécu l’expérience fondamentale. » .
Sur Alan Watts, l’excellent livre de Pierre Lherrnite, Alan Watts, taoïste d’Occident, préface d’Arnaud Desjardins, éditions la Table Ronde,1983.
Sur internet : Quelques vidéos de Watts sont disponibles sur YouTube, les enregistrements de ses séminaires et conférences peuvent être acquis sur plusieurs sites américains, dont le site « officiel » : www.alanwatts.com.
Sur jerryroad.over-blog.com
Alan Wilson Watts (6 janvier 1915 – 16 novembre 1973) est l’un des pères de la contre-culture en Amérique.

Philosophe, écrivain, conférencier et expert en religion comparée, il est l’auteur de vingt-cinq livres et de nombreux articles traitant de sujets comme l’identité individuelle, la véritable nature des choses, la conscience et la recherche du bonheur. Dans ses ouvrages, il s’appuie sur la connaissance scientifique et sur l’enseignement des religions et des philosophies d’Orient et d’Occident (bouddhisme Zen, taoïsme, christianisme, hindouisme). Par ailleurs, il était intéressé par les nouvelles tendances apparaissant en Occident à son époque, et se fit l’apôtre d’un certain changement des mentalités quant à la société, la nature, les styles de vie et l’esthétique. Alan Watts était un autodidacte réputé et c’est son interprétation des philosophies asiatiques qui l’a rendu populaire.
ll apparaît comme l’un des personnages des "Clochards célestes" de Kerouac. Toutefois, comme il le déclarera lui-même dans ses "Mémoires", il était plus dans ce milieu que de ce milieu. La suppression de la Collection Denoël/Gonthier a interrompu la traduction de son œuvre en français. Elle pourrait reprendre : le besoin d’une Philosophie "en liberté" se faisant de plus en plus sentir (d’où le succès des divers ouvrages de vulgarisation philosophique - ceux-ci portant sur les grands thèmes classiques ou sur l’Histoire de la Philosophie).
La pensée d’Alan Watts est celle d’un mode d’approche de la Réalité (vient-elle du monde ou de l’esprit observant le monde ?) qui se veut dépasser l’opposition d’une philosophie qui prouve et d’une ascétique qui s’éprouve. Cette approche libertaire implique une mise à distance de toute institution quelle qu’elle soit, et le refus de tous les bouddhismes comme de tous les christianismes. Il préconisait la philosophie perennis (telle que l’entendait Aldous Huxley dans l’ouvrage du même intitulé). Dans sa préface à "L’Identité Suprême", il rend un hommage appuyé à l’Ecole Traditionnelle. Mais, par ailleurs, il dit aussi que l’ésotérisme n’est pas un code pour service secret, mais simplement l’intérieur des formes et des apparences.
L’association du nom d’Alan Watts à une critique radicale de la société américaine est trompeuse en ceci : le monde entier est en cours d’américanisation. C’est l’américanisme qu’il critique, de même que tous les autres "ismes" de l’idéologisme, tous les prosélytismes, -académisme comme écologisme, végétarisme comme mysticisme inclus. À ses yeux, libertaire n’équivaut pas à révolutionnaire, ni critique à agression.
On peut tenir sa philosophie, sa démarche philosophique, comme taoïstes (il dégage bien l’influence taoïste dans la naissance du "Zen chinois", le Chan). Le Tao pouvant être considéré comme une vision et/ou vécu naturels, un "allant de soi ainsi" ou une écologie de l’étant au monde, il est peut-être à souligner que la philosophie écologique d’Alan Watts n’a strictement rien à voir avec tous les "écologismes".
Sa pensée pourrait se résumer par l’expression d’apophatique générale.
.jpg)
Citations
« Essayer de tout comprendre en fonction de la mémoire, du passé et des écrits, c’est comme avoir vécu l’essentiel de sa vie, le nez dans un guide touristique, sans jamais regarder le paysage. »
« Ce que nous savons par la mémoire, nous ne le savons que de seconde main. »
« Si l’univers n’a pas de signification, l’énoncé qui dit cela n’en a pas non plus. »
« Qui n’a pas la capacité de vivre dans le présent, ne peut faire de plans valables pour l’avenir. »
« L’engagement religieux irrévocable, quelle que soit la confession choisie, n’est pas seulement un suicide intellectuel, c’est aussi la négation même de la foi, puisqu’il s’agit d’un acte qui ferme l’esprit à toute nouvelle vision du monde. »
« La vision de Dieu ne s’obtient qu’en abandonnant toute croyance en une quelconque idée de Dieu. »
« Tout éveil doit nécessairement se produire spontanément, n’en déplaise à ceux qui veulent obliger les gens à devenir leurs disciples pour l’atteindre. »
« Chercher l’éveil, c’est comme utiliser ses lunettes pour les chercher. »
« Le drame de l’homme occidental vient de ce qu’il se sent séparé de l’univers. »François Roustang
Le corps est l’espritGlobal Systema
Art martial et spiritualitéFoutez vous la paix ! Et commencez à vivre
Fabrice MidalLa découverte suprême
La MèreSe libérer des jugements
Isabelle PadovaniSatprem
Restera seulement ce qui est vraiOublier ses certitudes - François Roustang
Le lâcher-priseÉloge de l’insécurité
Alan WattsLes mythes de la méditation - Fabrice MidalOn ne décide de rien
Pour la joie de ne rien être - Éric BaretUn immense désir de tout ralentir - Patrice Van EerselLa simplicité volontaireCommunication Non Violente
Être heureux n’est pas nécessairement confortableDivine Blessure - Jacqueline KelenRisquer la liberté - Fabrice Midal
Inventer l’existence indépendamment des sentiers connusChögyam Trungpa - Fabrice Midal
la révolution spirituelleBienheureuse infidélité - Paule SalomonÉloge de la lenteur - Carl HonoréVive la paresseLe droit à la paresse - Paul LaffargueL'intranquillité - Bernardo Soares (Fernando Pessoa)Le goût du vrai - Richesses du Présent - Contact - Liens
-
L'impuissance apprise et ses effets
- Par Thierry LEDRU
- Le 01/03/2021
J'ai découvert le principe de "l'impuissance apprise" dans un livre. J'avais environ 30 ans. J'étais instituteur depuis 11 ans. J'ai eu honte, vraiment honte de ne pas avoir découvert cela plus tôt. Parce qu'inévitablement, j'avais pu générer ce sentiment chez mes élèves. pas volontairement bien entendu mais par ignorance. Ma propre ignorance. C'est là vraiment que je me suis intéressé à la psychologie. Je n'avais reçu aucune formation professionnelle digne de ce nom. Je ne savais rien. Je devais apprendre pour que cette honte ne me submerge plus jamais.
Aujourd'hui, à maintes reprises, lorsque je regarde la société humaine, j'y vois des situations similaires à celle expérimentée dans la vidéo ci-dessous.
L'impuissance apprise est un mal terrifiant.
Et je pense que le déni des urgences actuelles et l'absence de décision relative à un changement radical de nos modes de vie est un phénomène qui peut se rapprocher de celui de l'impuissance apprise. Nous sommes conditionnés à ne pas remettre en question les fondements de nos sociétés modernes, de nos sociétés matérialistes. D'autres avant nous ont tenté de le faire et il n'en est rien resté à grande échelle. Ce furent des échecs. Il suffit de penser à la période 1970, le "Do it", Woodstock, les Hippies, les mouvements "marginaux" qui sont restés lettre morte.
Tout ça est encore flou dans mon esprit mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser.
Le formatage est une conséquence de l'impuissance apprise.
Nous n'avons pas été éduqués à sortir du cadre, nous n'avons pas été enseignés pour remettre en cause un système de pensées généralisé, nous n'avons pas été encouragés à développer d'autres formes de sociétés, sinon des micro-sociétés à l'échelle de la communauté.
Pourquoi est-ce que rien de puissant n'a jamais émergé de tous les esprits, de toutes les intelligences, pourquoi est-ce que toutes les "avancées, que tous les "progrès" ont toujours été guidés par une voie unique, celle de la croissance, celle du "toujours plus" ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, encore et toujours, celui qui cherchera à s'extraire du comportement général sera considéré comme une menace, comme un "rebelle" alors que la voie commune est une voie qui nous mène à une impasse ? Je pense qu'il existe dans le groupe humain un sentiment d'impuissance qui agit comme une fatalité.
"On ne peut pas vivre autrement, le "métro-boulot-dodo" est une voie incontournable, il n'y a pas d'issue. Sinon, ça se saurait. "
Et si justement les organisateurs de nos sociétés modernes ne voulaient pas que ça se sache ? Et si justement, les instances dirigeantes avaient choisi l'impuissance apprise comme moteur du maintien de ce monde qui leur convient ? Oui, je sais, ça fait complotisme tout ça. Je parlerais davantage d'opportunisme. Ils surfent sur la vague et s'en réjouissent. Et nous n'avons même pas conscience que la vague n'existe qu'au regard de l'océan et que nous sommes l'océan.
J'ai rencontré cet hiver un ancien élève. Il ne veut plus de ce monde matérialiste. Il veut tout quitter et créer sa propre voie. Il cherche, il réfléchit, il lit... Peut-être est-ce que lui, justement, n'est plus dans l'impuissance apprise.
Le théorème du singe est une fable décrivant une expérience imaginaire menée sur un groupe de singes. Elle exprime la transmission et la perpétuation de croyances collectives au sein d'une population progressivement renouvelée, et ce même après que la cause première de ces croyances est éteinte et après la disparition de tout témoin de cette cause. Le phénomène et les comportements supposés des singes n'ont pas été confirmés dans la réalité par une expérience conforme à celle décrite dans la fable.
Une vingtaine de chimpanzés est isolée dans une pièce où est accrochée au plafond une banane, et seule une échelle permet d'y accéder. La pièce est également dotée d'un système qui permet de faire couler de l'eau glacée dans la chambre dès qu'un singe tente d'escalader l'échelle.
Rapidement, les chimpanzés apprennent qu'ils ne doivent pas escalader l'échelle. Le système d'aspersion d'eau glacée est ensuite rendu inactif, mais les chimpanzés conservent l'expérience acquise et ne tentent pas d'approcher de l'échelle.
Un des singes est remplacé par un nouveau. Lorsque ce dernier tente d'attraper la banane en gravissant l'échelle, les autres singes l'agressent violemment et le repoussent. Lorsqu'un second chimpanzé est remplacé, lui aussi se fait agresser en tentant d'escalader l'échelle, y compris par le premier singe remplaçant.
L'expérience est poursuivie jusqu'à ce que la totalité des premiers chimpanzés qui avaient effectivement eu à subir les douches froides soient tous remplacés. Pourtant, les singes ne tentent plus d'escalader l'échelle pour atteindre la banane. Et si l'un d'entre eux s'y essaye néanmoins, il est puni par les autres, sans savoir pourquoi cela est interdit et en n'ayant jamais subi de douche glacée.

L’impuissance apprise ou comment induire la résignation
Induire la résignation : l’expérience d’échecs successifs
La résignation ou la notion d’impuissance apprise [Learned Helplessness] est développée dans les années 60 par Martin Seligman, un psychologue comportemental. C’est un état proche du renoncement et de la dépression induit chez un individu (ou un animal) faisant l’expérience d’échecs successifs et d’absence de maîtrise sur ce qui lui arrive.
Comment résigner une classe en moins de 5 minutes
Avant de rentrer plus en détail sur les aspects comportementaux, voici une vidéo dans laquelle une psychologue, Charisse Nixon, provoque de la résignation chez un groupe en quelques minutes :
« Je ne vais pas y arriver »
Dans cet extrait, on remarque que la capacité à résoudre des problèmes est comme « gelée ». Cette passivité (ou apathie) se met en place chez l’homme ou l’animal qui est plongé dans un état de résignation, l’amenant à supporter sans réaction des évènements négatifs. Le groupe expérimentant l’absence de maîtrise et l’échec face à une situation – l’impossibilité de résoudre les deux premiers anagrammes – n’arrive pas à réaliser le troisième qui était pourtant faisable.
Et c’est peut être l’élément le plus troublant : au delà de la frustration induite face aux deux premières taches, ce vécu conditionne les comportements ultérieurs. On parle donc d’impuissance « apprise » car cette attitude résignée, une fois installée, contamine même les situations pour lesquelles le comportement d’une personne aurait été efficace.
Par exemple, une recherche d’emploi qui se solde par des échecs systématiques peut, a terme, éteindre toute combativité pour retrouver du travail. Dans la vie personnelle également, les tentatives de régime, si elles échouent, vont amener la personne à renoncer en se disant « Les régimes ne fonctionnent jamais ». Autre cas de figure, une personne en quête d’une rencontre amoureuse, confrontée à des refus, va intérioriser ces échecs et mettre en place un système de croyances: le résultat négatif, malgré les actions, sera anticipé et généralisé au point de ne plus rien tenter. L’estime de soi est alors touchée, la motivation baisse et la dépression s’installe. Dans le langage, on retrouve certains marqueurs de cet état d’esprit comme les expressions : « je ne vais pas y arriver », « je ne suis pas fait pour cela ».
L’origine de l’impuissance apprise (IA)
Martin Seligman s’inscrit dans un paradigme en psychologie : le conditionnement opérant (ou conditionnement instrumental). Ce concept comportemental est initié au début du XXème siècle par Edward Thorndike et s’appuie sur le « modèle animal », qui vise à étudier un processus pathologique (spontané ou induit / biologique ou comportemental) sur les animaux pour en dégager des aspects communs avec un phénomène équivalent chez l’humain. L’auteur le plus célèbre de ce courant dit « behavioriste » s’appelle Skinner (on parle d’apprentissage skinnerien)..
Skinner et Seligman s’intéressent à l’apprentissage résultant d’une action, en analysant particulièrement les mécanismes favorisant la reproduction d’un comportement. L’idée générale est que la conduite humaine est conditionnée par les conséquences qu’un individu anticipe à partir de son comportement suite à ses expériences. La « récompense attendue » serait la base de toute motivation. Il est donc possible de favoriser des comportements induits par « renforcement » ou, à l’inverse, de provoquer des comportements d’évitement par « punition ». C’est dans ce cadre que Seligman expérimente et développe la notion d’impuissance apprise appelée également résignation acquise.
Un modèle expliquant la dépression
Au milieu des années 70, il étend son concept et le propose comme modèle explicatif de la dépression qui « résulterait de la perte par le sujet de la possibilité de faire une liaison entre l’action et les conséquences positives de celle-ci » (1975, Helplessness. On Development, Depression and Death). Plus précisément, il décrit trois conséquences lorsqu’il y a rupture entre nos propres actions et l’environnement :
Un déficit cognitif, qui rend encore plus difficile la possibilité d’apprendre que les évènements dépendent de ses actions.
Un déficit motivationnel, entravant la possibilité de réponses volontaires.
Un déficit émotionnel, sur un versant dépressif.
-
Courbe environnementale de Kuznets
- Par Thierry LEDRU
- Le 27/02/2021
En lisant des articles sur les adeptes de l'écomodernisme, je suis tombé sur cette courbe. C'est ce qu'il y a de passionnant quand on apprend, ça ne s'arrête jamais :)
Théorie selon laquelle la croissance serait nocive pour l’environnement dans les premiers stades du développement. En effet, initialement la qualité environnementale se détériore avec la hausse du revenu. À partir d’un certain niveau de richesse la croissance économique s’accompagnerait d’une amélioration de l’état de l’environnement. C’est-à-dire que la société aura les moyens et la volonté d’un environnement plus sain, ce qui conduit à un renforcement des normes et à une amélioration de la qualité de l'environnement dans certains domaines.
Pour la petite histoire, contrairement à ce que laisse penser le nom de cette théorie, la courbe, malgré son nom, ne dérive pas des travaux de l’économiste Simon Kuznets mais de ceux de Grossman et Krueger. Le nom fait juste référence à la forme de cette courbe en "U" inversé.
La courbe de Kuznets environnementale
https://keskec.fr/economie/johann/1651/

Un pays en situation post-industrielle tend à diminuer le niveau de pollution qu’il émet. En effet, les besoins primaires ayant été satisfaits, l’environnement devient peu à peu une priorité pour les populations, qui attendent des pouvoirs publics et des entreprises la mise en place de mesures adaptées à sa préservation. Les innovations technologiques permettent, en plus de ces mesures, de réduire la pollution de certaines activités.
A titre d’exemple, les visioconférences et le télétravail ont un impact positif sur le niveau de pollution quand ils évitent le déplacements de personnes vers un même point en vue d’une réunion. Cependant, pour que cela soit vraiment considéré comme efficace, il faut que les activités prévues puissent se dérouler aussi bien qu’en présentiel et que les technologies de substitution polluent moins que l’activité en cycle « normal ». Par exemple, la pollution des serveurs et matériels informatiques utilisés pour la visioconférence doit être plus faible que la pollution effectuée par les employés se rendant au travail en transport. Selon les situations, d’autres critères sont à prendre en compte pour affirmer de l’efficacité d’innovations technologiques.
D’autres facteurs comme la modification du PIB entraînent une diminution des pressions sur l’environnement. Ainsi, dans les pays d’Europe de l’Ouest, la production industrielle a peu à peu laissé place aux entreprises du secteur du service, qui sont généralement moins polluants que les productions industrielles. Mais bien souvent, la-dites pollution n’est que déplacée vers des pays moins développés, en phase d’industrialisation.
Une vision contestée
Cependant, de nombreux économistes et scientifiques pointent des incohérences dans la construction de la courbe, voire dans sa véracité pour certains polluants. Par exemple, l’évolution de la pollution en CO2 ne correspondrait pas à cette projection pour le 21ème siècle, ce qui remet en cause le modèle. Pour plus de détails, je vous invite à vous renseigner sur ces recherches (notamment la partie IV). (Un dossier très, très intéressant)
En général, les courbes de Kuznets peuvent être mises en évidence dans quelques données concernant certains questions environnementales locales (comme la pollution de l’air) mais ce n’est pas le cas d’autres (comme le renouvellement des sols ou la biodiversité). On doit aussi ajouter que les effets de changements climatiques comme la disparition d’espèces ou la perte de biodiversité est irréversible.
Pour aller plus loin
Courbe de Kuznets, définition et limites
Courbe de Kuznets en détail + calculs
Le mirage de la croissance - ou le mythe de la courbe de Kuznets
https://reporterre.net/Le-mirage-de-la-croissance-ou-le
Durée de lecture : 8 minutes
19 février 2012 / Nicolas Ridoux
Cet article de 2007 analyse avec clarté la théorie de la « courbe environnementale de Kuznets ».
Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM) est une femme brillante. Polytechnicienne, elle est à 33 ans députée UMP de l’Essonne, et conseillère écologie de l’UMP. Elle livre au quotidien Le Monde du 23 janvier 2007, une curieuse analyse scientifique pour réfuter la décroissance (1) :
"Question - Les bénéfices d’une croissance plus propre ne sont-ils pas annulés si l’on continue à produire plus ? La croissance durable n’est-elle pas un paradoxe ?
NKM - Regardez les fameuses ’courbes en cloche’ produites par l’OCDE. Elles montrent le volume de pollution créé par chaque point supplémentaire de PIB. Elles grimpent toutes jusqu’à un point culminant, à partir duquel la pollution marginale par point de PIB commence à baisser. Sauf pour les déchets et le CO2. Au point culminant, la courbe baisse mais le volume de pollution global continue de croître. Mais il y a un deuxième point, qui correspond à la dérivée seconde de la courbe, à partir duquel la pollution totale décroît, bien que le PIB continue d’augmenter.[…] La position de l’UMP est de pousser pour que nous arrivions le plus vite possible au deuxième point des ’courbes en cloche’.Cette réponse est un grand classique de la pensée économique néolibérale. La croissance n’est pas le problème, elle est la solution. Les problèmes créés par la croissance seront réglés par elle : il suffit donc de l’accélérer ! NKM appuie apparemment son discours sur des travaux scientifiques, alors regardons cela d’un peu plus près.
NKM fait allusion aux courbes en cloche, dites CEK (2).
Source : André Meunié – Centre d’Economie du Développement - Université Bordeaux IV.
La Banque Mondiale (3) a en effet déclenché une polémique scientifique, en 1992, en publiant les travaux de Shafik et Bandayopadhyay (4), qui montraient effectivement une courbe en cloche (CEK), basée sur des données empiriques pour quelques polluants aux effets locaux (5) (SO2, CO, NOx). Le rapport restait toutefois très prudent dans ses conclusions. Depuis cette date, de très nombreux travaux scientifiques ont été menés qui montrent que l’on ne peut pas généraliser ces quelques cas particuliers :
1. Les modèles de CEK utilisés initialement ne sont pas statistiquement robustes (voir Stern, 2004 ; Day et Grafton, 2003 ; Dijkgraaf et Vollebergh, 1998 ; Harbaugh et al., 2002 ; Millimet et al., 2003 ; Perman et Stern, 2003) (6). En clair, on peut faire dire n’importe quoi aux données que l’on a utilisées à l’époque.
2. La relation générale, trouvée pour la majorité des polluants par des analyses économétriques poussées sur des séries de données plus complètes est une relation de croissance (7) de la pollution avec le PIB par tête. Le rapport peut varier entre 0 et 1, mais n’est pas négatif (Stern, 2004), donc la courbe ne pointe jamais vers le bas... (adieu la cloche…).
3. La pollution croît en volume et croît également en nature (à certains polluants « classiques » et locaux type SO2, il faut ajouter les cancérigènes, le CO2, etc.) (Dasgupta et al., 2002)(8)
4. Lorsqu’il existe une décroissance de la pollution, elle est corrélée non pas avec le PIB, mais avec le temps, avec l’amélioration de la technologie, et avec des politiques explicites (9) de préservation de l’environnement. (Dasgupta et al., 2002 ; Stern, 2004, l’ont montré dans le cas de la Chine et de l’Asie du Sud-Est).
5. Des pays avec un faible PIB par tête ont pu réduire certaines de leurs émissions (SO2 en Asie du Sud-Est et en Chine (10)) alors que d’autres pays avec un fort PIB/tête, mais peu de liberté politique (c’était le cas de l’ex-URSS) ont maintenu une pollution élevée.
Ces éléments contredisent l’hypothèse simpliste des « fameuses courbes en cloche ». C’est bien une volonté politique (11) de lutte contre la pollution qui a permis sa réduction, et ce indépendamment de l’évolution du PIB.
La baisse des émissions de CFC, suite aux publications sur le trou dans la couche d’ozone, est clairement corrélée aux accords politiques internationaux et en rien à la croissance.
Abondance des CFC dans l’atmosphère
et prévisions en fonction des accords politiques de limitationD’après vous, c’est la croissance du PIB ou la régulation des marchés par la politique qui explique la baisse des émissions de CFC ?
Avoir foi (12) dans les CEK, c’est également faire l’impasse coupable sur les effets irréversibles (13) (par ex. la perte de biodiversité), se focaliser sur les émissions en oubliant les effets cumulatifs (la concentration du CO2 qui augmente, par exemple), les effets négatifs de la pollution sur l’activité, ou l’export des pollutions vers des pays moins regardants en matière de protection de l’environnement.
Que nous dit l’OCDE, que cite pourtant NKM ? « Un certain découplage des pressions exercées sur l’environnement et de la décroissance économique devrait intervenir mais il ne sera pas suffisant pour compenser les effets de l’augmentation des pressions » (14).
La courbe probable (Stern, 2004) est celle-ci :
Il est possible de décaler la courbe vers le bas avec le temps, si des politiques environnementales et une technologie appropriées sont appliquées.
NKM est bien trop intelligente et spécialisée dans l’écologie (15) pour faire des erreurs sur des données aussi solidement établies. Ne serions-nous pas en présence d’un discours au service d’une idéologie ? Cette idéologie ne serait-elle pas la totale substituabilité d’un capital artificiel au capital naturel (16) ? C’est la négation de toute irréversibilité réelle et la croyance irrationnelle qu’un environnement rendu invivable pourra toujours être corrigé, remplacé, par une création artificielle humaine.
Si on utilise un indicateur plus global comme l’empreinte écologique, la courbe qui relie celle-ci au PIB ou à l’IDH (17) est, elle aussi, clairement croissante.
Source : Boutaud Aurélien, Gondran Natacha, Courbes de Kuznets environnementales : l’apport des indicateurs alternatifs de type empreinte écologique dans la réflexion sur le développement durable, Centre SITE, Ecole des Mines de Saint-Etienne.
Les progrès scientifiques sont porteurs d’espoir mais nous montrent aussi, et toujours plus, l’étendue de notre ignorance.
Au-delà des querelles sur les courbes, c’est bien de politique dont nous avons besoin, afin de décider collectivement du futur que nous souhaitons et de la société vers laquelle nous voulons tendre.
Même si les « fameuses courbes en cloches » existaient, nous pourrions politiquement les trouver non désirables et choisir une autre voie de développement (18), plus conforme à l’idée que nous nous faisons du progrès humain.
.......................
Notes :
(1) Entretien avec Alexandre Piquard, Le Monde, édition du 23/01/07.
(2) Courbes Environnementales de Kuznets (CEK) ou EKC en anglais. Reprises à l’occasion par l’OCDE. L’OCDE est d’ailleurs très prudente à leur propos (voir Les perspectives de l’environnement de l’OCDE, OCDE, 2001, p.66).
(3) World Bank, World Development Report 1992 : development and the environment, The World Bank, 1992.
(4) Shafik, N. et Bandayopadhyay, "Economic Development and Environmental Quality : Time Series and Cross-Country Evidence", Background Paper for the World Development Report 1992.
(5) …quelques courbes et non pas toutes les courbes comme le dit NKM.
(6) Voir, pour une bonne synthèse : Stern, D. I., « The rise and fall of the environmental Kuznets curve », World Development, 32(8), 1419-1439, 2004.
(7) NKM reconnaît d’ailleurs la croissance des déchets et du CO2, ce qui n’est pas un détail, le CO2 étant l’un des principaux gaz à effet de serre.
(8) Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H., Wheeler, D., "Confronting the environmental Kuznets curve", Journal of Economic Perspectives, 16, 147–168, 2002.
(9) Donc une action correctrice de la société sur les marchés, via en particulier les pouvoirs publics.
(10) Ce qui n’exclut pas les autres graves atteintes à l’environnement en Chine que l’on connaît, et montre la faible représentativité de quelques indicateurs de pollution spécifiques comme le SO2.
(11) Volonté politique qui s’appuie sur les données scientifiques, voir par ex. la lutte contre les CFC, contre les Gaz à Effet de Serre, etc…
(12) Car c’est bien d’une foi, d’une croyance, dont il s’agit.
(13) De ce point de vue, même en croyant qu’une courbe en cloche existe, son point de retournement peut se situer au-delà de l’extinction de l’espèce humaine…
(14) Les perspectives de l’environnement de l’OCDE, OCDE, 2001, p. 23. Cela rejoint le point 2. décrit plus haut.
(15) Elle est députée, rapporteure de la mission d’information sur le climat de l’assemblée nationale.
(16) Ce qui nous paraît au minimum présomptueux, au pire suicidaire.
(17) IDH ou Indice de Développement Humain, meilleur indicateur que le PIB, puisqu’il conjugue longévité, éducation et niveau de vie.
(18) Qui évite le pic de pollution de la courbe en cloche, au lieu de le subir comme un mal nécessaire…
-
"Ils sont devenus décroissants"
- Par Thierry LEDRU
- Le 27/02/2021
KIM BASCHET / LE MONDE
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/13/ils-sont-devenus-decroissants-quatre-francais-temoignent_
Patricia Mignone, 60 ans, est formatrice et cadre dans le marketing numérique à Charleroi, en Belgique.
« L’empêchement principal à la décroissance ? Les habitudes »
« Je fais partie de la première vague des décroissants, celle des années 1970. A 16 ans, en 1974, j’ai été touchée par le mouvement écologique naissant : j’ai adopté la frugalité et le minimalisme. Puis dans les années 1980, alors que j’étais jeune mère, nous avons vécu dans le Brabant, une région de Belgique qui constituait un véritable vivier en matière d’écologie. Nous avions un maraîcher bio, un boulanger bio, un boucher bio et, au village, un précurseur avait organisé un système de tri et de recyclage des déchets ménagers.
J’ai toujours été perçue comme une personne originale et austère. Il est clair que je détonnais par rapport aux autres adolescentes. Quand j’étais à l’université, il est arrivé que l’on me dise que j’étais radine parce que je n’étais pas aussi coquette que les autres filles de ma promo. J’ai élevé mes enfants dans cet esprit-là. Arrivés à l’âge adulte, ils m’en ont remerciée, ce qui ne les a pas empêchés de faire d’autres choix de consommation.
Chez moi, on trouve un pain de savon de Marseille et une bouteille d’eau vinaigrée pour le rinçage des cheveux !
Concrètement, je consomme ce dont j’ai besoin, en m’efforçant d’observer des comportements résilients : j’évite les produits non éthiques et les déchets ; je tends vers l’autonomie. De passage à Paris ces jours-ci, j’ai loué un appartement sur la plate-forme Airbnb et j’ai découvert dans la cabine de douche un nombre de flacons en plastique inutiles… Chez moi, on trouve un pain de savon de Marseille et une bouteille d’eau vinaigrée pour le rinçage des cheveux ! C’est économique et sain : la publicité fait croire qu’on a besoin d’un produit pour chaque fonction alors que des produits de base suffisent.
Je me passe de télévision depuis une vingtaine d’années, je suis végane et j’ai mon propre jardin. Je n’en suis pas pour autant exemplaire : il m’arrive encore d’acheter des produits emballés dans du plastique.
Comment arriver à convaincre davantage de personnes d’adopter ce mode de vie ? L’empêchement principal, ce sont les habitudes. En matière d’alimentation, les gens commencent cependant à admettre que nous devons réduire notre consommation de chair animale. Afin d’aider mes amis omnivores à évoluer en ce sens sans changer d’habitudes gustatives, j’adapte régulièrement des recettes de cuisine dites « traditionnelles ».
Selon moi, il faut être pédagogue, pas moralisateur : non culpabiliser, mais aider ceux qui le souhaitent à évoluer sur ce chemin. A une échelle un peu plus grande, la publication de livres, l’animation d’ateliers, les conférences permettent aux “éclaireurs” de sensibiliser ceux qui ont besoin d’aide.
Je pense que nous assistons aujourd’hui à la réplique d’un mouvement qui a eu lieu il y a cinquante ans, après Mai 68. Si dans les années 1970 ce mouvement était une lame de fond, là ça devient une véritable tendance : les médias s’intéressent au sujet ; l’Europe a légiféré quant à la responsabilité sociétale des entreprises ; les enseignes de la grande distribution vont désormais au-delà du bio en intégrant les concepts de la transition – local, de saison, en vrac… C’est souvent du greenwashing [marketing écologique], elles font ça pour se donner une bonne image, mais cela permet au moins de sensibiliser le grand public. Le mode de vie de la transition semble également séduire de plus en plus de jeunes, notamment ceux qui sont éduqués : ils ont une conscience aiguë de l’état du monde.
En 1972, le rapport Meadows [la première étude significative à alerter sur l’impact pour la planète de la croissance économique et démographique, intitulé “Les Limites de la croissance”] nous invitait à changer de cap. A l’époque, il était encore temps. Rien n’a été fait depuis, notamment parce que le monde politique manque de courage. Et nous le payons aujourd’hui. »
Olivia Cunéo, 19 ans, est étudiante en langues étrangères à Papeete.
« J’ai totalement arrêté le shampooing, le savon, le dentifrice industriel, le papier toilette… »
« Tout a commencé avec le déodorant. Je me souviendrai toujours de ce jour où mon père m’a dit de ne plus en mettre parce que cela pouvait provoquer un cancer. Cela m’a frappée, et j’ai cherché par quoi je pourrais le remplacer. J’ai testé le bicarbonate de soude, puis je me suis rendu compte qu’il pouvait servir à d’autres choses, comme fabriquer son dentifrice ou des produits nettoyants. Et de fil en aiguille, j’ai tout remplacé. J’ai voulu être cohérente avec mes convictions écologiques, je suis donc devenue une partisane du zéro déchet et de tout ce qui va avec : le minimalisme, la décroissance…
Honnêtement, ce n’est pas très compliqué pour une jeune adulte qui n’a pas de revenu fixe et qui vit chez ses parents. Malgré tout, mes seuls achats neufs récents sont des sous-vêtements et une paire de chaussures pour le scooter. Autrement, j’achète toujours des vêtements d’occasion. Bien sûr, il est très difficile de résister à certaines tentations du quotidien. J’adore le chocolat et les biscuits industriels, et quand j’ai un peu d’argent j’en achète encore. C’est difficile de ne pas succomber, avec toutes ces publicités qui nous incitent à consommer ! Même si l’on sait que c’est mauvais pour la santé et loin d’être écolo.
Mes proches m’ont totalement suivie. Ma mère est même allée plus loin : terminé la lessive industrielle, les produits ménagers industriels… et même, depuis cette année, le papier toilette ! C’est notre grande réussite. Pour les selles, nous utilisons l’eau de la douche. Et pour le reste, nous utilisons des serviettes que l’on garde après usage dans une petite poubelle, où ma mère a mis du bicarbonate pour éviter les odeurs, puis qu’elle lave régulièrement.
La plupart de mes amis comprennent mes décisions, mais cela ne va pas plus loin
Est-ce qu’on fait des économies ? Oui, oui et re-oui. A tel point qu’on s’en veut de ne pas avoir pratiqué le zéro déchet et le minimalisme plus tôt ! Du côté de mes amis, c’est beaucoup plus mitigé. L’un d’entre eux trouve “dégoûtant” que je n’utilise pas de shampooing. La plupart des autres comprennent mes décisions, mais cela ne va pas plus loin. Pour eux, cette prise de conscience est inutile et mon idéal impossible à atteindre. Je pense notamment à mes amies parties en métropole qui y ont découvert les « vrais » magasins de vêtements : pour elles, il n’est pas question de ne rien acheter de neuf, et je peux les comprendre. Ici, les vêtements coûtent affreusement cher. Heureusement, j’ai quand même deux ou trois amies qui essaient elles aussi d’être décroissantes. Donc on peut en parler et essayer de convaincre les autres.
Pour moi, un retour en arrière est impensable. Impossible de racheter un jour du shampooing par exemple. On me dit souvent “au cas par cas, ça ne sert à rien. J’adopterai ce mode de vie quand les politiques auront changé”. Je trouve ça assez facile.
Si on ne change rien soi-même, les responsables politiques ou les industriels n’ont aucune raison de le faire. Je pense, au contraire, que l’on doit tous agir au plan individuel, parce que ce sont les actions du peuple qui modifieront les façons de penser à plus grande échelle. Au bout d’un moment, si on arrête d’engraisser les industriels, ils finiront bien par cesser leurs activités. Et c’est eux qu’il faut viser. Ce sont eux les vrais pollueurs. »
KIM BASCHET / LE MONDE
Guy Renard, 45 ans, est informaticien en Suisse.
« Ouvrez un tiroir et demandez-vous “qu’est-ce que j’utilise régulièrement ?” »
« Le déclic n’est pas vraiment venu à un moment précis. C’est un processus qui s’est étiré sur plus de quinze ans. Au fil des années, j’ai pris de plus en plus de recul sur la société de consommation, vu les choses empirer : on ne peut pas continuer avec un tel mode de vie, un tel gaspillage des ressources.
A l’échelle de la planète, ce n’est plus soutenable ; il faut que ce soit plus équilibré. C’est pour cela que, progressivement, je suis devenu décroissant. Cela m’a permis de ralentir, de changer de mode de vie. De prendre davantage le train, de prendre le temps de cuisiner et de servir moins de plats préparés. Je passe aussi moins de temps dans les magasins.
Je dirais que 60 % des choses que l’on possède ne sont jamais utilisées
Après avoir découvert le mouvement minimaliste, j’ai décidé de changer d’appartement pour en prendre un plus petit. Faites l’expérience chez vous, ouvrez un tiroir dans votre salle de bains ou dans votre cuisine et demandez-vous “qu’est-ce que j’utilise régulièrement ?”. Je dirais que 60 % des choses que l’on possède ne sont jamais utilisées. Il est donc facile de s’en débarrasser : vêtements, matériel de cuisine, de bricolage… Je me suis rendu compte que je n’avais pas besoin d’un appartement si grand : je suis passé d’un 80 m² à un 60 m² et c’est encore trop grand. Je pense que je m’en sortirais très bien avec un 45 m².
J’ai aussi arrêté de prendre l’avion, je ne prends plus ma voiture tous les jours. J’utilise davantage le vélo ou le bus. Mais on a une énorme chance en Suisse, on a plusieurs alternatives à la voiture. Il y a beaucoup de lignes régionales pour se rendre dans les petites villes. Ce n’est pas forcément le cas en France. Je fais également plus de tourisme local et je visite des pays frontaliers. Economiquement, j’y gagne à tous les niveaux ; mon loyer a par exemple baissé de 20 % à 30 %. Je n’ai pas l’impression de vivre moins bien et j’ai redonné du sens à ma vie.
Cela a été assez facile avec mes proches, je n’ai pas vraiment eu de réactions posant problème, même si pour certaines personnes je suis excessif. Mais elles hésitent à me le reprocher car cela les renvoie à leurs propres contradictions.
Mon objectif, c’est d’en débattre dans une démarche pédagogique. Mais c’est vrai que nous sommes confrontés à une pression sociale de toujours consommer et cela crée de la frustration. Tout décroissant peut, à un moment donné, se sentir isolé socialement. Je mange par exemple moins de viande, mais je n’ai pas arrêté complètement : je sais que l’élevage pose beaucoup de problèmes à l’environnement, mais, socialement, la diminution de la viande, plutôt que l’arrêt complet, est plus facile à faire accepter à ses proches.
Je suis convaincu que les changements individuels, on ne peut pas y couper. Nous sommes les clients des multinationales. Dans l’idéal, il faudrait que les individus évoluent en parallèle des politiques, mais il y a une résistance au changement. Beaucoup sont convaincus par ce mode de vie décroissant, mais il est vrai que cela demande beaucoup d’efforts dans la vie de tous les jours. »
Comment agir pour le climat ? « Le Monde » se mobilise pendant une semaine
Que faire face au défi du changement climatique ? Comment agir, concrètement, à l’échelle individuelle ou collective ? Les initiatives citoyennes ont-elles un sens alors que c’est tout le système qu’il faudrait faire évoluer pour espérer limiter les effets du dérèglement ? Alors que la COP24 sur le climat s’est ouverte, dimanche 2 décembre, en Pologne, la rédaction du Monde se mobilise autour de ces questions. Au-delà du constat de l’urgence, nous avons voulu nous interroger sur les solutions existantes ou à explorer.
Chaque jour, pendant une semaine, des personnalités, expertes de leur domaine et engagées au quotidien, répondront en direct aux questions des internautes :
Peut-on se passer de la voiture ? Jérémie Almosni, chef du service Transport et mobilités à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), a répondu aux questions des internautes lundi 10 décembre.
Peut-on continuer à manger autant de viande ? Le chef cuistot Adrien Zedda, du resto lyonnais Culina Hortus et Cyrielle Denhartigh, responsable agriculture et alimentation pour Réseau Action Climat ont répondu à vos questions mardi.
Peut-on se chauffer autrement ? Vous avez pu dialoguer avec Jean-Baptiste Lebrun, directeur du CLER – réseau pour la transition énergétique, mercredi.
Peut-on consommer moins ? Le politologue Paul Ariès a répondu à de nombreuses questions jeudi.
Et, finalement, peut-on peser collectivement ? L’ingénieur agronome et collapsologue Pablo Servigne, auteur de Comment tout peut s’effondrer en 2015 et de Une autre fin du monde est possible. Vive l’effondrement en 2018 répondra à vos questions à partir de 13 h 30. Il sera suivi dans la foulée par le youtubeur écolo Nicolas Meyrieux, engagé dans la campagne « On est prêt », qui sera présent en tchat à partir de 15 heures.
-
"La solution de la décroissance"
- Par Thierry LEDRU
- Le 27/02/2021
Je sais très bien que ce terme de "décroissance" agit comme un épouvantail et qu'il est souvent associé à des esprits perturbés, extrémistes, anarchistes et autres "istes" monstrueux.
Je dois dire que ça m'agace quelque peu.
Si je ne me retenais pas, je bombarderai ce blog d'articles et de documentaires expliquant ce qu'il en est réellement. Il ne s'agit donc pas de propos d'huluberlus mais bien de chercheurs scientifiques en tous genres : économistes, sociologues, biologistes et même financiers (si, si, il y en a :) )
Vous êtes ici : Accueil / Articles / La solution de la décroissance ?
La solution de la décroissance ?
http://ses.ens-lyon.fr/articles/la-solution-de-la-decroissance
Publié le 20/02/2016
Auteur(s) : Fabrice Flipo
Alors que la croissance est réaffirmée comme indispensable en réponse à la crise économique et écologique, le philosophe Fabrice Flipo propose d'explorer la voie alternative de la décroissance. Après une introduction sur l'émergence de la problématique de la décroissance, il développe cinq types d'arguments en faveur de celle-ci et donc cinq critiques théoriques de la croissance : écologiste, économique, anthropologique, démocratique et spirituel. Cette conférence s'inscrit dans le cycle sur "Le défi du développement durable" qui s'est déroulé à l'ENS de Lyon en 2015-16.
SOMMAIRE
La conférence de fabrice Flipo : La solution de la décroissance ?
La troisième conférence du cycle à l'ENS de Lyon sur "Le défi du développement durable" s'est déroulée le 8 février 2016. L'invité était le philosophe Fabrice Flipo.
Fabrice Flipo est Maître de conférences en philosophie et épistémologie politique à Télécom École de Management (Institut Mines-Télécom) et chercheur au Laboratoire de changement social et politique (LCSP-Université Paris 7 Denis Diderot) où il travaille dans le domaine des nouvelles technologies d'une part et dans celui de l'écologie et du développement durable d'autre part. Ses recherches portent notamment sur l'écologie politique et le mouvement de l'écologisme, les questions de justice en lien avec les enjeux écologiques, l'épistémologie de la décroissance, l'impact environnemental des NTIC et les technologies vertes. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur ces questions. Il est également chroniqueur du journal La Décroissance.
La conférence de fabrice Flipo : La solution de la décroissance ?
Partie 1 : La présentation de Fabrice Flipo
ChapitresDurée
Introduction aux cinq arguments ou justifications théoriques de la décroissance12:26
1. La source écologiste04:59
2. La source économique12:34
3. La source anthropologique09:37
4. La source démocratique09:52
5. La source spirituelle10:54
Télécharger la vidéo de la conférence (clic droit, "enregistrer la vidéo sous").
Résumé des cinq arguments ou justifications théoriques de la décroissance développés par Fabrice Flipo :
1. La source écologiste : la croissance détruit l'environnement et les écosystèmes ; critique du courant de la durabilité faible – substitution du capital technique au capital naturel permettant de concilier croissance économique et environnement – et de la thèse de la dématérialisation de l'économie. L'impact positif des NTIC sur l'environnement par exemple n'est absolument pas évident.
2. La source économique : la croissance est vouée à s'amenuiser en raison de l'essoufflement des gains de productivité (cf. thèses sur la stagnation séculaire, Robert Gordon), de la raréfaction des ressources non renouvelables et de la difficulté croissante à les exploiter, mais aussi du caractère limité des ressources renouvelables (Nicholas Georgescu-Roegen et la loi d'entropie).
3. La source anthropologique : la croissance est un type de civilisation ou de rapport au monde qui repose sur la division du travail et l'échange considéré comme mutuellement bénéfique (Serge Latouche). L'époque moderne a imposé une norme de développement fondée sur la croissance économique et la marchandisation du monde, où la nature est une simple ressource support de l'échange, sans valeur intrinsèque. On peut imaginer un autre mode de vie ou modèle de société qui reposerait sur le bien-vivre ensemble plutôt que sur la croissance et le productivisme.
4. La source démocratique : la croissance est un processus de dépossession des besoins par le système industriel et publicitaire et d'«industrialisation du manque» (Ivan Illich, voir aussi John Kenneth Galbraith et Jean Baudrillard). Le système industriel et commercial impose par exemple l'usage des technologies numériques ou une certaine configuration de l'espace incitant à l'utilisation de la voiture, d'où une perte de liberté et de maîtrise des objectifs de la croissance, mais aussi un accroissement des inégalités.
5. La source spirituelle : la décroissance favorise la réappropriation des besoins et des désirs à l'échelle individuelle. Une révolution intérieure est nécessaire pour faire face à la crise de sens que traversent nos sociétés. La "simplicité volontaire" est un moyen de se libérer de l'obligation de consommer toujours plus et de revenir à plus d'authenticité dans nos modes de vie (Pierre Rabhi).
Ces cinq sources de la décroissance sont indépendantes mais peuvent se renforcer mutuellement.
Partie 2 : Les questions du public
Télécharger la vidéo de la conférence (clic droit, "enregistrer la vidéo sous").
Questions abordées : la problématique démographique, comment produire le changement attendu avec des démarches individuelles minoritaires, la décroissance est-elle compatible avec le plein emploi, la décroissance implique-t-elle une baisse du revenu et du pouvoir d'achat ?
Pour aller plus loin
Fabrice Flipo, François Schneider, Denis Bayon, La décroissance. Dix questions pour comprendre et débattre, La Découverte Poche / Essais n°362, mars 2012. Compte rendu de Pascal Décarpes dans Lectures.
Fabrice Flipo, "Les cinq sources de la décroissance", Implications philosophiques (revue électronique de philosophie), 16 janvier 2015.
Fabrice Flipo, "Décroissance", Encyclopædia Universalis en ligne.
Fabrice Flipo, "L'urgence de la décroissance", Le Monde, 9/12/2015.
Fabrice Flipo, "Les trois conceptions du développement durable", Développement durable et territoires, Vol. 5, n°3, décembre 2014.
Film Demain, réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2015 (le site du film propose une rubrique enseignant et un dossier pédagogique).
Retour vers la présentation du cycle "le défi du développement durable".
-
"L'écomodernisme"
- Par Thierry LEDRU
- Le 27/02/2021
A la suite des deux articles reprenant les écrits et les propos de Michael Shellenberger et pour tenter d'en comprendre la teneur, j'ai continué à chercher sur le net. J'ai lu quelques articles, études, interview et je me suis intéressé à un autre scientifique couramment cité : Roger Pielke.
Roger A. Pielke Jr. (né le 2 novembre 1968) est un politologue et professeur américain, et a été directeur du Sports Governance Center au sein du département d'athlétisme du Center for Science and Technology Policy Research de l'Université du Colorado à Boulder1.
Il a précédemment servi dans le programme d'études environnementales et a été membre de l'Institut coopératif de recherche en sciences de l'environnement (CIRES), où il a été directeur du Center for Science and Technology Policy Research de l'Université du Colorado Boulder de 2001 à 2007. Pielke a été chercheur invité à la Saïd Business School de l'Université d'Oxford au cours de l'année scolaire 2007-20082.
Écrivain prolifique, il s'intéresse notamment à la politisation de la science, aux prises de décision dans l'incertitude, à l'éducation politique des scientifiques dans des domaines tels que le changement climatique, les plans d'urgence, le commerce mondial et des recherches sur la gouvernance des organisations sportives, dont la FIFA et la NCAA.
Sommaire
Éducation et formation
Pielke a obtenu une licence en mathématiques (1990), une maîtrise en politique publique (1992) et un doctorat en science politique, tous de l'Université du Colorado Boulder. Avant d'occuper ses fonctions à l'Université du Colorado Boulder, de 1993 à 2001, il a été chercheur au sein du groupe Impacts environnementaux et sociétaux du National Center for Atmospheric Research.
De 2002 à 2004, Pielke a été directeur des études supérieures pour le programme d'études supérieures en études environnementales de l'l'Université du Colorado Boulder et en 2001, les étudiants l'ont sélectionné pour le prix du meilleur conseiller diplômé (Outstanding Graduate Advisor Award). Pielke siège à de nombreux comités de rédaction et comités consultatifs, conserve de nombreuses affiliations professionnelles et a siégé au conseil d'administration de WeatherData, Inc. de 2001 à 2006. En 2012, il a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Linköping et le prix du service public de la Geological Society of America.
Publications
Les premières publications de Pielke ont été réalisés dans le cadre du programme de la navette spatiale américaine. En 1993, 7 ans après l'accident de la navette spatiale Challenger, il suggère que la navette est coûteuse et risquée et qu'il est « probable » qu'une autre navette soit perdue dans un délai de 20 à 35 vols7. Peu avant la perte de Columbia en 2003, il avertit que la perte d'une autre navette n'est qu'une question de temps8. Il a également critiqué le programme de la station spatiale internationale9.
Pielke a également beaucoup écrit sur les politiques en matière de changement climatique. Il est d'accord avec le GIEC : « Le GIEC a conclu que les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité humaine sont un important facteur de changement du climat. Et sur cette seule base, je suis personnellement convaincu qu'il est logique de prendre des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ». Selon Pielke, « toute politique concevable de réduction des émissions, même si elle est efficace, ne peut avoir un impact perceptible sur le climat pendant de nombreuses décennies », et il en conclut « que dans les décennies à venir, les seules politiques qui pourront être utilisées efficacement pour gérer les effets immédiats de la variabilité et du changement climatiques seront des politiques d'adaptation ».
Sur les questions des ouragans et du changement climatique, il fait valoir que la tendance à l'augmentation des dommages causés par les ouragans est principalement due à des facteurs sociétaux et économiques (principalement une augmentation de la densité de la richesse), plutôt qu'à un changement de fréquence et d'intensité. Cette opinion a conduit différentes personnes dont le Guardian à le considérer comme un « négateur » du changement climatique et un « alarmiste », ce qu'il rejette « fermement ».
Pielke est mentionné dans des courriels impliquant John Podesta, président de la campagne d'Hillary Clinton révélés par WikiLeaks. Le courriel en question a été envoyé par Judd Legum, l'éditeur de ThinkProgress, un site qui fait partie du Center for American Progress Action Fund, le bras de défense du think tank libéral Center for American Progress, qui a été fondé par Podesta en 2003. Dans son courriel à l'écologiste milliardaire Tom Steyer, Legum a décrit comment, selon lui, Climate Progress, la branche environnementale de ThinkProgress, a obtenu de Pielke qu'il cesse d'écrire sur le changement climatique pendant une période de cinq ans et demi.
En avril 2015, Pielke s'est joint à un groupe de chercheurs pour publier un « Manifeste de l'écomodernisme » : John Asafu-Adjaye, Linus Blomqvist, Stewart Brand, Barry Brook. Ruth DeFries, Erle Ellis, Christopher Foreman, David Keith, Martin Lewis, Mark Lynas, Ted Nordhaus, Rachel Pritzker, Joyashree Roy, Mark Sagoff, Michael Shellenberger, Robert Stone et Peter Teague.
Pielke a été nommé dans une lettre envoyée par le sénateur Edward Markey (D-MA) à de nombreux groupes de l'industrie énergétique, leur demandant de révéler les noms des scientifiques qu'ils avaient financés. Concernant la divulgation des conflits d'intérêts, M. Pielke a déclaré que la non-divulgation des conflits d'intérêts est assez endémique au sein des scientifiques du climat.
Si je reprends une des idées énoncées par Schellenberger et que je la juxtapose avec cette dernière phrase écrite en rouge, je ne peux m'empêcher de penser à des conflits d'intérêt : "La prévention des futures pandémies nécessite plus d’agriculture « industrielle » et non pas l’inverse."
Cette phrase-là m'a singulièrement interpellé. J'ai déjà évoqué ici la puissance du lobbying, au sein de l'UE comme dans tous les états développés. Mais bon, il faudrait que je lise le livre de Shellenberger pour comprendre ce qu'il veut dire.
Je pourrais en tout cas délivrer ici de très nombreuses études qui affirment le contraire. L'agriculture intensive industrielle n'est aucunement une fatalité et encore moins une nécessité. Disons que j'ai là un sérieux doute sur l'objectivité de ce monsieur. Il n'en reste pas moins que son parcours scientifique et son engagement dans l'écologie, durant une partie de sa vie, m'incite à m'interroger.
En continuant donc mes recherches, j'ai fini par croiser un terme dont j'ignorais l'existence : l'écomodernisme. Pielke, Shellenberger et les autres scientifiques mentionnés plus haut sont des adeptes de ce mouvement. On retrouve d'ailleurs le nom de Schellenberger et de Pielke dans l'article suivant.
A chacun de se faire son idée. Je renvoie bien évidemment au "paradoxe de Jevons" avant de tirer des conclusions.
ECOMODERNISME
https://www.hisour.com/fr/ecomodernism-34769/
Lecture audio
L’écomodernisme est une philosophie environnementale qui soutient que les humains peuvent protéger la nature en utilisant la technologie pour «dissocier» les impacts anthropiques du monde naturel. L’écomodernisme est une école de pensée de nombreux spécialistes de l’environnement et du design, critiques, philosophes et activistes. Le modernisme basé sur l’écologie est la manière la plus directe de définir ce mouvement. Il englobe les aspects les plus réussis des Designers Outlaw (Jay Baldwin, Buckminster Fuller et Stewart Brand) des années 1960 et 70 avec le pragmatisme optimiste des Modernistes basé sur la réforme. Il exige une compréhension plus détaillée de l’histoire de la discipline et encourage les objets conçus et les systèmes créés avec l’inspiration logique du cycle de la nature intégré à ses objectifs.
Les créations matérielles et immatérielles qui en résultent espèrent mieux unir la technologie, l’humanité et la nature. L’éco-modernisme incite les designers à se déconnecter de leur univers de pixels et à renouer avec les nuances de notre environnement naturel pour mieux comprendre les matériaux que nous utilisons, les procédés que nous utilisons et apprécier l’importance de nos ressources naturelles. Au lieu de l’approche linéaire d’un processus de conception, basé sur le fordisme et le taylorisme, l’éco-modernisme embrasse le modèle de la «nourriture égale» (William McDonough et Michael Braungart) et le berceau-à-berceau inventé par Walter R. Stahel dans le 1970 (pendant le mouvement de conception d’Outlaw) où la conception et la fabrication visent à «fermer la boucle».
Pour réaliser cette composante du mouvement, les concepteurs doivent minimiser leur empreinte environnementale en utilisant des ressources locales et renouvelables pour tous nos projets futurs. Dans leur manifeste de 2015, 18 écomodernistes autoproclamés – y compris des chercheurs du Breakthrough Institute, de l’Université de Harvard, de l’Université de Jadavpur et de la Long Now Foundation – ont élargi la définition originale d’Eric Benson et Peter Fine en 2010: l’idéal environnemental durable, que l’humanité doit réduire ses impacts sur l’environnement pour faire plus de place à la nature, alors que nous en rejetons une autre, que les sociétés humaines doivent s’harmoniser avec la nature pour éviter l’effondrement économique et écologique.
Aperçu
L’écomodernisme comprend explicitement la substitution des services écologiques naturels à l’énergie, à la technologie et aux solutions synthétiques. Les éco-modernistes adoptent notamment l’intensification agricole, les aliments génétiquement modifiés et synthétiques, le poisson des fermes aquacoles, le dessalement et le recyclage des déchets, l’urbanisation et le remplacement des combustibles moins denses par des combustibles plus denses (par exemple, remplacer le charbon par du bois). les technologies à faible teneur en carbone telles que les centrales électriques à combustible fossile équipées de systèmes de capture et de stockage du carbone, les centrales nucléaires et les énergies renouvelables avancées). L’utilisation de la technologie pour intensifier l’activité humaine et faire plus de place à la nature sauvage est l’un des principaux objectifs d’une éthique environnementale respectueuse de l’environnement.L’écomodernisme a émergé de la rédaction académique d’Eric Benson et Peter Fine dans un article publié en 2010. Divers débats, y compris le débat sur le moment où Homo sapiens est devenu une force dominante agissant sur les écosystèmes terrestres (dates proposées pour la gamme Anthropocène) depuis l’avènement de l’agriculture il y a 10 000 ans jusqu’à l’invention des armes atomiques au XXe siècle). Parmi les autres débats qui forment la base de l’écomodernisme, on peut citer la meilleure façon de protéger les milieux naturels, d’accélérer la décarbonisation pour atténuer les changements climatiques et d’accélérer le développement économique et social des pauvres dans le monde.
Dans ces débats, l’écomodernisme se distingue des autres courants de pensée, notamment le développement durable, l’économie écologique, la décroissance ou l’économie stationnaire, la réduction de la population, l’économie du laisser-faire, la «soft energy» et la planification centrale. L’écomodernisme considère beaucoup de ses idéologies fondamentales empruntées au pragmatisme américain, à l’écologie politique, à l’économie évolutionniste et au modernisme.
L’éco-modernisme embrasse les principes fondamentaux de la durabilité où tout design est créé pour: respecter et prendre soin de la communauté, améliorer la qualité de vie, conserver la vitalité et la diversité de la Terre, minimiser l’épuisement des ressources non renouvelables et changer les attitudes et pratiques personnelles maintenir la capacité de charge de la planète.
Les concepteurs et les artistes qui travaillent dans ce mouvement cherchent la réalisation créative dans les problèmes de conception systémique plus grands afin d’élever la profession du niveau inférieur de l’échelle de l’entreprise aux leaders respectés et aux innovateurs à travers la culture. Ils embrassent la logique moderniste et les initiatives basées sur la réforme, mais rejettent les solutions universelles et utilisent plutôt des matériaux locaux et des idées sexospécifiques / culturelles qui créent ce que Jorge Frascara considère comme le meilleur design: faciliter, soutenir et améliorer la vie.
Origine
L’éco-modernisme est né aux alentours de 2004 aux États-Unis. La manière de penser a surgi en partie en réponse aux idées d’une partie du mouvement environnemental traditionnel. Selon les écomodernistes, une grande partie du mouvement environnemental traditionnel est:Trop critique sur les effets de la modernité et du progrès sur l’environnement.
Trop critique du rôle de l’homme par rapport à la nature, et pense trop en termes de limitations des actions humaines qui seraient nécessaires.
Trop critique sur les inconvénients de la technologie et de l’économie pour l’environnement.
Trop négatif sur l’avenir de la nature, et trop positif sur la nature elle-même.
Des idées
Les écomodernistes se distinguent au sein du mouvement environnemental par leur forte appréciation du modernisme et de la modernité. Il se félicite de la poursuite de la modernisation et est convaincu que cela conduira à de grands progrès, y compris dans le domaine de la durabilité.Les éco-modernistes reconnaissent les problèmes environnementaux existants, mais croient en la possibilité de les réduire à l’avenir avec l’inventivité humaine.
Ils s’attendent à court terme à de nombreuses innovations technologiques, telles que, par exemple, des techniques de production plus propres, qui contribueront grandement à une nouvelle économie durable. Parce qu’ils croient que l’économie peut devenir pleinement viable, ils ne voient pas la croissance économique comme un problème, mais comme une augmentation positive de la prospérité. Selon les écomodernistes, aucune restriction de comportement ne doit donc être imposée aux personnes ou au monde des affaires pour atteindre la durabilité. Ils ont une résistance aux règles du comportement et des appels moraux à la sobriété.
Ils ne considèrent pas la nature comme intrinsèquement utile, mais comme un fournisseur de ressources naturelles et de services écosystémiques pour les humains. Les écomodernistes n’ont aucun problème avec la prédominance des humains sur notre planète dans l’Anthropocène et croient qu’il peut être souhaitable d’augmenter davantage la domination humaine afin de contrôler de façon optimale le système naturel.
Positions
Les éco-modernistes veulent se démarquer des points de vue communs et répandus sur l’environnement et le climat et offrir une alternative à un débat qui, selon eux, est au point mort. Ils doutent surtout que les changements culturels demandés par de nombreux écologistes (moins de consommation, plus de subsistance, etc.) soient réalisables. Surtout en raison de la persistance de la pauvreté généralisée dans de grandes parties du monde qui serait naïve. Ils supposent que la plupart des problèmes environnementaux peuvent être résolus technologiquement.Un document important de l’Ökomodernisten est le Manifeste Ecomodernist. Ses points clés comprennent:
L’intensification de l’agriculture, de l’aquaculture, de la production d’énergie et des zones de peuplement humain devrait protéger la nature selon le principe d’économie de la terre.
L’énergie est essentielle pour une utilisation plus efficace des ressources naturelles (par exemple, la purification et le dessalement de l’eau, le recyclage, l’agriculture intensive avec un minimum d’utilisation des terres), d. H. L’énergie moins chère est un facteur très important dans la réalisation de ces technologies. À long terme, l’énergie nucléaire et l’énergie solaire sont considérées comme les producteurs d’énergie les plus efficaces.
Les menaces graves comprennent le changement climatique, l’amincissement de la couche d’ozone et l’acidification des océans.
La dépendance générale vis-à-vis de la nature devrait être réduite afin de la protéger.
L’urbanisation mondiale devrait réduire la consommation naturelle et promouvoir la croissance.
La durabilité peut être atteinte par la renaturalisation et la réimagerie de la planète.
La protection du climat ne doit pas être placée inconditionnellement avant les intérêts de la population, en particulier dans les pays les plus pauvres.
Les États et les sociétés doivent consacrer leurs énergies à la réalisation de ces objectifs. Le niveau de vie moderne dans le monde et la promotion des pays en développement et émergents doivent être prioritaires. Les fonds sont réellement là. Pour cela, cependant, les réserves idéologiques devraient être supprimées.Un manifeste écomoderniste
En avril 2015, un groupe de 18 écomodernistes autoproclamés a publié collectivement un manifeste éco-moderniste. Les auteurs étaient:John Asafu-Adjaye
Linus Blomqvist
Stewart Brand
Barry Brook
Ruth DeFries
Erle Ellis
Christopher Foreman
David Keith
Martin Lewis
Mark Lynas
Ted Nordhaus
Roger Pielke, Jr.
Rachel Pritzker
Joyashree Roy
Mark Sagoff
Michael Shellenberger
Robert Stone
Peter Teague
Les auteurs ont écrit:Bien que nous ayons à ce jour écrit séparément, nos opinions sont de plus en plus discutées dans leur ensemble. Nous nous appelons écopragmatistes et écomodernistes. Nous offrons cette déclaration pour affirmer et clarifier nos points de vue et pour décrire notre vision pour mettre les pouvoirs extraordinaires de l’humanité au service de la création d’un bon Anthropocène.
Réception et critique
Des journalistes environnementaux éminents ont fait l’éloge du Manifeste Ecomodernist. Au New York Times, Eduardo Porter a écrit d’une manière approbatrice l’approche alternative de l’écomodernisme au développement durable. Dans un article intitulé «Le Manifeste appelle à mettre fin à l’écologisme des« gens sont mauvais », Eric Holthaus de Slate a écrit:« C’est inclusif, c’est excitant, et cela donne aux environnementalistes quelque chose à se battre pour un changement. La revue scientifique Nature a éditorialisé le manifeste.Les critiques courantes de l’écomodernisme ont inclus son manque relatif de considération pour la justice, l’éthique et le pouvoir politique. Dans “Un diagnostic sympathique du Manifeste Ecomoderniste”, Paul Robbins et Sarah A. Moore décrivent les similitudes et les points de départ entre l’écomodernisme et l’écologie politique.
Certains écologistes [qui?] Ont également caractérisé l’écomodernisme comme une excuse pour continuer l’exploitation des ressources naturelles pour des gains humains.
Un autre courant important de critique envers l’écomodernisme vient des partisans de la décroissance ou de l’économie stationnaire. Dix-huit économistes écologiques ont publié une longue réplique intitulée “Une réponse de décroissance à un manifeste écomoderniste”, (je l'ai cherchée sur le net mais sans succès ) écrivant que “les écomodernistes ne fournissent ni un modèle très inspirant pour de futures stratégies de développement ni beaucoup de solutions à nos problèmes environnementaux et énergétiques.”
Lors du Dialogue annuel de l’Institut Breakthrough en juin 2015, plusieurs éminents spécialistes de l’environnement ont présenté une critique de l’écomodernisme. Bruno Latour ( ce Monsieur est une sacrée référence dans le domaine de la réflexion.) a fait valoir que la modernité célébrée dans le Manifeste Ecomodernist est un mythe. Jenny Price a soutenu que le manifeste offrait une vision simpliste de l ‘«humanité» et de la «nature», qui, selon elle, sont «rendues invisibles» en parlant d’elles en termes si généraux.