Blog
-
Dominique Bourg : la sobriété
- Par Thierry LEDRU
- Le 14/08/2022
Dominique Bourg : "La sobriété, ce n'est pas vivre plus mal, c'est apprendre à vivre mieux"
Vendredi 12 août 2022
ÉCOUTER (24 MIN)
Image d'illustration ©AFP - CAMILLO BALOSSINI / ROBERT HARDING

Provenant du podcastL'invité de 8h20 : le grand entretien
CONTACTER L'ÉMISSION
Résumé
Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et spécialiste des questions environnementales et Olivier Sidler, membre fondateur et porte-parole de l'association négaWatt, qui prône la sobriété énergétique, sont les invités de France Inter.
En savoir plus
"On se comporte comme si la Terre n'existait pas. Comme s'il n'y avait pas d'équilibres sur cette planète, et comme si on pouvait, par nos techniques, tout transgresser", commence le philosophe Dominique Bourg, spécialiste de l'écologie. Il donne une définition de la sobriété : "Ce n'est pas de vivre plus mal, c'est d'apprendre à vivre mieux, avec une empreinte écologique beaucoup plus petite". Or, dit-il, "quand vous parlez de sobriété, si chacun doit faire moins, ça rend les écarts de richesse beaucoup plus insupportables. Qu'un Jeff Bezos fasse du tourisme planétaire et émette en carbone ce que des centaines de personnes ne feront même pas dans leur vie, ça n'est plus tolérable", analyse-t-il.
"L'idée clé de la sobriété, c'est l'autolimitation"
Il revient sur l'origine philosophique de ce concept. Selon Dominique Bourg, l'idée clé de la sobriété, "c'est l'autolimitation et la civilisation qui a le plus excellé dans ce domaine, c'est la Grèce. La Grèce s'est construite sur le rejet de la démesure, de l'hubris", détaille-t-il. Puis il poursuit : "la sobriété, ce n'est pas pour se faire suer. C'est pour trouver une forme d'équilibre, car il n'y a pas de bonheur sans une forme d'équilibre. Dans nos sociétés, où on nous incite à acheter sans cesse, c'est très anxiogène. On crée un manque artificiel". Selon lui, passer à la sobriété, c'est donc changer de "civilisation".
Pour Olivier Sidler, membre fondateur et porte-parole de l'association négaWatt : "La sobriété, c'est tout ce qu'on peut faire à titre individuel et collectif pour changer nos comportements et nos choix afin de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire nos besoins de base. Si chacun s'astreint à cela, c'est un grand progrès", avance-t-il.
"On peut tous prétendre qu'on est libre, sauf qu'on fait mourir l'espace qui nous fait vivre"
Que répondre à ceux qui prônent plutôt la liberté, et notamment celle de consommer ? "La Terre a ses limites", déclare Olivier Sidler*. "On peut tous prétendre qu'on est libre et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Sauf qu'on est en train de faire mourir l'espace qui nous fait vivre, qui nous nourrit. Donc c'est suicidaire de faire ça*."
Et donc, cette fameuse liberté individuelle que chacun s'octroie est au final la disparition de la liberté de tous puisque chacun condamne les autres à souffrir et même à mourir. On pourrait donc dire "que j'ai le droit d'être libre de faire ce que je veux, légalement parlant, même si cela impacte la vie de tous. C'est face à ce paradoxe mortifère qu'il est urgent et impératif de légiférer. Mais qui aura le courage de le faire ?
Dominique Bourg revient sur ce concept de liberté : "La liberté a pour limite ce qui ne nuit pas à autrui, or c'est ce qu'on fait. La manière dont nous, Occidentaux, avons répandu une illusion de l'accomplissement de soi par la consommation, ça a pour conséquence de détruire la vie sur Terre. Donc ce n'est pas de la liberté", estime-t-il.
Les "énormes intérêts pour le particulier" de la sobriété
Olivier Sidler, fondateur de négaWatt, liste les "énormes intérêts pour le particulier" de la sobriété : "l'intérêt économique, se sentir mieux dans la maitrise de sa vie, l'amélioration de sa santé, une plus grande résilience, la préservation du bien être animal et de la biodiversité…Ca fait beaucoup de choses qui sont positives lorsqu'on s'engage dans ce concept de sobriété."
-
Coupable d'ignorance.
- Par Thierry LEDRU
- Le 07/08/2022
Je me sens coupable, fautif, irresponsable.
J'ai vécu pendant une grande partie de ma vie dans une ignorance béate, un individualisme immature, comme un enfant gâté. Je n'ai rien lu des alertes lancées par de nombreux scientifiques, je les ai ignorées alors que les premières études datent de 1972, des études partagées à grande échelle. J'aurais pu les trouver si j'avais cherché.
J'ai fait mes études, j'ai appris ce qu'on me demandait d'apprendre, j'ai eu mes diplômes, je me suis engagé dans une voie professionnelle, puis une aventure amoureuse, puis une famille. J'ai suivi une voie toute tracée sans jamais détourner mes regards et mon attention de cette "réussite".
Une "réussite" qui consistait à participer au saccage.
Je n'ai jamais fait de croisière, je n'ai pris l'avion qu'une fois ; lorsque mon frère est mort et qu'un gendarme m'a téléphoné pour me dire que mes parents étaient injoignables, qu'ils étaient partis avec leur camping car et que personne ne savait où. Alors, j'ai pris l'avion pour retrouver mon frère à la morgue. Et pour chercher mes parents. Je ne suis plus jamais monté dans un avion. Je suis revenu en train.
Et je ne veux pas aller voir les sommets de l'Himalaya qui me fascinent tant, ni les volcans d'Islande, ni les grandes parois du Yosémite parce que je refuse que mon plaisir laisse une trace dans l'atmosphère.
Je ne mange plus d'animaux depuis quinze ans mais j'en ai tant mangé que j'ai l'impression d'être un cimetière.
J'ai grimpé au sommet du Mont-Blanc et sur bien d'autres montagnes et glaciers sans jamais m'inquiéter de leur disparition. J'ai profité des merveilles de la nature sans jamais penser que mes comportements contribuaient à leur effacement.
Aujourd'hui, je suis grand-père et je me sens coupable lorsque j'entends les rires de notre petit-fils, que je vois le bonheur dans ses yeux. Le bonheur de celui qui ne sait rien encore du monde que nous lui "offrons".

Le Glacier des Gourgs Blancs (3128m) dans le Luchonnais s’en est allé… et d’autres vont le suivre.

Mais rien n'arrête le commerce mondial et le tourisme de masse.


« Sans avion vert avant 15 ans, il faut diminuer le trafic dès maintenant ! »

13 septembre 2021 - La Relève et La Peste
Générations, notre nouveau livre qui marque dans le temps l’esprit d’une génération qui se bat pour préserver notre monde
- Thème : Changements climatiques, répression policière, inégalités, agroécologie, politique, féminisme, nature…
- Format : 290 pages
- Impression : France
Selon l’Association du transport aérien international (IATA), la demande en juillet 2021 est restée « bien en-deçà des niveaux d’avant la pandémie », malgré plus de vols à l’intérieur de l’Europe. En juillet 2021, le nombre total de voyages aériens était ainsi en baisse de 53,1% par rapport à juillet 2019. Si le secteur du transport aérien a été cloué au sol par la pandémie, ce n’est pas pour autant qu’il doit redémarrer « comme avant », plaident les auteurs de cette tribune, qui rappellent le rôle de l’aérien dans la crise climatique et le mythe de « l’avion vert ».
» Emmanuel Macron a annoncé le 2 septembre le maintien de l’extension de l’aéroport Marseille-Provence qui doit être achevée d’ici à la fin de l’année 2023, juste avant les Jeux Olympiques. Et ce, malgré les luttes menées par des associations de riverains et des ONG contre les extensions d’aéroport et alors que l’interdiction des extensions d’aéroports était l’une des mesures proposées par la Convention Citoyenne pour le Climat, non reprise par la loi climat, Marseille se situant à moins de quatre heures de Paris en train.
Partout en France, les associations et ONG sont confrontées aux mêmes problématiques. Depuis 2020 et la pandémie de Covid-19, la région Occitanie a perdu plus de 8 000 emplois dans le secteur aérospatial. La date et l’ampleur de la reprise sont incertaines. Des investissements très forts sont nécessaires pour faire repartir l’industrie, et redynamiser un territoire déboussolé. Pour autant, faut-il reconstruire sur un modèle pré-Covid-19 ?
L’association Notre Choix et le collectif PAD (Pensons l’Aéronautique pour demain) font partie des acteurs qui se mobilisent depuis le début de la crise sanitaire pour penser et implanter des solutions concrètes en faveur d’une réduction du trafic aérien post-Covid et une sensibilisation des citoyens et citoyennes à leurs modes de consommation sur l’aviation.
Parce qu’ils souhaitent garder les avions dans le ciel, mais de manière plus équilibrée et en accord avec les préconisations du GIEC, Notre Choix et le PAD ont invité 80 spécialistes pour débattre des sujets de l’avenir de l’aviation, des salariés, de la santé des riverains, des actions des ONG, du futur du ferroviaire et de la nécessité d’un tourisme responsable : il s’agit de la première édition des Assises de l’Aviation.
80 experts et experts parmi lesquels des salariés et étudiants du secteur, des ONG (Greenpeace, Non au T4, Alternatiba…), des scientifiques, des sociologues, journalistes et acteurs proposant des méthodes de voyages sans avion. Fédérer ces acteurs est devenu indispensable pour atteindre leur objectif commun : réduire drastiquement les émissions liées à l’aviation et aux voyages.

En effet, l’urgence de la crise environnementale liée au réchauffement climatique et à l’extinction massive de la biodiversité exigent des changements, y compris pour le secteur de l’aérien, dont les gaz à effet de serre sont en croissance annuelle de 5 %.
Pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5° C, le GIEC préconise au niveau mondial une baisse des émissions de GES dès 2020, avec a minima -35 % d’émissions en 2030 par rapport à 2010. Or, le secteur aérien, dans ses plans les plus ambitieux présentés par l’IATA, prévoit le maintien des émissions de GES au niveau de celles de 2020 jusqu’en 2035.
Le délai instauré par le secteur de l’aérien pour commencer à baisser ses émissions de GES est explicable : 15 ans sont nécessaires pour monter à maturité le concept « d’avion vert » avant sa mise au marché (avion à hydrogène, SAF (biocarburant)). Pour autant, nous considérons que cette perspective n’est pas acceptable en l’état : chaque secteur industriel doit prendre sa part à l’effort de réduction de GES.
Puisque sur les 15 années à venir il n’y aura pas d’avions verts, le collectif PAD considère qu’il faut baisser le trafic. Ce qui implique une baisse du nombre d’avions en exploitation, soit certainement une baisse du nombre d’avions neufs à construire. Quel impact pour l’emploi dans la région Occitanie, si dépendante de l’industrie aéronautique ? Quelles solutions pour la mobilité de demain ?
La patience n’est plus une vertu mais une complicité avec ceux qui nous précipitent vers des cataclysmes alors venez penser l’après et agir maintenant en participant aux Assises de l’aviation qui auront lieu du 17 au 26 septembre à Toulouse et Paris.«
Pré-inscriptions et programme complet disponibles sur le site des Assises.
Note : L’essentiel du texte proposé est extrait du rapport « moins d’avions / plus d’emplois » publié par le collectif PAD en Août 2021.
13 septembre 2021 - La Relève et La Peste
-
Ecologie radicale
- Par Thierry LEDRU
- Le 06/08/2022
L'écologie radicale n'existera jamais à grande échelle. Il n'est qu'à voir les critiques acerbes et parfois haineuses envers les "écolo-bobo-gaucho". La majeure partie de la population s'opposera toujours à la restriction de leurs "libertés", c'est à dire la possibilité de continuer à détruire la vie de la planète.
« Si nous ne prenons pas soin du sol et des milieux vivants, l’espèce humaine se tire une balle dans le pied »
Je ne suis pas optimiste mais j’aime à croire qu’en agissant collectivement, il y a toujours des espèces à sauver, des terres agricoles à sauvegarder, des dixièmes de degrés de réchauffement à gagner et donc des êtres humains et non-humains à protéger.

20 septembre 2021 - Matthieu Delaunay
Générations, notre nouveau livre qui marque dans le temps l’esprit d’une génération qui se bat pour préserver notre monde
- Thème : Changements climatiques, répression policière, inégalités, agroécologie, politique, féminisme, nature…
- Format : 290 pages
- Impression : France
Avec La Révolution du potager, la militante anarcha-féministe Béné propose une nouvelle façon de cultiver la radicalité écologique par de nouveaux modes d’action. Plutôt que l’écologie de la carte bleue, elle prône l’urgence de rompre avec la dichotomie entre nature et culture, et encourage à remettre les mains dans la terre. Entretien autour de l’engagement et de des joies et des défis du grand dehors.
LR&LP : Sur quoi et pourquoi tentez-vous d’agir en ce moment (sachant que le moment peut avoir duré et durer encore longtemps) ?
Béné : Je fais partie du collectif Stop Carnet qui lutte contre un projet de zone industrielle de 110 ha en bord de Loire et plus globalement je lutte contre toutes formes de violences systémiques (écologiques, racistes, sexistes, spécistes, validistes…) et pour un monde digne et soutenable pour tous et toutes !
Lire aussi : La ZAD du Carnet a été expulsée ce matin pour un « projet au point mort »
LR&LP : Qu’est-ce qui vous a amené aux joies (et aux difficultés) du jardin ?
Mes parents ont toujours beaucoup jardiné et ont eu un potager très tôt, et mes grands-parents étaient paysan.ne.s. Cultiver un potager est donc un héritage familial en plus d’un plaisir et une nécessité écologique pour moi !

Se ressourcer au potager avec Melle Béné
LR&LP : Quelle est la genèse de ce livre ? Était-ce d’abord pour vous un moyen de rejoindre et convaincre de nouvelles personnes ou surtout de poser sur le papier la somme de connaissances que vous avez assimilée depuis plusieurs années ?
J’ai été contactée par la maison d’édition La Plagepour écrire un livre sur le potager au fil des saisons, accompagné de recettes végétariennes aux légumes de saison. Honorée par ce projet, j’ai fait de mon mieux pour donner au potager et à l’alimentation végétale un angle politique.
L’idée était surtout de transmettre ma passion pour l’écologie, le monde animal et végétal et donner des clés de compréhension sur l’écologie systémique et politique.
Globalement, je souhaitais faire évoluer l’imaginaire des lecteurs et lectrices sur la radicalité écologique et sur l’écologie individuelle et collective, en leur montrant qu’il y avait de nombreux modes d’actions pour s’emparer de l’écologie, à différentes échelles et en fonction de ses moyens.
LR&LP : Si on retrouve des conseils, des recettes, des façons de faire et de bonnes pratiques pour apprendre à cultiver et entretenir son jardin, ce livre témoigne aussi de vos engagements de militante. Peut-on vous décrire comme une ecoféministe? Quels sont les combats que vous menez et pour quelle raison ?
J’ai toujours eu du mal à me revendiquer éco-feministe. Ce terme est galvaudé particulièrement depuis quelques mois et récupéré politiquement à toutes les sauces. Cela dit, je me revendique de l’éco-féminisme radical, celui des Bombes Atomiques de Bure ou du camp de femmes de Greenham Common.
Je me sens hermétique à l’éco-féminisme spirituel, que je respecte évidemment par ailleurs. Comme la notion est encore floue et récupérée par des partis politiques ou des méthodes avec lesquelles j’ai peu d’affinités, je préfère me voir comme anarcha-féministe ou éco-anarchiste (rires).
Mes sensibilités prioritaires sont l’écologie et le féminisme. Les deux sont fortement liées puisque les femmes font partie des premières victimes du dérèglement climatique et qu’on exploite les femmes comme on exploite “la nature”. Plus globalement, je me bats contre tous les rapports de domination en essayant de prendre part à la construction d’alternatives politiques.
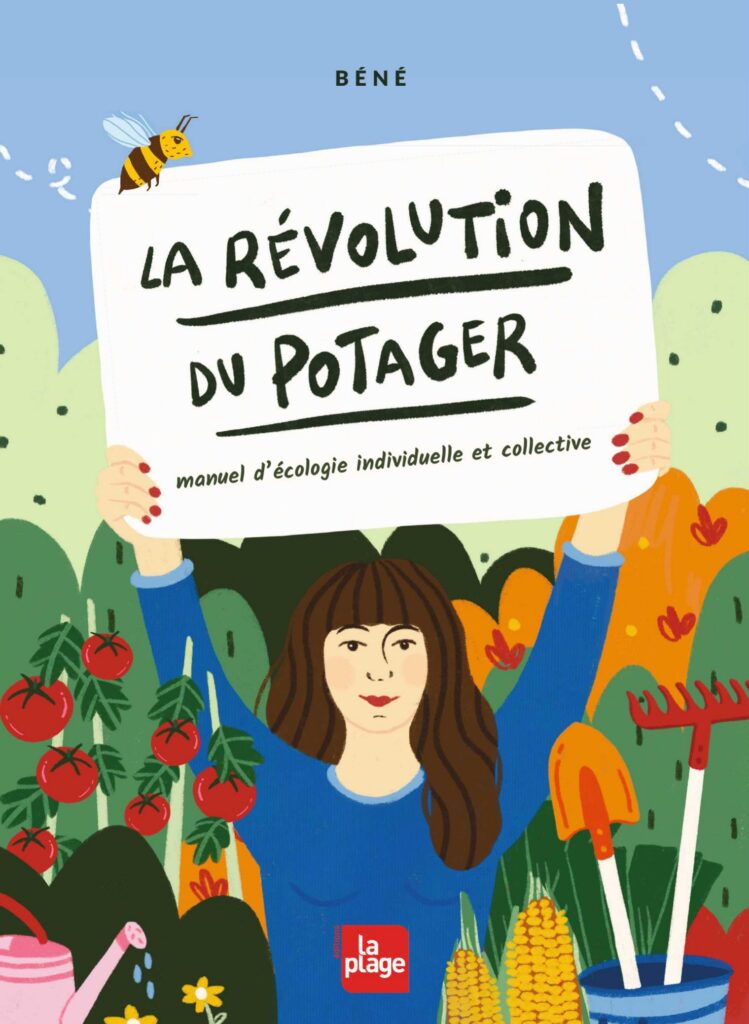
La révolution du potager, Manuel d’écologie individuelle et collective, de Béné
LR&LP : Plutôt que de pratiquer l’écologie de la carte bleue, vous nous proposez de faire la révolution par le potager. Qu’entendez-vous par là et pourquoi continuez-vous d’y croire ?
À travers le potager, je propose en effet que chacune et chacun se saisisse des enjeux liés au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Je suis convaincue que comprendre comment fonctionne la culture de fruits et légumes, de quoi notre sol a besoin pour nous nourrir, donner des clés de compréhension des aberrations écologiques de notre monde à travers des focus sur les engrais de synthèse, l’artificialisation des sols, l’élevage intensif, etc., peut donner envie aux personnes de militer concrètement et radicalement pour l’écologie.
Je ne suis pas optimiste mais j’aime à croire qu’en agissant collectivement, il y a toujours des espèces à sauver, des terres agricoles à sauvegarder, des dixièmes de degrés de réchauffement à gagner et donc des êtres humains et non-humains à protéger.

Le sourire de Bene au potager
LR&LP : Qu’est-ce que le potager vous a appris ? Que retirez-vous, en plus d’une excellente nourriture, de cette vie de « grand dehors »?
Que la dichotomie “nature” et “culture” est complètement erronée. Que nous faisons partie de la nature, que si nous ne prenons pas soin du sol et de nos milieux vivants, l’espèce humaine se tire une balle dans le pied. Elle ne pourra plus se nourrir dignement, n’aura plus d’air respirable, plus d’eau potable. C’est d’ailleurs déjà le cas pour des millions de personnes déjà confrontées aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité.
LR&LP : Alors que vous avez les deux mains et les pieds dans la terre, vous menez aussi un travail de fond sur les réseaux sociaux. Pourquoi être sur ces deux terrains ? Comment arrivez-vous à jongler entre ces deux « écosystèmes » et à garder le moral, alors que nous venons de traverser un été particulièrement concentré en drames climatiques de toutes sortes et que les réseaux sociaux exacerbent ?
Je ne garde pas du tout le moral. Je suis très fragilisée par les évènements de cet été, en plus du reste comme la montée du fascisme… Essayer d’informer sur les réseaux pour donner envie de lutter est selon moi nécessaire, pour ne pas laisser la place aux discours haineux ou fascisants anti-écologistes.
Je pense que l’information sur l’écologie loin des discours catastrophistes, qui peuvent résigner plutôt que d’inciter à agir, est vitale.
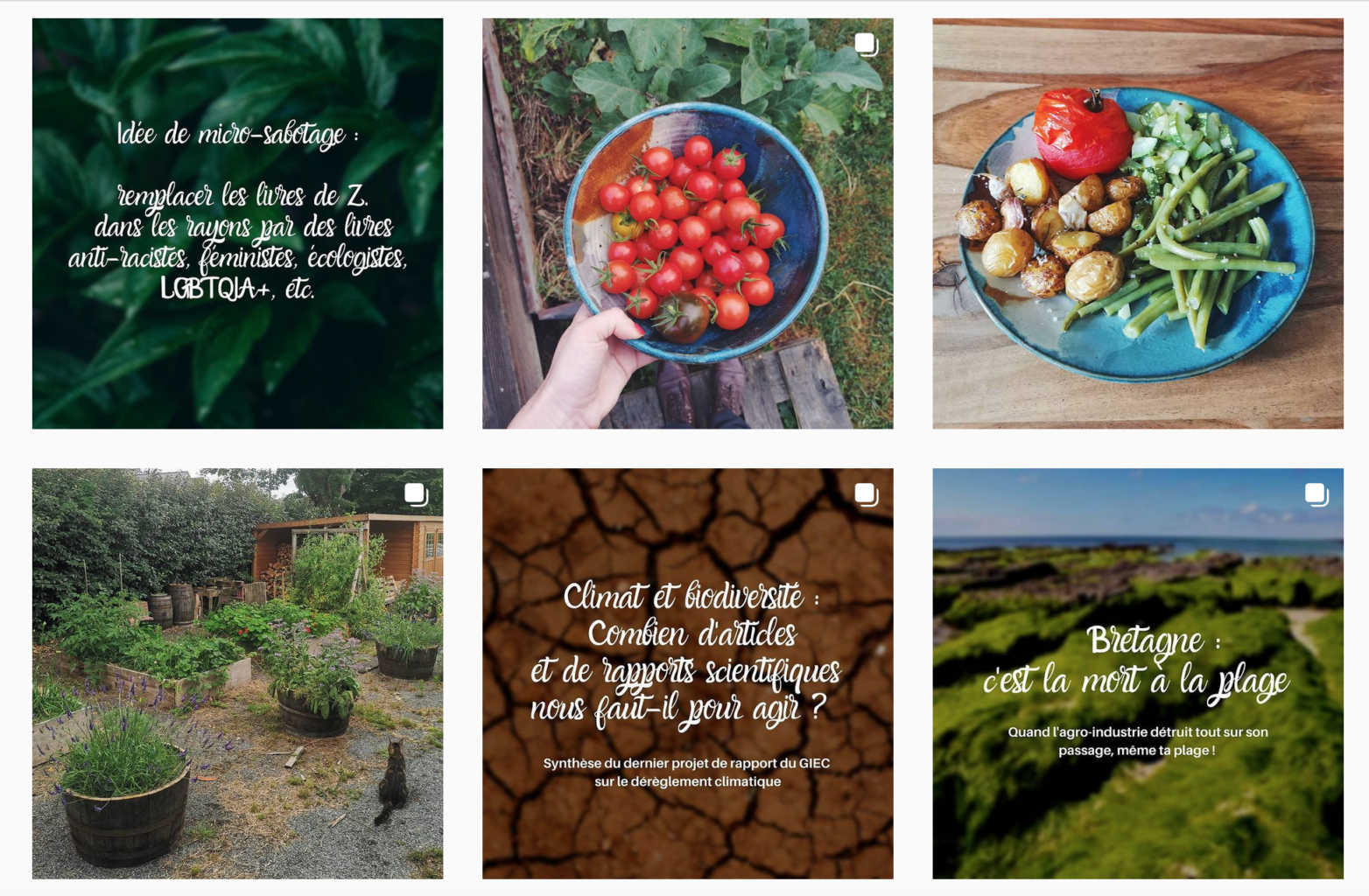
Extrait du compte Instagram de Melle Bene
LR&LP : La période que nous traversons est très anxiogène et étouffante. À bien y regarder, rien ne peut laisser supposer que l’avenir sera plus encourageant. Avant de pouvoir toutes et tous retrouver la terre et faire pousser nos légumes (si nous le pouvons et le souhaitons), que vous semble-t-il urgent de mettre en place, au niveau individuel mais aussi collectif, pour sortir de l’ornière que la COVID a creusée plus profondément ?
Lutter contre les causes et les conséquences du dérèglement climatique, de l’effondrement de la biodiversité et contre les rapports de domination à échelle individuelle et collective est urgent et nécessaire.
Cela passe par la végétalisation de son alimentation et la lutte contre le modèle agro-industriel. Mais aussi par revoir sa mobilité et réduire drastiquement ses trajets en avion tout en luttant contre le tourisme de masse et les projets d’aéroports.
En bref, remettre en question son mode de vie et sa façon de consommer (si on a le privilège de pouvoir le faire) tout en luttant contre le capitalisme à échelle plus globale.
Il y a une palette d’actions très vaste dont on peut se saisir, tout en privilégiant l’action collective (au sein de collectifs écologistes, féministes, anti-racistes, etc.) pour changer radicalement le système. Cela permet d’agir avec un rapport de force incomparable à l’écologie individuelle et de s’émanciper en même temps.
Lorsqu’on se sent seul.e, que l’on ne sait plus quoi faire pour agir, le collectif est une soupape en plus d’être un moyen d’action dont on doit s’emparer au maximum pour faire la révolution !
LR&LP : Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin et qui continue de vous faire marcher la journée ? Une Musique, un livre, une peinture, un paysage, une personne…
Le chant des oiseaux le matin, les câlins de mes animaux, les bons petits plats, les fêtes entre ami.e.s, danser… Il y a plein de moments de joie dans la vie. C’est d’ailleurs parce que j’aime autant la vie que j’ai envie de la préserver !
Lire aussi : Paroles de Zadistes : « La nature suffoque et c’est à notre génération de faire bouger les lois »
Propos recueillis par Matthieu Delaunay. Journaliste, auteur, voyageur au long cours, Matthieu Delaunay contribue régulièrement à La Relève et La Peste à travers des entretiens passionnants, vous pourrez le retrouver ici.
20 septembre 2021 - Matthieu Delaunay
"Le plus souvent, les gens renoncent à leur pouvoir car ils pensent qu'il n'en ont pas"
Votre soutien compte plus que tout -
Le fruit de notre liberté
- Par Thierry LEDRU
- Le 06/08/2022
"Le fruit de notre liberté"
Est-ce un fruit condamné à pourrir et à contaminer l'ensemble de l'arbre ?
Cette fameuse liberté nous donne-t-elle le droit de condamner ainsi la multiplicité merveilleuse de la vie ?
Est-ce donc dans ce cas-là une forme de condamnation de tous par personnes interposées ? C'est ça la question essentielle.
J'ai écrit dernièrement à l'office de tourisme de la Creuse pour les alerter sur les risques qu'il génère eux-mêmes en appelant les touristes à venir goûter à la magie de ce département.
La Creuse n'a aucun intérêt, c'est un désert culturel, il n'y a pas de zones commerciales, il n'y a pas de festivals, les villages sont silencieux et ne proposent que des petits commerces aux heures d'ouverture limitées, les routes sont sinieuses et en mauvais état, les locaux ne cherchent pas à entrer en contact avec les gens de passage. Ne venez pas.
Pollution, maltraitance animale et construction à outrance. Le tourisme de masse, une catastrophe environnementale
Que faire ? Comme tous les problèmes environnementaux, c’est avant tout notre rapport au monde qu’il faut changer.

30 juillet 2019 - Sarah Roubato
Générations, notre nouveau livre qui marque dans le temps l’esprit d’une génération qui se bat pour préserver notre monde
- Thème : Changements climatiques, répression policière, inégalités, agroécologie, politique, féminisme, nature…
- Format : 290 pages
- Impression : France
En 2018, la croissance du tourisme mondial fut de 9 %, un chiffre record qui n’avait pas été prévu par les observateurs. Ce sont près de 1,4 milliards de personnes qui voyagent chaque année. C’est l’un des moteurs les plus puissants de l’économie mondiale. Représentant à elle seule 3,2 % du PIB intérieur mondial, cette industrie florissante ne va pas sans son lot de mauvaises nouvelles pour le vivant : pollution, constructions à outrance, maltraitance des animaux. Le tourisme de masse représente 8 % des émissions de gaz à effets de serre et ce chiffre ne va cesser d’augmenter dans les prochaines années.
Une pollution hors norme
L’engrenage du tourisme de masse est souvent le même : construction de résidences sur des sites paradisiaques, pollution des sols des océans et de l’air, affluence des véhicules, prolifération des fast foods et des produits low cost. Si les promoteurs avancent souvent l’argument du développement local et des emplois créés, cela se fait au détriment des artisans locaux adeptes de la qualité qui ne peuvent rivaliser avec les produits bon marché.
Des pays comme la Chine voyant une classe moyenne émerger, des millions de personnes réclament le droit de découvrir le monde et ses merveilles. Comment leur interdire ? Comment prendre conscience que notre soif d’aller admirer la beauté de la nature la détruit ?
Si de nombreux pays ont mis en place la taxe carbone en 2017, elle ne s’applique toujours pas au transport aérien. Or pour les pays les plus pollueurs comme les États-Unis ou la Chine, ce sont bien les vols intérieurs qui produisent le plus de gaz à effets de serre.
Du côté de la faune, le tourisme animalier joue son rôle dans l’extinction des espèces. On se souvient de ce bébé dauphin échoué trop près des côtes argentines, mort de déshydratation à force d’être exhibé pour les selfies d’une foule de touristes. Le phénomène du selfie est étudié de près par des ONG de protection des animaux. Nouvelle source lucrative, elle encourage les éleveurs à séparer les bébés de leurs mères, ou à maltraiter de grands animaux comme les tigres ou les éléphants, pour les rendre dociles lors de la prise de photo. Les animaux ne survivent pas plus de quelques mois, obligeant les fournisseurs à acheter capturer ou braconner encore plus d’animaux sauvages.

Quand on regarde derrière la carte postale, l’impact du tourisme est non négligeable : les quartiers touristiques des villes et les villages se ressemblent, avec leurs lots de boutiques de souvenirs pas toujours fabriqués localement, de restaurants sans clients locaux, car ce qui en faisait la spécificité – artisans, commerces de proximité, cafés du coin – n’ont pas tenu le coup. Les prix montent, les habitants vont vivre ailleurs, les villages se retrouvent désertés quand les touristes ne sont pas là.
Que faire ? Comme tous les problèmes environnementaux, c’est avant tout notre rapport au monde qu’il faut changer.
À la découverte, à la beauté, à l’aventure. Nombreux seraient surpris de ce qu’ils pourraient vivre non loin de chez eux, en termes d’expériences humaines, culturelles et naturelles. Nous devons peut-être réapprendre à nous enchanter près de chez nous. Le droit de circuler librement est un droit fondamental de l’individu moderne. C’est un gage de progrès et d’ouverture au monde.
Pourtant, l’urgence de la situation nous mettra un jour face à la nécessité de réfréner certains de nos droits individuels, tout simplement pour que notre espèce et le vivant puissent survivre. À nous de décider si nous attendons le blocage des avions faute de carburant, l’imposition par les gouvernements, ou le fruit de notre liberté, celle de choisir de préserver la vie.
30 juillet 2019 - Sarah Roubato
-
Ne pas s'inquiéter
- Par Thierry LEDRU
- Le 03/08/2022
Je ne crois pas à une émergence de conscience collective, un acte volontaire de masse, un abandon de la société consumériste.
Je ne crois pas que la masse abandonnera l'alimentation carnée et donc les agriculteurs continueront à produire du maïs et à faire de l'élevage et on connait, quand on cherche, les effets dévastateurs sur la nature.
Je ne crois pas que la masse entière abandonnera les voyages touristiques en avion et les croisières, la voiture pour les vacances, les ruées sur les magasins qui soldent.
Je ne crois pas que la masse entière abandonnera les piscines et les climatiseurs, la consommation effrénée d'eau potable, le tourisme de masse, les périodes festives annuelles et toute la consommation qui les accompagne.
Je ne crois pas que la masse entière mettra un jour au pouvoir un gouvernement essentiellement écologiste et je ne crois pas d'ailleurs qu'un gouvernement écologiste ait la moindre chance de gagner la lutte contre les forces financières.
Je ne crois qu'en une seule chose et je l'ai déjà écrit ici : une dictature survivaliste. Car, il ne faut pas se voiler la face, nous partons vers des temps très, très compliqués où l'idée de survie sera prioritaire. On va me dire que c'est une vision très pessimiste. Qu'on vienne me prouver que j'ai tort, je serais très heureux de l'apprendre.
Quant à ceux ou celles qui considèrent qu'une dictature survivaliste est inacceptable, parce que le terme de "dictature" est associée à des exemples effroyables, je répondrais simplement que nous sommes depuis l'émergence de l'exploitation pétrolière dans une dictature philosophique, un exemple unique, un modèle répliqué de façon planétaire, un paradigme auquel il n'est quasiment pas possible de s'opposer et qui est enseigné aux plus jeunes. C'est une dictature qui ne dit pas son nom parce qu'elle a mis en place un système qui laisse à penser que les choix sont possibles. Et c'est sa plus grande réussite. Pour notre plus grand malheur.
Canicule, sécheresse... "Qui a encore le luxe de ne pas s'inquiéter ?" : le chercheur François Gemenne a répondu à vos questions sur cet été suffocant
Alors que la France métropolitaine traverse une troisième vague de chaleur en à peine deux mois, franceinfo a sollicité mercredi le chercheur François Gemenne pour prendre la mesure de ce phénomène.
Article rédigé par

France Télévisions
Publié le 03/08/2022 16:49Mis à jour le 03/08/2022 16:50
Temps de lecture : 12 min.

Certaines parcelles du lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes, sont complétement à sec, le 2 août 2022. (THIBAUT DURAND / AFP)
Champs jaunis, lacs à sec, coupures d'eau, sommeil perturbé... L'été 2022 n'en finit pas de se réchauffer. Une troisième vague de chaleur frappe, depuis mardi 2 août, la France métropolitaine, et ce alors que le pays est concerné par une sécheresse intense. La journée de mercredi devrait être la plus chaude à l'échelle nationale, a averti Météo France, même si ce nouvel épisode caniculaire sera plus court que les précédents.
Cet été caniculaire est-il un aperçu de ce qui nous attend désormais ? Faudra-t-il s'habituer à de telles températures, et à autant de conséquences désastreuses sur nos écosystèmes et notre quotidien ? Si oui, comment s'y adapter ? Les internautes de franceinfo ont interrogé le chercheur François Gemenne, spécialiste de l'impact du réchauffement climatique sur nos sociétés, pour évoquer la crise climatique. Voici ses réponses à vos questions.
Sur la météo que connaît la France en ce moment
@Patrice : La sécheresse en cours peut-elle être enfin l'élément déclencheur d'un changement d'habitudes et de politiques ?
François Gemenne : Honnêtement, je ne pense pas. Ceux qui vont souffrir concrètement des conséquences de la sécheresse restent une minorité de la population. La plupart des gens, à part quelques restrictions pour laver leur voiture, ne verront pas à quoi a ressemblé cette sécheresse. Quand il y a une catastrophe, les gens ont envie de trouver un responsable, et si l'on dit que c'est le changement climatique, ils ont l'impression qu'on les rend responsables, ce qui est inaudible. Après Katrina, par exemple, la Louisiane a voté contre un gouverneur très climatosceptique, qui avait fait campagne sur cette déresponsabilisation.
"Mais il est vrai que les événements extrêmes nous permettent de prendre conscience de notre vulnérabilité."
François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement
aux internautes de franceinfo
@Cyril : La France traverse actuellement, et s'apprête à l'avenir à traverser, une grave crise de l'eau. Allons-nous manquer d'eau potable en France à l'avenir ?
Il est tout à fait possible que dans certains endroits, ou pour certaines populations, il y ait un manque d'eau potable. Ce n'est pas uniquement une question de quantité d'eau disponible, mais aussi de choix sur ses usages. Aujourd'hui, l'agriculture est l'usage qui consomme le plus, de très loin. Et à l'avenir, il faudra sans doute revoir certaines allocations de la ressource et changer certains types de cultures pour privilégier celles qui consomment le moins.
@Jean-Philippe : On voit énormément en France de cultures de maïs, qui est une plante tropicale demandant beaucoup d'irrigation. N'est-ce pas aberrant ?
Le maïs est typiquement une culture qu'il est possible que l'on abandonne en France à cause de sa consommation d'eau. Avec une eau rationnée, elle risque d'être de plus en plus problématique. On a commencé à le cultiver à une époque où l'on n'imaginait pas de pénurie.
@Gauthier Gosselin : En Californie, victime de grosses sécheresses, l'eau devient un produit spéculatif et est entrée dans le monde de la finance. Est-ce possible en France ? Est-ce une solution ?
C'est possible en France, mais je ne pense pas que ce soit une solution. Cela souligne la nécessité d'avoir des services publics forts pour l'adaptation climatique, pour garantir l'accès à l'eau, mais aussi la protection : en Californie se développent aussi des pompiers privés qui ne protègent que les habitations de ceux qui les paient.
"La spéculation sur l'eau se ferait au détriment des plus vulnérables."
François Gemenne
aux internautes de franceinfo
Or, une société plus inégalitaire est plus vulnérable aux impacts du changement climatique, car la solidarité est un élément crucial de la résilience. Tout le monde a intérêt à cette réduction des inégalités.
@Barbara : Si les cours d'eau baissent notablement et se réchauffent, quel sera le scénario concernant les centrales nucléaires ? Jusqu'à quel point peuvent-elles fonctionner ? Doit-on craindre des coupures d'électricité ?
Je n'irai pas jusqu'à craindre des coupures. C'est vrai que la baisse du débit des fleuves peut poser quelques problèmes ponctuels, mais je ne voudrais pas non plus affoler les gens avec ça. Cela serait un peu malhonnête de l'utiliser comme un argument contre le nucléaire ; il y en a d'autres qui sont plus recevables.
Sur l'enjeu de l'adaptation au changement climatique
@Jeanne : Je m'interroge sur l'articulation entre limitation du changement et adaptation au changement climatique. Faudra-t-il choisir entre les deux ?
Nous n'avons plus le luxe de choisir entre l'un ou l'autre. Nous avons longtemps cru que la limitation du changement climatique suffirait. On se rend compte qu'il va falloir aussi s'adapter. A la fois tenter d'éviter l'ingérable, et gérer l'inévitable. Ces deux options peuvent parfois entrer en concurrence, comme sur la climatisation. On va alors parler de maladaptation, une adaptation qui aggrave le problème. Mais il y a aussi des cas où les deux se renforcent mutellement : la rénovation thermique permet de réduire la consommation des logements et d'éviter qu'ils soient des fours en été.
@choux : Est-il possible de parler "lutte contre le réchauffement" sans "décroissance" ? Je fais partie des 5% de privilégiés : puis-je continuer à vivre dans 200 mètres carrés à deux ?
Je pense que le problème, quand on parle de décroissance, est, d'une part, qu'on ne peut pas en parler de la même façon pour tout le monde, en France comme en Inde par exemple. Il faut choisir la décroissance pour que certains aient la possibilité de croître. D'autre part, il faut que ce soit quelque chose de choisi, qui commence par les plus riches, sinon cela risque d'être une précarité imposée. Et il faut questionner quelle croissance on cherche : de l'économie ? de la santé ? des services publics ?
@climat : La préoccupation environnementale se traduit-elle par un changement des pratiques individuelles ? L'accumulation de piscines, la climatisation, les projets de maison et nos modes de vie ne montrent-ils pas un décalage important entre le "il faut changer" et le "nous sommes prêts à changer" ?
Absolument. Nous sommes tous face à un certain nombre de contradictions et d'injonctions contradictoires. Nous allons parfois penser qu'une de nos actions compense une action délétère : comme je suis parti en vacances en train, je peux faire creuser une piscine. En réalité, ces gestes ne s'annulent pas : chacun d'entre eux compte. Il faut sortir d'une vision du changement climatique comme un problème binaire alors qu'il est graduel. En même temps, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens mais de reconnaître qu'il y a une limite à ce que nos gestes individuels peuvent accomplir. Il faudra aussi des changements structurels.
Sur les solutions possibles
@perplexe : Peut-on continuer à promouvoir la voiture électrique tout en demandant au consommateur de réduire sa consommation d'électricité ?
Question compliquée. Aujourd'hui, si on remplace le parc thermique par son équivalent électrique, on va avoir des problèmes de génération d'électricité. On doit poser la question des modes de déplacement et en particulier des transports publics. Et il faut aussi réduire notre consommation d'électricité. La question de la sobriété n'est pas juste une question de se donner bonne conscience ; elle est vitale pour la transition énergétique.
Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent 84% du mix énergétique mondial. Il y a vingt ans, c'était 86%. Malgré toutes les alertes, cette part ne s'est réduite que de 2%, malgré le développement du nucléaire et du renouvelable. Ces sources n'ont pas remplacé les énergies fossiles : elles s'y sont ajoutées pour satisfaire notre surplus de consommation. Tant que celle-ci continuera à augmenter, jamais on ne parviendra à sortir des énergies fossiles.
@Hébert : Est-ce qu'une limitation par foyer de la consommation du nombre de m3 d'eau et de kwh d'électricité serait une solution efficace pour limiter les impacts du réchauffement climatique ?
Ça pourrait être une solution, bien entendu. Mais on touche là à certaines libertés fondamentales. Cela risque de ne pas être accepté dans la population. Il faut se méfier des solutions autoritaires : au-delà de la question des libertés se pose une question d'efficacité, car elles risquent d'être rejetées. D'autant qu'on parle de mesures permanentes : on a vu au moment de la crise du Covid-19 que certaines choses n'étaient acceptées que parce qu'elles étaient temporaires.
"Par contre, on pourrait jouer avec les prix, donner un quota d'énergie gratuite permettant de vivre décemment puis faire payer un prix croissant pour les volumes supplémentaires consommés."
François Gemenne
@Bernard : Entre l'eau potable et l'alimentation carnée, ne devons-nous pas faire un choix ?
Je pense que ce débat est déjà largement posé, et que chacun réalise que nos régimes sont trop carnés, que la réduction de notre consommation de viande est un impératif pour des raisons climatiques et d'économies d'eau. Il est important de garder en tête que toutes les viandes n'ont pas la même empreinte carbone ni le même usage de l'eau : le bœuf a de très loin la plus lourde, même s'agissant des produits laitiers. Mais il y a déjà une forme d'évolution de la société à ce sujet.
@SME : Que peut-on espérer d'une rénovation thermique des logements, d'un point de vue de l'efficacité, du coût énergétique pour le faire et de son amortissement (à moyen terme) ?
On peut en attendre beaucoup de choses. Le logement est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre en France, il pèse un peu moins d'un cinquième du total, et ce poids peut être réduit. C'est aussi un énorme enjeu de justice sociale, car les plus pauvres sont souvent ceux qui n'ont pas les moyens de rénover leurs logements et qui voient leur facture énergétique exploser. C'est aussi bon en matière d'adaptation aux températures extrêmes. Enfin, c'est un vivier d'emplois.
A mon sens, il y a deux obstacles : c'est un investissement – et l'on n'investit pas assez pour le climat en France – et il n'y a pas assez de main-d'œuvre dans le bâtiment. Il faudrait sans doute faire venir des travailleurs de l'étranger, et je ne suis pas sûr qu'on y soit prêts.
@Loulou : La question du transport revient souvent quand on parle de climat. Ecologiquement parlant, vaudrait-il mieux quelques très grosses villes concentrées ou bien décentraliser et avoir des pôles plus petits ?
Je dirais qu'il vaut sans doute mieux quelques grosses villes très concentrées. Le fait que la France ait tellement encouragé l'habitation dans les zones pavillonaires ou péri-urbaines a fait exploser l'empreinte carbone des transports. L'idée n'est pas de faire culpabiliser leurs habitants : c'est le résultat de politiques sur le logement à long terme. Les transports représentent 14% des émissions de gaz à effet de serre : 9% pour la route, 3% pour les avions et 2% pour les bateaux.
Sur la crise climatique que nous traversons
@Bertrand : Le dérèglement climatique est mondial. Faisons-nous suffisamment pression sur le Chine, les USA, l'Inde, la Russie pour qu'ils transforment leur société de façon plus respectueuse des accords de Paris ?
Les gens en Chine et en Inde se posent la même question : est-ce que nous faisons assez pression sur la France ? En Europe, nous avons souvent l'impression d'être vertueux et que les autres ne le sont pas. Nous ne prenons pas la mesure, par exemple, de l'ampleur des capacités solaires installées en Chine, tandis que nous sommes en retard à ce sujet. Et dans les sommets, les pays émergents reprochent aux pays riches de ne pas en faire assez. Par ailleurs, il ne s'agit pas de faire pression sur ces pays – comme l'Egypte, le Mexique ou l'Indonésie, qui deviendront les grands émetteurs de demain –, mais de se demander comment travailler avec eux.
@Fred : Au final, le problème n'est-il pas juste démographique ? A priori, la Terre devrait accueillir au maximum deux milliards d'individus ; or, aujourd'hui, nous sommes sept milliards…
Attention à ne pas établir une corrélation directe entre la taille de la population d'un pays et ses émissions. La Chine et l'Inde ont une population comparable mais la Chine émet quatre fois plus. L'Afrique est le continent dont la population croît le plus et dont les émissions croissent le moins. La question qui va se poser est celle de la transition démographique, souvent corrélée au niveau de développement : parfois, la baisse de la démographie peut s'accompagner d'une hausse des émissions. Tout dépend donc de la trajectoire de développement qui sera suivie.
@Bimbeau : Comment agir pour que les gouvernements prennent des mesures efficaces et pertinentes pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Aujourd'hui, les gouvernements ne prennent pas de mesures suffisamment radicales parce qu'ils ne reçoivent pas ce mandat de leurs électeurs. Ceux-ci, dans leur majorité, votent pour le statu quo. Si on veut que les gouvernements se saisissent de ces enjeux, il faut qu'ils soient identifiés comme la priorité par les électeurs.
"Aujourd'hui, 80% des Français se disent préoccupés par le climat, mais seulement 31% estiment qu'il s'agit d'une priorité politique."
François Gemenne
aux internautes de franceinfo
Pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas trop attendre des gouvernements. Si on veut que ça change, il faut faire en sorte que, lors des campagnes éléctorales, les gens réalisent que le changement climatique menace leurs intérêts directs.
@Benjamin : Quelles sont les sources d'espoir qui permettraient de ne pas sombrer dans une éco-anxiété indéfinie ?
C'est une interrogation très compréhensible... Aujourd'hui, on se demande qui a encore le luxe de ne pas s'inquiéter. La solution peut être l'action collective : se rendre compte que d'autres gens partagent ces préoccupations. Même au niveau très local, s'associer avec d'autres pour faire avancer les choses me semble être le meilleur moyen de lutter contre cette anxiété et de faire bouger les choses.
-
Raymond Devos
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/08/2022
C'est une fois à la retraite que j'ai vraiment pris conscience à quel point la vie avant ça était celle d'un fou.
Il est toujours possible de se dire que c'est normal puisque tout le monde court de la même façon.
Et c'est bien là que repose toute la fourberie du système. Jusqu'à montrer du doigt ceux ou celles qui ne courent plus.
-
Dictature survivaliste
- Par Thierry LEDRU
- Le 01/08/2022
Aucune mesure locale, régionale ou nationale ne parviendra à freiner le processus. Pour l'arrêter, c'est déjà trop tard.
Il ne peut et ne doit y avoir qu'une décision planétaire, au niveau des plus pays les plus pollueurs bien évidemment mais également de la part des pays en "voie de développement". Ce fameux développement qui est à la source même des problèmes. Mais comment faire comprendre à des populations manquant de tout ce dont nous profitons que c'est la mauvaise voie ? Et comment faire comprendre aux populations privilégiées dont nous faisons partie que seul l'abandon partiel de nos privilèges consuméristes peut contribuer à encourager et à décider les pays en voie de développement de choisir un autre développement ?
En fait, il faudrait un nouvel ordre mondial, celui que beaucoup condamnent. Une dictature survivaliste. Et ça n'arrivera jamais. Donc ...

Il n'a jamais fait aussi sec en France, depuis le début des relevés météo en 1959. Les scénarios les plus alarmistes qui imaginaient des rationnements d'eau pour les prochaines décennies étaient très en retard. Des coupures d'eau potable auront probablement lieu dès cette année. Le désastre est là. Quelques chiffres :
 Le cumul mensuel de précipitations à l'échelle de la France est le plus bas jamais mesuré depuis 1959. En moyenne, sur le pays, il s'élève à 7,8 mm d'eau sur tout le mois de juillet. Autrement dit, un déficit de 88% par rapport à ce qui aurait été nécessaire selon le ministre de l'écologie.
Le cumul mensuel de précipitations à l'échelle de la France est le plus bas jamais mesuré depuis 1959. En moyenne, sur le pays, il s'élève à 7,8 mm d'eau sur tout le mois de juillet. Autrement dit, un déficit de 88% par rapport à ce qui aurait été nécessaire selon le ministre de l'écologie.
 Cette sécheresse se voit depuis l'espace. La France a pris une couleur ocre, y compris la Bretagne, pluvieuse même en été d'habitude. Cette année, fin juillet, la France a déjà traversé 3 épisodes caniculaires, et explosé tous les records de températures maximales. Il fait à nouveau plus de 40°C sur une partie du pays sur un sol extrêmement sec.
Cette sécheresse se voit depuis l'espace. La France a pris une couleur ocre, y compris la Bretagne, pluvieuse même en été d'habitude. Cette année, fin juillet, la France a déjà traversé 3 épisodes caniculaires, et explosé tous les records de températures maximales. Il fait à nouveau plus de 40°C sur une partie du pays sur un sol extrêmement sec.
 A Nantes, il est tombé 11 mm de pluie en juillet 2022. Les précipitations habituelles à Nantes en juillet sont de 45 mm. Une baisse de 75% par rapport à la moyenne des autres mois de juillet. Les cours d'eau souffrent. L'Erdre, trop chaude, est remplie de cyanobactéries très toxiques.
A Nantes, il est tombé 11 mm de pluie en juillet 2022. Les précipitations habituelles à Nantes en juillet sont de 45 mm. Une baisse de 75% par rapport à la moyenne des autres mois de juillet. Les cours d'eau souffrent. L'Erdre, trop chaude, est remplie de cyanobactéries très toxiques.
 Situation encore plus grave en Bretagne et Auvergne, où le déficit est proche de 95 % ! En Bretagne, 2,9mm de précipitations, autant dire rien, contre 50mm pour un mois de juillet moyen. La Bretagne et les Pays-de-la-Loire constituent l'une des premières zones agricoles de France.
Situation encore plus grave en Bretagne et Auvergne, où le déficit est proche de 95 % ! En Bretagne, 2,9mm de précipitations, autant dire rien, contre 50mm pour un mois de juillet moyen. La Bretagne et les Pays-de-la-Loire constituent l'une des premières zones agricoles de France.
 Il n'a pas plu du mois en région PACA et en Corse. Pas de précipitations. En moyenne « en plaine », Météo France a recensé 3 jours de pluie en un mois.
Il n'a pas plu du mois en région PACA et en Corse. Pas de précipitations. En moyenne « en plaine », Météo France a recensé 3 jours de pluie en un mois.
 93 départements sont classés en alerte sécheresse par les autorités, la quasi totalité de la France métropolitaine. La plupart sont en alerte « crise », le seuil maximal.
93 départements sont classés en alerte sécheresse par les autorités, la quasi totalité de la France métropolitaine. La plupart sont en alerte « crise », le seuil maximal.
 Les risques de coupure d'eau potable sont réels, notamment à St Malo où les autorités sonnent l'alarme. Le niveau des nappes phréatiques en Bretagne est critique. Les cours d'eau français sont presque tous en alerte.
Les risques de coupure d'eau potable sont réels, notamment à St Malo où les autorités sonnent l'alarme. Le niveau des nappes phréatiques en Bretagne est critique. Les cours d'eau français sont presque tous en alerte.
 La France est particulièrement mal préparée face à la sécheresse : toute l'industrie nucléaire dépend de l'eau, nécessité absolue pour refroidir les réacteurs. De nombreuses centrales doivent être arrêtées lorsque l'eau des rivières est trop chaude ou en quantité insuffisante. Le nucléaire est donc une menace supplémentaire gravissime dans le cadre du réchauffement climatique et de la sécheresse.
La France est particulièrement mal préparée face à la sécheresse : toute l'industrie nucléaire dépend de l'eau, nécessité absolue pour refroidir les réacteurs. De nombreuses centrales doivent être arrêtées lorsque l'eau des rivières est trop chaude ou en quantité insuffisante. Le nucléaire est donc une menace supplémentaire gravissime dans le cadre du réchauffement climatique et de la sécheresse.
 Cette sécheresse implique moins de récoltes, donc moins de nourriture, et une hausse des prix de l'alimentation. Mais aussi moins de fourrage pour l'élevage. La production de fourrage a baissé de 21%. Se passer de viande sera une nécessité pour tout le monde.
Cette sécheresse implique moins de récoltes, donc moins de nourriture, et une hausse des prix de l'alimentation. Mais aussi moins de fourrage pour l'élevage. La production de fourrage a baissé de 21%. Se passer de viande sera une nécessité pour tout le monde.










