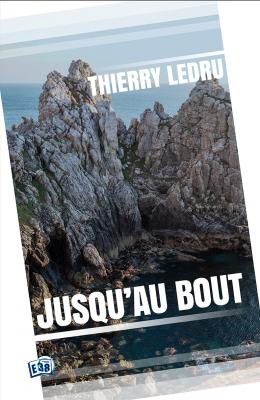Blog
-
A CŒUR OUVERT : témoignage
- Par Thierry LEDRU
- Le 26/12/2020
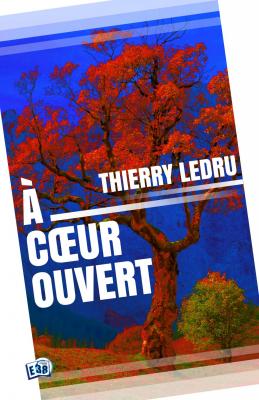
Plusieurs passages de ce livre m'ont porté durant ma convalescence.
J'avais recopié quelques citations et je les relisais quand les forces et le moral m'abandonnaient.
Si je suis debout aujourd'hui, c'est en partie grâce à Thierry .
Ayant vécu une épreuve similaire, il m'a insufflé une part de sa force mentale par le biais de son livre (qu'il m'a envoyé un matin) et de ses mails échangés.
Merci Thierry pour ce magnifique cadeau !
PS : Ce livre est un ressourcement. L'âme de l'auteur est mise à jour...
C'est donc dans la logique des choses qu'il s'est trouvé un dernier coin de paradis : la nature, la vraie, sans artifices.Vincent
Merci infiniment Vincent. Rien ne peut m'enthousiasmer davantage dans le registre de l'écriture de romans que ceux-ci puissent se révéler utiles.
"Si je suis debout aujourd'hui, c'est en partie grâce à Thierry ."
Tu es le deuxième lecteur à m'écrire ce témoignage. Le premier émanait d'une personne amputée tibial. Elle a lu "Là-Haut" après avoir assisté à une remise de prix à laquelle j'avais été invité. Ce monsieur a décidé d'aller en montagne, pour la première fois, l'été suivant cette lecture. Il voulait éprouver réellement le cheminement du personnage principal du livre. Puisque lui aussi est amputé.
Sans doute faut-il avoir exploré les abysses en soi pour pouvoir les raconter. Sachant cela, je bénis mon parcours pour ce qu'il m'a permis de développer : l'écriture. -
Jarwal le lutin : le détachement de soi
- Par Thierry LEDRU
- Le 18/12/2020
JARWAL LE LUTIN
/https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FH4htKB7%2FIMG-3525.jpg)
« Cette histoire, les enfants, montre que toute mon expérience est centrée sur moi-même. Je suis celui par lequel tout ce qui vient à moi est reçu, analysé, commenté, rejeté, détesté, magnifié, adoré...Ce moi qui perçoit est au centre. Tout du moins, c'est l'impression qu'il donne. J’ai compris en ayant perdu provisoirement la mémoire que ce moi est ce qui m'appartient le moins, c’est une entité constituée de multiples fragments, parfois éparpillés au vent des conditions de vie. Lorsque je sais que quelqu'un pense du mal de moi, comme Jackmor par exemple, je suis en quelque sorte relié à cette personne, je me laisse emporter par les pensées générées par cette crise. De la même façon lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui m'aime. C'est à partir du moi que j'entre en relation avec le monde. Je vais donc m'appliquer à confirmer l'existence de ce moi en accumulant des fragments à partir desquels je pourrai sculpter l'identification dont ce moi a besoin pour se prolonger. On devine le piège. Quelle est la réalité de ce moi sitôt qu'il prend forme à travers des pièces diverses qu'il ne maîtrise pas ? Juste un amalgame hétéroclite. C’est cela que j’ai compris. J’essayais d’exister alors que je n’avais aucune idée de l’image initiale.
-Ca me fait penser à un puzzle que je voudrais reconstituer alors que je n’aurais même pas eu l’image finie en modèle, expliqua Marine.
-Qu’est-ce que c’est ce puzzle ? demanda Jarwal.
-C’est un jeu de patience, on a des petites pièces avec un morceau d’image et quand on les assemble, ça donne une grande image complète.
-Je comprends, c’est une occupation très intéressante et effectivement, c’est un très bon exemple pour expliquer la façon dont nous voyons la Vie. On croit que parce que nous avons dans les mains quelques petites images, on a saisi l’ensemble. On essaie de construire quelque chose dont on ne possède même pas la vue générale.
-On dirait un ouvrier qui voudrait construire une maison alors qu’il n’a même pas idée de ce que ça va donner à la fin, ajouta Rémi.
-Oui, c’est exactement ça, s’enthousiasma le lutin. Vous voyez, vous comprenez très bien de quoi je parle. L'énergie dispensée pour élaborer cette image est pourtant phénoménale. Je vais accumuler et protéger mes objets, mes relations, mes connaissances, mes passions, mes projets...Tout cela créé un attachement grâce auquel je pense pouvoir donner de la valeur à mon existence. J'appartiens à mes attachements et je m'en glorifie... Il va falloir en plus que je protège mon territoire, toutes ces possessions. Je vais devoir lutter contre ceux qui s'opposent à mes droits. Je chercherai sans doute à intégrer un groupe qui me ressemble et qui pourra me défendre. J’abandonnerai certainement une partie de mes convictions pour être bien vu, bien accueilli et pouvoir bénéficier de la force de ce groupe.
-Ah, oui, on voit ça à l’école. Tous ces enfants qui veulent absolument suivre un chef et faire comme lui ou qui s’habillent comme leurs idoles de télévision. Ça m’énerve ! lança Rémi.
-Ils ont peur Rémi, tout simplement. C'est inévitable. Beaucoup de gens fonctionnent de cette façon. La peur qu'on me vole mon identification ou qu'on ne la reconnaisse pas, que je sois rejeté ou incompris, que mes choix de vie soient bafoués. J'entre en confrontation avec ceux qui ne me reconnaissent pas ou qui défendent leur image. La colère se nourrit de ma peur. Attachement, aversion, colère, peur, réjouissance, reconnaissance, insatisfaction, désillusion, amour, joie, peine. C’est un chaos immense. Il se peut qu'un jour, pour une raison connue ou pas, je prendrai conscience de ces tourments répétés. Une illumination, un choc, une révélation, quelque chose d'incompréhensible pour la raison mais qui me bouleversera au-delà du connu. J'entrerai peut-être dans une nouvelle dimension, ça sera long évidemment, douloureux sans doute mais je sentirai pourtant que c'est mon chemin.
-C’est ce qui t’est arrivé chez les Kogis ?
-Oui Léo. Mais il y a un autre risque. Si j’attribue cette révélation à moi-même sans comprendre qu’elle vient de la Vie elle-même, j'aurai l'impression d'être supérieur aux autres, d’être plus puissant qu’eux. Je détournerai la révélation pour m’en glorifier.
-Mais ça sera toujours le moi qui serait le Maître.
-Tout à fait Marine. Alors je chercherai à préserver cette plénitude, à l'accroître même, et dès lors se mettra en place une nouvelle identification. D'autres empilements. Juste d'autres perceptions, d'autres sensations, d'autres pensées, d'autres réflexions narcissiques. Je me prendrai pour un Sage ou un grand Maître. J'aurai juste changé ma façon de regarder les pièces du puzzle éparpillées.
-En ayant été incapable de voir l’image originale.
-Oui Marine. Cette quête n'aura été qu'une illusion, une machination du moi qui se sera finalement révélé le plus malin... Il sera toujours le maître des lieux.
-Mais quelle est cette image originale Jarwal ?
-Il faut comprendre avant tout qu’il n’y a rien à chercher. Tout est déjà là mais en le cherchant, je m'en éloigne. Tout le problème vient de ce remplissage inconsidéré de l’existence. On ne voit plus rien quand on a entassé des gravats.Le Soi, c’est la fusion de ce moi, du je et de la conscience de la Vie. C’est une entité immuable qui a le pouvoir d’analyser ces changements sans que ces changements n'influent sur elle. C'est l'identité véritable. L'expérimentateur. Mais un expérimentateur qui doit parvenir à se dessaisir de lui-même comme objet. Il ne s'agit pas là de s'observer dans les évènements extérieurs mais d'entrer dans un espace sans expérience et que cette observation ne devienne pas elle-même une expérience...Au risque de renvoyer l'expérimentateur face à son objet... Être conscient de n'être conscient de rien...Comme si l'on écoutait mais qu'il n'y avait rien à entendre. Même si ce silence est un bruit inaudible, il est toujours là. Le Soi n'est ni acteur, ni objet de l'action mais le contenant de ces deux entités identifiées. Le Soi n'a pas pour autant d'enveloppe, il n'est pas identifiable par des termes matérialistes ou scientifiques. Il est de l'ordre de l'ineffable.
-Je ne comprends plus rien, avoua Léo.
-Tu ne comprends pas les mots Léo mais ton âme sait de quoi je parle parce que tu es déjà dans cette vie intérieure. Sinon, tu ne serais pas là à m’écouter.
-Il ne s’agit pas de constituer l’image originelle parce qu’elle est nécessairement déjà là mais de parvenir à enlever tout ce qui la couvre. C’est ça Jarwal ?
-Oui Marine.
-Et cette image originelle, c’est la conscience de la Vie qui la détient. C’est lorsque nous avons abandonné notre appartenance à ce chaos humain.
-Pas exactement Rémi. Il ne s’agit pas de l’abandonner parce que sinon il faudrait aller vivre sur une île déserte. Il s’agit de ne pas lui appartenir. De faire la distinction entre la participation lucide et la disparition dans le flot. Imagine une particule d’eau de l’Océan. Elle n’est pas "dans" l’Océan car elle fait partie de l’Océan. Un bâton qui flotte est dans l’Océan. Pas une particule d’eau. Je dis par conséquent qu’elle est "de" l’Océan. Sans ces particules d’eau, l’Océan n’existe pas. Mais sans l’Océan, les particules ne seraient que des individualités esseulées. La fusion des particules crée l’Océan. Il y a plusieurs menaces ensuite. Soit certaines particules regroupées considèrent qu’elles ont un pouvoir plus grand que celui de l’Océan et elles finissent par l’oublier, le contester, le combattre même, soit certaines particules refusent de se voir assemblées dans un Tout et considèrent qu’elles doivent préserver une liberté de décisions, une autonomie qui leur paraît plus importante que le Tout. Dans les deux cas, ces particules sont dans l’erreur. Celles qui s’imaginent obtenir un pouvoir parce qu’elles pensent avoir une ressemblance, une particularité, des idées communes, des intentions autres que la participation à l’Océan, celles-là participent au désordre. Elles fabriquent une rupture dans la cohésion des particules. D’autres particules vont prendre peur et vont vouloir assembler leurs peurs pour fonder d’autres groupes. La confrontation prend une ampleur inéluctable et incontrôlable. De leur côté, celles qui pensent bénéficier d’une autonomie vont s’efforcer de s’isoler ou de lutter individuellement contre ces groupes. Elles ne participent pas pour autant à la cohésion perdue mais elles l’entretiennent en réagissant contre un désordre qu’elles condamnent. Elles utilisent le même fonctionnement que les groupes qu’elles critiquent. Des entités rebelles entêtées dans une distinction qu’elles vénèrent ne participent aucunement à la réhabilitation de l’Unité. Elles se voient comme plus importantes que l’Océan lui-même et succombent à la peur de disparaître. C’est toujours la peur qui crée le chaos. Cette incapacité à dépasser la vision restrictive de l’individu est une condamnation de l’Unité.
-Mais comment doit-on se comporter alors Jarwal ?
-C’est là qu’intervient cet apprentissage du détachement de soi. Il ne s’agit pas de se nier en tant qu’individu ni de rejeter l’appartenance à l’Océan mais de parvenir à observer les deux phénomènes. Juste les observer, sans leur apporter la moindre émotion. C’est ce qu’on appelle « agir dans le non-agir ». Je suis une particule animée par l’Océan. J’agis dans le champ de mes expériences mais sans jamais être dissocié d’une dimension bien plus grande. L’Amour est à la source de cette paix intérieure. Laisse la vie te vivre, elle sait où elle va. Cette phrase est essentielle pour moi. On pourrait penser que c’est une invitation à l’abandon et à la lâcheté, comme un bâton qui flotte sur l’Océan. Mais nous ne sommes justement pas des bâtons. Nous sommes animés par la Vie et c’est en son cœur que nous devons apprendre à agir. Non pas agir contre elle en nous dressant fièrement devant elle mais agir dans la dimension qu’elle nous propose. C’est un équilibre extraordinaire à trouver. »
Le silence retombé. L’écho de tous les mots, la nécessité d’aller au plus profond de la compréhension. Chacun animé par la volonté d’explorer les horizons proposés, au regard de son propre potentiel, sans se soucier de l’avancée des compagnons, juste dans l’acceptation de ses limites et de l’énergie disponible.
« Il faut que vous rentriez les enfants. Vous avez une longue descente et le jour va tomber. »
Cette difficulté à quitter les espaces intérieurs. Comme si les mouvements de l’Océan participaient au bonheur des voyages. Une particule aimante du grand corps qui l’accueille et qu’elle constitue elle-même. Comment abandonner un tel cadeau ?
« Tu sais Jarwal, c’est très à la mode depuis quelques temps de parler de l’environnement. La pollution, les destructions de la planète et tout ça. Mais j’ai un peu l’impression que cette façon de voir cet environnement est totalement fausse et en plus je me dis que notre façon de nous voir est également fausse. Ce que nous voyons de nous n’est qu’un environnement mais c’est au cœur de cet environnement que se trouve la réalité. Enfin, j’ai du mal à l’expliquer. Tu vois, c’est comme si nous, les humains, on voyait la Terre comme quelque chose de séparée de nous mais en fait, c’est pareil pour nous. Nous sommes séparés de nous-mêmes parce que nous ne percevons que ce qui est visible ou identifiable, tout ce sur quoi on sait mettre un nom. Ah, ça m’énerve, je ne sais pas comment l’expliquer !
-J’ai parfaitement compris ce que tu veux dire Marine. Notre identité, tout ce que sur quoi nous avons-nous-mêmes apportés une reconnaissance que nous transmettons aux autres, toute cette fabrication est artificielle. Elle n’est qu’un environnement. Mais ce qui importe et qui est réel est caché en nous-mêmes. Nous portons un trésor et nous nous occupons du coffre qui le contient. De la même façon que les hommes s’inquiètent de l’environnement ou y sont totalement indifférents sans comprendre qu’ils ne s’intéressent qu’à des formes matérielles en ignorant le flux vital qui les anime. Mais il n’en reste pas moins que je préfère les voir s’inquiéter de la préservation de cet environnement plutôt que de le délaisser. Il existe au moins la possibilité qu’un jour ils parviennent à établir un vrai regard et qu’ils cessent de jouer des rôles de sauveur, juste pour leur gloire personnelle.
-Tout ça, c’est de l’espoir Jarwal et cet espoir est une illusion. Tu l’as dit toi-même.
-C’est vrai Rémi. C’est pour cela qu’il faut juste agir dans le non-agir, faire ce qui te semble juste sans te préoccuper des résultats éventuels. Faire ce que tu es sans vouloir que les choses soient ce que tu aimerais. Puisque les choses ne peuvent pas être ce que tu n’es pas.
-Tu veux dire que les choses sont ce que je suis ?
-Oui Rémi. Tu crées la réalité qui te correspond. Tu vis ce que tu es et tes actes influent sur la réalité de ton environnement mais ils ne changent rien à la réalité de la Vie que tu portes. La Vie que tu portes, je l’appelle le réel. L’environnement n’est que la réalité. Mais il faut arrêter nos discussions les enfants, vous allez vous mettre en retard et je m’en voudrais que vos parents s’inquiètent. Filez vite. Nous nous reverrons.
-C’est difficile de te laisser Jarwal. J’aimerais tellement ne plus te quitter, avoua Marine en baissant les yeux. La vie quotidienne ne sera jamais aussi belle qu’avec toi.
-Ta vie quotidienne sera ce que tu es Marine. Ne l’accuse pas d’être d’une quelconque responsabilité.
-Tu as raison Jarwal. Je m’en souviendrai. Allez les garçons, on y va. » -
Le message prémonitoire des Indiens d'Amérique
- Par Thierry LEDRU
- Le 13/04/2020

Je me suis souvent demandé ce que le monde serait aujourd'hui si ces peuples premiers, où qu'ils soient, avaient été entendus, écoutés, aimés, si leurs sagesses avaient été reconnues, si leurs modes de vies avaient été suivis, si les hommes blancs n'avaient pas agi de la sorte avec eux...J'aime infiniment les Indiens Kogis, j'ai souvent parlé d'eux ici. Les Indiens d'Amérique font également partie de ces peuples que j'estime immensément. Je sais que leurs relations entre tribus n'étaient pas toujours des plus amicales. J'ai lu une grande quantité d'ouvrages sur leur histoire. Je sais aussi combien leur attachement et leur respect de la Terre était remarquable. C'est cela que je retiens d'eux. C'est cela que nous aurions dû écouter et comprendre.

https://www.syti.net/MessageIndiens.html

Le message prémonitoire
des Indiens d'Amérique



Le destin des Indiens d'Amérique annonçait celui de l'ensemble des habitants de la planète qui assistent impuissants à la destruction de leur environnement, après la confiscation de leur espace et de leurs ressources.

Le message des Indiens est aussi une source de sagesse, fondée sur le respect de la nature et la compréhension de "l'Esprit qui est en toute chose"...
 "Nous avons toujours eu beaucoup; nos enfants n'ont jamais pleuré de faim, notre peuple n'a jamais manqué de rien... Les rapides de Rock River nous fournissaient un excellent poisson, et la terre très fertile a toujours porté de bonnes récoltes de maïs, de haricots, ce citrouilles, de courges... Ici était notre village depuis plus de 100 ans pendant lesquels nous avons tenu la vallée sans qu'elle nous fût jamais disputée. Si un prophète était venu à notre village en ce temps-là nous prédire ce qui allait advenir, et ce qui est advenu, personne dans le village ne l'aurait cru."
"Nous avons toujours eu beaucoup; nos enfants n'ont jamais pleuré de faim, notre peuple n'a jamais manqué de rien... Les rapides de Rock River nous fournissaient un excellent poisson, et la terre très fertile a toujours porté de bonnes récoltes de maïs, de haricots, ce citrouilles, de courges... Ici était notre village depuis plus de 100 ans pendant lesquels nous avons tenu la vallée sans qu'elle nous fût jamais disputée. Si un prophète était venu à notre village en ce temps-là nous prédire ce qui allait advenir, et ce qui est advenu, personne dans le village ne l'aurait cru."Black Hawk, chef indien
"Nous aimons la tranquillité; nous laissons la souris jouer en paix; quand les bois frémissent sous le vent, nous n'avons pas peur."Chef indien au gouverneur de Pennsylvanie en 1796
"Nous le savons: la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons: toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre.L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même."
Seattle, chef indien Suquamish
"Le Lakota était empli de compassion et d'amour pour la nature, et son attachement grandissait avec l'âge. (...) C'est pourquoi les vieux Indiens se tenaient à même le sol plutôt que de rester séparés des forces de vie. S'asseoir ou s'allonger ainsi leur permettait de penser plus profondément, de sentir plus vivement. Ils contemplaient alors avec une plus grande clarté les mystères de la vie et se sentaient plus proches de toutes les forces vivantes qui les entouraient.Le vieux Lakota était un sage. Il savait que le coeur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Il savait que l'oubli du respect dû à tout ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l'homme. Aussi maintenait-il les jeunes sous la douce influence de la nature."
Standing Bear, chef Lakota (Sioux)

"Nous voyons la main du Grand Esprit dans presque tout: le soleil, la lune, les arbres, le vent et les montagnes; parfois nous l'approchons par leur intermédiaire. (...) Nous croyons en l'Etre Suprême, d'une foi bien plus forte que celle de bien des Blancs qui nous ont traité de païens... Les Indiens vivant près de la nature et du Maître de la nature ne vivent pas d'ans l'obscurité.Saviez-vous que les arbres parlent? Ils le font pourtant ! Ils se parlent entre eux et vous parleront si vous écoutez. L'ennui avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas ! Ils n'ont jamais écouté les Indiens, aussi je suppose qu'ils n'écouteront pas non plus les autres voix de la nature. Pourtant, les arbres m'ont beaucoup appris: tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le Grand Esprit."
Tatanga Mani (ou Walking Buffalo), indien Stoney (Canada)

"Les Blancs se moquent de la terre, du daim ou de l'ours. Lorsque nous, Indiens, cherchons les racines, nous faisons de petits trous. Lorsque nous édifions nos tipis, nous faisons de petits trous. Nous n'utilisons que le bois mort.
L'homme blanc, lui, retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre dit « Arrête, je suis blessé, ne me fais pas mal ». Mais il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Il arrache les arbres et les ébranle jusqu'à leurs racines. Il scie les arbres. Cela leur fait mal. Les Indiens ne font jamais de mal, alors que l'homme blanc démolit tout. Il fait exploser les rochers et les laisse épars sur le sol. La roche dit « Arrête, tu me fais mal ». Mais l'homme blanc n'y fait pas attention. Quand les Indiens utilisent les pierres, ils les prennent petites et rondes pour y faire leur feu... Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc?... Partout où il la touche, il y laisse une plaie."
Vieille sage Wintu (Indiens de Californie)
"Je peux me rappeler l'époque où les bisons étaient si nombreux qu'on ne pouvait les compter, mais les Wasichus (hommes blancs) les ont tués tant et tant qu'il ne reste que des carcasses là où ils venaient paître auparavant. Les Wasichus ne les tuaient pas pour manger; ils les tuaient pour le métal qui les rend fous et ils ne gardaient que la peau pour la vendre. Parfois ils ne les dépeçaient même pas. Ils ne prenaient que les langues et j'ai entendu parler de bateaux-de-feu descendant le Missouri chargés de langues de bison séchées. Parfois ils ne prenaient même pas les langues; ils les tuaient simplement pour le plaisir de tuer. Ceux qui ont fait cela étaient des fous. Quand nous chassions le bison, nous ne le faisions que selon nos besoins."Hehaka Sapa, grand chef Sioux

"Vous avez remarqué que toute chose faite par un indien est dans un cercle. Nos tipis étaient ronds comme des nids d'oiseaux et toujours disposés en cercle. Il en est ainsi parce que le pouvoir de l'Univers agit selon des cercles et que toute chose tend à être ronde. Dans l'ancien temps, lorsque nous étions un peuple fort et heureux, tout notre pouvoir venait du cercle sacré de la nation, et tant qu'il ne fut pas brisé.
Tout ce que fait le pouvoir de l'Univers se fait dans un cercle. Le ciel est rond et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une balle et que toutes les étoiles le sont aussi. Les oiseaux font leur nid en cercle parce qu'ils ont la même religion que nous. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle, la lune fait de même, et tous deux sont rond.
Même les saisons forment un grand cercle dans leur changements et reviennent toujours là où elles étaient. La vie de l'homme est dans un cercle de l'enfance jusqu'à l'enfance, et ainsi en est-il pour chaque chose où l'énergie se meut."
Hehaka Sapa, ou Black Elk, indien Oglala, branche des Dakotas (Sioux)

 "La vie dans un tipi est bien meilleure. Il est toujours propre, chaud en hiver, frais en été, et facile à déplacer. L'homme blanc construit une grande maison, qui coûte beaucoup d'argent, ressemble à une grande cage, ne laisse pas entrer le soleil, et ne peut être déplacée; elle est toujours malsaine. Les Indiens et les animaux savent mieux vivre que l'homme blanc. Personne ne peut être en bonne santé sans avoir en permanence de l'air frais, du soleil, de la bonne eau. Si le Grand Esprit avait voulu que les hommes restassent à un endroit, il aurait fait le monde immobile; mais il a fait qu'il change toujours, afin que les oiseaux et les animaux puissent se déplacer et trouver toujours de l'herbe verte et des baies mures.
"La vie dans un tipi est bien meilleure. Il est toujours propre, chaud en hiver, frais en été, et facile à déplacer. L'homme blanc construit une grande maison, qui coûte beaucoup d'argent, ressemble à une grande cage, ne laisse pas entrer le soleil, et ne peut être déplacée; elle est toujours malsaine. Les Indiens et les animaux savent mieux vivre que l'homme blanc. Personne ne peut être en bonne santé sans avoir en permanence de l'air frais, du soleil, de la bonne eau. Si le Grand Esprit avait voulu que les hommes restassent à un endroit, il aurait fait le monde immobile; mais il a fait qu'il change toujours, afin que les oiseaux et les animaux puissent se déplacer et trouver toujours de l'herbe verte et des baies mures.L'homme blanc n'obéit pas au Grand Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons être d'accord avec lui."
Flying Hawk, chef Sioux du clan des Oglalas
"Les vastes plaines ouvertes, les belles collines et les eaux qui serpentent en méandres compliqués n'étaient pas « sauvages » à nos yeux. Seul l'homme blanc trouvait la nature sauvage, et pour lui seul la terre était « infestée » d'animaux « sauvages » et de peuplades « sauvages ». A nous, la terre paraissait douce, et nous vivions comblés des bienfaits du Grand Mystère. Elle ne nous devint hostile qu'à l'arrivée de l'homme barbu de l'Est qui nous accable d'injustices insensées et brutales."Standing Bear, chef Lakota (Sioux)
"Notre terre vaut mieux que de l'argent. Elle sera toujours là. Elle ne périra pas, même dans les flammes d'un feu. Aussi longtemps que le soleil brillera et que l'eau coulera, cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux. Nous ne pouvons vendre la vie des hommes et des animaux. C'est pourquoi nous ne pouvons vendre cette terre. Elle fut placée ici par le Grand Esprit et nous ne pouvons la vendre parce qu'elle ne nous appartient pas."Chef indien Blackfeet (Pieds-Noirs)

"Mes jeunes gens ne travailleront jamais.
Les hommes qui travaillent ne peuvent rêver. Et la sagesse nous vient des rêves."Smohalla, chef indien Sokulls
"Le Grand Esprit nous a donné une vaste terre pour y vivre, et des bisons, des daims, des antilopes et autres gibier. Mais vous êtes venus et vous m'avez volé ma terre. Vous tuez mon gibier. Il devient dur alors pour nous de vivre.
Maintenant vous nous dites que pour vivre, il faut travailler. Or le Grand Esprit ne nous a pas fait pour travailler, mais pour vivre de la chasse.Vous autres, hommes blancs, vous pouvez travailler si vous le voulez. Nous ne vous gênons nullement. Mais à nouveau vous nous dites « pourquoi ne devenez-vous pas civilisés? » Nous ne voulons pas de votre civilisation ! Nous voulons vivre comme le faisaient nos pères et leurs pères avant eux."
Crazy Horse, grand chef Sioux du clan Oglalas
"Vous êtes déjà si misérables que vous ne pouvez le devenir plus. Quels genre d'homme doivent être les Européens? Quelle espèce de créature choisissent-ils d'être, forcés de faire le bien et n'ayant pour éviter le mal d'autre inspiration que la peur de la punition? (...) L'homme n'est pas seulement celui qui marche debout sur ses jambes, qui sait la lecture et l'écriture et montrer mille exemples de son industrie...En vérité mon cher frère, je te plains du plus profond de mon âme. Suis mon conseil et devient Huron. Je vois clairement la profonde différence entre ma condition et la tienne. Je suis le maître de ma condition. Je suis le maître de mon corps, j'ai l'entière disposition de moi-même, je fais ce qui me plaît, je suis le premier et le dernier de ma nation, je ne crains absolument aucun homme, je dépends seulement du Grand Esprit.
Il n'en est pas de même pour toi. Ton corps aussi bien que ton âme sont condamnés à dépendre de ton grand capitaine, ton vice-roi dispose de toi. Tu n'as pas la liberté de faire ce que tu as dans l'esprit. Tu as peur des voleurs, des assassins, des faux-témoins, etc. Et tu dépends d'une infinité de personne dont la place est située au-dessus de la tienne. N'est-ce pas vrai ?"
Kondiarionk, chef Huron, s'adressant au baron de Lahontan, lieutenant français en Terre-Neuve
"Les hommes blancs annonçaient bien haut que leurs lois étaient faites pour tout le monde, mais il devint tout de suite clair que, tout en espérant nous les faire adopter, ils ne se gênaient pas pour les briser eux-mêmes.
Leurs sages nous conseillaient d'adopter leur religion mais nous découvrîmes vite qu'il en existant un grand nombre. Nous ne pouvions les comprendre, et deux hommes blancs étaient rarement d'accord sur celle qu'il fallait prendre. Cela nous gêna beaucoup jusqu'au jour où nous comprîmes que l'homme blanc ne prenait pas plus sa religion au sérieux que ses lois. Ils les gardait à portée de la main, comme des instruments, pour les employer à sa guise dans ses rapports avec les étrangers."
Pachgantschilhilas, chef des Delawares
"Chaque année notre envahisseur blanc devient plus avide, exigeant, oppressif et autoritaire... La misère et l'oppression, tel est le lot qui nous échoit... Ne sommes-nous pas dépouillés jour après jour du peu de liberté qui nous reste ?A moins que les tribus ne se liguent unanimement pour modérer les ambitions et l'avidité des Blancs, ils nous auront bientôt tous conquis et désunis, nous serons chassés de notre pays natal et éparpillés comme les feuilles d'automne par le vent."
Tecumseh, chef Shawnee, en 1812
"Nous ne voulons pas des chariots de feu qui font du bruit (trains à vapeur) sur les terrains de chasse au bisons. Si les Visages Pâles s'avancent encore sur nos terres, les scalps de vos frères seront dans les wigwams des Cheyennes. J'ai dit !"Roman Nose, chef-guerrier des Cheyennes, s'adressant au général Palmer en 1866 dans le Kansas

"Regardez mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu les baisers du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine est éveillée, et de même, tout animal est en vie. C'est à ce pouvoir mystérieux que nous devons nous aussi notre existence. C'est pourquoi nous concédons à nos voisins, même nos voisins animaux, autant de droit qu'à nous d'habiter cette terre.
Cependant écoutez-moi mes frères, nous devons maintenant compter avec une autre race, petite et faible quand nos pères l'ont rencontrée pour la première fois, mais aujourd'hui, elle est devenue tyrannique. Fort étrangement, ils ont dans l'esprit la volonté de cultiver le sol, et l'amour de posséder est chez eux une maladie. Ce peuple a fait des lois que les riches peuvent briser mais non les pauvres. Ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, pour eux seuls et ils se barricadent contre leurs voisins. Ils défigurent la terre avec leurs constructions et leurs rebuts. Cette nation est comme le torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage."
Tatanka Yotanka, ou Sitting Bull, grand chef Sioux
"Frère, notre territoire était grand et le vôtre était petit. Vous êtes maintenant devenus un grand peuple, et il nous reste à peine l'espace pour étendre nos couvertures. Vous avez notre pays, mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez nous forcer à épouser votre religion.Frère, continue à écouter. Tu te dis envoyé ici pour nous apprendre à rendre le culte au Grand Esprit d'une manière qui lui soit agréable. Et tu prétends que si nous n'adoptons pas la religion que vous les Blancs vous prêchez, nous seront malheureux ici-bas. Tu dis être dans le vrai et que nous sommes perdus. Comment pourrions-nous vérifier la vérité de tes paroles? (...)
Frère, tu dis qu'il n'y a qu'une seule façon d'adorer et de servir le Grand Esprit. Si il n'y a qu'une religion, pourquoi le peuple blanc est-il si partagé à ce sujet? Nous savons que votre religion est écrite dans un livre. Pourquoi n'êtes-vous pas tous d'accord, si vous pouvez tous lire le livre?
Frère, nous ne comprenons pas ces choses. On nous dit que ta religion a été donnée à tes ancêtres, et s'est transmise de père en fils. Nous aussi nous avons une religion que nos ancêtres ont reçue et nous ont transmise, à nous, leurs enfants. Nous rendons le culte de cette manière. Il nous apprend à être reconnaissants pour toutes les faveurs que nous recevons, à nous aimer les uns les autres et à être unis. Nous ne nous querellons jamais à propos de religion parce que c'est un sujet qui concerne chaque homme devant le Grand Esprit."
Sa-go-ye-wat-ha, ou Red Jacket, chef Seneca (Iroquois) et grand orateur des Six Nations

"J'assiste avec tristesse au déclin de notre noble race. Nos pères étaient forts et leur pouvoir s'étendait sur tout le continent américain. Mais nous avons été réduits et brisés par la ruse et la rapacité de la race à peau blanche. Nous sommes maintenant obligés de solliciter, comme une aumône, le droit de vivre sur notre propre terre, de cultiver nos propres terres, de boire nos propres sources.Il y a de nombreux hivers, nos sages ancêtres ont prédit qu'un grand monstre aux yeux blancs viendrait de l'Est, et qu'eu fur et à mesure qu'il avancerait il dévorerait la terre. Ce monstre, c'est la race blanche, et la prédiction est proche de son accomplissement."
O-no'-sa, chef indien
"Le changement du costume tribal pour celui de l'homme blanc fut brutal. Les effets sur la santé et le confort des enfants furent considérables. Notre premier grief fut d'avoir les cheveux coupés. Les hommes Lakotas ont toujours porté les cheveux longs. Plusieurs jours après avoir été tondus, nous nous sommes sentis bizarres et mal à l'aise. Si l'argument avancé était vrai, à savoir l'élimination des poux, pourquoi les filles n'avaient-elles pas subi le même traitement que les garçons?La vérité, c'est qu'ils voulaient nous transformer. Les cheveux courts étant la marque distinctive de l'homme blanc, on nous l'imposa, alors que lui-même conservait sa propre coutume de se laisser pousser les poils du visage."
Standing Bear, chef indien Lakota
"Les Wasichus nous ont mis dans ces boites carrées (maisons), notre pouvoir s'en est allé et nous allons mourir parce que le pouvoir n'est plus en nous.Nous sommes des prisonniers de guerre tant que nous attendons ici. Mais il y a un autre monde."
Hehaka, ou Black Elk (Wapiti Noir), indien Sioux
"Enfant, je savais donner. J'ai perdu cette grâce en devenant civilisé. Je menais une existence naturelle, alors qu'aujourd'hui je vis de l'artificiel. Le moindre joli caillou avait de la valeur à mes yeux. Chaque arbre était un objet de respect. Aujourd'hui, j'admire avec l'homme blanc un paysage peint dont la valeur est exprimée en dollars !"Chiyesa, écrivain indien contemporain
"Je suis allé à l'école des hommes blancs. J'y ai appris à lire leurs livres de classe, les journaux et la bible. Mais j'ai découvert à temps que cela n'était pas suffisant. Les peuples civilisés dépendent beaucoup trop de la page imprimée. Je me tournai vers le livre du Grand Esprit qui est l'ensemble de sa création. Vous pouvez lire une grande partie de ce livre en étudiant la nature.Si vous preniez tous vos livres et les étendez sous le soleil, en laissant pendant quelque temps la pluie, la neige et les insectes accomplir leur oeuvre, il n'en restera plus rien. Mais le Grand Esprit nous a fourni la possibilité, à vous et à moi, d'étudier à l'université de la nature les forêts, les rivières, les montagnes, et les animaux dont nous faisons partie."
Tatanga Mani (ou Walking Buffalo), indien Stoney (Canada)
 "L'homme blanc, dans son indifférence pour la signification de la nature, a profané la face de notre Mère la Terre. L'avance technologique de l'homme blanc s'est révélée comme une conséquence de son manque d'intérêt pour la voie spirituelle, et pour la signification de tout ce qui vit. L'appétit de l'homme blanc pour la possession matérielle et le pouvoir l'a aveuglé sur le mal qu'il a causé à notre Mère la Terre, dans sa recherche de ce qu'il appelle les ressources naturelles. Et la voie du Grand Esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes, et même pour beaucoup d'Indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc.
"L'homme blanc, dans son indifférence pour la signification de la nature, a profané la face de notre Mère la Terre. L'avance technologique de l'homme blanc s'est révélée comme une conséquence de son manque d'intérêt pour la voie spirituelle, et pour la signification de tout ce qui vit. L'appétit de l'homme blanc pour la possession matérielle et le pouvoir l'a aveuglé sur le mal qu'il a causé à notre Mère la Terre, dans sa recherche de ce qu'il appelle les ressources naturelles. Et la voie du Grand Esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes, et même pour beaucoup d'Indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc.Aujourd'hui, les terres sacrées où vivent les Hopis sont profanées par des hommes qui cherchent du charbon et de l'eau dans notre sol, afin de créer plus d'énergie pour les villes de l'homme blanc. On ne doit pas permettre que cela continue. Sans quoi notre Mère la Nature réagirait de telle manière que presque tous les hommes auraient à subir la fin qui a déjà commencé. Le Grand Esprit a dit qu'on ne devait pas laisser cela arriver, même si la prédiction en a été faite à nos ancêtres. Le Grand Esprit a dit de ne pas prendre à la terre, de ne pas détruire les choses vivantes.
Aujourd'hui, presque toutes les prophéties se sont réalisées. Des routes grandes comme des rivières traversent le paysage; l'homme parle à travers un réseau de téléphone et il voyage dans le ciel avec ses avions. Deux grandes guerres ont été faites par ceux qui arborent le swastika ou le soleil levant.
Le Grand Esprit a dit que si une gourde de cendres était renversée sur la terre, beaucoup d'hommes mourraient, et que la fin de cette manière de vivre était proche. Nous interprétons cela comme les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans aucun autre pays pour aucun autre peuple; cette énergie devrait servir à des fins pacifiques, non pour la guerre.
Nous, les chefs religieux et porte-parole légitimes du peuple indépendant des Hopis, avons été chargés par le Grand Esprit d'envoyer au président des Etats-Unis et à tous les chefs spirituels une invitation à nous rencontrer pour discuter du salut de l'humanité, afin que la Paix, l'Unité et la Fraternité règnent partout où il y a des hommes."
Lettre des Indiens Hopis au président Nixon en 1970
Stan DAVIS est un peintre américain qui a nourri dès son plus jeune âge une grande fascination pour les Indiens. Davis peint dans un style photo-réaliste, spécialisé dans la représentation de scènes des Indiens Pieds-Noirs tels qu'ils vivaient au 19e siècle. Il a également représenté les Sioux et Cheyenne. Pour assurer la précision historique et culturelle de son travail, Davis confectionne à la main chaque costume présenté dans ses peintures.











-
Alimentation carnée et souffrance animale.
- Par Thierry LEDRU
- Le 09/04/2020
Il y a le coronavirus chez les humains et puis il y a les abattoirs pour les animaux.
En ce moment, on oublie trop de choses...Cet article date de 2016.
Malgré toutes les vidéos et témoignages, rien n'a changé. Absolument rien. Sinon le fait que ce gouvernement a rendu punissable le fait de filmer dans les abattoirs l'abattage des animaux...Donc, je reposte cet article étant donné que seul l'arrêt de cette consommation animale mettra fin à ce massacre quotidien.
Il ne s'agit pas d'une lecture "facile"...Souvent, je passe certains passages en rouge pour en appuyer l'importance mais là, il aurait fallu que j'applique cette méthode à l'ensemble du texte.
Du rouge sang.
A chacun, en son âme et conscience, de choisir.
Souffrance animale : «L’objectif n’est pas d’éviter de la douleur à l’animal, mais de sécuriser le travail du tueur»
Par Sarah Finger —
https://www.liberation.fr/futurs/2016/05/16/souffrance-animale-l-objectif-n-est-pas-d-eviter-de-la-douleur-a-l-animal-mais-de-securiser-le-trava_

Extrait de la série «Rouge vif», dans un atelier d'équarissage. Photo Emmanuel Pierrot / Agence VU Les vidéos insoutenables diffusées par l’association L214 ont ravivé l’indignation face à la souffrance faite aux animaux. Un ex-inspecteur des services vétérinaires livre son expérience dans les abattoirs, qui l’a conduit à abandonner ce métier.
-
«L’objectif n’est pas d’éviter de la douleur à l’animal, mais de sécuriser le travail du tueur»
Des abattoirs où on ne laisse même pas à l’animal le temps de mourir avant de le découper, où on lui inflige d’ultimes blessures pour soi-disant l’anesthésier, où les procédés sont pensés pour protéger le «produit» mais jamais pour éviter la souffrance… Martial Albar, 43 ans, a travaillé plus de douze ans dans cet univers. Aujourd’hui consultant en sécurité alimentaire, il raconte la routinière mise à mort des animaux.
Vous avez travaillé dans de nombreux abattoirs en tant que technicien supérieur. Quelles étaient vos missions ?
Entre 2 500 et 3 000 agents du ministère de l’Agriculture travaillent dans les abattoirs, ainsi que 500 inspecteurs de la santé publique vétérinaire. Les agents sont des contrôleurs sanitaires ou des techniciens supérieurs spécialisés. Leur rôle est essentiellement d’ordre sanitaire et consiste à inspecter les carcasses et les organes des animaux qui viennent d’être abattus en vue de déclarer les viandes propres ou impropres à la consommation. Seuls ces agents de l’Etat peuvent procéder à la saisie vétérinaire quand la viande est impropre à la consommation. Les contrôles, l’estampillage sur chaque carcasse, absorbent les trois quarts du temps.
Les vidéos diffusées par l’association L214 semblent montrer que l’étourdissement des animaux fonctionne mal. Comment cette étape se déroule-t-elle concrètement ?
Certains abattoirs utilisent des caissons de CO2 qui asphyxient les cochons. Mais généralement, pour eux comme pour les moutons et les chèvres, on utilise l’électronarcose. Deux pinces mécaniques sont appliquées par un opérateur sur les tempes des agneaux, des moutons, des chevreaux ou des chèvres, et envoient une décharge électrique à l’animal. Pour les cochons, c’est le même système, mais automatique : une pince mécanique vient leur serrer la tête et envoie l’électricité.
Il n’y a pas à ma connaissance d’étude sur la perte de sensibilité à la douleur qu’induit l’électronarcose. Autrement dit, rien ne prouve que l’animal ne ressent pas ce qui se passe ensuite. Ce système d’étourdissement, comme les autres procédés, est avant tout utilisé afin de favoriser le travail de l’homme pour la mise à mort car après avoir reçu la décharge, l’animal tombe à plat, inerte.
A LIRE AUSSILe P'tit Libé: de la vache au steak, d'où vient la viande?
Comment se déroule cette mise à mort ?
Après avoir reçu le choc électrique, l’animal est suspendu par une patte arrière sur la chaîne d’abattage qui le transporte jusqu’au poste de saignée. Dans tous les abattoirs que j’ai connus, presque systématiquement, les animaux reprennent conscience avant d’être saignés car trop de temps s’est écoulé depuis le choc électrique. L’électronarcose, ce procédé franchement archaïque, provoque ainsi une souffrance supplémentaire et inutile à l’animal avant d’être tué…
Qu’en est-il pour les vaches et les veaux ?
On leur applique sur le front un pistolet à tige perforante qui perce l’os frontal et leur cerveau. C’est le seul procédé, peu coûteux et pratique, qui est utilisé pour faire tomber un animal de 800 kg. Car là encore, le but recherché n’est pas d’anesthésier l’animal, mais bien de l’immobiliser. Parler d’anesthésie est un pur mensonge, une tromperie. L’objectif n’est pas d’éviter de la douleur à l’animal, mais de ne pas abîmer le «produit» et de sécuriser le travail du tueur. D’ailleurs, dans de nombreux abattoirs, du courant électrique est appliqué à l’aide de pinces sur les lèvres des bovins au moment de la saignée : ce choc les tétanise, limite le mouvement des pattes et permet donc d’éviter des accidents.
Comment se déroule la saignée ?
Cette opération consiste à trancher les carotides et les jugulaires pour que l’animal perde son sang. Les cochons sont saignés différemment : on ne laisse pas couler leur sang, on le pompe. On leur enfonce un trocart dans la gorge pour récupérer le sang qui servira à faire du boudin, des saucisses pour les hot-dogs ou même des produits cosmétiques. Ensuite, le cochon est échaudé : il est trempé dans l’eau bouillante pour préparer le brûlage des poils. Pour les bovins, le tueur ouvre souvent complètement la gorge pour accélérer la perte de sang avant d’enlever le «masque», c’est-à-dire la peau de la tête de la vache. Ensuite on lui sectionne les extrémités des deux pattes avant. J’ai vu des vaches encore vivantes et donc parfaitement sensibles à ce stade-là.
Et après la saignée ?
Dans tous les cas, la mort met du temps à venir. Le tueur est censé attendre que cette mort arrive avant de continuer à «travailler le produit», mais ce n’est pas du tout ce qui se passe. J’ai vu des cochons encore conscients quand ils entraient dans l’échaudeuse, le bain d’eau bouillante. Pareil pour les chèvres et les chevreaux, les agneaux et les moutons : après la saignée, on leur sectionne les quatre avant-pattes pour commencer à retirer leur peau, et bien souvent, quand l’opérateur attaque ça, l’animal n’est pas complètement mort.
Que faudrait-il faire selon vous pour éviter ces agonies ?
Sectionner la moelle épinière au niveau des premières vertèbres cervicales. Cela entraînerait une insensibilité totale de l’animal et permettrait une mise à mort par saignée sans souffrance. Mais en 2016, en France, on n’est toujours pas capables de tuer des animaux sans les faire souffrir.
Comment se déroule un abattage rituel par rapport à la procédure classique ?
Généralement, les moutons sont suspendus par une patte arrière et égorgés en pleine conscience. Les vaches et les veaux sont quant à eux placés dans des dispositifs mécaniques de contention, des sortes de cages rotatives qui se referment sur eux et se retournent. L’animal se retrouve les pattes en l’air, la tête enserrée dans un système qui fait tendre son cou. Le sacrificateur tranche profondément sa gorge, puis le piège se retourne à nouveau, l’animal tombe, parfois il tente de se relever, alors que sa tête ne tient plus que par la colonne vertébrale, avec des projections de plusieurs mètres… Ces scènes dépassent l’entendement.
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant ces années de travail dans cet univers ?
Les agneaux. Avant d’être abattus, quand ils sont parqués, ils pleurent comme des bébés. On se croirait dans une crèche. Et quand on s’approche d’eux, ils veulent téter nos doigts parce qu’ils ont faim… C’est une pure horreur. Comme ils sont petits et qu’ils se manipulent facilement, il est fréquent que les opérateurs leur fracassent la tête pour aller plus vite, ou bien ne les électrocutent pas, comme on l’a vu dans une des vidéos diffusées par l’association L214. Je repense aussi à un cochon arrivé moribond dans un abattoir. J’ai appelé un saigneur pour l’égorger sur place, à l’extérieur, mais l’animal était tellement faible que son sang ne s’écoulait pas. Il a mis dix minutes à mourir.
Les vétérinaires présents dans les abattoirs ne sont-ils pas censés veiller au «bien-être» animal ?
Les vétérinaires sanitaires contractuels (des libéraux mandatés par l’Etat) et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire assistent peu à la mise à mort des animaux et n’ont pas envie d’embêter les abattoirs avec des questions de souffrance animale. Parfois même, ils ne viennent que l’après-midi, lorsque les abattages sont terminés, comme je l’ai vu à Megève, en Haute-Savoie. Dans les abattoirs, ceux qui commencent à s’émouvoir sont très vite mis à l’index, même par leurs propres collègues. On se moque de leur sensiblerie. Car c’est un milieu viril, hein, pas le monde des Bisounours, comme ils disent… J’ai entendu fréquemment ces réflexions : «De toute façon, ils sont là pour mourir»… Personnellement, j’ai démissionné en 2012 après une douzaine d’années passées dans ce milieu. Pourtant, j’étais fonctionnaire d’Etat, j’avais la sécurité de l’emploi, je n’avais qu’à attendre la retraite…
Les cadences imposées au personnel expliquent-elles en partie toute cette souffrance animale ?
Les cadences sont en effet élevées : par exemple, un bovin était abattu toutes les trois minutes à Bonneville, l’un des sites où j’ai travaillé… En Bretagne, dans certains grands établissements, un porc est abattu toutes les six secondes ! Pourtant, les cadences sont loin de tout expliquer. Même si les métiers dans un abattoir restent durs, depuis vingt ans les conditions de travail se sont beaucoup améliorées, les étapes se sont mécanisées, les salariés sont davantage protégés, moins mis à l’épreuve. En revanche, rien n’a bougé pour les animaux. Rien n’est pensé pour leur éviter de souffrir. Mais ni les éleveurs ni les consommateurs ne veulent voir l’horreur, et au final, nous sommes tous complices de cette barbarie.
-
A CŒUR OUVERT : crise et simplicité volontaire
- Par Thierry LEDRU
- Le 25/03/2020
- Vous n’en avez jamais entendu parler ?
- Je n’ai connu que la complexité volontaire, dans une totale inconscience, répondit-il avec amertume. C’est en tout cas l’image que j’en aie aujourd’hui.
- Pour moi, la simplicité volontaire est la seule issue. C'est-à-dire l’élimination du superflu, non pas sous les effets dévastateurs d’une crise mais de façon anticipée afin justement d’éviter que la crise l’emporte. C’est juste du bon sens en fait. Mais ce monde moderne a renié le bon sens. Il n’use que de sa logique. Nous ne parvenons même plus à élaborer en nous une vision globale, un inventaire du désastre, nous les percevons chacun séparément, nous nous en occupons et délaissons dès lors tous les autres, c’est un piège sans fin. Il n’y a plus qu’une seule solution : aller consciemment vers la simplicité volontaire afin que les problèmes disparaissent d’eux-mêmes, par effacement, juste parce qu’ils ne seront plus activés.
- Mais sans ce monde moderne, je serais déjà mort aujourd’hui, contesta-t-il avec gêne.
- Je le sais bien et loin de moi l’idée de rejeter les progrès technologiques. Ce ne sont pas les améliorations qui sont contestables mais l’usage qui en est fait. Dès lors que les progrès ne sont pas précédés d’une réflexion existentielle sur ce qu’ils vont apporter ou les risques qu’ils contiennent, ils deviennent l’étendard de la croissance. Il ne s’agit pas de faire mieux mais surtout de faire plus. Sans se préoccuper le moins du monde d’être. Mais dans ce cas-là, l’individu est la proie du progrès au lieu d’être son maître. Le gaspillage des ressources naturelles est le symbole le plus terrifiant de ce fonctionnement. On court à l’épuisement.
- Est-ce qu’il reste un avenir ?
- L'avenir de l'humanité ? C'est bien simple, elle l'a déjà tellement rogné qu'il ne reste plus que l'os. On entend souvent parler du « pic de pétrole » mais "le pic de survie" finira par s’imposer. C’est inéluctable. Soit on continue à procréer pour préserver la fameuse croissance et on fonce la tête dans le mur, soit on abandonne ce fonctionnement et on inverse la courbe démographique. Mais le choc, dans un cas comme dans l'autre, est inimaginable. La seule différence, c'est la possibilité du choix ou l'abandon. Il arrivera un jour où mettre au monde un enfant relèvera d'un crime prémédité.
- Personne ne parviendra à limiter la population. C’est impossible.
- C’est à chaque individu de le décider. Les décideurs politiques, quels qu’ils soient, ne sont que les bras armés de la croissance.
- Pourquoi dites-vous que l’humanité continue à procréer pour préserver la croissance ? Ça n’est pas l’idée que les gens se font lorsqu’ils décident d’avoir un enfant.
- Non, bien sûr, ils ne pensent pas à la conséquence planétaire de leurs actes et si je n’avais pas été stérile, j’aurais certainement aimé avoir un enfant avec Tyler. Mais les choses évoluent terriblement vite et il est plus que temps de réfléchir à cet acte de procréation au-delà de l’amour parental. C’est à l’amour pour la planète que nous devons penser. L’amour de la vie. Et l’humanité en est devenue l’ennemie. Elle est la seule espèce vivante à mettre en danger l’ensemble du monde vivant. Nous n’avons plus le droit de vivre en vase clos dans nos égos. Ce temps-là est fini. Regardez maintenant le conditionnement phénoménal que nous absorbons au regard de cette idée d’enfantement. Les petites filles sont de futures mères consommatrices et les petits garçons sont de futurs pères consommateurs. Une famille nombreuse consomme beaucoup plus qu’un célibataire. Et même les célibataires fortunés, il faut bien les remplacer à leur mort. Aucun état ne prônera jamais la limitation des naissances. C'est à chaque couple d'y réfléchir. Les deux jeunes qui vont acheter la maison ne veulent pas d’enfants. Cela aussi fait partie, pour eux, du concept de simplicité volontaire. Ne pas renforcer le poids que supporte la planète.
- On pourrait aussi penser que c’est égoïste. Si nos parents avaient pensé de cette façon, nous ne serions pas là.
- Ils n’avaient pas à le faire mais le temps d’apprendre à vivre en osmose avec le phénomène vivant est venu. Et cette osmose passera nécessairement par une diminution énorme de notre impact. Dans ce processus d’inversion de la population, la mondialisation s’effondrera. Il n’y aura plus assez de consommateurs, ni même de bras pour la maintenir. Les économies régionales prendront le pas. Des échanges à échelle humaine et non à échelle financière. Comme cela existait il y a un siècle. Cela ne signifie pas pour autant une régression. Les technologies ne disparaîtront pas. C’est juste le nombre de personnes lucides à en bénéficier qui rétablira l’équilibre. Il faut une technologie au service de la vie et non de la croissance matérielle. Il serait fou et criminel d’attendre des conflits mondiaux ou des épidémies planétaires ou d‘autres catastrophes pour limiter cet impact du nombre. C’est aux humains de le décider.
- Vous avez l’air d’avoir grandement réfléchi à tout ça. Et c’est vrai que si je pense à mon activité au sein de mon entreprise, je n’envisageais que la croissance du chiffre d’affaire. Je ne me suis jamais soucié des effets sur la planète.
- Votre cœur a bien fait de vous lâcher alors ! lança-t-elle avec un sourire radieux.
- Vous êtes bien la première personne à voir les choses comme ça.
- Non, vous m’avez devancé. »
Il plissa le front, cherchant à comprendre.
« Vous ne seriez pas là. Vous auriez tenté à tout prix de reprendre votre vie.
- Oui, effectivement, on peut voir les choses de cette façon mais malgré tout, je n’ai pas le souvenir d’avoir pris beaucoup de décisions volontaires depuis que j’ai retrouvé mon autonomie. L’impression même que je suis embarqué dans un courant que je ne contrôle pas.
- Et cela vous inquiète ?
- Non.
- Alors tout va bien. »
Elle avait sorti deux assiettes et des couverts. Elle lui demanda de couper deux tranches de pain. Elle posa un pichet d’eau du robinet sur la table.
Il s’installa face à elle. Elle servit.
« Poivrons, aubergines, échalotes, épices et légumineuses, pain bio cuit au four, fromage du pays, eau de source.
- Je me suis mis à la cuisine dernièrement mais je ne suis pas aussi imaginatif. Et sûrement pas aussi doué dans mes choix de produits. »
Il goûta.
« Délicieux.
- Merci. J’ai passé les années parisiennes et les heures dans les hôtels, les halls de gare ou d’aéroport à manger des produits infâmes. Je n’y faisais pas attention. Trop de stress. C’est absurde étant donné que je me détruisais encore plus en y ajoutant la malbouffe.
- Pas mieux pour moi. Et le stress, j’en ai mangé jusqu’à la nausée.
- Racontez-moi. »
Il la regarda, but un grand verre d’eau.
« Aujourd’hui, quand je pense à ce que j’ai vécu, j’en arrive à éprouver de la honte. Non pas, pour ce que j’ai fait, pas pour le mal que j’ai causé, les erreurs stratégiques ou l’inattention envers mes proches, pas pour tout ce que j’ai oublié de vivre mais bien plus profondément pour cette impression de gâchis par rapport à la vie. Je ne sais pas trop comment l’expliquer en fait. Dans une vie, on peut regretter des décisions, des choix, des actes, mais tout ça reste au niveau des événements et il est bien souvent possible de corriger le tir. Moi, ce que je ressens, c’est bien au-delà de ces événements. C’est comme si j’avais trahi l’existence, cette vie qui m’a été donnée. Vous comprenez ? »
Cette chaleur dans son ventre, ces frissonnements qui coulaient en elle comme un délice infini. Elle aimait sa voix, ses yeux, la largeur de ses mains, elle se surprenait à lui porter un regard d’adolescente et s’en amusait. Ce plaisir immense d’échanger avec lui, cette impression de l’avoir attendu pendant très longtemps.
« Oui, tout à fait. Vous n’êtes plus simplement dans l’observation visible des conséquences de vos actes mais dans l’observation spirituelle de votre indifférence au regard du phénomène vivant. Chacun de nos actes devraient se référer à ce phénomène. Nous devrions nous interroger sur ce que la vie penserait de ce que nous pensons, de ce que nous projetons de faire ou de ce que nous accomplissons. Mais ça ne me dit pas ce que vous avez vécu. »
Il raconta en détail son parcours d’entrepreneur, de financier, sa vie avec Alice, la naissance de Chloé, les dernières années, la lutte pour s’imposer sur le marché.
« Et puis, j’ai eu cet infarctus, aucun signe précurseur. C’est Philippe, mon associé, qui m’a sauvé.
- Vous n’aviez jamais eu de problèmes avant ?
- Non, rien, absolument rien.
- C’est impressionnant alors. Personne n’est à l’abri en fait.
- Il faut croire. Mais pas grand monde n’y pense. Ou alors, c’est l’angoisse qui l’emporte, ce qui ne vaut guère mieux.
- Et ensuite ?
- J’ai vendu l’entreprise à Philippe. Il le méritait amplement pour son travail de toute façon. Après l’implantation de la prothèse, j'ai vécu un basculement total, foudroyant, incompréhensible. Je me souviens très bien des premières heures. Pas de douleurs insupportables, j’étais sous morphine, je suppose. Je n’ai rien demandé. Le chirurgien est passé, tout allait bien, ils étaient très satisfaits et je m’en moquais. Sans comprendre pourquoi. Un détachement totalement fou. J’ai d’ailleurs pensé que j’étais fou ou que mon cerveau n’avait pas été assez oxygéné pendant l'opération. J’aurais dû être rempli de joie et de reconnaissance, j'avais imaginé le pire, je savais que ça pouvait mal se terminer. Et puis, là, peu à peu, dans la solitude de ma chambre, je me suis aperçu qu’il n’y avait aucune joie en moi, même pas l’once d’un soulagement. Rien. Absolument rien. Aucun désir de reprendre le travail, aucune projection sur l’avenir, aucune interrogation sur le devenir de cette prothèse de cœur, sur ma récupération, le suivi médical...Rien. Un grand vide et pourtant une présence indéfinissable. J'étais là. Mais je ne sais pas comment le décrire. C’était comme si je découvrais le fait de vivre et que je devais me contenter d’enregistrer tout ce que je percevais dans l’instant.
- Rien d’étonnant pour moi. L’effleurement avec la mort révèle la vie de l’instant.
- Oui, c’est exactement ça. La vie de l’instant. D’ailleurs, la première fois qu’on m’a laissé sortir dans le parc, je me suis assis sur un banc et j’ai regardé des pigeons. Ça n’a l’air de rien mais vous n’imaginez pas à quel point c’était stupéfiant pour moi. Je regardais le balancement de leur cou quand ils marchent, j’essayais de les reconnaître, d’identifier leurs différences de plumage, de voir si certains restaient proches, si des couples étaient constitués, comment ils repéraient leur nourriture et puis j’ai fini par ne plus penser à rien, à ne plus vouloir intégrer des données précises, je les ai juste regardés. À un moment, je suis sorti de cette observation, comme si j’avais quitté une pièce, l’impression d’être projeté dans un vacarme épouvantable, j’entendais le bruit de la ville, des discussions autour de moi, des ambulances, j’ai vu passer des gens, j’ai vu tous les bâtiments, ces milliers de fenêtres comme autant de souffrances cachées, des traînées d’avions dans le ciel, et puis l’herbe piétinée autour des bancs, des papiers abandonnés à côté de poubelles vides et la première idée qui a surgi, c’est que dans l’observation des pigeons, je n’étais pas en train de rêver comme on dit, les yeux dans le vague mais que c’était maintenant que j’étais tombé dans le rêve. Je ne sais pas comment l’expliquer en fait. C’est tellement étrange. Vous savez, souvent les adultes disent aux enfants quand ils ont les yeux dans le vide, « arrête de rêver et écoute-moi », eh bien, moi, j’avais l’impression que c’était l’inverse. Ça m’a fait un mal de chien, à en pleurer, là, tout seul, sur mon banc, comme si j’avais quitté la vie pour tomber dans un cauchemar immonde. Vous voyez, j’ai passé tellement d’années à vouloir tout contrôler, à me battre pour atteindre les objectifs que je visais, à valider matériellement l’idée que je me faisais de l’existence, j’aurais dû reprendre tout ça, j’étais sauvé après tout, j’aurais pu retourner au boulot, doucement bien sûr, mais en tout cas, relancer la machine. Et c’est cette expression qui a tout déclenché. Relancer la machine. Mais, c’était moi la machine.
- On se voit toujours comme un individu menant des activités multiples et trouvant des compensations diverses, intervint-elle, avec même parfois des satisfactions personnelles, des occasions de fierté ou d’estime de soi, mais c’est complètement fou finalement puisque nous sommes effectivement des machines et que nous répétons mécaniquement les activités pour lesquelles nous avons été programmés dès notre enfance. »
Ce bonheur pour lui d’entendre en écho les éclaircissements indispensables, les validations partagées de tous ses tourments.
« Oui, je n’avais pas été programmé à regarder béatement des pigeons et à en éprouver étonnamment un sentiment de bien-être. C’est comme si quelqu’un avait appuyé sur le bouton off. Fin du vacarme, suspension des pensées intentionnelles, abolition des objectifs, disparition de toute identification projective, de notion de rentabilité, d’utilité, comme l’effacement du disque dur. Un ordinateur sans disque dur n’a aucune utilité. Je n’étais donc plus un ordinateur et je découvrais la liberté. Un mélange d’angoisse et d’euphorie. Vous voyez ? Comme si je décrochais de mes dépendances, je ne touchais plus à ma dope, je me purifiais mais c’était douloureux. De regarder ainsi toute l’agitation comme un rêve a fait de moi un marginal, un dérangé, un individu inquiétant. C’est pour ça qu’Alice est partie, c’est pour ça que Chloé ne veut plus me voir, que mon associé ne voyait en moi qu’un illuminé qu’il fallait sauver. Je n’ai même pas essayé de leur expliquer quoi que ce soit. Je n’en avais pas la force, ni même l’envie d’ailleurs. Comme si j’étais tombé dans une bulle sans contact avec le monde extérieur. On ne parlait plus le même langage. Pas pour autant que je me voyais comme un être pur et sauvé du néant, un élu des cieux ou je ne sais quelle fumisterie. J’étais juste devenu un paumé sans repère, un errant, un exilé bourré de pognon qui avait juste envie de regarder des pigeons. Alors, j’ai cherché un endroit perdu et j’ai atterri ici. C’est sans doute ce que j’ai fait de mieux en trente ans. »
-
Les lieux perdus
- Par Thierry LEDRU
- Le 02/03/2020
Dans une discussion sur les maisons isolées, perdues dans des lieux déserts, des vallées de montagnes, loin des masses et de leurs nuisances, j'ai réalisé à quel point, dans mes romans, ces lieux d'habitation trouvaient souvent une place...
Il n'est pas étonnant que ça soit aujourd'hui notre projet le plus intense : quitter cette vallée désormais trop urbanisée, trouver une maison sans aucun vis-à-vis, enveloppée dans un cocon de silence, hors de tous regards, au bout d'une piste en terre qui semble ne mener nulle part...
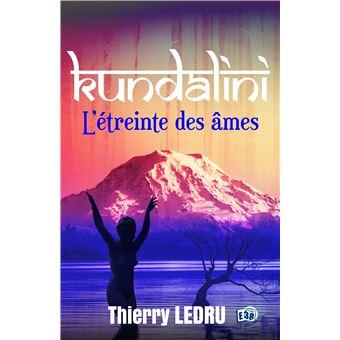
Piste forestière de l’aiglon. Un grand panneau en bois. Elle trouva étrange que la direction soit aussi bien signalée. Elle pensa à l’indication d’un restaurant d’altitude, une ferme auberge. Elle espérait se tromper.
Elle roula doucement en regardant dans le rétroviseur le nuage de poussières. Elle sourit en pensant que ces volutes retombaient sur sa vie passée, qu’elle montait vers la lumière.
Elle atteignit enfin un vaste replat encadré de végétation et parsemé d’arbres solitaires, la surface d’un terrain de football, un plan horizontal inséré dans la pente. Elle devinait au plus loin une rupture de pente, l’impression que le plateau basculait sur le vide. L’emplacement d’une citadelle isolée.
Une bâtisse en pierres à l’entrée du pré, comme une ancienne ferme d’alpage. Un plain-pied ramassé, trapu, un défi au temps.
Un hangar ouvert protégeant un véhicule.
Une vingtaine de mètres plus loin, un petit chalet rectangulaire avec un toit d’un seul pan. Couvert de panneaux solaires. Elle pensa à un bungalow de camping qui aurait été renforcé par des bardages. De grandes fenêtres, une étrange éolienne au sol, des pâles horizontales, courbées et qui tournaient régulièrement malgré l’absence totale de vent.
Des murs de pierres sèches qui délimitaient l’espace, un potager aussi vaste qu’un bassin olympique, des réservoirs d’eau disséminés. Des troncs entiers couchés au sol, empilés et débités. Des stères de bois rangés sous un appentis.
D’autres panneaux solaires inclinés sur des supports métalliques.
Et puis, cette immense cabane à mi-hauteur d’un feuillu. Une maison perchée qui la fascina.
Elle gara son véhicule sur le bas-côté de la piste. Une allée gravillonnée conduisait à la maison. Un toit récent. Pas de mousse sur les lauzes, des poutres brutes, pas encore traitées. Deux grandes baies vitrées sur la façade. Des rideaux opaques entièrement tirés.
Elle claqua la porte de la voiture pour signaler son arrivée.
Aucun mouvement. Des chants d’oiseaux, le murmure d’un cours d’eau qu’elle ne voyait pas.
Un lieu si étrange. Elle se moqua d’elle. Toujours ce mot qui revenait. Tout était étrange dès lors qu’il s’agissait de Sat. Elle ne se souvenait plus exactement des paroles de Carine.
« …il est connu pour tellement de choses… »
Des brides de phrases qui l’accompagnaient.
Le visage de la gérante resplendissait et cela avait suffi à la rassurer. Carine ne l’aurait pas guidée vers une personne dangereuse. Elle semblait plutôt amusée, presque heureuse pour elle, comme s’il s’agissait d’un privilège.
Elle observa le potager. Impressionnée par la taille et la diversité des plantes. Des tuteurs, des filets de protection, des murets séparateurs, des allées. Un travail qui relevait davantage du professionnel que du particulier. Une telle quantité de légumes, ça ne pouvait être pour sa consommation personnelle. De quoi nourrir tous les résidents du camping de Carine pendant un mois. Un lacis de rigoles parcourait l’étendue, un réseau minutieusement conçu pour apporter de l’eau d’un bout à l’autre de l’espace. Une serre avec de grandes toiles plastifiées à l’extrémité des plantations, un demi-tube d’une dizaine de mètres de long.
« Maud ! »
Elle se retourna en sursautant. Il venait de franchir l’angle de la maison. Il poussait une brouette.
Il était nu. Sans se l’expliquer, elle n’en fut même pas surprise. Comme s’il ne pouvait en être autrement.
Sat.
Elle le regarda s’approcher, figée, tremblante, émue, le cœur affolé.
Les bras et les pectoraux tendus par le chargement, les muscles saillants de ses cuisses, les sangles de son ventre qui descendaient en triangle vers son pubis imberbe.
Il s’arrêta à quelques mètres, s’assura de l’équilibre de la brouette et s’approcha. Il ouvrit les bras et déposa une bise sur une joue, puis l’autre.
Le contact de ses mains sur ses épaules, la proximité de son visage, la douceur de ses lèvres. Elle frissonna et se le reprocha. Sat percevait ce qui ne se voit pas. Elle le savait.
Un instant suspendu.
« Bonjour Maud, vous avez bien dormi ?
-Absolument pas. Des voisins beaucoup trop bruyants à mon goût.
-Eh bien, venez ici, ça n’est pas la place qui manque, » lança-t-il, joyeusement.
Un large sourire sur son visage.
« Je sais que vous êtes emplie d’interrogations, ajouta-t-il, mais c’est une invitation amicale, désintéressée, juste un moyen de vous reposer comme vous le souhaitez. C’est inutile de gâcher vos vacances alors que vous pouvez disposer ici d’un calme absolu. »
Une voix posée, un regard chaleureux. Elle sentait toute sa douceur, juste ce bonheur qu’il lui proposait. Elle n’aurait jamais imaginé une telle issue et elle en arrivait à remercier intérieurement ses voisins.
Elle avala sa salive et baissa les yeux.
L’impression de se lancer dans le vide et d’ouvrir les ailes. L’euphorie des grands espaces, le survol des jours sombres, comme si le soleil entrait en elle, parcourait son corps, cascadait en torrents scintillants.
« Je ne voudrais pas m’imposer mais puisque vous me le proposez, je suis très heureuse d’accepter.
-Très bien, alors, on ira chercher vos affaires ce soir mais dans l’immédiat, on part là-haut.
-Là-haut ?
-L’endroit que j’aimerais vous montrer ? Vous avez déjà marché nue, toute la journée, pas juste sur une plage ou au bord d’un lac, mais dans la montagne, en forêt, dans les alpages ?
-Non, jamais.
-Eh bien, ça vous dit de tenter l’expérience ? »
Il la regardait. Intensément. Un éclat pétillant dans ses yeux immenses.
« Je ne le ferais pas toute seule mais avec vous, je suis partante. De toute façon, je suis prête à tout vivre. »
Il la regarda en souriant et elle se rabroua intérieurement. Les mots avaient jailli sans qu’elle n’en juge la portée.
Elle le suivit sans un mot. Le cœur à tout rompre.
« C’est un bungalow que j’ai habillé de bois pour renforcer la structure et l’isolation. C’est mon habitation principale pour le moment.
-Et cette grande bâtisse alors ?
-Je la retape depuis mon arrivée ici, il y a onze ans. J’avais vingt-trois ans quand mes parents m’ont donné ce terrain. »
Trente-quatre ans. Elle s’était empressée de calculer son âge.
Ce mélange troublant entre ce corps d’éphèbe et la portée spirituelle de ses paroles, cette voix grave et apaisante qui la liquéfiait, la délicatesse de ce regard et cette plongée inexplicable, comme un périscope en elle. Elle se sentait si jeune à ses côtés.
« Mais je préfère vivre dans mon bungalow. »
Ils traversèrent une large terrasse en bois puis Sat ouvrit la porte.
« Et vous avez fait ça… tout seul ? »
Elle pensa subrepticement à une compagne. Ou à un compagnon. Puisqu’elle savait désormais que tout était possible.
« Non, il y a des amis qui m’aident. La cabane, là-haut, on était cinq à travailler dessus. On y a passé sept mois. Je vous la montrerai ce soir. Mais il faut y aller maintenant, on a du chemin et une longue journée à vivre. »
6
Il arriva à la Godivelle après vingt heures. Une lumière rasante sur les monts et les bois, des nuages blancs qui erraient comme des pensées disparates. Il imagina que les cieux observaient la terre et commentaient le spectacle. Un sourire intérieur en constatant que la paix en lui était revenue. Peut-être le retour à cette nature, l’éloignement de la ville…
À mesure qu’il prenait de l’altitude, il avait senti l’apaisement l’envahir. Lentement, comme s’il était sorti d’un mauvais rêve et qu’il s’était éveillé. Dans les derniers kilomètres, il n’avait croisé aucun véhicule. Chaque vallonnement révélait de nouveaux paysages : des houles de collines figées, des creux protégés des vents furibonds, des bois serrés comme des retranchements de silence.
Les traversées de villages s’étaient raréfiées.
Il ne restait parfois que les lignes électriques et cette route pour marquer l’empreinte des hommes.
Il aimait particulièrement la traversée d’un vallon totalement désert, un enchâssement surprenant de prairies et de collines, quelques bois impassibles, des crêtes arrondies comme des crânes antiques.
Toujours cette impression bienheureuse d’être observé par le monde, tel un passager inconnu qui attirerait les regards.
Il s’était arrêté la première fois et répétait la chose désormais.
Il coupait le moteur, sortait et écoutait le silence en laissant ses yeux dériver lentement.
Il n’y avait rien de particulier à voir finalement. Rien de sensationnel, rien de singulier. C’est pour ça que la paix ressentie était si profonde. Il avait pensé à l’amour des océans, à cette étendue mouvante qui comblait d’amour les marins. Rien de particulier. Juste l’immensité.
Lui, il aimait les collines et les palettes de couleurs.
La Nature comme un baume apaisant, un câlin maternel, la douceur de l’amour.
Il conduisit jusqu’au village et passa devant l’épicerie. Fermée. De la lumière dans la partie habitée. Il n’osa pas aller frapper. Une douleur au ventre. Il reprit la route jusqu’au hameau.
L’air était frais quand il sortit de la voiture. Un parfum d’espace, quelque chose d’inexplicable qui l’emplissait d'une joie profonde. Il prit une longue inspiration.
Il s’arrêta à l’entrée du terrain et regarda la maison. Ancrée comme un rocher, tassée comme un dolmen. Indéracinable. Combien d’humains ces pierres avaient-elles entendus, combien de pieds avaient foulé cette terre, combien de mains s’étaient posées sur ce grain millénaire ? Combien de temps resterait-il là ? Un doute qui s’insinuait. Comme si déjà, il appartenait à ce lieu, cette vie ancestrale qui coulait en lui, un flux séculaire… Il comprenait soudainement l’attachement des gens à une terre. Il se souvenait d’un Breton qui avait travaillé dans l’usine de son père. Il ne parlait que de sa terre natale. Il avait fini par y retourner. C’était plus fort que tout.
Il se fit un plat de légumes verts. Il avait posé le saucisson sur la table sans pouvoir y toucher. L’impression inattendue d’entendre la viande pleurer la vie perdue.
Il fit la vaisselle, l’essuya et la rangea dans le buffet.
La musique du blog de Diane. Parfois, il devait s’arrêter tant les émotions l’étourdissaient, des envolées symphoniques alternant avec des plages de ressac apaisé. Il finit par s’asseoir dans le fauteuil pour écouter, les yeux fermés. Ne plus s’agiter. Comment avait-il pu ignorer ce bonheur aussi longtemps ?
Il regretta ses reproches, ils étaient inutiles, tout comme il ne servait à rien de vouloir comprendre ce qui s’était produit. Puisque cela le projetait en arrière alors que le temps présent s’offrait à lui. Il devait rester réceptif et ne pas s’encombrer. Être là, simplement. Abandonner les quêtes temporelles, ne rien vouloir, laisser venir les réponses, comme des bêtes apaisées qui n’ont plus peur, tendre l’esprit comme une main ouverte, laisser les révélations s’approcher d’elles-mêmes, le respirer, s’habituer à lui, prendre confiance, s’asseoir dans le silence et s’abandonner au présent. C’est là que la vie prenait forme, tout le reste n’était qu’une litanie de commentaires, des couvertures sombres, épaisses, irritantes, il n’avait même pas à vouloir repousser ces masses invalidantes, c’était encore une volonté emplie de peur. Juste être là, réceptif, ouvert, apaisé. Cette idée qu’il avait constamment vécu avec un temps de retard, qu’il s’était contenté de commenter les évènements et de ne jamais les vivre en pleine conscience, qu’il avait couru après les heures en s’agitant pour combler le vide, que le présent en lui n’avait jamais été autre chose qu’un passé à corriger, qu’une accumulation de réactions entachées de la nausée du temps qui s’enfuit et de l’inquiétude du temps à venir.
Il avait vécu tout en espérant vivre mais sans jamais être là. "
Il rangea soigneusement les achats et reprit la route. Deux villages, des vieilles bâtisses en pierre, des collines, des murets encadrant des champs à l’herbe grasse. Il croisa une voiture. Et un vol de corneilles.
Direction « lac de Charpal. »
Il s’engagea sur la route étroite. Aucune habitation. Cinq kilomètres de longues courbes encadrées par des peuples de pins. La lumière matinale s’étendait comme une marée câline, sans vague, ni courant, juste une nappe gigantesque, tendue comme un tissu d’aquarelles. Elle rasait le sommet des épineux. Des paysages scandinaves. La palette de couleurs l’hypnotisait. Infiniment joueur, le soleil, comme un rouleau de peinture insatiable, nuançait les teintes, cendrait les crêtes, enflammait les fûts, des parcelles s’embrasaient, d’autres coulaient dans l’ombre. Ces changements incessants donnaient au paysage l’impression étrange de mouvance. Comme des risées sur l’océan.
Enfin, la pente s’atténua et il déboucha sur un immense parking. Un barrage à l’extrémité du lac. Des chemins suivaient le bord de l’eau, d’autres disparaissaient sous les arbres.
Il coupa le moteur mais dans son crâne l’écho mécanique perdura comme un écho qui s’épuise. Les mains sur le volant, il balaya le paysage, lentement, avec délectation, hésitant presque à sortir. Mettre un terme à la complicité qui l’avait uni à la cabine, au volant, à l’odeur chaude du moteur, au ronflement des pièces. Il éveilla dans ses muscles des contractions libératrices, des volontés de mouvements. Il attrapa la poignée de la porte et il descendit.
Plongeon dans le silence. Comme s’il était entré dans un bain. La paix qui coule sur la peau de son visage, se mêle à ses cheveux, glisse sous ses habits. Respiration suspendue.
Il s’appuya contre le pare-chocs avant et reprit son souffle. Rien. Il n’y avait absolument aucun bruit.
Bruit.
Le mot lui-même ici semblait privé de sens.
La limpide tranquillité ruissela en lui comme une divine liqueur et nettoya son corps de la fatigue de la route.
Il marcha vers la surface chatoyante du lac. Le crissement de ses pas sur le goudron gravillonné remplit l’espace comme un affront. Il essaya de se faire léger. Il rejoignit l’herbe avec soulagement. Comme tout promeneur au bord de l’eau, il eut envie de lancer une pierre mais il pensa aussitôt que le lac se briserait comme un miroir. Ce silence incroyable n’était que la peur terrible du lieu, que le souffle retenu de chaque plante devant l’ennemi absolu. Il imagina autour de lui des regards inquiets. Il s’assit délicatement sur une grosse roche lisse et ronde, caressant doucement le poli de la pierre. Devant lui, la surface immobile de l’eau. Une image arrêtée, un plan fixe suspendu dans le temps. Une paix indéfinissable.
Un sanctuaire. Les hommes s’étaient égarés en donnant ce rôle suprême à leurs dieux et à leurs églises. Oubliant que tout était là devant leurs yeux salis. On apprenait aux enfants à respecter un crucifix et on les laissait cueillir des fleurs. Mais sur chaque fleur arrachée, le grand corps de la nature était cloué. Et personne ne le pleurait.
Le silence du monde comme une tristesse, la détresse de la trahison.
Il retourna au fourgon et le rangea le long des arbres. Face au lac. Les mains posées sur le volant.
Le chant solitaire d’un oiseau, dans le secret des branches. Aucune réponse, aucun échange, absence de partenaire. Et pourtant cette ritournelle pétillante, cet amour de la vie. Sans intention. Un bonheur qui déborde.
La chaleur dans son ventre, un sourire qui se dessine, un flot d’émotions qui se déverse, une joie partagée.
Il avait délaissé le bonheur. La vibration dans la poitrine, cet embrasement irraisonné. Il avait associé la vie à des missions assumées, le sens de son existence à des défis achevés, comme si les actes humains offraient à la vie une raison d’être. L’oiseau n’avait pas ces tourments, il chantait simplement.
7h30.
Quand il enleva les rideaux isothermes des vitres, il vit le fourgon vert. Il avait dû arriver pendant la nuit. Il n’avait rien entendu.
Il s’habilla et sortit. Un grand sourire dans l’âme. La température était fraîche mais le bleu limpide du ciel annonçait une belle journée. Il avança vers le lac. L’eau qui se reflétait dans la passivité immobile du ciel n’esquissait aucun mouvement. Les couleurs, selon l’intensité de la lumière, éclataient de jaune ou sombraient dans le vert. Les parties terreuses et les zones rocheuses qui tapissaient les fonds dispensaient à la surface les teintes qui leur convenaient."
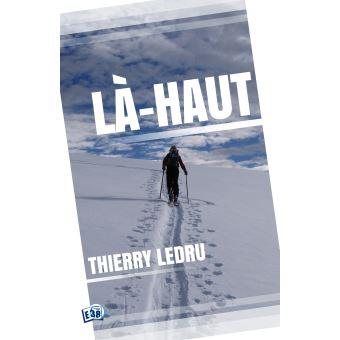
"Il a vu dans les yeux de Maud la montée des larmes. Ce sourire comme un paravent fragile. Il espère que là-bas, à Chamonix, avec Mathieu, le goût du bonheur lui reviendra, que le travail à la mairie étouffera les douleurs. À ses côtés, la joie est ignoble. Indécente. Un peu d’apaisement, à la rigueur. Mais pas davantage. Maud devait en sortir. La vie est si longue à reverdir. Il ne pourrait même pas dire si le rire renaîtra un jour et, si cela se fait, combien de temps ça prendra. Il ne voulait pas lui imposer cette attente.
La voiture a disparu. Il tourne lentement sur lui-même et balaie le paysage. Hameau de Beauvoir. Huit cents mètres d’altitude. Une route unique, étroite, qui par-delà les alpages se poursuit dans les forêts en simples pistes forestières empruntées par les bûcherons, les chasseurs, les cueilleurs de champignons ou les amoureux de la marche. Là-bas, tout au fond de la vallée, Chambéry étend ses constructions et ses brouillards opaques. Le vert sombre des pentes boisées redonne heureusement aux horizons des couleurs de vie puissante. La neige est en attente. Les nuages se remplissent, construisent en silence des avalanches floconneuses. Demain, le paysage sera transformé. Magie des montagnes qui s’habillent chaque saison des couleurs de leurs complices. La neige, douce et cristalline, offrira à la terre cet écrin de pureté où il a toujours aimé plonger. Le silence, alors, sera la note parfaite, celle de l’âme qui se repose dans l’immobilité immaculée. Il entend déjà ce silence. Il s’en est si souvent nourri. Il est en lui à tout jamais. Et il l’attend avec impatience. Pour s’y enfoncer encore plus profondément.
Il n’est pas assez habillé pour patienter dehors. Il retourne vers le chalet. Il aime cette maison. Son isolement et son architecture. Les troncs entiers qui font la structure, les baies vitrées mangeuses de lumières, le grand poêle à bois au milieu de la pièce principale, le plancher et toutes les boiseries, l’escalier en chêne, les lambris colorés, tous ces arbres transformés qui se parlent de forêts communes, qui exhalent des parfums de résine et de feuilles mordorées, s’échangent des secrets de racines, des légendes oubliées. Enfant, il aimait dormir dans un placard traversé par une poutre maîtresse. Il écoutait les chuchotements du bois, les fibres qui se racontent les saisons qui passent. Il caressait les nœuds apparents comme autant d’êtres vivants, leur demandait pardon et leur expliquait le pourquoi de leur présence.
Le chalet est de plain-pied. Pas d’escalier. Dans la région, c’est suffisamment rare pour l’avoir immédiatement enthousiasmé. Pas de cave, mais un très grand garage et l’abri pour le bois de chauffage. Un jardin très simple entoure la maison. Quelques résineux et de l’herbe. Une haie de lauriers ceinture l’ensemble.
Il entre dans le couloir et prend une veste dans la penderie. Il retourne dans le garage par une porte communicante. Il s’assoit sur un tabouret et entreprend d’enfiler une paire de bottes fourrées. Le système de laçage, très bas, a la particularité de permettre une large ouverture. Une solide bande velcro referme la partie haute. Il ne peut plus porter les chaussures qui lui plaisent, mais uniquement celles qui conviennent aux réglages de sa prothèse. Il sort.
L’air froid semble hypnotisé par la puissance des nuages qui s’accumulent. Rien ne bouge, le vent s’est enfui. Le ciel pourtant se charge continuellement de nouvelles masses sombres. C’est comme une marée opaque qui n’en finit pas de gonfler, un océan céleste qui laisserait suinter de ses profondeurs abyssales des noirceurs épaisses. Il regarde l’horizon comblé et sait qu’avant la nuit il neigera. Ce moment magique où l’humidité accrochée au vide s’abandonne à la chute et se déverse en trombes ou en bruines, en giboulées ou en neige. L’esquisse d’un sourire se dessine sur ses joues. Il n’a jamais vraiment observé le monde. Il projetait dans les horizons des intentions renouvelées, des désirs aveuglants, des projets flamboyants. Les paravents sont tombés. Ses regards sont plus larges.
Il traverse lentement le terre-plein gravillonné et se dirige vers la route. À l’angle de l’entrée, marquée par une barrière glissée sur un rail, un sapin semble monter la garde. Le tronc est déjà épais. La tête le domine. Sur le côté droit, il distingue une marque, une empreinte dans l’écorce, un trou dans l’étagement des branches. Il s’approche. Il y a longtemps, dans la jeunesse de l’arbre, une branche a été brisée. Tempête, poids de la neige ? La cicatrice est propre. C’est une tache jaune couverte de résine séchée. Il passe un doigt sur les fibres noueuses et respire le parfum puissant. Autour de la plaie refermée, les autres branches se sont espacées. À cet endroit, l’objectif de la guérison concentrait l’énergie de l’arbre. Refermer la plaie, éviter les infections et l’extension du mal, ne pas ralentir la croissance du tronc, guérir, mais ne pas se focaliser sur la perte d’un membre… Il s’amuse de la comparaison et se dit que sa tendance à l’anthropomorphisme est décidément exagérée.
« Frère de malheur », lance-t-il au sapin, avec un sourire triste et un salut de la main.
Il sort du jardin et s’engage sur la route. Le ruban de goudron est ancien, craquelé, délavé et les bas-côtés sont abandonnés aux herbes. Il a acheté une carte du secteur et a repéré une piste qui se dirige vers le col de Claran. Il aime bien ce nom. Sans trop savoir pourquoi. La ressemblance avec « clarté » peut-être. Il ne cherche pas davantage et commence à monter. Le chalet est le dernier du hameau, le plus haut et le plus isolé. Il sait qu’il a peu de risques de rencontrer du monde. Il n’a pas envie de parler ni même de croiser un regard. C’est le monde qui l’apaise, pas les humains. En cinq mois, il a côtoyé tant de personnes que les visages sont déjà mêlés les uns aux autres. C’est une glu poisseuse dont il veut s’extirper. Trop d’efforts à maintenir, d’ambiguïtés à éclaircir, trop de regards fuyants à oublier, de non-dits à deviner, trop de faux-semblants à déchiffrer, de compassions forcées à vomir… Trop d’humains à supporter.
Il marche. La montagne exhale des silences qui le revigorent. Il pose sa respiration sur le rythme de ses pas. La mélodie qui s’installe l’hypnotise et vide son esprit des tourments habituels. La brûlure de ses muscles a toujours éteint les incendies de son âme. Enfant, il aimait marcher dans les pas de Walter et écouter dans son corps la vie qui bouillonne. Il n’y mettait pas de nom, ne savait rien expliquer, c’était une joie immédiate, puissante, la remontée de forces profondes. Il trouvait dans le monde le terrain idéal pour user cette énergie qui l’étourdissait parfois, et suivre Walter représentait le premier objectif de son existence. Il se construisait sur ce repère. Le monde n’était qu’un exutoire. Walter disparu, il avait longtemps erré, abattu. L’effacement du modèle ne lui avait laissé que sa propre silhouette, juste une esquisse fragile qui ne savait plus comment se remplir.
Le monde, alors, avait pris le relais. Juste le monde. Et lui-même. C’est son image qu’il avait cherché à rattraper, à affiner, à établir solidement, à étendre surtout vers une connaissance toujours plus fine et profonde. Le monde était devenu le complice. Et le guide.
Peu à peu, avec les heures douloureuses des souvenirs ressassés, la passion de la montagne s’était nourrie de sa soif de vengeance. Elle en était même devenue la source de toutes ses forces. Dominer les sommets, atteindre des pointes reculées, escalader des parois aussi lisses que le bleu du ciel, c’était redonner vie à Walter, c’était marquer la montagne de l’empreinte de la famille, le fils usant des enseignements du père pour progresser et se dresser sur les plus hauts sommets. Ils étaient deux à grimper. Il n’avait plus voulu de compagnon de cordée. Walter l’accompagnait."

"TOUS, SAUF ELLE"
Dans ce roman, achevé mais non publié, j'ai poussé la réflexion à son extrême. Ce lieu représente tout ce qu'on cherche à atteindre.
CHAPITRE 39
Deux semaines qu’elle vivait à la ferme. Vibrait en elle la certitude qu’elle n’en partirait plus. L’intensité des jours passés et le bonheur de l’instant la comblaient au-delà du possible.
Toutes les émotions s’agitaient follement dans un maelstrom intemporel de souvenirs intenses.
La ferme de Théo. Un choc immense.
Il était venu la chercher. Le vendredi midi après un passage obligé à la brigade. Elle avait emporté des affaires pour plusieurs jours.
La première fois qu'elle abandonnait le foulard sur ses cheveux. Comme un rituel de passage, une autre vie, l'abandon des souvenirs. Une chevelure renaissante que Théo avait caressée tendrement.
Elle avait aimé le frisson dans son crâne, dans sa colonne, dans son ventre, elle avait fermé les yeux en posant la tête sur l'épaule de l'homme qui l'aimait.
L'homme qui l'aimait... Le cheminement de la vie était totalement imprévisible. L'idée lui fit ressentir une sorte d'étouffement, une onde de choc très profonde, comme un séisme à peine contenu. L'anticipation relevait-elle d'une illusion totale ? Là, maintenant, au regard de ce qu'elle avait connu ces derniers mois, pouvait-elle établir clairement et indubitablement la suite de son parcours ? Elle faillit en rire tellement l'idée était absurde. Elle pouvait imaginer une suite mais aucunement l'affirmer. Rien de ce qui était écrit en elle n'était accessible . La vie irait là où elle a besoin d'aller.
La conclusion l'avait apaisée et elle avait levé les yeux vers ceux de Théo.
« Je ne sais pas où la vie en moi souhaite aller et je ne demande pas à le savoir puisque l'instant contient tout ce qui me réjouit. »
Il n'avait rien répondu. Il l'avait embrassée.
Ils s’étaient arrêtés à la ferme des Balthuzar, le couple de retraités. Raymond et Yolande leur avait offert une bolée de jus de pommes.
« C’est du fait maison, ma jolie dame, » avait lancé joyeusement le vieil homme, en l’invitant à emporter la bouteille.
Elle l’avait remercié et Mme Balthuzar avait ajouté un panier de légumes.
« Ceux-là aussi, c’est du fait maison, que du bio, pour vous les jeunes. »
Ils avaient eu du mal à quitter le couple, l’un ou l’une, relançant inlassablement les discussions.
« Ils ne voient plus grand monde, avait expliqué Théo, en roulant sur la piste. Leurs deux filles ont quitté la région, mariées avec des gars des villes. La ferme leur reviendra à la mort des parents et ils la vendront le plus vite possible pour se partager le pognon, expliqua Théo. Et c’est pitoyable. »
Cinq cents mètres de piste en terre, de nombreuses ornières, des roches calcaires qu’il fallait éviter, puis la traversée d’un pré suivi d’un sous-bois de hêtres et de bouleaux.
« Et en hiver ? demanda-t-elle.
–Raymond a un tracteur avec une lame, ça fait déneigeuse quand ça tombe fort mais ça devient très rare. Je ne veux surtout pas améliorer la piste. C’est le garant de ma tranquillité. Et de toute façon, avec le réchauffement climatique, l’enneigement est de plus en plus faible.
–Je comprends mieux l’utilité d’un 4X4.
–L’avantage des vieux Toyota comme celui-là, lança-t-il en tapotant amicalement le tableau de bord, c’est l’absence d’électronique et je n’en veux surtout pas. Ensuite, ce sont des moteurs indestructibles et une mécanique assez simple.
–Pourquoi tu ne veux pas d’électronique ? C’est juste pour ne pas suivre la mode ou autre chose ?
–C’est très fragile l’électronique. Et le jour où toute l’électronique sera hors service, il n’y aura que des vieilles caisses rustiques qui pourront rouler. Une bombe à impulsion magnétique et plus rien ne fonctionne. Je t’en parlerai. Et je te montrerai les dégâts aussi de l'exploitation des terres rares dont l'industrie électronique se sert. Je ne veux pas participer à ça, en tout cas le moins possible et pas dans ma bagnole. »
Elle aimait l’écouter et elle se réjouissait de toutes les discussions qu’ils avaient eues en quelques jours tout autant que celles à venir. Elle aimait son calme tout autant que sa détermination, elle aimait ses secrets tout autant que les révélations sur lui-même, l’écartement progressif des rideaux intérieurs.
L’arrivée à la ferme. Tout était là, gravé dans sa mémoire. De ces instants de vie qui se logent au plus profond des fibres. Elle pouvait en revivre chaque minute comme un film qui tourne en boucle. Comme un instant présent dans un passé ineffaçable.
Le véhicule avait franchi le seuil d’un plateau. Un horizon découvert jusqu’à la lisière d’une forêt dense.
À quelques centaines de mètres, droit devant, elle aperçut les bâtiments.
Un pré encadré de bois, deux blocs rocheux monumentaux, cinq ou six mètres de haut, posés comme des sentinelles, une longue ceinture de barrières horizontales clouées sur des pieux massifs enserrant le terrain sans qu’elle n’en distingue intégralement l’étendue.
Elle scruta le corps de ferme. Elle y vit comme un fortin et ne parvint pas clairement à identifier une raison précise. Elle ressentit un ensemble énergétique, une aura qui semblait envelopper l'espace.
Elle entrait dans un lieu particulier et elle aima le frisson le long de sa colonne.
Théo arrêta le véhicule devant une barrière métallique posée sur deux poteaux en acier blanc. Il prit une clé dans le vide-poche et descendit. Il ouvrit un cadenas pour libérer une lourde chaîne puis il souleva le long tube fixé à un pivot. Il déposa la barre, reprit le volant et avança de quelques mètres.
Il s’arrêta de nouveau et referma l’entrée.
Elle pensa au franchissement d’un pont-levis.
Il roula jusqu’au seuil du bâtiment d’habitation.
Elle put alors en détailler l’architecture : une bâtisse en pierre, trapue, le corps soudé au sol, sur un seul niveau, le toit en lauzes, partiellement couvert de panneaux solaires. Une longère parfaitement entretenue, soignée, une rudesse ancestrale. Volets fermés, une cour gravillonnée en façade, trois grands troncs évidés, posés en ligne sur des socles en béton et garnis de plantes. Ils semblaient interdire l’entrée du lieu, comme trois gardiens empêchant l’avancée de véhicules ennemis.
Une grange fermée par deux lourds battants en bois massif se tenait sur le flanc ouest, un soubassement en grosses pierres brutes surmontées d’un bardage vertical, des planches couvertes d’une lasure sombre et parfaitement jointes. Un toit de tôles grises et un châssis supportant d’autres panneaux solaires. « Un hangar pour son matériel », avait-elle pensé. Elle nota également la présence d’une antenne très haute, bardée d’éléments horizontaux. Rien à voir avec une parabole. Plutôt l’installation caractéristique d’un radio amateur.
Une extension en pierre occupait le flanc est, comme un appartement contigu à l’habitation principale.
En arrière-plan, à une dizaine de mètres de la maison, elle devina un potager fermé par des filets tendus sur des pieux, à l’abri des sangliers, biches et chevreuils qui devaient fréquenter les lieux.
L’ensemble dégageait une force étrange, comme une obstination, un ancrage buté et indestructible. Une citadelle ou un fortin, c’était vraiment ça. Le positionnement des trois bâtiments constituait une muraille, elle imagina un convoi de chariots de cow-boys face à l’attaque des Indiens. Elle s’amusa de l’image enfantine. Elle aurait pu s’émerveiller des couleurs, de la lumière, de cette merveilleuse végétation, des panoramas magnifiques devant elle mais plus puissante que la beauté du lieu s’imposait cette idée qu’elle entrait dans un territoire réservé, une enclave militaire.
Rien de fragile, rien de vulnérable, chaque élément ayant été pensé, étudié, érigé, renforcé de toutes parts avec une volonté indéfectible. Voilà ce qu’elle ressentait.
Théo.
L’impression que l’homme devant elle se dénudait intégralement. Corps et âme.
Elle repensa à ce moment émouvant où elle avait serré sa main dans le parc de l’hôpital. Comme un territoire impénétrable en lui, un mystère qu’il avait pourtant eu envie de lui révéler.
Elle comprenait maintenant.
Elle entrait dans son secret.
Théo avait contourné la voiture, il avait ouvert la porte puis il lui avait pris la main.
« Bienvenue à la ferme, plus communément appelée dans ma tête, le désert des Tartares. »
Elle l’avait regardé, intriguée puis elle était descendue.
« C’est un film, ça, je crois bien.
–C’est surtout un roman de Dino Buzzati.
–Ils attendent dans une forteresse un ennemi qui n’arrive jamais, c’est ça ?
–Exactement. »
Elle le regarda déverrouiller deux serrures massives à la porte d’entrée, il en ouvrit grand le battant puis il l’invita d’un geste de la main.
Elle le suivit dans l’ombre de la pièce, le corps enveloppé par le rai de lumière dans son dos. Elle aima aussitôt l’odeur si particulière de ces maisons qui ont protégé des chapelets de vies humaines."
-
LE DÉSERT DES BARBARES (2)
- Par Thierry LEDRU
- Le 21/08/2019
C'est Nathalie qui m'avait encouragé à écrire un polar. Je n'avais aucune idée de tout ce que allait déclencher et du foisonnement d'idées qui allait jaillir en écrivant le premier tome.
L'avidité et l'absence de morale qui en découle, les effets mortifères sur les individus dans le tome 1.
Il fallait que j'élargisse la réflexion.
Les effets dévastateurs sur la planète, sur la vie elle-même. L'ego, comme un moi souverain, enfermé dans une vision limitée, "moi au-dedans, le reste au-dehors"...
Tous s'est mis en place peu à peu. Le tome 2 a pris forme. "TOUS, SAUF ELLE"
Puis est venu "LE DÉSERT DES BARBARES"
L'idée fondamentale est très simple : Comment réagiront les puissants de ce monde lorsqu'ils prendront conscience que leur existence est aussi menacée que celle de l'ensemble de l'humanité ?
Au final, la réponse qui s'est imposée m'effraie au plus haut point et me semble parfaitement plausible.
"LE DESERT DES BARBARES"
CHAPITRE 61
Laure était sortie marcher. Elle avait juste besoin d'entrer dans le silence de la forêt. La chaleur du jour avait mis longtemps à se retirer et la nuit ne parvenait toujours pas à diffuser la fraîcheur espérée. Elle était allée s'asseoir sur un tronc couché, un ancien hêtre déraciné depuis longtemps. Le fût avait séché, posé sur un lit de roches. Elle aimait la douceur du corps blanchi par le temps.
Théo dormait. Il récupérait bien plus rapidement que les prévisions médicales. Chaque jour, depuis son retour à la ferme, elle s'était appliquée à chercher la résonance en appliquant les mains sur sa jambe.
Elle lui avait lu le mail de Tim.
Ils en avaient beaucoup parlé.
Elle refusait de croire que le désastre n'offrait aucune issue. L'idée tournait en boucle.
Elle avait longuement cherché le paramètre indispensable pour maintenir vivante l'éventualité d'un possible renouveau et la solution lui était venue, comme une évidence, après avoir rejeté toutes les autres idées qui se succédaient et ne menaient à rien.
Les yeux dans le vague.
« Il faudra beaucoup d'amour. »
Elle répéta intérieurement la supplique, comme une rengaine salvatrice, avec en arrière-plan les images chaotiques de la fin d'un monde.
« Il faudra beaucoup d'amour... Il faudra beaucoup d'amour... Il faudra beaucoup d'amour... »
-
LES HEROS SONT TOUS MORTS : En deçà de la réalité.
- Par Thierry LEDRU
- Le 05/05/2019

Oui, bon, je sais, c'est sordide mais ça m'amène à penser à cette réflexion d'un lecteur des "héros sont tous morts" qui trouvait que l'enchaînement des cadavres et les conditions dans lesquelles ils passaient de vie à trépas étaient quelque peu "inhabituelles".
Sauf que j'ai lu les "faits divers" pendant plusieurs mois avant de me lancer dans cette écriture et qu'à un moment, j'ai arrêté de compiler les documents tellement ça finissait par puer la mort dans mon ordinateur.
Dans le registre des capacités humaines, on est toujours en deçà du possible.
« Toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours au-dessous de la vérité. »
Balzac
Le cadavre d’une femme a été découvert lundi sur l’Oise, à hauteur de Neuville-sur-Oise Fin mars, un batelier avait repéré une valise qui flottait dans l'Oise. Dedans, le corps d'une femme. Il s'agit d'une consultante scientifique franco-américaine âgée de 53 ans.
Par MT/AFP
La femme retrouvée morte fin mars dans une valise qui flottait dans l'Oise était une consultante scientifique franco-américaine âgée de 53 ans, selon une source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien.
Le corps de cette femme avait été découvert dans un bon état de conservation le 23 mars, dans une valise repérée par un batelier à hauteur de Neuville-sur-Oise (Val-d'Oise).
La victime était de nationalité franco-américaine et travaillait comme consultante en communication et développement dans le domaine de la "biotechnologie" et des "industries de la beauté", selon son site internet et le site Expertes France, qui recense les femmes expertes dans différents secteurs.Causes de la mort inconnues
Les causes de sa mort ne sont pas connues pour l'heure. "Les investigations médico-légales sont encore en cours", a indiqué à l'AFPle parquet de Pontoise.
Sa disparition avait été signalée à Puteaux (Haut-de-Seine), quelques jours avant que son corps ne soit retrouvé.
EXTRAIT : "C’était sûrement de l’argent sale. Qu’est-ce que ce gars faisait là-haut avec une telle fortune ? Il n’avait vraiment pas l’allure d’un truand. Rien ne collait. De quoi avait-il eu peur ? Des tueurs aux trousses du chasseur, il les aurait vus. C’était incompréhensible. S’il cherchait à planquer du pognon, ça n’était pas vraiment une cachette idéale. Et pourquoi trimballer ça dans une mallette en cuir ? Un mec en montagne aurait dû avoir un sac à dos. À moins que… Il venait peut-être de la trouver, elle n’était pas à lui, il a eu peur en étant surpris, il a paniqué. Bon, et bien, si ça n’était pas à lui, à qui appartenait-elle ? Peut-être que des mecs pas nets la cherchaient cette foutue mallette. Il ne fallait pas descendre comme un bourrin. Rester très prudent. En mode « alerte ». Son préféré.
Réfléchir…
Il ne dirait rien à Lucie, elle aurait sûrement peur et c’était le meilleur moyen pour qu’elle dise une connerie. C’était déjà compliqué pour lui. Il ne pouvait pas prendre ce risque.
Il s’aperçut subitement qu’il ne lui était jamais venu à l’idée d’aller poser la mallette au commissariat.
L’idée l’arrêta net, comme un mur intérieur contre lequel il venait de buter.
Il avait décidé d’emblée qu’il garderait tout, sans le moindre doute, sans même y réfléchir, ça s’était imposé à lui, comme s’il n’avait jamais éprouvé la moindre morale. C’était certainement de l’argent sale, il avait tué un gars, il l’avait cramé, et rien, aucune pensée, aucun trouble ne s’étaient immiscés... Il en fut considérablement surpris. Il était devenu lieutenant de police par amour de la loi, pour combattre les voleurs, pour protéger les citoyens, pour être utile et parce qu’il aimait l’adrénaline et les armes. Et là, en l’espace d’une seconde, sans la moindre interrogation, il avait décidé de balayer tout ça comme de la poussière. Et de basculer de l’autre côté. Il avait déjà abattu deux gars dans sa carrière. Légitime défense. Mais c’était dans le cadre de son boulot et il n’avait rien caché. Il n’y avait même pas eu d’enquête. Le témoignage de ses collègues avait suffi. Mais lui, ça l’avait bien brassé. Le deuxième, tout autant que le premier.
Et là. Rien. Absolument rien. Il se foutait totalement de ce gars et ne pensait qu’à la fortune qu’il tenait.
C’était donc ça la folie des truands. L’argent balayait tout.
Il ne se pensait pas aussi faillible. Il était comme eux. À partir de quelle somme basculait-on ? À partir de quel rêve devenions-nous des truands ? La morale ne concernait peut-être que les gens sans espoir, les gens soumis, les gens éteints. Et lui se sentait brûler d'une euphorie diabolique. Et c'était délicieux.
Il entendit des sirènes monter de la vallée. Droit vers lui. Plusieurs véhicules. Gendarmerie. Puis un véhicule de pompiers. Il pensa que le chalet en feu avait dû se voir depuis la ville. Il continua à descendre sous le couvert des arbres. À l’écart du sentier. Un coureur en montagne avec une mallette en cuir, le moindre promeneur s’en souviendrait immanquablement. Personne ne devait le voir.
À cent mètres du parking. Des portes qui claquent, des appels de voix, des moteurs. Il chercha un angle de vue sous le couvert des arbres, juste de quoi se faire une idée.
Non, ça n’était pas le chalet en feu qui avait déclenché un tel raffut. Une certitude. Les pompiers ne seraient pas montés dans cette impasse. Aucun moyen d’accéder aux pentes supérieures. Il vit les deux véhicules arrêtés, les bandes de rubalise encadrant la scène, les gendarmes délimitant la zone, des photographes en action, toute la procédure enclenchée.
Scène de crime.
Le chasseur.
Putain, dans quel bordel il avait mis les pieds ! Toutes les suppositions déboulèrent dans son crâne, toutes les décisions à prendre, toutes les précautions à établir.
Il vit des draps blancs sur des corps. Le chasseur les aurait butés, il aurait pris la mallette, il serait monté se planquer là-haut ? Mais pourquoi ? Quel intérêt ?
Deux collègues en service qui discutaient. Fabien et Mathieu. Deux bons. Demain, il aurait un compte-rendu détaillé. Ce soir, peut-être. Ils souhaiteraient certainement lui parler de l’affaire.
Il devait rentrer. Planquer la mallette. Et reprendre une vie normale, participer à l’enquête. Il comprendrait peut-être l’énigme. Est-ce que le chasseur avait tué ces gars ? Il ne parvenait pas à distinguer toute la scène. Combien y avait-il de morts ? Pourquoi ensuite serait-il monté là-haut ? C’était n’importe quoi. Si c’était pour se planquer, l’idée était pourrie. Vu la merguez carbonisée que ça devait être maintenant, le chasseur ne le contredirait pas. Peut-être un idiot, le crétin du village, un ivrogne, un viandard qui tire sur tout ce qui bouge, un amoureux de cette cabane, un refuge habituel. Peut-être aussi que tout ce pognon l’avait rendu dingue.
Il quitta sa planque, remonta pendant cent mètres et traversa en diagonale pour s’éloigner des lieux. Il croisa le chemin des muletiers et entama une descente hors sentier. La cheville le lançait, il devrait trouver une excuse s’il ne pouvait s’empêcher de boiter devant les collègues. Surtout pas une course dans le coin. Raconter une sortie dans le Vercors, par exemple. Loin de la vallée. Ses collègues savaient de toute façon qu’il avait l’habitude de partir seul. Il n’aurait pas eu de témoin et ça ne surprendrait personne.
Rejoindre la voiture par les bois, ne jamais sortir à découvert, attendre que les deux amoureux béats s’en aillent, foncer jusqu’au break, les clés dans la main, ouvrir et cacher la mallette sous sa veste de montagne. Il s’accorda cinq minutes de pause. Les yeux fermés. Il se félicita de n’être pas parti de la maison en courant. Il ne s’était pas vraiment expliqué cette inhabituelle entame. Les deux kilomètres de plat représentaient pourtant un bon échauffement. Encore une étrange intuition, comme si en lui, tout était déjà prévu, comme si les événements à venir coulaient déjà dans ses pensées. Il se surprit à sourire et se sentit invincible.
Il démarra et quitta le parking. Il roula avec une attention accrue. Vraiment pas le moment d’avoir un accrochage. Il réalisa que la pression interne ne le lâchait plus et il comprit soudainement la tension inhérente aux actes illégaux. Cette nervosité chronique qu’il avait souvent ressentie chez les malfrats inexpérimentés… Un qui-vive permanent. La main sur le flingue pour calmer les angoisses. Il se souvenait de ce gars qui baisait uniquement avec son holster, un dingue qui avait déballé toute sa vie de taré pendant la garde à vue. Finalement, c’était tout à fait compréhensible.
Il se gara devant la maison, une allée empierrée, il descendit et ferma les vantaux en bois du portail. Il prit la mallette, l’enveloppa dans la veste et entra par le garage. Porte d’accès à la partie habitable. Il traversa la cuisine en direction du salon. Il voulait se servir un scotch avant de prendre une douche. Réfléchir encore.
Lucie.
Elle était assise dans le canapé. Il s’arrêta. Un coup au ventre, une décharge courut en lui, comme s’il venait de toucher une clôture électrique.
Il posa la mallette sur la table et la couvrit rapidement avec la veste.
« Qu’est-ce que tu fais là ? »
Il se reprocha la dureté de sa voix. Il n’avait rien deviné et ne le supportait pas.
« Je t’attendais. J’ai quelque chose d’important à te dire.
-Tu veux baiser ? lança-t-il sur un ton rieur. Il voulait se reprendre, cacher son inquiétude, ne pas laisser transparaître sa nervosité.
-Non, vraiment pas. Ni ce soir, ni plus jamais. Je te quitte. »
Elle s’était levée, elle avait pris son sac.
Elle posa distinctement les clés sur la table.
Il n’avait rien pressenti. Comme avec Chloé. Les femmes s’obstinaient à l’humilier. Une colère immense, une brûlure qui l’envahit et réveilla la douleur de son front. Comme si la colère était allée se nicher dans un antre fragilisé.
« Qu’est-ce que c’est que ce délire ? C’est parce que je suis allé courir que tu me fais une crise ? J’ai besoin de décompresser, tu le sais bien pourtant !
-Rien à voir. Je sais bien que ton boulot est stressant et que tu lui accordes une place immense. C’est bien ça le problème d’ailleurs. Moi, je ne suis rien qu’un substitut, un produit de remplacement quand tu n’as pas le temps d’aller te vider là-haut. Alors, tu me baises et tu te vides. J’en ai marre de ça, c’est sans espoir. Je ne compte pas pour toi. J’en ai marre que tout soit sali, j’ai besoin d’amour, un véritable amour. »
Il n’avait rien pressenti et c’était insupportable. Bien pire que tout. Comme si les femmes détenaient un pouvoir plus puissant que le sien, comme si, à tout jamais, il ne serait que le dindon de la farce, celui qui ne voit rien venir, qui ne comprend rien, qui ne serait qu’un jouet dans leurs mains. La brûlure dans son crâne s’amplifia. Il savait comment l’éteindre.
Elle n’aimait pas son silence, elle devinait des crispations redoutables. Elle n’avait plus rien à dire. Elle voulut quitter la maison, s’éloigner, ne plus le voir, l’oublier.
Elle ne vit pas le coup venir. Une claque monumentale. Elle tomba au sol et il se rua sur elle.
« T’es qu’une salope, comme toutes les autres, toujours à m’humilier, c’est ça qui te fait jouir, hein, c’est ça ? »
Elle chercha à se redresser mais un coup de pied dans le ventre lui coupa le souffle.
Il hurlait.
« Tu t’es foutue de ma gueule hein, t’en as bien profité, t’as bien caché ton petit manège. Et maintenant, tu me jettes comme une merde. Tu m’as manipulé pour que je ne devine rien.
-Arrête, lâcha-t-elle en se glissant sous la table.
-Sors de là, salope, je vais te montrer ce que ça coûte de te foutre de moi. »
Elle se releva en saisissant la mallette posée à l’extrémité de la table, elle la jeta au sol en courant vers la cuisine. Porte d’entrée inaccessible, il lui barrait la voie.
« Putain, touche pas à ça! »
Il ramassa la mallette avec délicatesse, comme un animal blessé, un objet précieux, une marque de tendresse, un amour absolu. Il la reposa sur la table, respectueusement, et se tourna vers Lucie. Une rage totale. Des affronts qu’il fallait laver.
Elle espérait sortir par la baie vitrée de la cuisine. Il était dans son dos.
Elle saisit le couteau à pain posé sur le buffet américain et le serra contre son ventre.
« Cette fois, tu vas t’en souvenir un bon moment ! » hurla-t-il en se précipitant dans la pièce.