Blog
-
Le moi encapsulé.
- Par Thierry LEDRU
- Le 15/10/2010
Le modèle du moi le plus commun est celui du moi individuel, séparé et distinct du monde. C'est un paradigme extrêmement puissant et tous les schémas de pensées qui en résultent conditionnent notre rapport aux autres et à la Terre.Le philosophe Alan Watts a surnommé cela "l'ego encapsulé de peau" (skin-encapsulated ego), ce qui est à l'intérieur de la peau est moi, ce qui est en dehors d'elle n'est pas moi. Toutes nos expériences, nos perceptions, nos rapports, nos relations sont générées par ce paradigme et nous modelons la réalité en conséquence. Nous transformons en fait la réalité puisque nous n'en percevons que la partie inhérente à cette façon de penser et de vivre. Il est dès lors quasiment impossible dans la cadre d'une vie formatée de sortir de cette enceinte et de s'ouvrir de nouveaux horizons. Nous n'avons même pas conscience qu'il puisse exister une autre réalité, ou plutôt une extension de la réalité.
Le moi existe, il ne s'agit pas de le nier, c'est une réalité mais il n'est pas une entité fermée. Elle a été fermée. Le paradigme le plus développé a pris le pas sur toutes autres formes de perceptions. On peut bien entendu se demander ce qui a poussé l'être humain à une telle diminution de se perception...Un égocentrisme surpuissant peut-être lié à sa fragilité originelle. Le besoin de se sauver au coeur d'une Nature insoumise. Le goût du pouvoir sans doute également. Prendre la place du chef à la place du chef. Et le chef se doit d'être le Maître du monde pour recevoir l'adhésion du groupe. La Nature en devenant l'ennemi à dominer offrait un piédestal à ce goût du pouvoir...Juste des hypothèses bien entendu...On ne peut pas résumer une évolution aussi considérable en deux ou trois idées...
Mais ce qui est essentiel, c'est d'accepter l'idée qu'un paradigme n'est qu'une méta théorie, non pas une "méta réalité". Il n'est qu'une interprétation de cette réalité. Il est donc toujours possible de changer de théorie, il suffit de changer de regard...L'intellect suivra. Et fondera une autre théorie. la théorie n'a pas d'existence propre, elle est créée par un raisonnement. Effaçons le raisonnement ou changeons le et la théorie se transforme, rien n'est figé.
La tectonique des plaques restera à mon sens un des exemples les plus puissants de cette évolution possible. Wegener a commencé par observer, par regarder, par comparer les éléments naturels qu'il trouvait : les fossiles. Et puis il a travaillé sur les cartes de la Terre. Juste des regards à la source et puis les raisonnements qui s'emballaient...Mais les scientifiques de l'époque ne voulaient pas de ce changement de paradigme parce qu'ils auraient dû admettre que leurs théories précédentes étaient fausses, c'était une remise en cause inacceptable. Il s'agissait pourtant de scientifiques mais leurs connaissances paraissaient sérieuses et fondées aux yeux de tous et il ne leur était pas possible, intellectuellement parlant et existentiellement d'admettre une erreur...
L'ego encapsulé. Une force d'inertie redoutable. Le pouvoir ne peut pas tomber de cette façon. C'est insupportable.
Nous sommes sans cesse, générations après générations, dans la même situation. Les scientifiques ont bien évidemment raison puisque toutes les preuves qu'ils ont apportées correspondaient aux recherches qu'ils menaient. On trouve ce qu'on cherche, c'est une évidence. Et puisqu'on l'a trouvé, c'est que c'était juste. Pour trouver autre chose, il faut aller chercher ailleurs. Mais là les scientifiques courent le risque de ne pas être subventionnés, de perdre leur poste, de ne pas voir publier leurs recherches ou de ne même pas obtenir les fonds pour les mener à terme.
Je pense de plus en plus que les recherches scientifiques s'engageront dans des voies différentes lorsque le peuple lui-même mettra en avant les priorités qui l'occupent. C'est de la masse que viendra le changement en haut de la pyramide. Sans doute aussi parce que nos egos encapsulés le sont moins que ceux qui l'ont renforcé au coeur de leur parcours universitaire...
Heureusement, à l'opposé d'un Gilles de Robien, on trouve les Rupert Sheldrake, John Lilly, Jean Marie Pelt, Stanislas Groff, Prigogine, Dabid Bohm, Michael Sabom, Raymond Moody...
-
Un étrange phénomène.
- Par Thierry LEDRU
- Le 23/08/2010
Vu mes activités sportives, il m'arrive parfois de "prendre cher" comme disent mes garçons :)
Ma dernière sortie de vélo, je l'ai faite à fond. Dans une montée assez longue, mes cuisses brûlaient sous le feu d'un chalumeau. Je me suis concentré sur la vitesse affichée par le compteur, tête baissée, lançant parfois de rapides coups d'oeil sur la route. Une concentration que je ne voulais pas quitter, un refus de toutes pensées, juste ce regard fixé sur les chiffres, la nécessité de relancer l'allure à la moindre baisse de régime, l'hésitation des chiffres comme une guillotine suspendue à l'énergie de mon corps, ne pas baisser la vitesse, ne pas baisser la vitesse, la lame au-dessus de la nuque, allez, allez, va en haut, va en haut, à fond, à fond, regarde les chiffres...Et puis toujours ce décrochement de l'attention et ce basculement insensible dans l'absence totale, sans que rien ne le laisse paraître, sans que la moindre alerte ne retentisse, il n'y a plus rien qu'un corps en action mais sans aucune conscience réelle de ce corps, une mécanique vide de pensées.
C'est en passant le sommet de la bosse et en relançant aussitôt l'allure sur le grand plateau que j'ai réalisé que mes jambes ne se plaignaient plus. Mais sitôt cette conscience de la douleur réactivée dans mes pensées, la douleur est revenue...Ca n'était pas la première fois que je réalisais qu'une douleur physique s'amplifiait avec la pensée associée à cette douleur, et que le détachement de l'esprit pouvait au contraire l'effacer...
Comme si cette douleur s'activait par la pensée et s'en nourrissait.
"Les Egarés".
Extrait.
"Aller au bout de l’effort, approcher du noyau d’énergie qui rayonne dans les fibres, sentir palpiter la vie comme un cœur d’étoile, un clignotement infime mais constant, inaltérable, éternel. Se détruire pour vivre. Et entrer en communion avec l’infini. Ses sorties en vélo. Cent kilomètres, cent cinquante, deux cents. Trois cent soixante-quinze. C’était son record. Une journée entière à rouler. Il était parti sans savoir où il allait. Direction plein nord. Le bonheur de rouler. Juste engranger des kilomètres, découvrir des paysages puis la fatigue qui s’installe, plonger en soi et voyager à l’intérieur. Le ronronnement mécanique du dérailleur, la mélodie des respirations, l’euphorie de la vitesse, cette déraison qui le poussait à écraser les pédales, cette folie joyeuse qui consumait les forces, ce courant étrange qu’il sentait dans son corps, cette détermination irréfléchie, juste le besoin inexpliqué de plonger au cœur de ses entrailles, d’en extraire les éléments nutritifs, de les exploiter, jusqu’à la moelle, que chaque particule soit associée à cette découverte des horizons intimes, être en soi comme un aventurier infatigable, un guerrier indomptable, passionné, amoureux, émerveillé, ne jamais ralentir, ne jamais relâcher son étreinte, enlacer ses forces comme un amant respectueux, les honorer, les bénir et sentir le bonheur de la vie, une vie qui lutte, qui se bat, qui s’élève, cette certitude que cette vie ne pouvait pas s’éteindre. La sienne certainement. Mais pas la vie, pas ce souffle qui circulait en lui. Il n’était pas en vie. La vie était en lui. Il n’était qu’un convoyeur. Juste une enveloppe. Elle se servait de lui. Et il la remerciait infiniment de l’avoir choisi. Cette occupation n’était qu’épisodique mais il aurait eu cette chance. Il se devait d’en profiter. Cette palpitation le quitterait un jour. Elle irait voir ailleurs. L’enveloppe qui devient poussière. Et la vie investira une autre capsule, un autre fourreau, un écrin juvénile. L’épuisement le guidait infailliblement vers le cœur lumineux de la vie retranchée. Il finissait par ne plus entendre les voitures, ni les rumeurs des villages traversés, par ne plus percevoir les paysages. Il ne restait que des formes innommées, le parfum âcre de sa sueur. L’oxygène capturé inondant les abîmes affamés. Et le sourire délicat de son âme extasiée, la plénitude infinie de la vie en lui. Les derniers kilomètres. Il avait pleuré de bonheur. Vidé de tout. Les yeux fixant le goudron qui défilait. Les muscles liquéfiés. Incapable de savoir ce qui permettait encore aux jambes de tourner. Vidé de tout. Coupé de sa raison, un mental éteint, une absence corporelle, un état de grâce, l’impression d’être ailleurs, hors de ce corps épuisé, une légèreté sans nom sous la pesanteur immense de la fatigue souveraine, un néant de pensées, juste ce sentiment indéfinissable de la vie magnifiée.
Cette vision étrange d’un cycliste déambulant sur la Terre, il était dans les cieux, un regard plongeant, une élévation inexplicable, les arabesques des routes, les champs, les collines, quelques maisons, et ce garçon écrasant les pédales, ce sourire énigmatique, béatitude de l’épuisement, cet amour immense, cette étreinte spirituelle, il était dans les cieux, une échappée verticale. Comme emporté par les ailes d’un ange."
Cette absence de pensées qui libère de la douleur. Depuis si longtemps déjà que je l'éprouve. Comment est-ce possible ? La pensée est immatérielle, elle ne peut pas avoir d'effet sur un phénomène physique, c'est irrationnel ! Ah, cette fameuse rationalité, la voilà qui refait surface. Mais il faudrait dès lors admettre que le corps et l'esprit n'ont aucun lien, qu'ils sont deux entités distinctes et on voit tout de suite l'absurdité du raisonnement. Pourquoi seraient-ils associés dans une enveloppe matérielle s'ils n'avaient aucun rapport, aucune influence, s'il n'y avait aucune osmose. La Nature aurait pu se simplifier la tache en créant d'un côté des esprits et de l'autre des enveloppes organiques mais lobotomisées.
D'ailleurs la douleur influence nos pensées, pourquoi l'inverse serait-il impossible, pourquoi le courant ne passerait-il que dans un sens ?
Donc, dans cette sortie, j'ai "pris cher" ! Bien cassé le bonhomme. Et même mal à la nuque, une contracture assez pénible toute la soirée. Et c'est là que j'ai repris une expérience déjà éprouvée...Puisque cette douleur n'était pas en moi et que maintenant elle s'y trouve, c'est qu'elle a trouvé une porte d'entrée. Si je reste absorbé par cette douleur, que j'y pense et que je m'en plaigne, cela revient à fermer la porte et à me priver de l'éventualité qu'elle ressorte, comme une mouche qui après avoir tapé contre les vitres finit par retrouver la sortie. Penser à la douleur lui donne une contenance, je vais même finir par m'identifier à elle.
"Je suis mal" au lieu de dire "j'ai mal", ce qui déjà en soi est une erreur.
"Je" n'a pas mal mais une contracture créé une douleur dans un endroit précis de "Je".
"J'ai mal à la nuque" alors ? Non.
"Ma nuque me fait mal" alors ? Non.
"Ma nuque a mal" alors ? Oui.
Et on voit bien que dans notre éducation, cette tournure n'est pas habituelle. Il s'agit pourtant de celle qui établit cette distinction primordiale entre la douleur et le Soi. On pourrait penser qu'il ne s'agit que de jouer sur les mots mais le problème est plus sérieux que ça. C'est un formatage. Le langage créé des phénomènes puissants. Parce qu'il est associé à nos pensées. Et que nos pensées sont associées à notre corps. La boucle est bouclée.
Je me suis donc adressé à la douleur de ma nuque et je lui ai dit que j'avais bien vu qu'elle était venue, que j'avais bien noté sa visite mais que je ne pouvais rien pour elle, qu'il était inutile qu'elle reste bourdonner dans la pièce et que je laisserais la fenêtre ouverte sans m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle décide d'aller voir ailleurs.
C'est ce qu'elle a fait.
Bon, je sais bien qu'elle peut revenir à tout instant, je ne maîtrise pas l'ouverture et la fermeture des fenêtres de façon parfaite et ça n'arrivera sans doute jamais. Je sais juste que les fenêtres existent.
-
"L'expérience de ma vie" : Mahut/Isner
- Par Thierry LEDRU
- Le 29/06/2010
Le match de tennis Mahut-Isner à Wimbledon, 11h de match sur trois jours, 70 à 68 au cinquième set, tous les records pulvérisés mais surtout une attitude extraordinaire des deux hommes et puis cette itw.
http://www.lequipe.fr/Tennis/breves2010/20100629_200600_mahut-l-experience-de-ma-vie.html
En tout humilité je sais de quoi il parle. Cette sensation indéfinissable d'être au meilleur de soi, dans une dimension inconnue et pourtant qui transcende l'individu, c'est là, en nous, et seule quelques expériences, quelques situations particulières parviennent à le mettre à jour.
Merci, merci, merci à ces deux joueurs, à ces deux hommes.
-
Souffrir de soi.
- Par Thierry LEDRU
- Le 01/04/2010
J'aurais pu rester paralysé d'une jambe, de deux, boîter pour le reste de mes jours. Et je marche en montagne, je skie, je tronçonne des stères de bois, je ne sens rien, aucune douleur, j'ai connu des rêves étranges, des auras bleutées qui venaient me parler, "laisse la vie te vivre", des impressions soudaines et inconnues, comme quelqu'un qui poserait son coeur dans le mien, comme un ange en moi, une présence bienveillante et confiante, et cet apaisement des larmes chaudes, celle qui coulent parce qu'il y a trop de bonheur et que ça déborde, qu'on ne sait plus où le mettre, qu'on manque d'expérience.
J'ai vu des matins aux couleurs naissantes qui ruisselaient en moi comme des sèves nourrissantes, je ne les avais jamais reçues, je ne voyais dans ces cieux lactescents que des jeux de lumière, aucun lien, aucune communion, juste un éblouissement passager, oh, comme c'est beau, insignifiant regard humain aveuglé de suffisance, des oeillères rigides commes des accoutumances, je restais en moi au lieu de naître cette fois, délivré de cette enveloppe carcérale, il a fallu que la vie rougeoit en moi comme des tisons qui fourragent, que la douleur jusqu'au bout de mes résistances me conduisent à l'outrage d'une mort espérée, il a fallu que je perde toutes les images de cet individu formaté, lacéré de décharges électriques, liquéfié par le magma des fibres enflammées, nuits et jours, jours et nuits, jusqu'à la disparition du temps, jusqu'à la disparition de tous les repères, plus aucune résistance, plus aucun espoir, plus aucune attente puisque le temps n'existait plus, puisque je n'existais plus, puisque le mental avait lâché prise.
Et j'ai vu l'inconnu un matin, j'ai vécu, j'ai plongé au coeur du monde, pas moi, mais cette vie en moi qui fusionnait, j'ai vu ces particules, ce monde que j'ignorais, cette énergie originelle, j'ai pleuré quand elle a plongé en moi, j'ai pleuré quand je me suis éparpillé en elle. Comme une éjaculation d'atomes, un orgasme primitif.
Et puis, je suis revenu au monde des hommes. Peu à peu. Comme s'il était impossible de rester tendu ainsi dans une érection d'univers.
"Laisse la vie te vivre."
J'ai souffert de moi-même,comme un prisonnier réintégrant sa cellule. J'ai frappé les murs, cherché une fissure, ça n'était pas possible, pourquoi ?
"Laisse la vie te vivre."
J'ai prié pour que ça revienne, c'était injuste, tout ça et plus rien, pourquoi ?
Et puis il a bien fallu que je m'habitue. Ca n'était plus là. Mais la souffrance qui m'accompagnait, je l'entretenais, comme une pénitence, dans le secret des silences mensongers, je me disais bien que cette souffrance "on" viendrait m'en délivrer, encore une fois, sinon à quoi bon tout ce chemin, à quoi bon ces révélations ?
Mais quelles révélations finalement? Je n'y comprenais rien. Ni les médecins. Alors j'ai cherché dans les livres. Il devait bien y avoir des compagnons quelque part. Des voyageurs de l'étrange, de ce qui n'est pas identifié, qui n'a jamais été ausculté, radiographié, de cet insaisissable qui s'était évanoui. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai lu, j'ai écrit...Et je n'ai jamais rien compris. Parce que l'intellect n'a rien à faire dans cette dimension d'univers fusionné.
Comment le mental pourrait-il comprendre ce qu'il ne peut nommer ? C'est comme vouloir écouter une musique qui n'a pas été écrite ? Que pourrait-on jouer ? Mais pourtant la musique existe puisque dans le silence elle résonne en moi. D'où vient-il cet écho infini ? Y a-t-il en nous le bruit de fond de l'univers qui vibre ? Est-ce cela cette musique qui m'éparpille et me reconstruit? Rien à comprendre. Ca n'est pas accessible. Il s'agit juste de le vivre. Téter avidement, goulûment comme un bébé au sein de sa mère. Il n'a pas besoin de comprendre intellectuellement ce qu'il fait.
Je plonge mes yeux dans les yeux de la Terre.
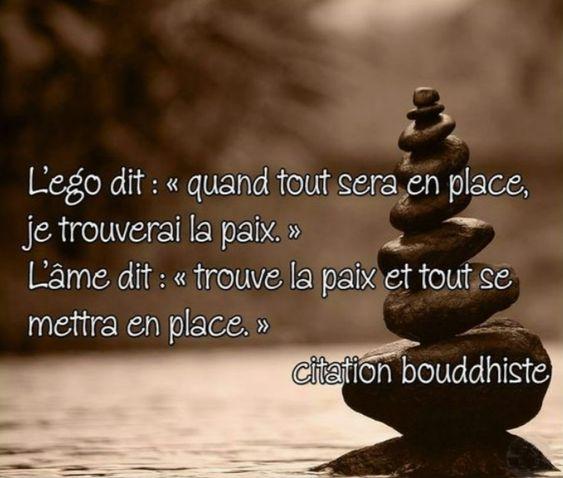
TU N'ES PAS JE.
Qui es-Tu toi qui m'étouffe sous tes certitudes
entassées comme autant de fêlures
Tu as établi ta souveraineté au royaume des altitudes
miasmes enluminés d'infinies convenances,
soumissions passives, perverses accoutumances,
qui es-Tu pour vouloir ainsi me perdre alors que Je t'héberge
Tu as voulu te nourrir des amitiés soudoyées,
honorer les vénérations, les reconnaissances
te gaver sans répit des amours galvaudés,
Tu as cru prendre forme, pâte malléable
abandonnée langoureusement aux caresses versatiles
Tu réclamais ta pitance le cœur éteint
et l'ego malhabile, prêt à t'humilier pour calmer ta faim,
l'euphorie anarchique te servait de remède et
Tu refusais d'écouter en ton sein
vibrer une âme éteinte qui tendait vers sa fin
mais la Vie a trouvé la faille et t'a mené vers le tombeau
nulle crainte pour elle tu n'étais qu'un vaisseau
tu pouvais bien sombrer dans les abysses lointaines
elle était l'Océan, Tu te croyais capitaine
au creux des montagnes mouvantes Tu as eu peur enfin
tes pensées se sont tues et Je suis revenu
de ton corps paralytique ont jailli des lumières
des étreintes amoureuses ruisselant de semence
palpitations d'univers comme autant de naissances
j'ai compris tes douleurs car Tu n'étais plus là
dressé à la barre d'un navire perdu Tu n'avais pas le choix
ta solitude morbide t'emplissait de morve
il fallait que tu craches toutes tes nuisances
pour échapper enfin aux avides noirceurs
Je ne t'en veux pas Tu sais,
Tu as fait ce que Tu croyais juste
le courant était bien trop fort pour toi
Je te tends la main désormais
cette main que tu as toujours donnée aux autres
en ignorant qu'elle était ton bien
il n'y a plus rien à fuir, ni peur à nourrir
Tu as rejoint ton âme et Tu t'y sens bien
laisse -toi porter la Vie sait ce dont elle a besoin
l'Océan n'existe que là où Je me trouve
cesse de regarder les horizons éteints
ils ne sont que chimères et Tu t'épuises pour rien
Je suis là maintenant et Tu peux t'abandonner.Tu es mort pour ton bien.
-
Illumination et réalité.
- Par Thierry LEDRU
- Le 15/02/2010
Je suis la vie en moi. Je suis l'énergie, la beauté de l'ineffable.
Je ne suis pas ma douleur, je ne suis rien de ce que je veux sauver. Je ne suis rien de ce que j'ai été.
Révélation. Illumination.
Il ne reste que l'illumination. Elle est la seule issue. Car lorsqu'il ne reste rien de l'individu conditionné, lorsque tout a été ravagé jusqu'aux fondations, lorsque le mental n'est plus qu'un mourrant qui implore la sentence, lorsque le corps n'a plus aucune résistance, qu'il goûte avec délectation quelques secondes d'absence, cette petite mort pendant laquelle les terminaisons nerveuses s'éteignent, comme par magie, comme si le cerveau lui-même n'en pouvait plus, c'est là que les pensées ne sont plus rien, que le silence intérieur dévoile des horizons ignorés.
S'installe alors peu à peu l'épuisement. Le dégoût de tout devant tant de douleur. Ça n'est qu'une autre forme de pensée, une autre déviance, une résistance derrière laquelle se cache l'attente d'une délivrance, un espoir qui se tait, qui n'ose pas se dire. Une superstition qu'il ne faut pas dévoiler. La colère puis le dégoût, des alternances hallucinantes, des pensées qui s'entrechoquent, des rémissions suivies d'effondrements, rien ne change, aucune évolution spirituelle, juste le délabrement continu des citadelles. Cette impression désespérante, destructrice de tout perdre, de voir s'étendre jour après jour l'étendue des ruines.
Survient alors, parfois, le drame. L'évènement qui fait voler en éclat les certitudes, les attachements, les conditionnements. La douleur physique se lie à la souffrance morale. Les repères sont abolis, les références sont bannies. L'individu sombre dans une détresse sans fond, il en appelle à l'aide, il cherche des solutions extérieures, condamne, maudit, répudie, nie, rejette, conspue, insulte le sort qui s'acharne sur lui alors qu'il est lui-même le bourreau, le virus, le mal incarné. Il a construit consciencieusement les murs de sa geôle et jure qu'il n'est pour rien. Dieu, lui-même, peut devenir l'ennemi juré alors qu'il avait jusque là été totalement ignoré. Tout est bon pour nourrir la révolte.
Etre capable d'expérimenter la réalité telle qu'elle est, sans interférence, sans distorsion, sans apport personnel, dans une complète acceptation, sans projection, sans peur, sans attente, sans espoir, est un état d'illumination. Cela revient à déposer ses charges, ses fardeaux, son passé et toutes les identifications qui s'y sont greffées. Il s'agit des fardeaux d'ordre mental. Ils peuvent bien entendu avoir des répercussions sur le physique. Cette conscience temporelle dont nous disposons peut se retourner contre notre plénitude. Elle installe une charge émotionnelle, majoritairement inconsciente. Pour entrer dans cette acceptation libératrice il est indispensable d'établir la liste de ces fardeaux, de les identifier et de prendre conscience qu'ils ne sont pas ce que nous sommes. Ils sont l'image que nous avons donnée de la vie mais ils ne sont pas la vie. La vie n'est rien d'autre que l'énergie qui vibre en chacun de nous. Elle ne doit pas être salie, alourdie, morcelée par cette vision temporelle à laquelle nous nous attachons.Les pensées que nous avons établies comme l'étendard de notre puissance est un mal qui nous ronge. L'ego y prend forme et se détache dès lors de la conscience de la vie. L'individu se couvre d'oripeaux comme autant de titres suprêmes. Ça n'est que souffrance et dans la reconnaissance que nous y puisons nous créons des murailles carcérales. L'illumination consiste à briser ce carcan. L'individu n'en a pas toujours la force, il manque de lucidité, d'observation, il est perdu dans le florilège d'imbrications sociales, familiales, amoureuses, professionnelles. Il se fie à son mental nourri inlassablement par les hordes de pensées.
Même à un niveau très bas (où je me situe) on prend conscience qu'on n'est pas ses émotions ou ses pensées: elles ne sont que des perturbations, comme les vagues sur la mer qui sont faites d'eau mais ne sont pas l'eau. Elles n'en sont que son mouvement. Et nous, humains, nous considérons bien souvent que notre agitation nous constitue. La société marchande s'est construite et s'entretient sur ce drame existentiel.
Il ne faut pas prendre le mot "illumination" à la lettre, sinon ça fait fort "illuminé."Ces perturbations sont utiles, à condition de les "dompter" et d'en faire un outil, et non pas un maître. Le dépressif, par exemple, s'identifie à ses émotions, il dit "je suis dépressif", alors qu'il devrait se détacher de ses émotions, ne pas s'y identifier, et dire "j'ai une dépression...
L'illumination (la conscience, la vue claire, non perturbée), permettrait de la même façon de se rendre compte de ce qu'est la vraie nature du monde, et donc d'être beaucoup plus réaliste, de savoir mettre chaque chose à sa place, connaître sa raison d'être, etc.
Le corps et l'esprit sont liés, donc agir sur l'un a un effet sur l'autre. Pour moi, ce qu'on considère comme notre esprit est aussi un "corps" de matière plus subtile. Physique, énergétique, émotionnel, pensées... tous des corps, de moins en moins structurés à mesure qu'on va vers les matières plus subtiles. Notre « corps des pensées » est le plus chaotique et indiscipliné.
Tout ce qui a pu m'arriver pendant des années, c'est justement parce que je n'étais pas dans la réalité. Quant à l'irrationnel, ça n'est jamais qu'une dimension qui ne nous est pas accessible, et non quelque chose qui n'existe pas. Mais ce qui n'a pas de nom n'est pas pour autant exclu de la réalité. La dimension que l'on connaît par notre raison, notre logique, nos sens, notre intellect n'est qu'une part de la réalité et elle est bien souvent détournée par notre mental qui déraisonne par son jugement inique.
Notre esprit est comme un verre d'eau boueuse agitée. Les émotions et les pensées anarchiques sont cette agitation. Si on laisse reposer le verre (état de méditation, zen, détachement des émotions), la boue se dépose et l'eau devient claire: on "voit" la vraie nature des choses. La première étape étant justement que nos possessions matérielles et notre corps ne sont pas "nous", et nos émotions non plus (deuxième étape).Il ne s'agit pas de ne pas avoir de rêves, d'attentes, d'espoirs mais de faire en sorte que toutes ces pensées ne soient pas des paravents à la réalité.
Si je parviens par contre à identifier ce qui relève de ma responsabilité, je me dois de tout mettre en oeuvre pour parvenir à mes fins. Imaginons qu'il ait neigé toute la nuit et que j'arrive sur le parking, que j'ouvre le coffre et que je réalise que j'ai oublié de prendre mon ARVA (détecteur de victime d'avalanche) parce que j'avais vu qu'il n'y avait plus de piles, que je suis allé en chercher, que j'ai rencontré un copain, qu'on s'est mis à parler de la neige, du sommet qu'on allait faire, etc, etc... Le rêve et toutes les images afférentes m'ont coupé de la réalité, je me suis laissé embarquer dans des schémas de pensées temporelles alors que je devais rester dans l'instant pour que ce projet se réalise. Et on ne part pas en montagne sans son ARVA... La sortie est fichue. Il se peut même que je décide d'y aller quand même et là, parce que le rêve est le plus fort en moi, je me mets gravement en danger...
Il s'agit en fait pour ma part d'établir clairement et constamment ce qui relève de moi, de ma liberté, et ce qui est extérieur à moi. Si je m'enferme inconsciemment dans des projections mentalisées, je n'ai pas le droit de me plaindre... J'ai "choisi" d'être dépendant de mes rêves. Il faut assumer.
Je vais préparer mon sac, mes skis, un itinéraire, prendre la météo, et si jamais la neige est au rendez-vous, je pourrai en profiter. Je sais pourtant parfaitement que tout cela sera peut-être inutile. Ça ne dépend pas de moi mais en tout cas je serai prêt si ça s'avère possible. Et si ça ne l'est pas, et bien j'irai marcher mais je ne serai pas déçu pour autant. Je ne pourrais être déçu que si je me laisse emporter par un rêve qui me coupe de la réalité.
Le projet est quelque chose qui relève de la volonté de l'individu. Il s'agit de construire des actes par une projection temporelle mais qui s'ancre dans l'instant.
Ces deux exemples expriment quelque chose qui ne relève pas de la volonté de l'individu. Ce ne sont que des extrapolations imaginaires. C'est très infantile en fait et le meilleur moyen d'être déçu. Le désir est très lié à la notion de manque. Ce que l'individu aime dans cette dimension, c'est l'idée qu'il se fait d'une réalité qu'il espère et dès lors, étant donné qu'il se soumet à des paramètres extérieurs à lui, il se place dans une situation de dépendance.
"J'espère qu'il va neiger autant que l'hiver dernier."
"J'espère que demain il va neiger.J'espère que je finirai par oublier les moments douloureux de ma vie."
L'absence d'attente et d'espoir ne signifie absolument pas que l'individu a abandonné ses rêves mais bien au contraire qu'il se trouve dans un état de perception, de réception absolument complet, qu'il n'y a aucune interférence liée à une projection temporelle. L'individu existe dans le présent, dans l'instant, il n'est pas question de laisser les pensées couper l'individu de cette vie immédiate. Je fais une distinction entre l'espoir et le projet. L'espoir est à mon sens une projection des pensées dans une dimension temporelle, futur et même passé. Espérer quelque chose qui relève du passé et qui ne peut être modifié, c'est le comble de l'enchaînement.Jamais là. Jamais dans la réalité. On peut considérer que cet individu là continue à dormir d'ailleurs. Et le cinéma qu'il se fait voile le film de sa vie.
Mais étant donné que mon fonctionnement habituel est de créer sans cesse des tensions liées au désir, je vais pendant la sortie me mettre à regretter que la neige ne soit pas tombée autant que ce que j'espérais, que le vent ait soufflé et qu'il y ait des plaques, qu'elles soient croûtées, que le vent au sommet va nous gâcher le plaisir d'être arrivé, qu'on aurait peut-être dû aller faire une sortie sur un versant sud-est pour que le soleil ait le temps de ramollir la croûte, on aurait eu une descente plus agréable, tiens oui, la semaine prochaine on ira faire une autre pente mieux orientée, j'espère qu'il va reneiger pendant la semaine, j'espère que la météo sera bonne pendant le prochain week-end, j'espère que Blandine pourra venir, j'aimerais bien lui montrer les montagnes mais c'est qui ce gars qui lui tourne autour au boulot, quel con celui-là avec sa BMW, quel prétentieux, et ce vent de fou là-haut ça va être l'enfer, y'a toute la poudre qui est soufflée, pas la pêche moi, pas bien dormi à force de penser à cette météo j'ai les jambes en coton et puis Blandine aussi, comment je vais faire pour lui dire, faut pas que je traîne, deux semaines qu'elle est arrivée et y'a déjà trois gars qui lui tourne autour... etc etc etc etc etc etc etc ...
Imaginons que je sois parti sans mon ARVA parce que mon copain m'a convaincu que le manteau neigeux était suffisamment stable. Je risque pendant une bonne partie de la sortie de me fabriquer des scénarios catastrophe: si je pars dans une coulée, mon ami ne pourra pas me retrouver. Si c'est lui qui part, il a un ARVA mais pas moi et donc je ne pourrai même pas le chercher. Dans un cas, j'y reste et dans l'autre je suis responsable de sa mort...Super sortie...
Continuons la balade de ski de randonnée.Ce que nous croyons être la réalité tangible, concrète est un aspect du monde seulement, un aspect réel certes, mais relatif.
Tout dépend du niveau de conscience auquel on est, la conscience d'un ver de terre n'est pas la conscience d'un chien, qui n'est pas la conscience d'un humain ordinaire, qui n'est pas la conscience d'un Bouddha.
Si nous pouvions percevoir les pensées et la conscience des autres, à nouveau le monde serait très différent.
Si nous avions les organes capables de percevoir le coeur des atomes en mouvement, le monde paraîtrait tellement différent.
Si nous avions des organes de perception semblables à ceux d'une chauve souris ou d'un serpent, nous verrions le monde bien autrement, si nous étions beaucoup plus petits ou beaucoup plus grands encore autrement.
Le matériel, le tangible tel que nous le percevons au travers de notre conditionnement d'humain est une projection du spectateur qui observe le spectacle, lui donne une myriade de noms, comme s'il en était l'inventeur.
La qualité de nos pensées, nos bavardages intérieurs, nos rêves nocturnes, mais aussi notre émotion devant un beau paysage, une musique sublime, l'intensité d'un échange affectif, toute notre vie psychique n'est pas mesurable expérimentalement, scientifiquement, et pourtant, on ne peut pas nier que c'est une part et même une part essentielle de la vie.On peut appeler ça le "sixième sens". On peut lui donner tous les noms qu'on veut. Il n'en reste pas moins que la science n'y comprend rien. Pourtant ça existe. C'est réel.
Walter Bonatti était un alpiniste italien très connu dans le milieu et totalement respecté. Pendant un hiver il avait décidé d'escalader en solitaire la face de la Brenva au Mont Blanc. Il rejoignit au milieu de la face une cordée de grimpeurs italiens, deux guides qu'il connaissait. Le temps était magnifique, glacial, des conditions idéales pour une ascension hivernale, aucun risque objectifs. Pourtant, après avoir dépassé cette cordée d'alpinistes Bonatti se mit à traverser vers une bande de rochers en criant aux deux guides italiens de sortir du couloir dans lequel ils se trouvaient tous les trois. Il n'y avait aucun signe de dangers perceptibles, aucune chute de neige, de coulée, de séracs, rien. Et pourtant Bonatti continuait à hurler aux deux guides de traverser vers les rochers. Ils ne comprirent pas et ne l'écoutèrent pas, ils continuèrent à avancer dans le couloir. Bonatti rejoignit le bord du couloir. Une coulée, partie du sommet, dévala le couloir et emporta les deux guides italiens. Bonatti y réchappa.
Juste un exemple.Dans quelle "réalité" était-il lorsqu'il prit conscience de ce danger imminent ?
Cette perception sensorielle à laquelle nous sommes tellement habitués peut se révéler être un paravent à une perception d'une autre qualité mais qui n'est pas relative à nos cinq sens. Le problème vient du fait qu'elle n'est pas reproductible, qu'elle n'est pas identifiable et que par conséquent elle n'entre pas dans le champ de compétences de la science. Néanmoins il existe de très nombreux phénomènes qui laissent entrevoir une autre "réalité."
La réalité est beaucoup plus la relation que j'ai avec mon environnement, que l'environnement lui même. Il n'existe que parce que j'ai une relation avec lui: je le vois, je le sens, je le rejette ou je l'apprécie. Un objet que je n'ai jamais vu ou dont je n'ai jamais entendu parler n'existe pas. Il existe pour d'autres personnes, mais pas pour moi. L'émotion qui m'a submergée devant un beau coucher de soleil est une réalité, c'est ma VIE, c'est une expérience. Or l'expérience, il est impossible de la partager.
Dès lors que quelqu'un me dit que la réalité est parfaitement identifiée, je vois apparaître une certaine forme d'Inquisition. Au lieu d'avoir à subir une forme théologique de la réalité, on subit aujourd'hui une forme cartésienne. On en est donc toujours à une forme de pouvoir qui nie tout ce qui n'est pas exploitable par la pensée dominante.
Une "réalité" bien dangereuse.
Un médecin à qui je racontais les "rémissions" inexpliquées de mes trois hernies discales m'a certifié que ça n'était pas "réel" étant donné que ça n'était pas scientifiquement explicable ni reproductible. Ça n'était donc qu'une illusion provisoire.Ça m'a d'abord bien fait rire et puis ça m'a considérablement effrayé que la "raison" de ces gens là puisse être aussi étroite et limitée. Effectivement, dans les mains (et le "savoir") de ces gens là, une personne malade n'a que peu de chances de guérir. Ça lui est même interdit si ça sort du cadre officiel.
Nous sommes vraiment à "la fin des certitudes » newtoniennes.
Il arrive parfois qu'une pensée de guérison agisse sur la guérison elle-même. Est-ce que cette pensée a eu un effet "réel" à travers une certaine "réalité" ? Est-ce que ce contenu pourrait être une réalité plus profonde que la réalité tangible, matérielle, évènementielle, palpable, visible ? Est-ce que la pensée de l'individu pourrait transformer d'un point de vue moléculaire et non par auto persuasion un état donné ?
Si cela a un effet dans la matière, c'est que cela existe en soi. Pas possible autrement.
Toricelli a inventé le baromètre grâce auquel il a pu prouver que l'air était une matière. Avant lui, les savants le qualifiaient d'"éther" (terme qui s'est reporté sur une éventuelle matière plus subtile que l'air, actuellement). D'après eux, c'était les arbres et les vagues, qui, en bougeant, créaient le vent !
Alfred Wegener a été conspué lorsqu’il a présenté sa théorie de la tectonique des plaques.
Nous savons pour nous même que nous connaissons des états intérieurs de qualité différente. Des moments de paix et d'harmonie, des moments de compréhension privilégiés. Comment les mesurer ?
Comment mesurer la beauté d'une oeuvre de Beethoven ? Quelle unité de mesure de sa créativité ? Avec quelle "machine" va-t-on mesurer la qualité de l'éveil d'un Bouddha ? La beauté ineffable de la nature ?
La qualité des choses est plus importante que la quantité, ne regarder comme réel que ce qui est mesurable, c'est passer à coté de tout un pan de la réalité.
La science moderne découvre que l'objectivité chère aux scientistes du XIXème siècle n'existe pas. Il y a interaction entre l'observateur et ce qui est observé.
L'acte dans la matière est toujours précédé d'une pensée, c'est la pensée qui est à l'origine de tout.
Dire qu'une pensée n'est pas réelle est un postulat, simplement, rien de plus, un postulat que le bouddhisme réfute totalement puisque au contraire, par la méditation, on découvre que tout vient de la pensée, tout vient du mental, c'est le mental qui conditionne notre vision du monde. -
Krishnamurti : L'unité
- Par Thierry LEDRU
- Le 30/01/2010
"La pensée juste va de pair avec la connaissance de soi. Sans elle, votre pensée n'a aucune base, sans elle, ce que vous pensez n'est pas vrai.
Vous et le monde n'êtes pas deux entités séparées, avec des problèmes distincts. Vos problèmes et ceux du monde ne font qu'un. Vous pouvez être le produit de certaines tendances, de certaines influences liées au milieu, vous n'êtes cependant pas fondamentalement différents les uns des autres. Sur le plan intérieur, nous avons quantité de ressemblances ; nous sommes tous mus par l'avidité, la malveillance, la peur, l'ambition et ainsi de suite. Nos croyances, nos espoirs, nos aspirations ont une base commune. Nous ne faisons qu'un ; nous ne formons qu'une seule et même humanité, en dépit des frontières artificielles de l'économie, de la politique et des préjugés, qui nous divisent. Si vous tuez quelqu'un, c'est vous-même que vous détruisez. Vous êtes le centre de ce tout et si vous ne vous comprenez pas vous-même, vous ne pouvez comprendre la réalité.
Nous avons de cette unité une connaissance intellectuelle, mais nous gardons nos connaissances et nos sentiments dans des compartiments étanches, et voilà pourquoi nous ne faisons jamais l'expérience réelle de cette extraordinaire unité du genre humain."
Krishnamurti. -
LA-HAUT : Plénitude de l'unité
- Par Thierry LEDRU
- Le 20/01/2010
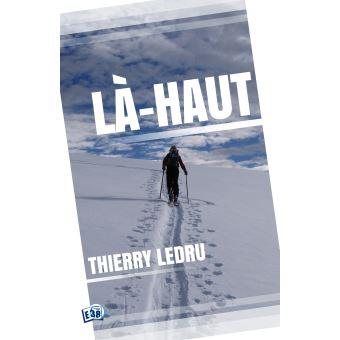
Bonheur de la solitude.
"Il marche.
Avec application.
Un oiseau solitaire chante son bonheur de la vie.
Il s’arrête et l’écoute.
Un sourire. Il est comme cet oiseau invisible. Retiré dans les hauteurs, loin de ses congénères, fidèle à la Terre, il entame à chaque instant de contemplation des hommages respectueux. L’idée le frappe alors. Il n’est pas comme cet oiseau, il est l’oiseau. Et l’oiseau dans son chant se mêle à lui-même. La vie les constitue, elle les anime, elle leur a donné forme. Peu importe que ces deux images les différencient. Elle ne leur ôte pas l’essence commune qui les rassemble. Et puis le doute aussitôt, comme une dualité qui se rappelle, un ancrage qui marque sa résistance. Et l’émotion qui s’efface.
Il comprend alors à quel point tout ce qu’il connaît s’inscrit dans le cadre restreint de ses expériences passées et limite les extensions possibles. Comme s’il était finalement inconcevable que l’homme échappe à ses rôles, aux images constituées par une humanité tyrannique. Il n’avait jamais perçu l’oiseau caché comme une partie de lui-même ou lui-même identique au volatile. Incapable d’exprimer clairement ce qu’il ressent. Son existence passée comme la chute prolongée d’un esprit vers les gouffres insondables de la dispersion, de la soumission, des conditionnements. Aucun retour sur soi. Une accumulation d’activités adulées entraînant l’individu vers un effacement inéluctable. Il s’était vu, parfois, lors de quelques brefs instants d’euphorie, l’élément rebelle face aux idées dominantes de la masse. L’humanité comme le dictateur de chaque élément du troupeau. Mais il n’était jamais parvenu, malgré ses efforts, à identifier clairement le coupable entre les deux protagonistes. Un tourbillon dans l’élaboration chronologique de cette situation. Il avait bien fallu que les humains se multiplient pour créer une humanité. Ils avaient donc bien été maîtres, à leurs débuts, de leur destinée et de leurs choix. A quel moment l’entité, elle-même, de l’humanité avait-elle pris le pouvoir ? Quelles erreurs chaque homme avait-il commises pour finir ainsi par s’égarer et succomber à la dictature de la masse? S’il ne parvenait pas à expliquer que des hommes ayant décidés de s’associer pour former un groupe humain à l’échelle planétaire puissent aujourd’hui souffrir ainsi de leur propre création, il parvenait encore moins à déterminer quelle était l’intelligence, la volonté, l’esprit qui menaient désormais cette humanité déliquescente. Y avait-il une intention, un projet, une structure ?
Ses réflexions ne duraient jamais bien longtemps. La dispersion l’emportait toujours. Les conditions de vie comme une pénitence.
Il sait aujourd’hui que sa jambe disparue n’est que la matérialisation de cet oubli de soi. Il imagine un soldat assurant la garde d’un trésor de nourritures spirituelles. Tenant son attention vers l’extérieur, à l’affût de tout ce que l’agitation des jours lui propose, il en est venu, peu à peu, à oublier la nourriture et le trésor qu’il représente et tout s’est gâté, tout a pris le goût amer de la mort, une partie même y a succombé, insidieusement, en silence, désespéré par l’absence d’écoute et de considération. C’est l’intensité des regards qui créé la beauté. Lui ne se regardait jamais, jamais avec la clairvoyance nécessaire pour que le trésor apparaisse réellement. Il s’est contenté de garder des biens dont il ignorait finalement la vraie richesse dirigeant ses efforts vers des accumulations dérisoires. Ce n’est que dispersion. Il doit désormais remonter ce courant qui entraîne les âmes corrompues vers les abîmes puants de la fange. Pour lui. Pour Blandine. Et pour sa jambe perdue.
Il marche.
La lumière de la petite lampe frontale trace sur la neige vierge un sillage à découvrir. Il avance dans un tunnel mouvant qui se referme dans son dos. Sans la prothèse, il aurait pu se passer de lampe mais il a peur des pièges de la route. Le glissement feutré de ses pas dans la neige souple est une respiration qui accompagne le silence du monde endormi.
Il s’arrête.
Rien ne bouge et le manteau glacé de la neige retient sous ses lourdes épaisseurs le chant des arbres. Les nuages complotent en secret les prochaines floraisons de flocons et cette puissante menace invite les peuples cachés des forêts environnantes à préserver leurs forces.
Rien ne bruit dans le silence immobile.
Un peu gêné de troubler cette quiétude.
Les bâtons pour soulager la poussée des jambes. Les bottes, comme deux étraves têtues, tracent dans le tapis épais un sillon régulier.
Il pense à l’oiseau et à ce sentiment étrange de n’en être plus séparé. Ce désir commun d’honorer par une présence joyeuse la venue du jour les unit. Ce gonflement de la poitrine, cette chaleur qui ruisselle dans les muscles, ces frissonnements d’impatience à l’apparition lente du soleil, ces regards attentionnés vers le monde sont des gestes communs, des émotions partagées. Il se sait physiquement différent de l’oiseau mais la source de vie qui coule en eux est unique.
Dieu. Questionnement inévitable.
Il lui est impossible de concevoir un Dieu semblable aux hommes. Dieu ne saurait être aussi faible, aussi inconstant et aussi futile dans ses actes. De même, il ne parvient pas à imaginer un Dieu invisible, omniprésent, fondateur du Tout, architecte suprême de l’Univers, une volonté unique, un dessein planifié par un Etre supérieur. Entouré de la beauté du monde, il ne peut pas oublier le mal. Et la révélation à lui-même de celui qui a souffert ne peut expliquer ce mal. Car trop d’êtres se sont perdus en cours de route. Quel croyant aurait l’ignominie de dire à un enfant cancéreux, en le regardant dans les yeux, que Dieu a imaginé cette épreuve pour lui donner la chance de se découvrir ? Le bien révélé ne peut servir de justification au mal répété.
Mais l’impression pourtant que ce rejet est généré par des faits extérieurs. Toutes les images inhérentes à ce Dieu. Les hommes l’ont tellement souillé, détourné, approprié. Par orgueil et par détresse. A ses yeux, Dieu reste inexplicable. Toute solution, toute certitude, tout système incluant Dieu n’en est qu’une limitation. Quand l’homme pense à Dieu, il n’est déjà plus sur le chemin de Dieu. Le chant cristallin de l’oiseau l’honorait davantage que toutes les prières dans les églises. Ce chant n’éloignait pas les hommes de la Terre. Il ne fallait pas construire d’églises, ni dessiner toutes ces icônes. La Nature contenait toutes les paroles divines. Ce soin que les hommes accordent à tous les emblèmes fallacieux des religions. Si l’humanité ne peut pas se passer d’explication, si elle a irrémédiablement besoin de comprendre le Mystère qui l’entoure, alors elle doit écouter le murmure du vent, suivre le vol suspendu d’un rapace, marcher tête nue sous la pluie, plonger sans cesse dans le temple de la nature. Elle contient toutes les réponses. Elle est Dieu. Il faut se débarrasser de l’image du vieil homme, de son fils prophète, de la Bible et de tous les autres écrits mensongers. C’est le livre du monde qu’il faut réapprendre à déchiffrer et c’est lui qu’il faut honorer.
Il n’a jamais poussé aussi loin ses idées. Il en a presque chaud. Il entrevoit un chemin nouveau, une démarche intérieure qui rejoint étrangement sa rééducation vers la marche. Encore une fois, et malgré la douleur derrière les mots, il sent monter la joie d’une découverte.
Il éteint la lampe. Le rideau de la nuit se retire et laisse transparaître derrière la ligne courbe de la Terre une clarté montante.
Il sourit.
La sensation qui l’étreint à l’instant lui devient familière. Depuis l’hôpital un mur en lui s’est brisé. Il pense souvent au rêve du dauphin. Il sait désormais qu’ils sont tous les deux un seul et même être et que les profondeurs éteintes sont les reflets de son âme. La première plongée l’avait apaisé. Il avait même souhaité disparaître dans les douceurs abyssales. Mais il en était revenu. Sans connaître la raison. Aujourd’hui, à chaque nuit que le dauphin ressurgit, il sent combien il ne s’agit pas d’un tombeau mais bien davantage d’un puits de lumières sombres… L’absence de repères, de toute clarté tentatrice, de tout prétexte à la dispersion, donne à ce gouffre de nuit le pouvoir de la lumière. C’est ici, dans la noirceur des ténèbres, que tout s’éclaire. Il doit quitter l’agitation des hommes, le dauphin lui a montré la voie. Si dans les tourments du premier rêve, la solitude infinie des lieux l’avait effrayé, il avait pu sentir, peu à peu, dans les douces arabesques du dauphin les promesses des découvertes à venir. Le bonheur indicible de l’eau sur sa peau, la pesanteur liquide du silence, l’abandon de tout devant tant de rien. L’impression de vide qui l’envahit à chaque plongée. D’approcher ainsi la mort arrache les carapaces. Les moules massivement reproduits au fil des années. Imaginant cela, il entrevoit la coque vide s’emplir de salissures. Et l’être pur se gaver follement de nourritures immondes.
Il ne saurait, pour l’instant, en dire davantage. Les sensations du dauphin ne sont pas exprimables. Et de toute façon, il ne souhaite en parler à personne. Pour en dire quoi ? Et dans quel but ? Les échanges humains sont des accumulations de vides, des dispersions organisées dans le seul dessein de combler l’angoisse du néant. Du vide pour emplir le néant… Dérision quotidienne… Seule Blandine savait donner aux mots une substance délicieuse. A ses côtés, il n’éprouvait jamais la litanie dérisoire des discussions narcissiques.
Elle parlait pour l’écouter, il lui répondait pour l’entendre.
Il n’en dira rien. A personne. Même à Maud. Il ne veut pas l’inquiéter. Il sait qu’elle ne verrait qu’une souffrance dans l’étrangeté de ces mots, que la détresse d’une solitude qu’elle redoute. Elle n’entendrait que la matérialisation de toutes ses craintes. Elle ne peut pas le comprendre. Elle ne souhaite pour son fils qu’une vie moins douloureuse. Il ne lui en veut pas. C’est sa mère. Son cœur parle et ses entrailles ont peur.
Il marche.
La lumière du jour semble éveiller dans les cristaux assemblés des mémoires de clarté. Le tapis neigeux, accompagnant le ciel qui s’éveille, diffuse des haleines phosphorescentes. Ses pas soulèvent des myriades de flocons givrés, comme des scintillements d’étoiles. A l’horizon, l’astre montant, encore caché par les courbures de la Terre, a repoussé de chaque côté de la scène deux vagues noires de nuages boursouflés. Une couverture sombre, menace immobile, domine le lit du jour. Lentement, ces tentures mouvantes, plissées comme des chairs molles, se parent de rose. Rien de vif, juste des coulures discrètes mais qui s’imposent peu à peu. C’est un hublot qui s’est ouvert dans la masse compacte, un puits lumineux qui grandit lentement. Régulièrement, tout en préservant le rythme obstiné de ses pas, il tourne les yeux vers la naissance à venir. Les draperies de nuages se tendent, les tissus célestes se contractent, le rouge gagne la place. Enfin, le haut de la tête apparaît. Flamboyant. La boule lisse s’extirpe, se hisse, se faufile entre les parois nuageuses qui se déchirent sous les tensions.
Des traînées carmin se répandent de tous côtés mais rapidement la masse spongieuse des nuages accumulés engloutit dans le noir imposant les promesses de chaleur. Le disque rayonnant, malgré toute l’énergie concentrée, ne peut lancer ses cris de lumière. Le rond impuissant s’affaiblit, disparaît et s’éteint dans l’océan sombre des eaux suspendues.
Il s’est arrêté.
Impossible d’avancer quand le monde joue les scènes épiques.
Et c’est la nature, encore une fois, qui lui donne à voir son parcours, qui met à nu l’état de son être, qui dessine par delà les esquisses incertaines la profondeur réelle de sa vie. La vie, intense, bouillonnante, retranchée dans les tréfonds du corps, réfugiée dans les méandres de l’âme, la vie, insaisissable, indestructible, inexpugnable, résiste et s’élève. Là-bas, derrière les épaisses tentures mouvantes, gonflées de futures averses, nourrissant les prochaines tempêtes, il devine la montée inexorable de la lumière. Rien ne freine son cours. C’est à lui, avec la même obstination, d’ignorer les ténèbres qui l’entourent et de préserver l’irremplaçable élévation.
Il marche.
Les larmes coulent sur ses joues. Des larmes de bonheur. Le monde est son soutien. Il le sait pleinement désormais, le monde est son salut. Le monde est son Dieu. Il n’a pas besoin des hommes, ni de leurs religions, ni de tous leurs mensonges. Rien n’est plus simple que cet amour absolu pour la Terre car elle ne réclame rien, aucune prière, aucune idole, aucune guerre, aucune pratique doctrinaire. Juste de l’amour. Et de la contemplation.
Il dépasse le cinquième virage. Les bâtons de randonnée sont des aides indéniables. Le tapis de neige est si épais qu’il a du mal parfois à distinguer l’empreinte de la route. Le chasse-neige de la commune ne viendra pas jusque là. Aucune maison à dégager, aucun accès indispensable. Il est seul et le restera. Mais sitôt pensé cela, il sent combien sa solitude n’est qu’une fausse image. Les arbres muets le regardent passer, les oiseaux camouflés écoutent le chuintement de ses pas, le ciel est un observateur curieux. Rien n’est inerte. C’est la petitesse de nos regards qui limitent les contacts à nos semblables. Il le sait, sans rien pouvoir exprimer. Il n’est pas seul, il est même impossible de l’être. La vie ne peut pas être seule. Elle est partout, sous différentes images. Que ces images ne puissent communiquer entre elles par des mots humains n’effacent pas leurs présences. Il voudrait parler aux arbres, aux nuages et aux oiseaux, aux brins d’herbe, au vent et à la pluie qui tombe. D’être muré dans le silence humain, de ne pas prononcer parfois le moindre mot en une journée, lui ouvre d’autres langages. L’air qui tourne autour de lui le respire, les parfums de son corps sont des messages lancés alentours, les regards attendris vers les horizons blafards sont des mots d’amour. Rien n’est inerte et tout lui parle. Derrière le foisonnement merveilleux d’images, il devine une présence flamboyante. Une étrange mélancolie, l’impression d’avoir perdu un temps précieux, d’être resté sourd à des paroles essentielles, d’avoir ignoré la vie dans son extraordinaire diversité, de n’avoir été qu’un homme. Et c’est profondément décevant et douloureux.
Il marche.
Il cherche à comprendre ce qu’il est devenu. Est-il d’ailleurs si différent ou n’est-ce qu’une perception nouvelle ? Tout était-il déjà là ? Il lui semble que l’homme caché, l’homme réel, est parvenu à briser la carapace de l’homme sculpté. Sculpté par les rencontres, formé par les contraintes, modelé par les répétitions quotidiennes et la faiblesse de l’homme qui s’abandonne, repu de suffisance, en s’imaginant tenir entre ses mains les fils de son destin. Il sait désormais qu’il n’a été rien d’autre qu’une esquisse, une silhouette sans matière. Qu’une partie de la figurine ait été arrachée semble avoir permis à cette matière interne d’enfin se révéler au grand jour… Comme si du trou béant de sa jambe avait jailli en quelques instants une lueur inconnue.
La lumière s’impose. Les nuages, pourtant toujours aussi compacts, ne parviennent plus à étouffer la brillance de l’astre. La volonté du jour est la plus forte. Il s’étonne de cette clarté répandue alors que la source elle-même reste invisible. Il espère atteindre lui aussi cette capacité à rayonner quand tout autour n’est que ténèbres.
Il marche.
La chaleur de son corps animé exhale des parfums de sueur, de brûlure musculaire, de soif intense, de respiration contrôlée. Il a délacé sa veste. Des courants incandescents cascadent dans ses fibres. Chaque pas, chaque appui, chaque souffle est un instant de vie, unique, immensément joyeux, intensément désiré, profondément apprécié. Il sait qu’il a failli perdre tout cela, que l’image aurait pu totalement disparaître, qu’elle aurait pu également être terriblement déchirée, au point que rien n’aurait été possible, que l’image aurait désespérément jauni, jour après jour, sans qu’aucune couleur joyeuse ne vienne embellir le dessin. Il sourit. A lui-même. Il reconnaît aujourd’hui que les médecins ont eu raison. Il a eu un peu de chance… Malgré tout ce qu’il a perdu, il lui reste juste de quoi se reconstruire. Il a eu beaucoup de mal à l’admettre mais de sentir ainsi son corps en action le rassure. Il reste de belles couleurs à découvrir. Ses doigts serrent la poignée des bâtons avec une énergie redoublée, les épaules poussent le torse en avant. C’est une proue butée qui taille sa route, qui tranche l’océan de neige et laisse un sillage régulier. Une avancée silencieuse, juste rythmée par le frottement des pas dans la neige légère, le balancement hypnotique du corps, la régularité répétitive et efficace de chaque geste. L’escalade ne lui offrait pas cette simplicité. Trop de tensions, trop de contraintes. Aucune pensée ne pouvait être détournée de l’objectif à atteindre. L’importance de ce qu’il n’avait jamais réellement accueilli. Une palette nouvelle de couleurs inconnues, les complémentarités de l’être. En dehors du temps, à l’écart des hommes, dans les horizons intérieurs, des contrées à atteindre.
Septième virage. La route s’engage sous les arbres. Il s’arrête à l’orée de la forêt. C’est un peuple puissant qui l’observe. Les grands résineux tapissés de neige sont des gardiens impassibles. Il les regarde avec un léger sourire. Majestueux et immobiles, ils forment un mur compact. Le trait blanc de la route, sillage fragile, se glisse prudemment sous les branches figées comme des vagues écumeuses. C’est un monde secret qui s’ouvre, baigné par une lumière teintée de verts sombres. Les frondaisons épaisses cachent des vies de plumes, des fourrures agiles, des insectes fureteurs. Au plus profond des broussailles, dans les sous-bois les plus éloignés de tout, des oreilles inquiètes épient le moindre bruit. La vie joue de ses formes et impose à chaque espèce des règles immuables. Les plus faibles ne connaîtront pas la douceur du printemps. Les plus résistants supporteront les longues nuits froides.
Il est certain aujourd’hui qu’il goûtera à la lente montée de l’astre dans l’azur. Il n’aurait osé l’affirmer quelques semaines auparavant. Il a bien pensé, parfois, que tout devait s’arrêter, que rien ne justifiait la suite. L’idée, désormais, lui paraît inconcevable. L’absence glaciale de Blandine sera pour toujours une brûlure insupportable. Il ne saurait en être autrement.
Mais il marche.
Et la neige est si belle.
Il fait demi-tour. Sans amertume. Le moignon est échauffé. Il doit l’accepter et écouter la plainte. Il ne veut pas d’une plaie qui s’infecte. Il est resté trop longtemps dépendant du personnel de l’hôpital puis du centre de rééducation pour courir le risque d’une immobilisation. Lionel, le prothésiste de Grenoble, lui a clairement détaillé les risques. Il lui fait confiance. C’est d’ailleurs le seul spécialiste dont il accepte sans retenue les conseils. Lionel ne voit pas en lui un amputé mais une personne. La distinction est d’importance. Le spécialiste n’a pas pris le pas sur l’humain. Il sait combien dans le milieu hospitalier la rencontre est rare.
Les bâtons diminuent considérablement la difficulté de la descente. Il marche à petites enjambées, sans forcer sur l’articulation. Ce n’est plus son énergie qui commande mais la nécessité de rester en bon état. Il accepte la situation parce qu’il n’a pas le choix. Jouer le téméraire, faire la sourde oreille ne servirait qu’à amplifier le mal. Le bonheur qui se dévoile dans cette marche laisse entrevoir des lendemains heureux. Il ne pensait pas cela possible, il s’en étonne encore. La force de son rebond l’interpelle. Il ne se savait pas si sage ! Les souvenirs sont sans doute trop proches et trop sombres pour laisser le rideau retomber. Il ne veut plus de ce voile de ténèbres qui le laissait hagard et sans désir. Il doit apprendre à maîtriser ses élans.
Il se félicite d’avoir fait demi-tour.
Il sait qu’il reviendra.
Il s’arrête.
Longuement, il observe les horizons gagnés.
La lumière a empli le monde. A certains endroits du ciel, l’étendue nuageuse se désagrège. Des déchirures apparaissent. Des chapelets de vaisseaux fragiles se dispersent sur un océan grisâtre qui ondule. Une brise légère s’est levée et les pousse.
Les forêts impassibles.
Aucun bruit humain ne remonte jusqu’à lui. -
Satprem : la réalité.
- Par Thierry LEDRU
- Le 01/01/2010
WIKIPEDIA
Biographie [modifier]
Elève au collège de jésuites d'Amiens, il en est renvoyé. Il poursuit ses études secondaires dans un lycée parisien jusqu'au baccalauréat puis intègre une classe préparatoire à l'école coloniale. Il entre alors dans un réseau de résistance de la région de Bordeaux. Il est arrêté par la Gestapo à l'âge de vingt ans et passe un an et demi dans le camp de concentration de Mathausen. Il se retrouve ensuite en Haute-Égypte, puis en Inde, au gouvernement de Pondichéry. Il rencontre Aurobindo Ghose et Mirra Alfassa.
Leur message « l'homme est un être de transition » donne un sens à sa vie. Il démissionne des colonies et part en Guyane où il passe une année en pleine forêt vierge, puis au Brésil et en Afrique.
En 1953, à l'âge de trente ans, il revient définitivement en Inde auprès de celle qui cherchait le secret du passage à la « prochaine espèce », Mirra Alfassa, dont il deviendra le confident et le témoin pendant près de vingt ans. Elle lui présente celle qui restera sa compagne jusqu'à sa mort, Sujata Nahar en 1954.
Le 3 mars 1957, Mirra Alfassa lui donna son nom, Satprem ("celui qui aime vraiment").[2]
En 1959, Satprem quitta à nouveau l'ashram de Pondicherry. Il devint disciple d'un prêtre tantrique du temple de Rameshwaram. Puis, en tant que disciple d'un autre yogi, il passa six mois à errer sur les routes de l'Inde comme mendiant sannyasi pratiquant le Tantra, ce qui lui donnera les bases de son second essai, "Par le corps de la terre, ou le Sannyasin".
Il revint ensuite à l'ashram, auprès de Mirra Alfassa, qui commença à l'inviter de temps en temps dans sa chambre, au départ pour travailler en connexion avec le Bulletin de l'ashram. Lors de ces rencontres, Satprem se mit à poser davantage de question et décida finalement d'enregistrer leurs conversations. Ces enregistrements formèrent L'Agenda, dont le premier volume comprend également des lettres écrites à Mirra Alfassa par Satprem durant ses jours sur les routes.
Sous le regard de Mirra Alfassa, il consacre un premier essai à Aurobindo Ghose, « Sri Aurobindo et l'Aventure de la Conscience » : « Le règne de l'aventure est terminé. Même si nous allons jusqu'à la septième galaxie, nous irons là casqués et mécanisés, et nous nous retrouverons tels que nous sommes : des enfants devant la mort, des vivants qui ne savent pas très bien comment ils vivent ni pourquoi ni où ils vont. Et sur la terre, nous savons bien que le temps des Cortez et des Pizarre est fini : la même Mécanique nous enserre, la souricière se referme. Mais comme toujours, il se révèle que nos plus sombres adversités sont nos meilleures occasions et que l'obscur passage est un passage seulement, conduisant à une lumière plus grande. Nous sommes donc mis au pied du mur, devant le dernier terrain qu'il nous reste à explorer, l'ultime aventure : nous-mêmes. ».[3] Ce livre est l'introduction la plus populaire à l'oeuvre d'Aurobindo Ghose et de Mirra Alfassa.[4]
Le 29 février 1968, lors de l’inauguration d'Auroville, Mirra Alfassa lira la Charte, assise sur un haut tabouret dans sa chambre, Satprem à son côté. « Auroville n’appartient à personne en particulier, mais à toute l’humanité dans son ensemble... »[5]
À l'âge de cinquante ans, Satprem rassemble et publie, l'Agenda de Mirra Alfassa, en 13 volumes, tout en écrivant une trilogie : le Matérialisme divin, l'Espèce nouvelle, la Mutation de la mort puis un dernier essai : Le Mental des Cellules.
Au printemps 1980, Frédéric de Towarnicki, journaliste et critique littéraire, part pour l'Inde et rencontre Satprem. Leurs entretiens ont été diffusés sur France-Culture en décembre puis publiés chez Robert Laffont[6]. Satprem y évoque son passé, retrace son cheminement et l'objet de sa recherche.
En 1981, une équipe de cinéastes dirigée par David Montemurri, réalisateur de la télévision italienne, s’est rendue dans les Nilgiris, les Montagnes Bleues du Sud de l’Inde où Satprem résidait à l’époque, pour l’interviewer. « On n’est pas dans une crise morale, on n’est pas dans une crise politique, financière, religieuse, on est dans une crise évolutive. On est en train de mourir à l’humanité pour naître à autre chose...» C’est ainsi que Satprem répond à David Montemurri qui lui pose, au cours de cet interview, un certain nombre de questions concernant la crise de civilisation que nous traversons actuellement et l’avenir du monde moderne.[7]
À cinquante-neuf ans, il se retire complètement pour rechercher un « grand passage » évolutif vers ce qui suivra l'Homme. Sa dernière entrevue, en 1984, a donné lieu à La Vie sans Mort où il relate le début de son expérience dans le corps.
En 1989, après sept années passées à « creuser dans le corps », Satprem écrit un court récit autobiographique où il fait le point de la situation humaine, La Révolte de la Terre.
Vint ensuite en 1992 Evolution II, où il demande : « Après l'homme, qui ? Mais la question est : après l'homme, comment ? » En 1994 paraissent ses Lettres d'un insoumis, deux volumes de correspondance autobiographique. Il écrit en 1995 La tragédie de la terre - de Sophocle à Sri Aurobindo : « Dans cette vaste fresque, qui n'a rien d'un essai didactique, Satprem met en évidence le fil conducteur qui relie Sri Aurobindo, Sophocle et les Rishis védiques et commente : Entre un Occident post-socratique qui ne croit qu'en ses pouvoirs mécaniques sur la Matière et une Asie post-védique qui ne croit qu'en sa libération de la Matière, Sri Aurobindo incarne un autre grand Tournant de notre destinée humaine...»;[8]
Ce livre fut suivi en 1998 par La clé des songes et en 1999 par Néanderthal regarde, un court texte comme un appel aux hommes à se réveiller et à se mettre en quête de la vraie humanité. Car, dit Satprem, « Même l'homme de Néanderthal aurait honte de ce que nous sommes devenus ».[9] Suivi en 2000 par "La légende du futur". La même année, Satprem entama également la publication de ses Carnets d'une Apocalypse, aujourd'hui 6 volumes d'autobiographie qui s'étendent de 1973, année du départ de Mirra Alfassa à 1987 et décrivent son travail en profondeur dans la conscience du corps.
Satprem est mort le 9 avril 2007.
Sa compagne Sujata Nahar est morte peu après lui, le 4 mai 2007.
A écouter quand on a bien à l'esprit le parcours de vie de cet homme.
http://www.youtube.com/watch?v=9dIXT6WTQ40
http://www.youtube.com/watch?v=pUkaX7B8DGI&feature=related
"La vie n'est pas ce que nous vivons.
Elle est ce que nous imaginons vivre."
Pascal Mercier.









