Blog
-
L'esprit de la permaculture
- Par Thierry LEDRU
- Le 23/05/2021
Le portrait de la semaine : Johnny Simon, la passion du jardin et le coeur en permaculture
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/le-portrait-de-la-semaine-johnny-simon-le-coeur-en-permaculture-2071057.html
C'est sans le savoir que Johnny Simon pratiquait la permaculture. Depuis qu'il a mis un mot dessus, il en a fait un art de vivre. Tentant de créer l'harmonie entre l'homme et la nature dans son jardin de Saleux dans la Somme et partout où sa passion le pousse.
Publié le 22/05/2021 à 07h30 • Mis à jour le 23/05/2021 à 08h32

Johnny Simon au cœur du jardin forêt du jardin de la Selle. • © Mathieu Maillet
La première fois que j'ai rencontré Johnny Simon, je me suis rappelé mon professeur d’EPS de collège. Celui qui au siècle dernier apprenait aux pré-ados que nous étions à faire des plaquages de rugby les jours d’intempéries, le sol détrempé étant censé amortir nos chutes. J'avais alors du mal à imaginer chez cet homme d'autres passions que celle de nous faire souffrir.
Car Johnny Simon est prof d'EPS. Je ne sais pas s'il fait souffrir ses élèves, mais s'il n’est pas au collège ou autour d'un stade, vous aurez de grandes chances de le trouver dans son jardin à Saleux, dans la Somme près d'Amiens.
Car sa passion à lui, c'est la permaculture. C’est dans les 5650 m² du terrain qu'il occupe depuis 2013 qu'il m'a entraîné, me décrivant les multiples espèces végétales qui l'occupent. Chez Johnny Simon, pas de motoculteur pour retourner la terre, pas de ligne de légumes ou de haies constituées d'une seule espèce de plante. Mais des mares, des buttes de cultures recouvertes de couverts végétaux, de paille, de tontes de pelouse d'où sortent différentes pousses potagères, fleurs, plantes. Une piscine naturelle, un jardin forêt, une zone de re-naturalisation, un poulailler...
La permaculture, c'est le partage.
Johnny Simon, permacultivateur amateur
Des espaces conçus, d'après Johnny, comme les différentes pièces d'une maison. Chacune avec son propre rôle mais dont le but premier est de créer un équilibre entre la faune, la flore et les hommes qui occupent cet environnement.
Prendre soin de la terre
Quand Johnny a commencé son ouvrage, il ne savait pas que ce qu'il faisait avait un nom. Alors lorsqu'un de ses anciens élèves l’incite à assister à une conférence organisée par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement de la Somme sur la permaculture, il a compris que c'était ça qu'il faisait. Et sur la permaculture, il est intarissable.
"Les principes de la permaculture : prendre soin de soi, prendre soin de la terre, partager équitablement les richesses, m'explique-t-il. La permaculture, c’est le partage. Dans la nature, on ne verra jamais un oiseau prendre quatre cerises, en manger une et revendre les trois autres à ses congénères."
Cette notion de partage reviendra souvent dans la bouche de Johnny. Et ce ne sont pas que des paroles.
Je fais en sorte que mon jardin soit le plus autonome possible. La permaculture permet de créer un cycle qui s'auto-alimente.
Johnny Simon, permacultivateur amateur
Alors qu'il me montre ses serres faites de matériaux de récupération, deux personnes entrent dans le jardin. Guillaume et sa fille Maeline apportent un pot de tanaisie, une plante qui a pour vertu de repousser les insectes, et des enveloppes contenant des graines.

Guillaume et Maeline apporte un pot de tanaisie et des graines à Johnny • © Mathieu Maillet
"J’ai dépanné Guillaume qui s'est fait voler des outils", raconte Johnny. Comme lui, Guillaume a un jardin et l'entraide est précieuse entre ces amoureux de la nature. Un peu plus tard, nous sommes dans sa maison, un appel de son voisin : "je te mets du bois par-dessus la clôture". Par la baie vitrée, j'aperçois l'homme charrier des bûches chez Johnny. "Je récupère aussi les tontes de gazon ou les tailles de haies des voisins, ça fait des couvre-sols naturels".
Un équilibre entre les plantes et les animaux
"Je fais en sorte que mon jardin soit le plus autonome possible. La permaculture permet de créer un cycle qui s'auto-alimente : l'arbre dans le jardin perd ses feuilles, ses branches, ses fruits, il va nourrir la terre, l'homme, les écureuils, les oiseaux. Les oiseaux boivent dans la marre, ils font des déjections qui nourrissent arbres et potager et se nourrissent des insectes qui peuvent être ravageurs dans le potager." Tout s'équilibre.
Et c'est ainsi que le jardin est devenu refuge Ligue de protection des oiseaux il y a quatre ans et que Johnny accueille des hérissons via le sanctuaire des hérissons. Les animaux sauvages sont chez eux dans le jardin de Johnny : "sur le peuplier il y a un coucou gris, et vous pouvez avoir les étourneaux qui vont venir par bande. Dans le noyer, il y a un épervier qui va faire le tri au moment des cerises entre les pies et les grives et qui va leur expliquer qui a le droit de vivre ou mourir sur le terrain. Les tourterelles, les pinsons, les rouges-gorges, les mésanges et jusqu'aux troglodytes mignons vont voler autour des tas de bois installés pour eux. On commence à avoir des rapaces et on a des chauves-souris, les pipistrelles qu'on voit voler l’été à 22h."
Transmettre sa passion et ses pratiques
Son engagement, Johnny le pousse au-delà des limites de son jardin. Il initie les élèves du collège Gérard Philipe de Froissy à sa passion. "La première année, on a fait des lasagnes dans un aquarium en y mettant du carton, des feuilles... et trois mois après il y avait de la terre. On a créé un jardin forêt de 600 m² avec l'objectif de nourrir la cantine dans quelques années."

L'entrée du jardin forêt au mois d'avril • © Mathieu Maillet
Il est également intervenu dans le lycée de Grandvilliers pour la mise en place d'un jardin permacole. Il aide des associations comme Les robins des bennes qui luttent contre le gaspillage pour redistribuer des plantes destinées à finir à la benne, en déchetterie, en jardinerie, dans les cimetières, ou chez les particuliers.
Il milite pour un projet de ceintures alimentaires autour d'Amiens. Attirer des maraîchers et créer une forêt publique pour mettre à disposition gratuitement des fruits et légumes. Apprendre aux gens comment s'approprier les jardins est l'un de ses grands rêves.
"Quand j'étais jeune, je n'aimais pas ça"
Petit, Johnny n'aimait pas aller au potager de son père."Quand j'étais jeune, ça ne m'intéressait pas. Mon papa fonctionnait en conventionnel. À 14-15 ans quand j'allais au jardin, c'était pour bêcher et désherber et je n'aimais pas. En retirant ça, j'ai enlevé ce qui m'irritait le plus au jardin."
Aujourd'hui, il est assez rare de le croiser sans son fils de 6 ans. Avec lui, il partage le rythme des saisons, le plaisir de voir les plantes pousser, les oiseaux nicher. Un jeune garçon malicieux qui aime mettre en boite son père : "Mon fils m'a dit : plus tard, tu seras vieux et je te mettrai dans un fauteuil et tu feras décoration dans le jardin. Un autre jour, il a dit à des visiteurs : "mon père ne fait rien, heureusement que je suis là, c’est moi qui fais tout !""
"Il prend des graines qu'il mélange dans un saladier, il les jette et ça pousse. Et vous, vous essayez et ça ne marche pas et vous vous dites : pourquoi lui ça marche et pas moi ?", s'amuse ce papa qui ne cache pas sa fierté.
Johnny n'a pas encore découvert tous les secrets de la nature mais ce qu'il sait déjà, il le partage sans modération dans son jardin qu'il ouvre au public très régulièrement. Parce que la permaculture selon Johnny Simon, c'est avant tout le partage.
-
Les oiseaux et l'agrochimie
- Par Thierry LEDRU
- Le 22/05/2021
L'article date de 2018. Je le poste ici parce que ça me permettra de voir ce qu'il en sera dans dix ans. Ce blog me sert aussi d'archives.
Le CNRS et le Muséum démontrent une corrélation entre disparition des oiseaux et agriculture intensive
https://www.actu-environnement.com/ae/news/disparition-oiseaux-etudes-CNRS-Museum-catastrope-ecologique-30881.php4
Deux nouvelles études scientifiques révèlent une diminution d'un tiers des populations d'oiseaux vivant en milieu agricole depuis les années 1990. Cette diminution apparaît directement corrélée aux pratiques agricoles intensives.
Biodiversité | 20 mars 2018 | Laurent Radisson | Actu-Environnement.com
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail

Les chiffres révélés en ce premier jour du printemps par le Muséum d'histoire naturelle et le CNRS ont de quoi faire frémir. "Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En moyenne, leurs populations se sont réduites d'un tiers en quinze ans", révèlent les organismes de recherche à travers deux études.
La première a été menée à l'échelle nationale grâce à un programme de sciences participatives porté par le Muséum. Elle met en évidence les pertes les plus importantes parmi les espèces spécialistes des milieux agricoles comme l'alouette des champs, la fauvette grisette ou le bruant ortolan. Loin d'être enrayé, le déclin s'est même accéléré ces deux dernières années.
La deuxième étude a été menée à une échelle locale par le CNRS dans une zone atelier située dans les Deux-Sèvres. "En 23 ans, toutes les espèces d'oiseaux de plaine ont vu leurs populations fondre : l'alouette perd plus d'un individu sur trois (-35%) ; avec huit individus disparus sur dix, les perdrix sont presque décimées", révèle le CNRS.
Effondrement des populations d'insectes
Ces deux études mettent clairement en évidence la corrélation entre ces baisses de population d'oiseaux et les pratiques agricoles intensives, même si elles ne démontrent pas scientifiquement le lien de causalité. En effet, alors que des espèces généralistes adaptables comme le pigeon ramier, le merle noir, la mésange charbonnière ou le pinson des arbres ne déclinent pas à l'échelle nationale, leur population diminue aussi lorsqu'elles fréquentent les milieux agricoles, explique Benoît Fontaine, co-responsable du programme de sciences participatives au Muséum.
Les deux organismes de recherche mettent en avant plusieurs facteurs liés à l'intensification des pratiques agricoles, plus particulièrement depuis 2008-2008 : fin des jachères imposées par la politique agricole commune, flambée des cours du blé, sur-amendement au nitrate, généralisation des insecticides néonicotinoïdes.
Si les causes semblent multifactorielles, le rôle des pesticides semble prépondérant. Une étude scientifique, révélée en février dernier par l'Office de la chasse et de la faune sauvage, a démontré l'intoxication directe des oiseaux via la consommation de graines traitées par les néonicotinoïdes. Mais la menace est aussi indirecte avec l'effondrement des populations d'insectes comme l'a montré en octobre dernier l'étude allemande révélant que plus de 75% des insectes avaient disparu outre-Rhin depuis 1989.
Printemps silencieux dans les plaines céréalières
"Les scientifiques savent que la biodiversité s'effondre, mais nous avons été frappés par l'accélération du phénomène", explique Benoît Fontaine. Or, les oiseaux sont en bout de chaîne et traduisent ce qui se passe dans les différentes composantes de la biodiversité, ajoute le chercheur. "On atteint un niveau proche de la catastrophe écologique", alertent les deux organismes de recherche qui annoncent dès cette année un "printemps silencieux" dans de nombreuses régions de plaines céréalières, en référence à l'ouvrage de la biologiste américaine Rachel Carson paru en 1962.
"Si cette situation n'est pas encore irréversible, il devient urgent de travailler avec tous les acteurs du monde agricole pour accélérer les changements de pratiques ; et d'abord avec les agriculteurs qui possèdent aujourd'hui les clés pour infléchir la tendance", alertent les organismes de recherche à l'attention des politiques. Et ce, d'autant plus, que les agriculteurs seront les premières victimes de la disparition des pollinisateurs et de la micro-faune présente dans les sols. Or, pour l'instant, les changements de pratiques agricoles restent anecdotiques, estime M. Fontaine.
Ce deuxième article date de ce mois.
Néonicotinoïdes : la LPO réclame la réparation du préjudice écologique aux agrochimistes
Biodiversité | 21 mai 2021 | Laurent Radisson | Actu-Environnement.com
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a assigné en justice, ce vendredi 21 mai, les principaux producteurs et importateurs d'imidaclopride, la substance néonicotinoïde la plus commercialisée en France, annonce l'association dans un communiqué.
Soutenue par le collectif Intérêt à agir, elle demande au tribunal judiciaire de Lyon la réparation du préjudice écologique causé par cette substance persistante, systémique et neurotoxique, ainsi qu'une expertise en vue de déterminer l'étendue des dommages et les mesures de réparation à mettre à la charge de ses producteurs (Bayer et Nufarm) et importateurs (Fertichem, Gritche, Agri Canigou, Saga). L'association demande également l'arrêt immédiat de la commercialisation des produits contenant cette substance. Cette demande fait suite à l'adoption de la loi du 14 décembre 2020 qui a réautorisé ces produits de manière dérogatoire dans les cultures de betteraves.
« Les néonicotinoïdes symbolisent un modèle agricole productiviste qui a conduit nos paysans dans une impasse économique et fait disparaître les oiseaux de nos campagnes. La dernière victime en date est la Pie-grièche à poitrine rose, qui ne s'est plus reproduite en France cette année. Les responsables de ce désastre doivent rendre des comptes », tonne Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO.
L'association s'appuie sur plusieurs études scientifiques qui montrent un effondrement des populations d'insectes à partir des années 1990 concomitant avec celui de différentes espèces d'oiseaux insectivores fréquentant les milieux agricoles comme le Bruant jaune, le Pipit farlouse ou le Tarier des prés. « Aujourd'hui, c'est au minimum 25 % de ces populations qui ont disparu », estime la LPO. Pour l'association, ces études établissent le lien de causalité entre ces dommages environnementaux et les néonicotinoïdes dans la mesure où ces produits ont été introduits à la même époque et qu'une corrélation spatiale peut également être établie entre leur commercialisation massive et le déclin des oiseaux en zones rurales. Reste maintenant à voir si le tribunal de Lyon reconnaît ce lien de causalité.
-
Les rats taupiers et les prédateurs
- Par Thierry LEDRU
- Le 22/05/2021
Des subventions pour pallier aux frais occasionnés par les divers rongeurs.
C'est une vision court-termiste. Comme d'habitude.
La biodiversité a une raison d'être et si l'humain passe outre, il en paye inévitablement les frais.
Les rats taupiers font déjà de gros dégâts dans les prairies du Mézenc
https://www.leveil.fr/saint-front-43550/actualites/les-rats-taupiers-font-deja-de-gros-degats-dans-les-prairies-du-mezenc_
Publié le 21/02/2020 à 17h12

Christian Munier donne des formations aux agriculteurs pour lutter contre cette espèce de rongeur. Photo Vincent Jolfre © Vincent JOLFRE
Le rat taupier dévore les prairies du Mézenc et va obliger certains agriculteurs à sursemer pour s’assurer du fourrage. Ces derniers ont fait part de leur inquiétude au préfet, mercredi après-midi.
L’ennemi juré des agriculteurs du plateau du Mézenc est de retour. Ou plutôt, il n’a jamais quitté le sous-sol des prairies depuis cet été. Et cela en raison de la douceur des températures ces dernières semaines. Le rat taupier ou campagnol terrestre - appelez-le comme vous le voudrez - ravage tellement de parcelles à Saint-Front et ses alentours que les exploitants risquent de ne pas avoir de récolte de fourrage cet été.
 Les rats taupiers font déjà de gros dégâts dans les prairies du Mézenc. Photo Vincent Jolfre
Les rats taupiers font déjà de gros dégâts dans les prairies du Mézenc. Photo Vincent Jolfre
Cette problématique a été au cœur des discussions entre chambre d’agriculture, agriculteurs du plateau et le préfet, Nicolas de Maistre, mercredi après-midi. Car ces petits rongeurs qui cavalent dans les sous-terrains du Mézenc en se nourrissant des racines sont une des sources d’épuisement des paysans. Ces derniers prévoient d’ailleurs de sur-semer de l’avoine et du ray-grass sur leurs parcelles dès avril pour s’assurer d’un minimum de fourrage cet été. Des plants vivaces pour avoir un minimum de récolte durant l’été. Le préfet Nicolas de Maistre (deuxième en partant de la gauche) a écouté les agriculteurs pendant près d’une heure et demie.
Le préfet Nicolas de Maistre (deuxième en partant de la gauche) a écouté les agriculteurs pendant près d’une heure et demie. « Cela ne va pas détruire nos prairies car c’est du sur-semis. Après la récolte elles vont se régénérer ».
L’ASSEMBLÉE
En plus du coût des semences, les agriculteurs vont devoir faire appel à des entreprises pour sur-semer. Car ils n’ont pas le matériel. Pour combler en partie les 150 € à 200 € par hectare qui vont s’appliquer, les exploitants soutenus par la chambre d’agriculture ont demandé une subvention au Département à hauteur de 50 % pour chaque agriculteur (soit une demande totale d’environ 30.000 à 40.000 € selon la chambre d’agriculture).
La situation nourrit le ras-le-bol des exploitants. À l’image de Grégory Devidal, agriculteur bio à Chaudeyrolles.Cela fait trois ans que je dois acheter 20.000 € de bouffe ! Économiquement, on se demande si on ne va pas repasser en conventionné.
 Franck Chazallon, agriculteur de Saint-Front, que nous avions rencontré cet été, a lancé un « cri d’alarme » au préfet, après des mois à chasser le rat taupier. Photo d’archives Vincent Jolfre
Franck Chazallon, agriculteur de Saint-Front, que nous avions rencontré cet été, a lancé un « cri d’alarme » au préfet, après des mois à chasser le rat taupier. Photo d’archives Vincent Jolfre
Revenir à cette agriculture lui permettrait notamment de faire appel à des personnes formées à la lutte chimique contre le rat taupier. Une des solutions à court terme pour venir à bout du campagnol terrestre. Solution qui toucherait de facto les autres espèces vivant sur le plateau du Mézenc.
Si le court terme préoccupe les agriculteurs, la rencontre avec le préfet mercredi a aussi permis d’aborder les solutions dans le temps. Tous les acteurs se sont montrés unanimes :Il faut lutter collectivement.
Comment ? Avec l’installation de haies pour favoriser la vie des rapaces - notamment du milan royal mangeur de rats taupiers -, ou encore l’enrochement pour attirer les hermines, elles aussi mangeuses du rongeur. Des solutions durables aux conséquences sur le long terme pas toujours du goût des agriculteurs.

« Oui, nous allons vous aider, mais nous voulons une vision sur le long terme. Pour que je puisse porter votre message, la biodiversité doit être au cœur des réflexions ».
NICOLAS DE MAISTRE (Préfet de Haute-Loire)
Le président de la chambre d’agriculture, Yannick Fialip, a, lui, proposé à chaque agriculteur de débourser « 10 à 20 € chaque année par hectare » en terme de prévention. Et notamment pour limiter les proliférations de taupes, autre ennemi des agriculteurs. « La taupe prépare des autoroutes souterraines pour les rats taupiers », note Christian Munier, agriculteur à la retraite et vice-président de la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles en Haute-Loire (FDGDON43).
La lutte contre les taupes et les rats taupiers semble être trop tardive pour cette année. Reste aux agriculteurs du plateau à espérer que leurs sur-semis seront épargnés.« Sursemer est indispensable »
Le porte-parole de la Confédération paysanne de Haute-Loire, David Chamard, va dans le sens du sursemage envisagé par les agriculteurs du plateau du Mézenc et demande une aide supplémentaire des pouvoirs publics.
Quel est votre regard sur la possibilité de sursemer dans les prairies touchées par les rats taupiers ?
C’est indispensable. Aujourd’hui, il faut réimplanter les prairies pulullées. La part de parcelles touchées est énorme. Cela va avoir un coût important pour les éleveurs.
Nous aimerions davantage d’aide des pouvoirs publics. Une subvention à hauteur de 50 % du Département cela serait déjà bien, mais pourquoi pas 100 %, si l’on actionne d’autres leviers ? Cela serait un message fort des pouvoirs publics s’ils venaient à aider intégralement les agriculteurs de cette zone.
La lutte contre ces rongeurs est au cœur des discussions, quelles sont les solutions selon vous ?Sur le long terme, il faut maintenir la biodiversité. Sur le plateau, il faut conserver des renards, en arrêtant de les tirer, des hermines et des rapaces. L’entretien des haies est aussi primordial. On a vu par le passé que la solution de la chimie n’a pas eu le résultat escompté sur le long terme. Il faut trouver un équilibre dans le système. »
En chiffres
400
C’est, environ, le nombre d’hectares de prairies touchés par la prolifération des rats taupiers sur le plateau du Mézenc.
1.000
C’est le nombre maximum de campagnols terrestres qui peuvent vivre dans un hectare.
-
Renard et tiques
- Par Thierry LEDRU
- Le 22/05/2021
Ici, j'enlève des tiques tous les jours sur nos deux chats et j'en ai déjà chopé un qui trottait sur ma main en revenant du potager.
Autour de nous, on a déjà rencontré trois personnes atteintes par la maladie de Lyme.Encore une fois, un animal n'obtient pas le droit de vivre parce qu'il est utile à l'homme mais quand on voit la gravité de cette maladie chez l'humain et la multiplication exponentielle des cas, il y a quand même un sérieux problème.
https://lareleveetlapeste.fr/les-renards-sont-indispensables-pour-lutter-contre-la-propagation-de-la-maladie-de-lyme/
Les renards sont indispensables pour lutter contre la propagation de la maladie de Lyme
« Rien n’est utile ou nuisible, tout est nécessaire » Jean-François Noblet, zoologiste.

13 mai 2021 - La Relève et La Peste

Envie d’une vraie déconnexion ? Évadez-vous avec notre bande dessinée !
- Thème : effondrement de la société, abordé de manière douce et positive
- Format : 128 pages
- Impression : France
L’augmentation de la maladie de Lyme corrobore avec la diminution du nombre de renards roux. Et pour cause, ce mal-aimé de nos campagnes, encore trop souvent considéré comme un nuisible, est pourchassé sans répit. En France, les chasseurs tuent ainsi entre 600 000 et un million de renards chaque année. Alors que les cas de Lyme continuent d’augmenter, et que les agriculteurs déplorent les ravages des rongeurs sur leurs récoltes, il est grand temps d’accorder au goupil tout le respect qu’il mérite pour son rôle inestimable dans la régulation des écosystèmes. Un article de Liza Tourman.
Qu’est-ce que la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme, aussi connue sous le nom de « Borréliose de Lyme », est une zoonose dégénérative qui peut être traitée si elle est diagnostiquée à temps. Malheureusement, encore peu reconnue en France, elle se transforme souvent en maladie chronique. Elle est transmise via une tique infectée par une bactérie du complexe Borrelia burgdoferi.
Nécessitant un taux élevé d’humidité pour vivre, on la retrouve essentiellement dans les forêts, les lisières, les taillis et les bois. Utilisant comme hôtes des animaux vertébrés sauvages tels que les rongeurs ou domestiques, elle se transmet à l’homme lors de ses « repas de sang ».
Cela dit, ce n’est pas parce que nous sommes mordus par une tique infectée que l’on attrape obligatoirement la maladie. En effet, cela dépend de la stase de développement (larve, nymphe, adulte).
Moins de 1 % de la population touchée transmet la bactérie à sa descendance, et par voie de conséquence, ces dernières ne sont généralement pas infectantes le temps de la morsure. De plus, 17h à 24h de fixation sur une personne sont requises pour que celle-ci contracte la maladie.
Et même si une tique a terminé son repas, il n’y a que 14 % de risques d’infection. Malgré tout, la borréliose est une maladie grave dont les symptômes varient entre la paralysie musculaire et articulaire, des migraines violentes, des poussées de fièvre, des troubles de l’équilibre, cardiaque, de la vision et neurologiques voire, cas ultime, la mort. Le pic d’activité des tiques s’étend généralement d’avril à juin. Elles redeviennent peu actives à l’automne.
On dénombre aujourd’hui 60 000 nouveaux cas par an en France. Pour se faire une idée, on en comptait 26 000 entre 2009 et 2014, 33 200 en 2015, 54 600 en 2016 avant d’atteindre 205 000 en 2018. Au vu de ces nombres impressionnants, on peut légitimement se poser la question des causes de la progression alarmante de cette maladie.

Crédit : Erik Karits
Le rôle du renard roux
Concernant les facteurs naturels connus à l’origine du développement de Lyme, deux font l’unanimité, dont un plus particulièrement. Premièrement, il y a le réchauffement climatique qui favorise la prolifération des tiques.
Ensuite, vient un argument sur lequel une grande majorité des chercheurs semble d’accord : le manque de renards et / ou de chats selon les territoires (pour endiguer les rongeurs qui ramènent les acariens en zone urbaine).
En 2012, une étude américaine a démontré qu’au cours des trois dernières années, l’augmentation de la maladie de Lyme corroborait avec la diminution du nombre de renards roux.
Venant étayer cette dernière, une étude néerlandaise plus récente (2017), répartie sur 19 territoires forestiers des Pays-Bas, constate que le nombre de larves de tiques sur deux espèces de rongeurs (le campagnol roussâtre et le mulot sylvestre, réputés pour être des nids à Borrelia) diminue quand l’activité prédatrice du renard roux et de la fouine augmente.
Dans cette dernière, parue dans la revue néerlandaise Mens & Vogel, Tim Hofmeseeter, écologue, a présenté un rapport mené sur deux ans établissant le lien entre la présence du renard et celle de tiques d’une part et la survenance des bactéries du complexe Borrelia burgdoferi d’autre part.
Comment s’y est-il pris ? Elargissant sa recherche à une vingtaine de bois d’un hectare sur toute la Hollande, il conçoit deux formes de pièges pour établir ses statistiques. Le premier est un piège capable de détecter, filmer ou photographier tout mouvement repéré par la chaleur émise par un mammifère de taille moyenne ou grande.
Le deuxième, lui, est un piège non létal pour les plus petits mammifères comme les rongeurs (permettant ainsi de les marquer pour ne pas les compter plusieurs fois avant de les relâcher). Cette capture lui permet de déceler le nombre de tiques présentes sur ces animaux et de les envoyer pour analyse afin de savoir si elles sont infectées ou non.
5 faits majeurs sont ressortis de ce travail : le renard lui-même ne joue pas un rôle prédominant pour infecter les tiques. C’est la densité des petits rongeurs hébergeant les foyers des tiques, contaminées ou non, qui en serait la cause.
La prédation du renard, quant à elle, permet la limitation de la contamination en régulant le nombre de rongeurs ; les prélèvements faits sur le terrain concluent qu’il y a moins de tiques dans l’environnement lorsqu’il y a plus de renards.
De plus, là où ce dernier a été le plus photographié, il y a 4 fois moins de tiques présentes sur les rongeurs et également moins de nymphes dans la végétation. Ainsi, ces études nous amènent à penser qu’il y a bien un lien entre la diminution du nombre de renards roux et l’augmentation de la maladie de Lyme ces dernières années.
Pourtant, fort est de constater que depuis plusieurs millénaires, le renard est considéré comme un nuisible. Pourquoi ?

Renard chassant dans la neige – Crédit : Birger Strahl
De la mémoire collective à l’obstination des chasseurs
Depuis le Moyen-Age, à l’instar du corbeau considéré comme une malédiction, le renard est défini à travers les contes, les fables comme celles de Jean De La Fontaine, inspirées d’Ésope ou les récits d’aventures où il apparaît sous le nom de Goupil, comme un animal rusé et roublard.
Pour cause, la couleur rousse de son pelage est associée au diable et au mal. Ainsi, chassé pour sa fourrure, il a peu à peu été aussi traqué pour être un vecteur de maladies transmissibles à l’homme. Notamment avec la rage qui s’est éteinte en France en 2001.
Alors qu’un grand nombre criait à l’abattage de l’animal, le centre d’étude sur la rage préconisait une vaccination pour que les territoires des renards demeurent inchangés. De plus, des études ont prouvé que les renards vaccinés contre la rage empêchaient leurs congénères contaminés de l’ouest de l’Europe de venir.
En effet, les renards en bonne santé étaient en mesure de défendre leur territoire. Quand la rage a disparu, cet intelligent canidé du genre vulpes a alors été accusé de contaminer l’humain avec l’échinococcose alvéolaire. Pourtant, seulement 15 % de nouveaux cas par an sont détectés en France.
Cet argument est le cheval de bataille des chasseurs qui ne voient aucun mal à exterminer cette espèce qui d’une part nous protège d’une catastrophe sanitaire et d’autre part préserve des écosystèmes fragiles, toujours plus détruits par l’homme.
En décembre 2020, le juge des référés avait ainsi donné raison à l’ASPAS, association pour la protection de la vie sauvage, en suspendant l’arrêté qui autorisait la « destruction » de renards dans plusieurs communes des Ardennes et justifiant sa décision par l’inutilité de tuer des renards pour éviter la prolifération de l’échinococcose alvéolaire.

Crédit : Alexander Andrews
Pour un statut et une reconnaissance du renard
Le renard roux est un animal très adaptable. On le retrouve aussi bien sur des territoires proches de la mer que dans ceux situés plus en altitude. Il ne fait plus guère de doute que les prédateurs sont des êtres vivants essentiels à la préservation de l’écosystème. En effet, il y a beaucoup moins de risques d’avoir de maladies ou de parasites en leur présence.
Sur un autre registre, Alain Baraton, chroniqueur sur FranceInter, nous raconte qu’à Versailles une étude a mis en avant que la prédation des renards sur les lapins permettait aux jeunes arbres de ne pas être endommagés.
Il est estimé qu’en une année, un renard mange environ 6000 petits rongeurs. On peut donc facilement en déduire son efficacité quant à la préservation de terrains agricoles. Pourtant, les chasseurs tuent en France entre 600 000 et un million de renards chaque année.

Maman renarde ramenant des proies à ses bébés – Crédit : Martin Arusalu
Pendant le confinement où la chasse a été suspendue, il a été autorisé de tuer certaines espèces « occasionnant des dégâts » aux activités agricoles et sylvestres. Parmi elles, figure le renard. Étrange, lorsque l’on sait qu’en 2019 dans la Haute Loire, puis en 2020 dans le Cantal, les agriculteurs se sont plaints des ravages des campagnols dus au manque de renard. Où est la logique ?
Aussi, au lieu de lutter en permanence contre le vivant et les moyens de s’autoréguler, plutôt que d’utiliser des pesticides mortifères contre les rongeurs, dévastant nos sols et nos écosystèmes, pourquoi ne pas allier nos forces autour de ce qui est, afin de préserver la vie, notre santé, notre terre ?
En ces temps de pandémie où les zoonoses font plus polémique que jamais, ne serait-il pas judicieux de mettre nos forces en commun afin de lutter contre les futures catastrophes sanitaires ? Ne faudrait-il pas se battre pour octroyer un statut et une protection aux renards qui nous protègent de la maladie de Lyme et préservent notre environnement naturel ? Et en parallèle, sévir contre ceux qui le chassent impunément, pour le plaisir ou encore à cause de fables sorties tout droit de notre imaginaire collectif mémoriel ?
Pour défendre le renard, l’ASPAS a mis en place une pétition visant à protéger ce mal-aimé, pourtant essentiel au bon fonctionnement de nos écosystèmes.
-
Le renard
- Par Thierry LEDRU
- Le 21/05/2021
Jour après jour, on avance sur notre terrain-potager.
On s'est rendu compte que les rats taupiers s'y plaisent beaucoup également...
On sait très bien que le plus gros prédateur de ce rongeur, c'est le renard.
Sans vouloir chercher une utilité humaine à cet animal, comme cela se fait bien trop souvent, il est évident que l'élimination effrénée des renards est une aberration.
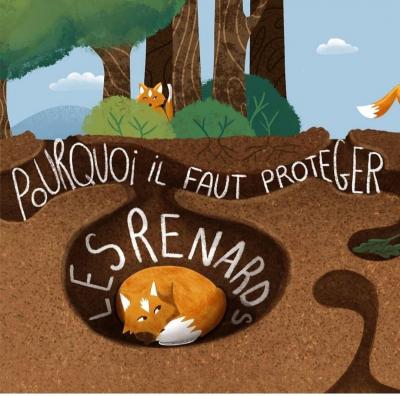
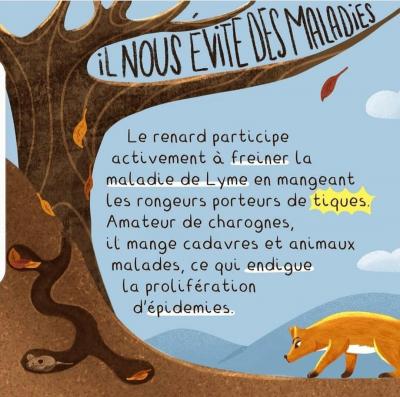



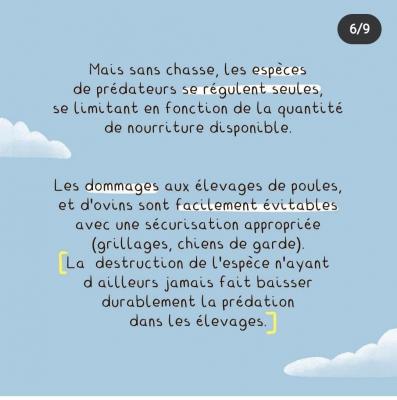
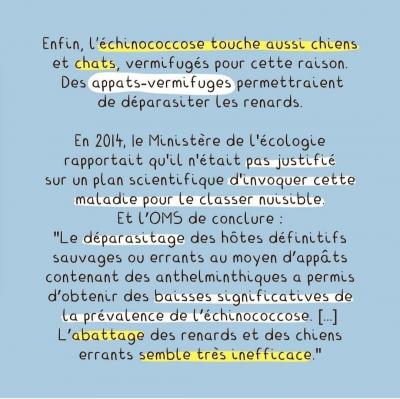
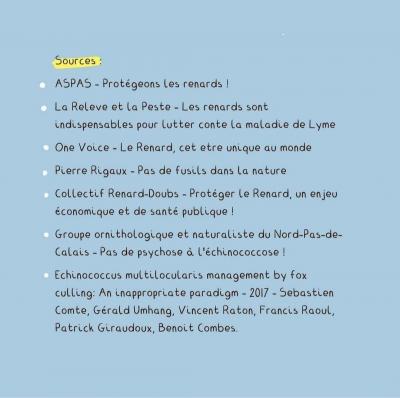
Il faudrait que les chasseurs apprennent diverses choses sur la nature. C'est vraiment urgent...La régulation des espèces est un phénomène naturel. L'intervention de l'homme est inévitablement désastreuse.
Déséquilibres dans les relations trophiques
le terme « trophique » se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition ; on appelle réseau trophique l'ensemble des chaînes alimentaires à l'intérieur d'un écosystème.
Le campagnol est un micro-mammifère herbivore, à la base d'une chaîne alimentaire relativement complexe. Quelles sont les relations prédateur-proie dans cette chaîne ?
Le renard roux chasse, entre autres proies, le campagnol terrestre.
Le renard roux est un prédateur généraliste vis-à-vis du campagnol : il n'est pas « spécialisé » dans cette proie ; il peut très bien chasser d'autres proies et se nourrir même d'insectes si les conditions sont défavorables3 (p. 12). S'il n'y a plus assez de campagnols, il se reporte sur le lièvre. On observe ainsi que plus il y a de campagnols, plus il y a de lièvres (et inversement : les années où les campagnols sont rares, il y a moins de lièvres) 3 (p. 11). On dénombre d'autres prédateurs généralistes vis-à-vis des campagnols : fouine, martre, milan royal, buse variable, faucon crécerelle...
La belette est un prédateur spécialiste du campagnol.
Il existe aussi des prédateurs spécialistes pour le campagnol : hermine, belette, busard cendré... Leur nombre suit , avec un certain retard, le nombre de campagnols. Mais s'il n'y a pas assez de prédateurs généralistes (par exemple les renards) quand la population de campagnols augmente, les prédateurs spécialistes ne sont pas assez nombreux pour éliminer les campagnols excédentaires ; le nombre de campagnols augmente, jusqu'à épuisement des disponibilités alimentaires (les végétaux) ou à cause du parasitisme ou des maladies ; plus tard dans le cycle, quand le nombre de campagnols retombe au plus bas, les prédateurs spécialistes meurent de faim. Ils ne seront plus là pour réduire les excédents de campagnols quand les conditions (alimentation, prédation, autres) seront réunies pour que le cycle du nombre de campagnols reparte à la hausse.
-
Sans glyphosate
- Par Thierry LEDRU
- Le 20/05/2021
https://www.bastamag.net/agriculture-sans-pesticides-glyphosates-desherbant-RoundUp-vignerons-pollution-des-eaux-cancerogene?fbclid=IwAR0OivyRSt68Y5EobCOY_cJZBOAZDTAMS0BQGP7GQx1_pYk65nnheDOyIos
« J’adore faire ça, c’est noble de travailler la terre » : ces agriculteurs qui bannissent les pesticides
PAR LOLA KERARON 20 MAI 2021
Préserver la ressource en eau, prendre soin de sa santé, apprendre à respecter la terre : les motivations des agriculteurs qui décident de se passer de pesticides varient. Sommés de revoir leurs méthodes de travail, ils découvrent parfois un nouveau métier.
« Depuis 2017, je n’ai pas appliqué une goutte de désherbant sur mes parcelles », indique Florian Bonneau, vigneron dans le Muscadet, à l’est de Nantes. Il y a cinq ans, après une formation d’ingénieur agronome, le jeune homme a rejoint son père à la tête du domaine familial. Les 15 hectares de vigne étaient cultivés en « conventionnel » ; c’est-à-dire avec usage de pesticides de synthèse, et notamment d’herbicides épandus au pied des ceps pour éviter que les mauvaises herbes, en retenant l’humidité, ne favorisent le gel et les maladies. « Mettre un produit chimique alors que je travaille avec du vivant, cela ne me paraissait pas sensé », raconte Florian qui s’est assez vite interrogé sur ce mode de production.
« Quand le Roundup est sorti, on avait l’impression que c’était un produit miraculeux »
Une formation l’a finalement convaincu de franchir le pas. Le discours d’un des formateurs, alertant sur les hauts niveaux de pollution des eaux au glyphosate, l’a particulièrement marqué. Ce produit, et son métabolite AMPA (c’est à dire l’une de ses molécules de dégradation), sont les deux premières substances quantifiées dans les eaux souterraines [1]. Florian décide alors de passer du désherbage chimique au désherbage mécanique. Pour Daniel, son père, c’est un retour dans le passé. Il avait vu le sien faire la démarche inverse : abandonner le travail de la terre pour adopter les herbicides synthétiques, considérés à l’époque comme des symboles de modernité.
Commercialisé depuis 1974 par Monsanto, sous le nom de Roundup, le glyphosate est un désherbant utilisé massivement car très peu cher et très efficace. « Quand il est sorti, on avait l’impression que c’était un produit miraculeux », se souvient Joseph Pousset, agriculteur dans une petite ferme biologique en Normandie. L’emballage était vert et la rumeur circulait que l’on pouvait même en boire sans aucun danger [2]. Classé « substance cancérigène probable » par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) en 2015, le glyphosate a fait l’objet d’âpres débats parlementaires en France ces dernières années, autour de son interdiction éventuelle. Promise par Emmanuel Macron en 2017, cette interdiction a finalement été remplacée par un objectif de diminution de 50 % de son utilisation d’ici 2022 [3]. Avec près de 10 000 tonnes vendues en 2018, le glyphosate reste pour le moment le deuxième pesticide le plus consommé en France. En tête de liste des cultures les plus consommatrices : la vigne et les grandes cultures céréalières (blé, maïs, avoine, etc.).
« C’est sûr que le travail du sol, c’est plus long que le désherbage chimique »
Quand il a décidé de renoncer aux herbicides, Florian a tout de suite été soutenu par son père, qui avait pourtant l’habitude de s’en servir. « Beaucoup de parents n’auraient pas réagi comme ça. J’ai eu de la chance », confie Florian. Avant d’investir dans un nouvel équipement coûteux, le jeune vigneron commence par tester le travail du sol avec ce qu’il a sous la main. « J’ai ressorti la charrue en parfait état de mon grand-père », raconte-t-il. Heureusement, son père se souvient du mode d’emploi pour la monter et la régler. « Si je n’avais pas eu son expérience, je pense que j’aurais bien galéré », se rappelle Florian. Labourer la terre entre les rangs, la ramener au pied de chaque ceps pour étouffer l’herbe avant l’hiver puis l’enlever quelques mois plus tard : se passer d’herbicide exige de la patience et de la précision car il ne faut pas abîmer les ceps avec les machines. « Il faut cinq passages dans les vignes contre deux avec du désherbant », explique Florian.
Florian Bonneau, vigneron en conversion bio dans la vallée de la Loire : « Mettre un produit chimique alors que je travaille avec du vivant, ça ne me paraissait pas sensé. »
« C’est sûr que le travail du sol, c’est plus long que le désherbage chimique, confirme Thierry, également vigneron en Vendée entre marais salant et océan. Dans les années 1990, après dix ans de « conventionnel », il a converti le domaine familial en biodynamie. « J’ai ramé pendant les premières années », se souvient-il. Passionné, son fils Antoine qui l’a rejoint depuis sept ans ne se verrait pas faire autrement. « J’adore faire ça. Il se passe quelque chose, il y a de la vie, s’enthousiasme le jeune vigneron. C’est noble de travailler la terre. » C’est aussi pourvoyeur d’emplois : il faut dix équivalents temps plein pour s’occuper des 40 hectares de vignes de Thierry.
Abandonner la chimie pour préserver la santé publique
« Si tu prends en compte dans la balance le traitement de tous les gens atteints d’un cancer, ce n’est pas plus cher de travailler la terre que d’utiliser des herbicides », souligne Thierry. [4] Ce n’est pas Samuel, qui tient avec son frère une ferme dans le Perche en Normandie qui dira le contraire. À 37 ans, alors qu’il est agriculteur depuis vingt ans, il apprend qu’il a un cancer. L’annonce de sa maladie a agi comme un déclic : du jour au lendemain, les deux frères décident que plus aucun produit chimique de synthèse ne sera épandu sur leurs 500 hectares de céréales et de prairies. Trois ans plus tard – le temps nécessaire pour accomplir une « conversion » – leurs terres sont labellisées AB. « On a presque changé de métier », s’exclame Samuel, en expliquant qu’ils ont dû complètement revoir leur calendrier et leur système de culture. « On ne peut plus alterner le blé, l’orge et le colza sans se poser de questions comme en conventionnel », témoigne-t-il. Maîtriser les mauvaises herbes sans chimie, cela exige de la diversité.
« On s’adapte en permanence à l’état de la parcelle », reprennent Samuel et Patrick, qui passent beaucoup de temps à observer leurs champs avant de décider ce qu’ils vont semer. Certaines cultures dites « nettoyantes » comme l’avoine et la vesce étouffent les mauvaises herbes alors que d’autres cultures dites « salissantes » comme le blé sont plus sensibles. Le principe est d’alterner ces deux types de cultures. D’autres stratégies sont développées pour maîtriser la flore spontanée : introduction de prairies temporaires, mise en place de couverts végétaux, travail du sol pour ramener les graines d’adventices en surface et détruire rapidement les jeunes pousses…
« Banquier, conseiller technique, comptable : à l’époque, tout le monde disait à mon grand-père de passer aux herbicides »
Les plantes spontanées, souvent appelées « mauvaises herbes », produisent énormément de graines, qui se retrouvent endormies dans les sols en attendant les conditions favorables pour se réveiller, et notamment la fin de l’usage des pesticides. Avec des dizaines de milliers de graines par mètre carré, « le stock de graines dans le sol est une véritable bombe à retardement », s’exclame Joseph Pousset. D’où l’importance de ce travail du sol, pour diminuer peu à peu les adventices.
Attachés à leur indépendance, Samuel et son frère n’ont jamais eu recours aux services des conseillers agricoles, ce qui a facilité selon eux leur conversion. Généralement employés par de grosses coopératives, ces conseillers sillonnent les campagnes pour délivrer leurs avis sur le travail des agriculteurs. Pendant longtemps, c’était aussi eux qui leur vendaient des pesticides. « La vente de phytosanitaires est l’activité la plus rentable pour les coopératives », remarque Samuel.
Thierry Michon, vigneron en biodynamie en Vendée : « Si tu comptes le prix du traitement de toutes les personnes atteintes d’un cancer, ce n’est pas plus cher de travailler la terre que de traiter avec des herbicides. »
Peu coûteux à produire et vendus cher aux agriculteurs, les pesticides constituent une des principales sources de profits des coopératives agricoles. « L’agriculture biologique ne se développe pas vite parce que ces gens-là sont sur le terrain à faire de la propagande », observe Samuel. Florian approuve : « Banquier, conseiller technique, comptable : à l’époque, tout le monde disait à mon grand-père de passer aux herbicides. Aujourd’hui, ce sont les utilisateurs qui sont montrés du doigt. »
« J’ai une culture qui peut se passer de glyphosate. Si je peux éviter d’en rajouter dans les eaux que nous buvons, ce n’est pas plus mal »
On ne peut pas substituer les désherbants chimiques par des produits naturels non toxiques. « Se passer d’herbicides est un raisonnement global », souligne Joseph Pousset. Après avoir vu ses parents, petits paysans bretons, pris en tenaille entre l’augmentation des prix des produits de synthèse et la baisse des prix de vente de leur production, il s’est installé en Normandie dans une ferme de 25 hectares pour promouvoir une agriculture naturelle. C’est ici qu’il expérimente depuis plus de trente ans des pratiques agroécologiques. « La première chose à faire, c’est de préserver les milieux », affirme-t-il. Haies, zones humides, c’est l’écosystème dans son ensemble qui participe au contrôle de la flore spontanée. Par exemple, quand une mauvaise herbe pousse sur une parcelle et que ces graines sont portées dans le vent, la haie va la bloquer, et éviter la parcelle voisine d’être contaminée.
Plus complexe, l’agriculture sans pesticides n’implique pas toujours un temps de travail plus élevé. Samuel et Patrick assurent ainsi que leur charge globale de travail n’a pas augmenté. Les résultats, cependant, sont tout aussi satisfaisants ; leurs champs n’ont pas plus de mauvaises herbes qu’au temps où ils utilisaient du glyphosate. Florian fait le même constat dans ses vignes, dont le rendement n’a pas bougé : « J’ai une culture qui peut se passer de glyphosate. Si je peux éviter d’en rajouter dans les eaux que nous buvons, ce n’est pas plus mal. »
Les systèmes économiques doivent souvent être repensés. Florian, par exemple, a tout revu. « Avant j’avais 30 hectares, dont 15 étaient vendus en négoce. » Passer la totalité des parcelles en bio n’était pas jouable, à cause de la charge de travail supplémentaire. Florian a donc décidé de se passer des terres dont il vendait la production à un négociant, sans maîtrise sur les coûts d’achat, et avec des marges très faibles. En privilégiant la qualité à la quantité, Florian valorise mieux son vin, qu’il commercialise directement à des clients connaissant ses pratiques. Le bilan est positif : il s’en sort mieux qu’avant et il est plus serein.
Après vingt ans d’expérience, Thierry constate d’importants bénéfices secondaires à la pratique d’une agriculture sans chimie. « À partir du moment où le sol est travaillé, tu casses la croûte en surface, explique le vigneron. Le sol retient mieux l’eau. » Un avantage non négligeable en cas de sécheresse comme en 2003, année particulièrement difficile [5]. « En biodynamie, on n’a perdu que 5 %, alors que mes collègues en conventionnel, ils ont perdu la moitié de leur récolte », se rappelle Thierry. Comme Florian et Thierry, de plus en plus de vignerons choisissent d’abandonner les pesticides. En 2019, 14 % des vignes françaises étaient cultivées selon le cahier des charges de l’agriculture biologique, bien au-dessus de la moyenne nationale des terres cultivées en bio (8,5%). Les consommateurs ne sont donc pas les seuls à être plus nombreux à préférer l’agriculture sans pesticides. Qu’attendent les politiques pour accompagner et soutenir financièrement les agriculteurs qui souhaitent se convertir ?
Lola Keraron (texte et photos)
Photo de une : Lola Keraron
À lire, sur le même sujet :
- Pourquoi la FNSEA est-elle accro au glyphosate ?, le 25 octobre 2017
 Sous la pression des lobbies, le gouvernement renonce à interdire le glyphosate, le 26 septembre 2017
Sous la pression des lobbies, le gouvernement renonce à interdire le glyphosate, le 26 septembre 2017
 Pesticides : le changement, c’est pour quand ?, le 10 mai 2012
Pesticides : le changement, c’est pour quand ?, le 10 mai 2012
 Des centaines de « pisseurs volontaires » partent en campagne contre l’empoisonnement au glyphosate, le 24 mai 2019
Des centaines de « pisseurs volontaires » partent en campagne contre l’empoisonnement au glyphosate, le 24 mai 2019Notes
[1] Voir cette étude de l’Institut technique de l’agriculture biologique.
[2] Voir cette interview d’un responsable de Monsanto invité à boire du glyphosate.
[3] Voir le tweet d’Emmanuel Macron ici.
[4] Selon une étude scientifique de 2016, les cancers attribuables aux pesticides, estimés à 1 % des cas, représentent un coût pour la société de 20 milliards de dollars par an aux États-unis.
[5] Une étude de l’INRA publiée en 2013, montre une meilleure résistance à la sécheresse dans les cultures en agriculture biologique.
-
Le blaireau
- Par Thierry LEDRU
- Le 19/05/2021
Pétition : Stop au déterrage du blaireau
Le blaireau, une victime innocente !
Alors que le blaireau est protégé dans de nombreux pays européens (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie…) car sa présence est le gage d’une nature préservée, il est chassable en France – alors que personne ne le mange – et chassé sans répit neuf mois et demi par an. Le pire étant le déterrage, ou vènerie sous terre.
Les blaireaux endurent des heures de stress, terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens – parfois même déchiquetés vivants pour les petits – pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre. Ils les extraient brutalement du terrier avec des pinces métalliques qui leur infligent d’atroces blessures. Les blaireaux sont alors exécutés avec un fusil ou une arme blanche.
C’est une pratique cruelle incompatible avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles.Le déterrage, barbarie d’un autre âge
À partir de l’ouverture générale de la chasse en septembre, le blaireau est chassé par tir jusqu’à fin février, et déterré jusqu’à mi-janvier. Le déterrage peut être prolongé sur simple volonté du préfet et une période complémentaire de chasse peut être autorisée par arrêté préfectoral dès le 15 mai, période où les blairelles s’occupent encore de leurs petits, incapables de se nourrir seuls et extrêmement vulnérables.
> Consulter la carte de France 2020 du déterrage
> Les arguments de l’ASPAS pour demander l’interdiction du déterrageStop au déterrage des blaireaux !
Votre signature a été ajoutée. Pour renforcer cette action, n'hésitez pas à partager cette pétition autour de vous !
116,855 signatures = 78% de l’objectif
0 150,000
Partagez la pétition :
L’ASPAS en action
Luttant depuis presque 40 ans pour la protection des animaux sauvages, l’ASPAS :

s’oppose fermement à la pratique brutale et injustifiée du déterrage ou vénerie sous terre.
sensibilise l’opinion publique sur l’utilité écologique du blaireau et à l’aberration du déterrage à travers ses brochures, ses communiqués de presse et son magazine trimestriel Goupil.
demande au ministère de l’Écologie l’abolition du déterrage et le classement du blaireau en espèce protégée.
Vous pouvez en savoir plus sur le déterrage en consultant le dépliant « Stop au déterrage des blaireaux ».
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la biologie du blaireau et sur son statut en France, commandez la brochure ASPAS Vive le blaireau !
L’ASPAS soutient l’action d’autres associations
MELES
Créée par Virginie Boyaval en 2005, l’association MELES est à la fois un centre de soins et un centre d’études en faveur du blaireau européen. Dans sa dernière vidéo publiée le 9 mai 2020, Virginie explique comment elle réhabilite les blaireautins orphelins, recueillis après un acte de déterrage de chasseurs ou d’une collision routière.BLAIREAU & SAUVAGE
Jeune association créée en 2018, Blaireau & Sauvage s’est donnée pour mission d’étudier, de sensibiliser, et de protéger le blaireau. Une campagne de recensement des terriers a notamment été lancée en 2019. >> En savoir plusLPO ALSACE ET GEPMA : intervenir sans massacrer !
L’initiative est assez unique en France. Le pôle Médiation Faune Sauvage (pôle MFS) de la LPO Alsace et du GEPMA (Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace) œuvre depuis 2008 en faveur d’une meilleure cohabitation entre la faune sauvage et les humains. Il intervient entre autres dans les situations impliquant le blaireau d’Europe, que ce soit au sein d’exploitations agricoles, au pied d’infrastructures de transports ou de digues, dans des terrains publics communaux et même chez des particuliers. Le pôle MFS s’efforce de systématiquement trouver des solutions adaptées à chaque situation, dans la durée, permettant de limiter ou neutraliser les gênes occasionnées en préservant la vie de ces animaux mal connus. >> En savoir plusLa pratique barbare de la chasse au blaireau doit cesser
https://lareleveetlapeste.fr/la-pratique-barbare-de-la-chasse-au-blaireau-doit-cesser/
Bien souvent, les chasseurs détruisent bien plus les cultures en traquant les blaireaux que les blaireaux eux-mêmes ! Quant à la tuberculose bovine, ce sont les pratiques de déterrage qui sont les plus susceptibles de la disséminer

20 mai 2020 - Augustin Langlade

Envie d’une vraie déconnexion ? Évadez-vous avec notre bande dessinée !
- Thème : effondrement de la société, abordé de manière douce et positive
- Format : 128 pages
- Impression : France
La polémique de la « vénerie sous terre », plus connue comme la chasse annuelle au blaireau, vient d’atteindre l’Assemblée nationale. Vendredi 15 mai, un groupe de vingt-deux parlementaires, sous l’impulsion du député LREM des Alpes-Maritimes Loïc Dombreval, a écrit une lettre à la ministre de la Transition écologique et solidaire pour lui demander de « mettre fin à ce mode de chasse totalement contraire à la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles ». L’Aspas a pour sa part mis en ligne une pétition.
La vénérie, une pratique de chasse cruelle
La vénerie sous terre est une pratique de chasse traditionnelle qui consiste à massacrer des familles entières de blaireaux directement dans leurs terriers.
Au petit matin, les chasseurs répartis en équipes traquent les tanières de ces animaux nocturnes. Quand ils en découvrent une, au creux da la forêt, ils commencent par effrayer les bêtes à l’aide de scies ou de pelles, en faisait un boucan du tonnerre qui ne manquera pas de jeter la terreur sur le bocage. Puis ils lâchent les chiens, qui se jettent la tête la première au fond du terrier et tentent de mordre les blaireaux qui s’y recroquevillent, pendant que d’autres chasseurs de l’équipe bouchent les sorties et creusent des trous pour les déterrer.
Au bout d’un moment, lorsque les chiens n’ont pas déchiqueté vivants les petits, les puits sont achevés et les blaireaux sont débusqués à l’aide de pinces métalliques qui leur infligent des blessures dignes d’instruments de torture. Enfin, les blaireaux sont exécutés par un tir de carabine ou avec des armes blanches, dagues, couteaux, barres à mine…
Voilà la réalité de cette chasse qu’on prétend traditionnelle pour la défendre, alors qu’elle tout bonnement dépassée. Une enquête vidéo de l’association de défense des animaux One Voice, publiée le 28 avril 2020, a montré que les chasseurs se permettent toutes les cruautés envers les animaux, même les plus inutiles.
Pendant des heures, les blaireaux — et ceci s’applique également pour les renards — sont harcelés, violentés, blessés, les chasseurs allant jusqu’à ensanglanter leurs propres chiens quand ils refusent d’obéir.

Terrier de blaireau, Bois de la Fontaine, Pagny-le-Château (Côte d’Or, Bourgogne, France) – Bertrand GRONDIN
Le blaireau, une espèce protégée en Europe
Dans la plupart des pays d’Europe, le blaireau est une espèce protégée et le loisir du déterrage une pratique formellement interdite. Mais en France, au contraire, les 40 000 adeptes de cette barbarie sont autorisés tous les ans à chasser 12 000 blaireaux sous terre et à en tirer 10 000, du 15 septembre au 15 janvier pour la vénerie et jusqu’à fin février pour la chasse à tir.
Chaque année, ce sont donc 22 000 bêtes en moyenne qui périssent en pure perte, puisque personne ou presque ne mange de blaireau et que nous n’avons guère besoin de sa fourrure pour nous vêtir. Depuis 1988, le blaireau n’est plus classé comme « nuisible » mais demeure considéré comme « gibier » ; de ce fait, on peut le chasser.
En sus de ces périodes de chasse fixes, au printemps, les préfectures publient des projets d’arrêtés autorisant des périodes complémentaires de déterrage des blaireaux, qui peuvent différer d’un département à l’autre, mais étendent en général l’autorisation de chasse du 15 mai au 15 septembre, le plus gros mustélidé ne disposant plus que de deux mois et demi de répit dans l’année.
Cette année, alors que tout semblait normal et que les concertations locales allaient bon train, c’est un arrêté de la préfecture de Saône-et-Loire qui a mis le feu aux poudres. Le 11 mai, le préfet y a décidé de déconfiner également la chasse, en décrétant que la vénerie sous terre était autorisée à partir du 15 mai.
Manque de chance, la section locale d’Europe-Écologie-Les Verts a repéré l’arrêté et s’est indigné, dans un communiqué du 15 mai, que le blaireau puisse être « chassé sans répit neuf mois et demi par an » en France, tandis que « sa présence est le gage d’une nature préservée ».
Aucune étude scientifique ne permet de connaître la population réelle de cette espèce, dont le taux de reproduction est faible (entre deux et trois jeunes par an et par femelle) et dont les effectifs sont toujours surestimés par les chasseurs. L’extension de la vénerie sous terre est un double crime, étant donné que la période de dépendance des blaireautins n’est pas achevée avant le mois d’août.
Toujours le 15 mai, les vingt-deux députés, qui se déclarent dans cette affaire « transpartisans », ont sommé la ministre Élisabeth Borne de mettre un terme définitif au déterrage. Confiant à L’Express sa détermination à porter la question de la vénerie sous terre devant l’Assemblée, le député Loïc Dombreval a déclaré que :
« les méthodes de chasses dites traditionnelles sont toutes plus odieuses les unes que les autres. Qu’elles disparaissent, cela rendrait service aux chasseurs. C’est dégradant pour l’animal et pour ceux qui la pratiquent. On peut faire ça progressivement, mais il faut arrêter l’hypocrisie. »

Crédit : andy ballard
Des accusations infondées contre le blaireau
Les chasseurs accusent les blaireaux de saccager les récoltes, de mettre en danger les infrastructures (lorsque leur comportement terrassier leur fait construire des galeries sous les voies ferrées ou dans les digues), et d’être des réservoirs de tuberculose bovine, une maladie infectant de nombreuses espèces domestiques et transmissible à l’homme. Mais ces accusations sont infondées.
Les dégâts qu’on impute au blaireau sont en très grande partie localisés à la lisière des forêts ; en ce sens, on les confond avec ceux du sanglier, une espèce autrement plus endémique. Une clôture électrique ou un répulsif suffiraient à éloigner les blaireaux, qui apprécient certes les légumes, mais sont relativement discrets et peureux.
Pour preuve, bien souvent, les chasseurs détruisent bien plus les cultures en traquant les blaireaux que les blaireaux eux-mêmes ! Quant à la tuberculose bovine, ce sont les pratiques de déterrage qui sont les plus susceptibles de la disséminer : en témoigne un arrêté ministériel du 7 décembre 2016, interdisant dans certaines zones à risque :
« la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée, en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ».
Selon un sondage Ipsos de 2018, 83 % des Français sont en faveur de l’interdiction pure et simple de la vénerie sous terre, presque autant que pour le piégeage des oiseaux à la glu. Qui plus est, 73 % des sondés ne savaient pas même que ce type de chasse pouvait encore exister. Ce sondage montre également qu’une écrasante majorité des personnes interrogées « estime que la chasse représente une menace pour l’environnement », ainsi qu’une pratique dangereuse et cruelle, véritable plébiscite en faveur d’une réforme radicale.
Dans la description de sa carte de France 2020 du déterrage, l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) indique que près de 50 consultations publiques se terminent le 20 mai 2020 et invite tous ceux qui en ont le temps et l’énergie à y participer.
« Si nous ne pouvons pas garantir que les préfets tiendront compte de l’avis des citoyens, il est inconcevable de laisser toute la place aux arguments fallacieux des chasseurs. Sur le plan symbolique et médiatique, il est important de remporter la victoire de l’opinion ! Plus les citoyens manifesteront leur opposition à ce mode de chasse barbare, plus notre demande de réforme sera audible et légitime », affirme l’Aspas dans sa publication.
Qu’on puisse ou non y participer, il est toujours possible de signer une pétition sur internet, exigeant l’interdiction totale du déterrage. Celle-ci a déjà récolté plus de 100 000 signatures.
-
La psychologie préventive
- Par Thierry LEDRU
- Le 17/05/2021
Le drame des Cévennes : deux morts, deux familles brisées, un jeune homme qui sortira de prison dans une vingtaine d'années, sa propre famille anéantie.
J'en parlais justement avec ma femme hier. Après avoir été institutrice pendant vingt ans, elle est retournée à la FAC. Licence puis master de psychologue clinicienne et retour dans la fonction publique comme psychologue scolaire. Elle ne voulait pas ouvrir de cabinet privé mais elle voulait permettre aux enfants et aux parents de bénéficier de cette structure d'aide dans le cadre de l'école publique (et donc gratuite.)
Elle a très vite mis en place un "point écoute" dans lequel les enfants pouvaient laisser un mot dans une boîte aux lettres à la porte de son bureau.(en plus de son travail dans les classes et avec les enseignants et les parents et les différentes structures) Rapidement les enfants des écoles où elle intervenait lui ont écrit. Des mots parlant de difficultés relationnelles à l'école ou dans les familles. Elle recevait les enfants et ils discutaient.
L'effet était considérablement positif. Le constat était simple : les enfants avaient besoin d'exprimer TOUS les mal-être, tous les problèmes, toutes les inquiétudes, toutes les interrogations et même s'il n'y avait pas toujours de réponse permettant de solutionner la problématique, le fait de pouvoir simplement en parler avec une personne "neutre" allégeait profondément le trouble. Les enfants parlaient entre eux de la "psychologue" et ils attendaient avec impatience que Nathalie vienne les chercher en classe pour ce moment d'échange.
J'ai vécu une période très compliquée à mon adolescence. Mon frère, plus âgé, s'est crashé en voiture. Cliniquement mort. Je suis resté à l'hôpital, dans sa chambre, pendant deux mois et demi, toutes les vacances scolaires d'été. Service de neuro-chirurgie. A chacune des opérations qu'il a eues, je n'étais pas certain de le voir revenir. Mes parents travaillaient et me rejoignaient le soir. Une période très dure pendant laquelle, j'ai vu mon meilleur ami de classe mourir à la suite d'un accident de mobylette. La seule nuit où je ne suis pas allé le voir, il est mort. J'aurais eu besoin, considérablement besoin d'une aide psychologique. Tout comme mes parents. Mon frère a survécu et est sorti de l'hôpital. Il est mort vingt ans après d'une hémorragie cérébrale. Mes parents ne s'en sont jamais remis. Et là encore, aucune aide psychologique.
Aujourd'hui, mes parents ont 85 ans et sont tous les deux frappés par la maladie d'Alzheimer et de démence sénile. Rien, aucun accompagnement psychologique, aucune aide, aucune prise en charge émotionnelle.
Le constat est simple : nous manquons considérablement d'aide d'ordre psychologique. La solution est simple. Des cabinets de psychologues dans le cadre de la fonction publique, prise en charge par la sécu. Les enfants dont ma femme s'occupait n'avaient aucun problème à venir la voir, ils avaient juste hâte qu'elle trouve un moment pour les recevoir. Ils n'avaient aucune idée préconçue au regard de cette aide psychologique.Mes parents, de leur côté, n'auraient jamais accepté et ils ne l'acceptent toujours pas aujourd'hui. "On n'est pas fous". C'est une question d'éducation et c'est pendant l'enfance que ça doit se mettre en place.
Il y a énormément de problèmes qui pourraient être résolus, dans les couples, dans les entreprises, dans les familles, pour de multiples situations.
Lorsqu'il y a un attentat ou une catastrophe naturelle, on voit des cellules psychologiques qui sont proposées. Il ne faudrait pas attendre ces situations de crises. Il faut anticiper...Quel serait le coût n'est pas un problème si on pense à tous les dégâts qui seraient évités, dégâts psychologiques et par contre-coup physiques. Ne serait-ce que le coût des traitements par antidépresseurs. C'est en anticipant qu'on empêche les dégradations.
Sans doute, par contre, que les laboratoires pharmaceutiques verraient d'un très mauvais oeil une prise en charge psychologique, en amont des troubles qu'ils sont censés "guérir"...
L'aide psychologique est un garde-fou et le terme est particulièrement adapté dans le drame des Cévennes et il y en a beaucoup d'autres.
Mais c'est justement cette association avec le domaine de la folie qui pose problème pour la majotité des individus. C'est pour cela qu'il faut engager ce processus dans l'enfance, lorsque les conditionnements n'ont pas encore établi leurs limites.
Encore faut-il que les parents l'acceptent...
Si on pense par exemple aux groupes de paroles pour les personnes qui souffrent d'addictions, alcool ou autres, le suivi psychologique dans le cas de drames, deuils, maladies, attentats, traumatismes de toutes sortes, on sait que cet accompagnement a un impact positif, parfois considérable, parfois même salvateur. Mais le problème, c'est que cela n'arrive qu'à la suite d'épreuves. Il n'y a pas d'anticipation. Bien évidemment qu'on ne peut pas prévoir qu'un jour, on peut être pris dans un attentat, en réchapper et en souffrir psychologiquement. Mais si l'habitude du soutien psychologique avait été prise dès l'enfance, bien des situations douloureuses, inextricables, seraient résolues ou pourraient être atténuées.
La dimension psychologique, les bienfaits de la parole partagée, les dialogues, l'écoute émanant d'un professionnel, d'une personne "neutre", sachant analyser les mots, les regards, les postures, les silences...Combien de drames seraient évités si tout cela était valorisé à sa juste valeur ?
Les Indiens Kogis organisent des cercles de paroles où chacun est invité à exprimer ses problèmes et où des "chamans" interviennent pour réguler les troubles, apporter des voies de réponses.
Prendre exemple sur des peuples "primitifs." Non, non, ça serait trop humiliant...Les laboratoires pharmaceutiques et la médecine occidentale sont là pour nous sauver. Oui, c'est certain, ça fonctionne aussi. Je ne le nie pas. Mais ça fonctionne quand le problème est déjà là.
La psychologie préventive n'oeuvrerait pas uniquement dans le constat mais principalement dans la protection. Afin que le problème meure dans l'oeuf et n'éclose pas.











