Blog
-
Simona Kossak
- Par Thierry LEDRU
- Le 28/08/2025
Quand je pense aux scénarios de cinéma, type "super héros" ou des bidules déjà scénarisés X fois, genre la soupe cuite et recuite au fond du chaudron, et que je lis cette histoire fabuleuse, je me dis que les scénaristes et les gens du cinéma en général, devraient sortir de leur zone de confort et s'intéresser vraiment aux gens qui ont une vraie existence, quelque chose de fabuleux, quelque chose qui fait d'eux des êtres extraordinaires et qui en même temps nous amène à réfléchir sur nos propres existences, sur nos choix, sur notre train-train, sur notre formatage, nos peurs, nos limites, notre abandon au regard d'une vie hors cadre, celle qui reste possible, celle qu'on peut saisir, celle qui nous permettra de mourir rassasiés.
La biologiste Simona Kossak a vécu plus de 30 ans dans la forêt entourée d’animaux
Considérée par les habitants comme un esprit de la forêt, « celle qui parle et marche avec les animaux », Simona ne se contentait pas de les soigner mais était leur véritable protectrice.
https://lareleveetlapeste.fr/la-biologiste-simona-kossak-a-vecu-plus-de-30-ans-dans-la-foret-entouree-danimaux/
Texte: La Relève et La Peste Photographie: Lech Wilczek 26 août 2025
Pendant plus de 30 ans, la zoologue Simona Kossak a vécu au cœur de l'une des dernières forêts primaires d'Europe, sans électricité ni eau courante. Elle était entourée de ses compagnons sauvages : une corneille cleptomane, un lynx nommé Agatka et un sanglier gigantesque. Avec son compagnon photographe Lech Wilczek, elle a passé sa vie à étudier les animaux et se lier d’amitié avec eux. Elle s'est battue pour la protection des forêts les plus anciennes d'Europe. Simona croyait qu'il fallait vivre simplement, et proche de la nature.
Un chalet sans eau ni électricité
C’est une histoire digne d’un conte de fées. Entre la Biélorussie et la Pologne, la biologiste polonaise Simona Kossak (1943-2007) a vécu dans un ancien pavillon de chasse au cœur de la forêt de Białowieża. Les habitants alentour l’appelaient sorcière, parce qu’elle bavardait avec des animaux et vivait avec un corbeau au fort caractère, qui volait de l’argent et attaquait les cyclistes. Un lynx a dormi avec elle dans son lit, et un sanglier apprivoisé vivait sous le même toit qu’elle.
Issue d’une célèbre lignée d’artistes polonais, elle a été mal acceptée par sa famille à cause de son manque de talent créatif et une lèvre fendue. Enfant, elle a trouvé a trouvé du réconfort dans les animaux qui abondaient autour de sa maison de campagne. Adulte, elle a choisi l’isolement en pleine nature et le langage de la forêt plutôt que le monde moderne.

Simona et Korasek © Lech Wilczek
Après avoir obtenu son diplôme en zoologie et comportement animal à l’Université Jagellonne de Cracovie en 1970, elle a travaillé à l’Institut de recherche sur les mammifères du parc national de Białowieża. C’est là, dans la dernière forêt primaire d’Europe, qu’elle a trouvé sa maison, un pavillon de chasse délabré appelé Dziedzinka. Signe du destin, un auroch, ancêtre aujourd’hui éteint de la vache, a croisé son chemin.
« C’était le premier auroch que je voyais de ma vie – sans compter ceux du zoo. Cet auroch monumental, ce blanc immaculé partout, […] et cette petite cabane cachée dans la clairière toute enneigée, une maison abandonnée que personne n’avait habitée. J’ai regardé cette maison en ruines, ceinte d’un halo argenté par la lune, et je me suis dit : « C’est ici ou nulle part ailleurs ! » a écrit plus tard la biologiste Simona Kossak

Dziedzinka © Lech Wilczek
Simona Kossak a demandé à ce que Dziedzinka devienne son logement de fonction. Les services forestiers ont réparé la maison, mais elle est restée sans électricité ni eau courante. Elle en a fait un centre d’étude des animaux de la forêt. Une chouette, plusieurs buses et un hérisson blessé s’installèrent également à Dziedzinka, puis, de façon inattendue, le photographe animalier et naturaliste polonais Lech Wilczek.
Après avoir obtenu l’autorisation des services du parc national, Lech Wilczek a emménagé dans la deuxième partie de la maison. Simona se méfiait de cet intrus. Mais grâce à l’amour pour la nature de Lech, les débuts difficiles se transformèrent en respect mutuel et cohabitation harmonieuse.

Simona Kossak au milieu des faons © Lech Wilczek
Simona Kossak, une vie dédiée aux animaux
C’est notamment l’adoption d’un bébé sanglier orphelin par Lech qui renforça le lien entre Simona et le photographe. Ils le baptisèrent Żabka – ce qui signifie « grenouille » en français – et s’occupèrent si bien de lui qu’il est devenu gigantesque. Des photos prises par Lech illustrent le lien qui unissait le sanglier aux deux humains qui l’ont élevé : on voit Żabka manger à table avec Simona, la câliner dans l’herbe et dormir dans son lit. Très sensible, Żabka est devenu le véritable gardien de Dziedzinka, et les visiteurs devaient s’en méfier.

Żabka et Simona © Lech Wilczek
Lech et Simona tombèrent amoureux, et il documenta leur vie commune extraordinaire pendant trois décennies à Białowieża. Le couple se lia d’amitié avec des dizaines d’animaux sauvages. Parmi eux, un corbeau nommé Korasek, qui attaquait les visiteurs et volait leurs objets dans leurs poches. Il y avait aussi la lynx Agatka, que Kossak appelait sa fille, un âne, une biche, les élans jumeaux Pepsi et Cola, une cigogne, des paons, des agneaux, et des rats.

Lech et Korasek
Considérée par les habitants comme un esprit de la forêt, « celle qui parle et marche avec les animaux », Simona ne se contentait pas de les soigner mais était leur véritable protectrice. Lorsqu’elle surprit un groupe de scientifiques utilisant des méthodes illégales pour braconner des carnivores à des fins de marquage, elle a subtilisé leur équipement, refusé de leur rendre et témoigné contre eux devant le tribunal.

Simona et l’un des élans jumeaux © Lech Wilczek
Durant son procès, à la question sur la menace que représentent de tels pièges pour les animaux, Simona Kossak répond : « Je pense que c’est un danger de mort pour ces animaux dont les blessures causées par ces pièges sont souvent fatales. Ces méthodes menacent notamment le Lynx d’Europe dont il ne reste que 12 individus dans cette forêt et qui ont un patrimoine génétique unique qui risque de s’éteindre à jamais. C’est une honte pour le monde de la science que nous ayons recours à de tels procédés. »

Simon et Agatka © Lech Wilczek
Elle a également contribué à la création du répulsif UOZ-1, un dispositif qui prévient les animaux sauvages de l’approche d’un train. En 1980, elle a obtenu un doctorat et, en 2000, le gouvernement polonais lui a décerné la Croix d’or du Mérite, la plus haute distinction civile, pour son travail et ses recherches en faveur de la protection de la forêt de Białowieża. En 2003, elle a été nommée directrice du Département des forêts naturelles, poste qu’elle a occupé jusqu’à sa mort en 2007.
Après sa mort, Lech Wilczek a continué à vivre à Dziedzinka. Il a poursuivi leur travail et a écrit la biographie de Simona, Meeting with Simona Kossak. Il est décédé en 2018. En 2022, le documentaire Simona est sorti. En 2024, le réalisateur Adrian Panek lui a consacré un film.
Simona et Lech ont passé leur vie dans cet écrin de forêt préservée, entourés des animaux qu’ils chérissaient tant. Leur amour l’un pour l’autre s’est développé au rythme de leur relation avec la nature, trouvant le contentement qui manquait dans le monde moderne au-delà de la lisière de la forêt.
Un autre monde est possible. Tout comme vivre en harmonie avec le reste du Vivant. Notre équipe de journalistes œuvre partout en France et en Europe pour mettre en lumière celles et ceux qui incarnent leur utopie. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.
-
Stress hydrique des arbres
- Par Thierry LEDRU
- Le 25/08/2025
A moins de vivre sans jamais regarder la nature autour de soi, tout le monde peut juger de la souffrance des arbres et de leur dépérissement.
Qu'en sera-t-il dans dix ans ?
Lesquels parviendront à s'adapter et à survivre ?
Demain, il est possible qu'il pleuve un peu ici et peut-être aussi les jours suivants. Mais pour le feuillage des chênes, c'est déjà trop tard. Même les robiniers faux-acacias, particulièrement résistants, jaunissent.
Entendre la pluie tomber, j'en rêve...
Je suis allé courir ce matin, un parcours dans des gorges, le long d'une rivière du secteur. Il n'y a plus de débit. Il ne reste que de rares flaques avec une eau croupie. Un habitant du coin, il vit là depuis trente ans, m'a dit que c'est la quatrième fois en cinq ans.
Il n'y a plus de poissons, plus rien, tout est mort.
Oui, je sais, tout ce que j'écris est désespérant.
Mais de quoi pourrais-je donc me réjouir ?
Je cours sous des arbres qui meurent, sur une herbe grillée, le long d'une rivière morte et je pense aux animaux qui cherchent un point d'eau.
En plein stress hydrique, les arbres arrêtent de respirer et transpirer
https://lareleveetlapeste.fr/en-plein-stress-hydrique-les-arbres-arretent-de-respirer-et-transpirer/
Avec une chute trop précoce des feuilles, l'arbre est en carence de carbone car il ne peut plus faire de photosynthèse et doit puiser dans ses réserves, « or, ils ont en besoin l’année suivante pour refaire des feuilles ».
Texte: Laurie Debove Photographie: Info Climat 25 août 2025
Partout en France, on observe un dépérissement précoce des arbres forestiers, et urbains, avec leur jaunissement et une perte de leurs feuilles en plein été. En cause : la sécheresse et les vagues de chaleur, qui ont mis les arbres en situation de stress hydrique. Un phénomène de plus en plus récurrent.
Le stress hydrique, un fléau pour les arbres
C’est un air sinistre d’automne, en plein été. Feuilles jaunes, trottoirs jonchés de feuilles mortes en plein mois d’août, forêts brûlées ou arbres marrons… Les arbres urbains et forestiers français sont rudement éprouvés.
« Ces phénomènes ont déjà été observés en 2003, mais aussi en 2022 en France », rappelle Brigitte Musch, cheffe de département ressources génétiques forestières à l’ONF, pour La Relève et La Peste. « Les années 2023 et 2024 ont été bénies pour les forestiers car il y avait des températures normales. Tout le monde s’est plaint d’un « été froid », mais ce n’était pas le cas ! Hélas on s’habitue à ces vagues de chaleur et ces sécheresses qui vont en s’amplifiant et en s’augmentant »
78% des stations météo françaises ont enregistré des records de températures ces dix dernières années. Or, quand les températures vont au-delà des normes acceptables pour les arbres, avec un seuil assez commun à 40°C, des défoliations (pertes de feuilles) et jaunissements se produisent.
« Comme nous, les arbres ont des systèmes de régulation : ils respirent et ils transpirent par leurs stomates (pores des feuilles). Cela leur permet de faire en sorte que la température à la surface des feuilles soit acceptable », précise Brigitte Musch. « Lorsque chaleur et sécheresse se conjuguent, les arbres, n’ayant plus d’eau à disposition à leur système racinaire, ferment leurs stomates pour éviter de transpirer et respirer »
L’arbre pompe l’eau du sol par ses racines. Cette eau se transforme en vapeur une fois arrivée au feuillage, puis relâchée dans l’atmosphère. La quantité d’eau rejetée par l’arbre à travers le phénomène d’évapotranspiration est très importante : 1 000 litres d’eau par jour pour un chêne, 75 litres d’eau pour un bouleau.

Les arbres perdent leurs feuilles à Paris – Crédit : Nicolas Berrod
Lorsque le réservoir en eau du sol n’est plus rempli qu’à 40 % et moins, les arbres sont en situation de stress hydrique. Les gros et vieux arbres, qui ont besoin de plus d’eau que les jeunes, sont particulièrement touchés. Leurs feuilles flétrissent, roussissent puis tombent pour lui permettre de faire des économies d’eau. C’est ce qu’il se passe actuellement.
« S’ils arrêtent de transpirer, on n’a plus cette humidité atmosphérique qui protège les feuilles des rayonnements du soleil », précise Brigitte. « Certains arbres ont eu leurs feuilles à moitié brûlée : elles sont restées vertes à l’ombre, tandis que la partie en plein soleil était brûlée »
Surtout, leur cycle de végétation est déjà bousculé par le réchauffement climatique : les arbres émettent leurs feuilles plus tôt et sont censés les perdre entre mi-octobre et fin octobre. « Là, la défoliation a commencé mi-août, donc c’est loin d’être négligeable », précise Brigitte Musch.
Ces moyens de défense affaiblissent aussi l’arbre. Avec une chute trop précoce des feuilles, l’arbre est en carence de carbone car il ne peut plus faire de photosynthèse et doit puiser dans ses réserves, « or, ils ont en besoin l’année suivante pour refaire des feuilles ». L’arbre devient moins apte à se défendre contre les insectes et les maladies.
« Quand chaleur et sécheresse se cumulent, des bulles d’air se forment dans les vaisseaux de l’arbre et empêchent la conduction de l’eau, créant une embolie qu’on appelle cavitation. Il peut y avoir un dépérissement des branches, une adaptation avec des feuilles de plus en plus petites », prévient l’experte en génétique des arbres Brigitte Musch.

Des centaines d’arbres ont viré au marron (en particulier les chênes) en août 2025 – Crédit : Catherine Mechkour – di Maria
La capacité d’adaptation des arbres
Un manque de réserves en carbone, un affaiblissement face aux ravageurs et des embolies peuvent entraîner le dépérissement de l’arbre, et à terme sa mort. Certaines espèces sont plus propices à faire des embolies comme les saules, alors que d’autres comme les cyprès, adaptés à des climats chauds, sont plus résistantes.
« Le hêtre est une espèce qui aime avoir la cime dans les nuages. Dans les montagnes, à l’endroit où sont les nuages, on est sûrs de trouver du hêtre. Quand cette sécheresse apparaît, ils se retrouvent dans des positions très inconfortables car ils sont très sensibles au coup de soleil au niveau de l’écorce qui peut se décoller », illustre Brigitte Musch.
Après avoir perdu ses feuilles suite à la sécheresse, sa capacité de guérison va dépendre de plusieurs choses. D’abord, l’automne à venir : « Si on a un automne doux et humide, les hêtres se mettent à re-débourrer, refaire des feuilles et entamer une phase de croissance, avec suffisamment de réserves pour re-synthétiser, mais les gelées précoces peuvent les abattre sans que des bourgeons aient pu se former » prévient Brigitte.
Cette année 2025, on se dirige pour l’instant vers un automne plutôt déficitaire en précipitations et doux à l’échelle du trimestre septembre-octobre-novembre. Le manque d’humidité pourrait aggraver l’état actuel des arbres.

A Eguzon, le paysage est déjà automnal malgré la présence de l’eau
« Les incendies empirent le phénomène car ils laissent des sols nus et compliqués pour la régénération et la plantation des arbres sans le couvert des grands arbres. Le deuxième problème, c’est la perte des graines des arbres qui n’ont pas fini leur cycle de maturation. Cette année les graines sont creuses, » avertit Brigitte Musch.
Les aires de répartition de certaines espèces s’amenuisent ainsi d’année en année, c’est le cas pour le hêtre. A l’inverse, d’autres espèces vont s’étendre car elles étaient limitées par le front hivernal : le chêne pubescent qui est déjà présent en Alsace, le chêne zéen du sud de l’Andalousie, le pin maritime, le chêne vert et le chêne-liège, l’érable de Montpellier.
Le dépérissement des arbres a un impact direct sur nos sociétés : l’évapotranspiration leur permet de stocker du carbone, nous apporter de la fraîcheur et contribue au cycle de la pluie. Certaines forêts sont désormais tellement dégradées qu’elles émettent du carbone au lieu d’en stocker.
« Le panorama n’est pas très optimiste, mais on a la chance d’avoir énormément de diversité génétique chez les arbres forestiers », pointe l’experte en ressources génétiques forestières.
L’ONF mise sur la régénération naturelle et sur l’adaptation d’une génération à l’autre pour aider les forêts à faire face au stress hydrique.
S’informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.
Laurie Debove
25 août 2025
-
Peter RUSSEL : "La Terre s'éveille"
- Par Thierry LEDRU
- Le 25/08/2025
Je reprends un article qui date de 2011 pour un ouvrage paru en 1982. C'était le premier article sur le blog qui évoquait la situation de la planète et de l'humanité. Ce qui me sidère, c'est de voir que depuis tout ce temps, l'humanité n'a jamais changé sa façon de concevoir la planète et la vie en général et que maintenant que les signes de déréglements se multiplient, on trouve des tas d'articles sur le sujet. L'immobilisme de l'humanité est effroyable et considérablement destructrice.
Liens vers d'autres articles :
Peter Russel : la révolution de la conscience
Peter Russel : une nouvelle conscience
Peter Russel :Sur la conscience de l'unité (conscience)
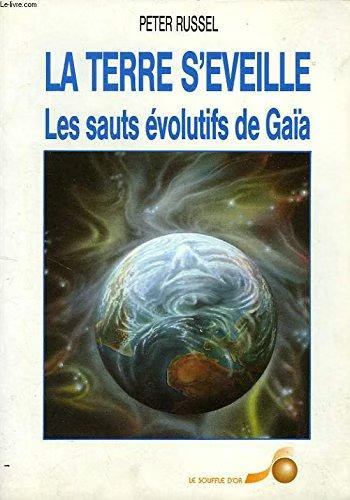
Peter Russel "La Terre s'éveille. Les sauts évolutifs de Gaïa."
Publié en 1982...
"On a beaucoup écrit et parlé à propos de cette idée qui veut que la Terre elle-même, prise dans son ensemble, soit comparable à un être vivant doté de fonctions vitales et capable de s'auto-réguler et ainsi de demeurer "en vie". En cette époque où pour la première fois l'humanité risque de mettre à mort, littéralement, la planète grâce à laquelle notre évolution depuis les premiers animacules marins et, en fait, notre existence même aujourd'hui, ont été possible.
Le symbole de la déesse Gaia, du nom que les anciens grecs donnaient à la Terre, est devenu un point de ralliement pour tous ceux et celles qui croient en la possibilité d'un changement radicale dans notre manière de voir, percevoir et concevoir notre planète. Les notions d'interdépendance de toute Vie et de grande fragilité des écosystèmes dont dépendent les myriades d'espèces vivantes peuplant notre monde sont maintenant admises par la science et par toutes les couches de la société.
Mais pourquoi alors nous acharnons-nous à détruire l'environnement par notre mode de vie gaspilleur et peu soucieux des conséquences à long terme, demeure un mystère qu'il est urgent d'élucider. Alors que les experts en environnement, aussi bien du gouvernement que des groupes écologiques, nous avertissent que le temps nous est compté pour effectuer des changements majeurs dans notre comportement à l'égard de la planète, il est tentant de se poser la question: "Qu'est-ce qui fera vraiment changer l'être humain au point où il prendra vraiment à coeur la sauvegarde de l'environnement et fera les changements qui s'imposent?" Pour trouver une réponse à cette question vitale, il faudrait peut-être commencer par se demander: "Qu'est-ce qui nous relie aux plans émotionnel, aussi bien que psychologique et spirituel, avec cette matrice de toute Vie qu'est notre planète?" Peut-être est-ce par là qu'il faut commencer à chercher pour trouver l'explication de notre apparente indifférence face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de la Vie sur Terre.
Ce n'est que récemment que l'image de la Terre vue de l'espace nous a été rapportée par les premiers astronautes à s'être rendus sur la Lune. Depuis ce temps, la perception que la Terre est notre maison commune, ou notre vaisseau spatial, ou encore un village global uni par la technologie et les communications, et enfin un être vivant capable de contrôler sa température et les différentes composantes chimiques de son environnement global, a marqué à divers degrés l'expérience et la vision que la plupart des humains ont de cette planète. Cette ouverture graduelle de notre esprit à la beauté unique et irremplaçable de la Vie sur cette boule d'eau et de pierre suspendue dans les espaces intersidéraux a permis pour une bonne part l'essor foudroyant des groupes environnementaux et de la conscience écologique qui de nos jours ont atteint le sommet de l'agenda gouvernemental, tel que démontré par la tenue du Sommet Planète Terre(1) de Rio de Janeiro. Bien sûr, les souffrances subies à la suite des catastrophes environnementales de même que les cris d'alarme lancés par les scientifiques à propos de l'avenir de la planète ont aussi grandement contribué à attirer notre attention sur le sort peu reluisant fait à notre bonne vieille Terre.
Pourtant au-delà de cette ouverture d'esprit et de ces préoccupations nées de la menace de cataclysmes écologiques, notre relation à la planète en tant qu'entité vivante et probablement pensante se limite à fort peu de choses. La révolution intérieure qui permet à un être humain de transcender les limites de ce que le scientifique britannique Peter Russell(2) appelle "l'ego encapsulé dans la peau", ne s'est pas encore faite à une échelle suffisamment globale pour affecter de manière significative la façon de penser de la majorité de la population mondiale.
La notion de planète en danger, de Terre nourricière dont toute Vie dépend, est encore bien abstraite et sans résonance émotive pour la plupart des gens, ce qui explique déjà en bonne partie l'indifférence quasi généralisée à l'égard de l'écologie planétaire. Oh, bien sûr, la plupart des gens sont en faveur du recyclage ou de la préservation de la nature par exemple; mais plus souvent qu'autrement, cette intérêt est motivé par des considérations d'ordre pratique comme les coûts élevés d'enfouissement des "ordures" ou du gaspillage de ressources ré-utilisables, et le besoin de loisirs tels la chasse et la pêche, donc la nécessité de préserver les "ressources fauniques".
De même le concept tant vanté du "développement durable" qui vise à faire en sorte que les générations futures puissent encore, comme nous le faisons aujourd'hui, profiter des ressources de la planète, ne constitue en somme qu'une forme de prise de conscience de notre responsabilité de ne pas être trop "goinfres" dans nos appétits de consommateurs insatiables afin que nos enfants ne se trouvent pas devant une table vide lorsque leur tour viendra de s'alimenter au festin planétaire. Et, à la remorque du mythe sacro-saint du développement économique continu, générateur de richesses toujours plus abondantes pour une minorité choyée, on nous encourage, ne l'oublions pas, à favoriser un développement soutenu, transformant ainsi une part de plus en plus grande de la nature en objets de consommation pour l'unique satisfaction de notre seule espèce.
Or qu'en est-il de nos chances de survivre collectivement devant la pression sans cesse accrue que ces modes de pensée "humano-centriques" infligent à un environnement sur le bord de l'effondrement écologique?... Presque nulle, à moins que... À moins que ne survienne globalement un éveil de conscience inespéré face à la fragilité de notre "nid" planétaire et surtout un épanouissement de notre conscience supérieure qui par l'Esprit nous relie à tout ce qui vit. Comme le disait si justement Malraux: "Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas!"
C'est ici qu'entre en jeu cette fameuse "Hypothèse Gaia", proposée par le scientifique britannique James Lovelock qui, à la suite de recherches, menées dans le cadre des expéditions Voyager de la NASA, visant à découvrir l'existence de formes de Vie sur d'autres planètes, en vint à se demander si la Terre elle-même ne formerait pas un organisme vivant. Rappelons brièvement le fondement de cette idée révolutionnaire qui, depuis sa proposition en 1970, a fait l'objet de vives controverses aussi bien que du soutien inconditionnel d'un nombre croissant de personnes de toutes origines, touchées par la beauté et la simplicité de cette idée.
Constatant que les instruments de lecture à bord du satellite Voyager laissaient voir que notre planète, à la différence de Mars, bouillonne littéralement de Vie, et réfléchissant sur le fait incontournable que depuis son apparition sur la Terre il y a trois milliards et demie d'années la Vie avait peu à peu colonisé les mers et les continents et, ce faisant, modifié la chimie et les conditions atmosphériques de la planète de manière à satisfaire ses exigences essentielles pour assurer sa survie, Lovelock en vint à réaliser que "...l'ensemble ce tout ce qui vit sur Terre, à partir des baleines jusqu'aux virus, et des chênes aux algues, pourrait à maints égards être considéré comme une seule entité vivante, capable de manipuler l'atmosphère de la Terre en fonction de l'ensemble de ses besoins, et possédant des facultés et pouvoirs dépassant de loin ceux de ses parties constituantes". Pour permettre de mieux comprendre les phénomènes fascinants qui contribuent à maintenir cet équilibre global favorisant la perpétuation de la Vie, citons quelques-uns de mécanismes grâce auxquels la Vie contrôle la planète, tel que mis en évidence par Lovelock:
1) La proportion d'oxygène dans l'atmosphère, rigoureusement maintenue à 21%: plus, les forêts brûleraient jusqu'au dernier arbre, moins, beaucoup d'animaux suffoqueraient. Orchestré par toutes les plantes et le plancton microscopique des océans, cet équilibre, grâce à la photosynthèse qui transforme le gaz carbonique en oxygène, se maintient comme par magie depuis plus d'un milliard d'années. De plus, c'est parce que l'oxygène est ainsi apparu que la couche d'ozone a pu se former et la Vie coloniser les surfaces émergées du globe.
2) De même la température moyenne à la surface du monde évite les écarts extrêmes, malgré les épisodes glaciaires qui n'affectent pas la ceinture verte équatoriale, grâce au contrôle par les plantes et le plancton des océans de la proportion du gaz carbonique à "effet de serre" qui retient la chaleur du soleil dans l'atmosphère, un peu comme le font les vitres d'une serre. D'autres facteurs, tels le couvert végétal favorisant une pluviosité régulière grâce à l'évaporation par les feuilles, et l'ensemencement des nuages à l'aide d'un élément chimique particulier produit par de minuscules organismes marins, démontrent une fois de plus le rôle clé de la Vie pour le maintien de conditions propices à son existence continue.
3) Une autre composante essentielle à l'harmonie de la biosphère est le taux d'acidité des pluies qui est maintenu au degré optimal par la présence d'ammoniaque dans l'air, à nouveau fruit de l'activité biologique. Pas assez d'acidité et les sels minéraux indispensables à la bonne santé des plantes ne seraient pas mis en circulation par réaction acide. Des pluies trop acides par contre délavent les sols de leurs éléments minéraux et affaiblissent d'autant les plantes, sans compter l'effet dévastateur d'une eau trop acide pour la survie des lacs et rivières.
4) Le taux de salinité des océans enfin. Par un mécanisme encore incompris, les océans parviennent à maintenir à exactement 3.4% le degré de salinité de leurs eaux, ce qui est le pourcentage idéal pour toutes les formes de Vie peuplant les mers. Sans cesse l'irrigation des continents amène par les fleuves et rivières de nouveaux sels dans les océans, et ce depuis qu'il a commencé à pleuvoir sur Terre. Pourtant, jamais sauf dans la Mer Morte (justement!) le taux de salinité n'a dépassé 3.4%. Deux pourcent de plus et toute Vie disparaîtrait des océans!
Lovelock a répertorié plusieurs autres facteurs semblables qui, réunis ensemble et maintenus stables pendant des centaines de millions d'années, ont permis le foisonnement prodigieux de dizaines de millions d'espèces qui, par le laborieux processus d'évolution, ont façonné le monde et mené à l'apparition de notre propre espèce.On sait les dommages considérables causés justement par notre espèce au fragile équilibre dont dépend la survie de tout ce qui grouille et respire en ce monde. Comme l'affirme lui-même Lovelock, même si nous parvenons à "bousiller" suffisamment l'écologie de la planète pour mettre notre propre survie en péril, il y a fort à parier qu'une extinction massive d'espèces - ce serait la sixième à survenir dans l'histoire de la Terre, la première provoquée par une seule espèce - ne serait perçue par Gaia que comme une indisposition passagère dont elle se remettrait avec le temps. Quelques millions d'années ne représentent qu'une courte période à son échelle."
-
L'étau se resserre (2)
- Par Thierry LEDRU
- Le 23/08/2025
Il y a bien longtemps que je ne mets plus les topos de nos sorties sur FB ou sur mon blog et j'ai même effacé tous ceux que j'avais publiés. Le PGHM de Chamonix est effaré du nombre d'interventions de secours qui concernent des "randonneurs" qui n'ont aucunement le niveau, sont mal équipés, partent n'importe où parce qu'ils ont vu des photos sur les réseaux sociaux. En Italie, Suisse et l'ensemble des Alpes, le secours en montagne comptablise un nombre records d'accidents, certains mortels.
J'ai parlé dernièrement du massif de Belledonne et j'ai bien précisé que c'est un massif exigeant, technique où on peut être considérablement isolés et où on ne doit aller qu'avec une grande connaissance de soi et avec un équipement approprié.
Dans notre virée sur le sommet du Taillefer, on est tombé sur une femme seule, engagée dans un couloir à cent mètres de nous, où elle avançait quasiment à genoux, en ayant loupé l'itinéraire parce qu'elle n'avait aucunement l'expérience. On l'a guidée pour qu'elle retrouve le bon passage. Il est clair qu'en continuant à monter dans ce couloir, elle allait droit au casse-pipe. Effrayant.
La montagne est devenue un bien consommable" : la "surfréquentation" touristique des Pyrénées agace les locaux

En 2024, un touriste sur deux pratiquait la randonnée pédestre durant son séjour dans les Pyrénées ariégeoises. • © imageBROKER/Tolo Balaguer / imageBROKER.com
Écrit par Inès Rochetin
Publié le23/08/2025 à 06h00
En Ariège, les sommets sont très prisés cet été. Entre bivouacs et randonnées en montagne, les touristes affluent sur les sommets des Pyrénées. Les parkings au départ des différents lieux de randonnée sont pris d'assaut. Une surfréquentation qui a tendance à agacer certains locaux, entre dégradations et déchets dans la nature.
L’actu des régions
Chaque jour, un tour d’horizon des principales infos de toutes les régions.
votre adresse e-mail
France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L’actu des régions". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité
Sur les réseaux sociaux, les annonces proposant des randonnées dans les Pyrénées affluent. Plusieurs kilomètres sur les sommets face à des paysages à couper le souffle et ... des centaines d'autres randonneurs. Une surfréquentation pas encore chiffrée pour la saison 2025, mais qui agace certains locaux. Entre détritus, parkings pris d'assaut et non respect de la nature, des Ariégeois demandent des règles pour limiter les nuisances.
Un engouement fort pour la montagne
Olivier parcourt la montagne ariégeoise depuis plus de 30 ans, des randonnées et sorties de plusieurs jours en montagne qu'il documente sur Facebook. Mais depuis la fin de la pandémie de COVID il s'éloigne des sentiers occupés par les touristes. "Il y a eu une vraie évolution de la pratique, la montagne est devenue un bien consommable et il y a de plus en plus de monde. Alors pour éviter la foule j'ai tendance à grimper plus haut et m'éloigner de cette surfréquentation". Mais même sur les sommets ariégeois qu'il a l'habitude de côtoyer, il est témoins de mauvaises pratiques : "Les gens ne se rendent pas compte, la montagne il faut la respecter, on trouve parfois les mouchoirs ou des défécations. Cette année je trouve qu'il y a de plus en plus de mauvais comportements".
Face à la surfréquentation, ils sont plusieurs à décider de passer "un coup de gueule". Frédéric Pasian maire de la commune du Lherm en Haute-Garonne, mais surtout amoureux de la montagne et randonneur aguerri dénonce sur Facebook les déchets laissés par certains en montagne. "Le voilà le véritable élément de distinction entre l'Homme et l'animal. Si tu ne sais pas gérer tes déchets, c'est que tu n'as rien à faire dans ces montagnes". Frédérique Pasian bénévole du challenge du Montcalm (une course de 109 km et 11500 mètres de dénivelé positif traversant la France et l’Andorre), balisait le parcours lorsqu'il a aperçu les détritus, mais pour lui, tout le monde doit respecter : "que l'on soit randonneur, pêcheur, chasseur ou berger nous ne devons pas laisser de traces de nos passages en montagne !".
Une exaspération partagée par d'autres comme Gabriel Bombyx.
Contacté l'Ariégeois détaille : "c'est un sujet tabou depuis trop longtemps. Nos politiques locaux ne veulent rien entendre et ça devient ingérable. Et surtout invivable pour les locaux. Je n'ai rien contre le tourisme mais il doit y avoir des règles vu que, comme sur beaucoup de sujets, les gens sont en majorité irrespectueux. On assiste à se nouvel engouement pour la montagne mais personne n'a anticipé les problèmes, dégradation, dérangement, pollution, insécurité etc...".
De la régulation ?
Pour la plupart, de la régulation est possible. Frédéric Pasian explique : "En Andorre, des barrières sont mises en place pour limiter le flux des voitures et des camping-caristes, les chiens doivent être tenus en laisse. Il y a également des animateurs pour faire de la médiation envers les randonneurs afin de leur expliquer les règles à suivre. Il y a des bonnes pratiques qui existent ce n’est pas si difficile de les mettre en place !"
Olivier partage ce sentiment : "Quand on aime la montagne, on aime la liberté et la gratuité qui en découle. Mais on le voit à Cauteret par exemple les parkings sont payants, l'Ariège devrait peut-être aussi s' y mettre. Je pense que l'Ariège est aussi un des derniers départements à ne pas interdire l'accès routier aux vans et aux camping-cars à Soulcem ou Pla des Peyres contrairement aux Hautes-Pyrénées ou aux Pyrénées orientales".
Des actions ont d'ores et déjà été mises en place dans les Pyrénées : "Ce qui est observé depuis la crise sanitaire, c'est la venue de clientèles "novices", ne connaissant pas les "codes" de la montagne. Des actions sont en cours d'expérimentation à ce sujet : médiation en montagne, avec la présence d'accompagnateurs pour sensibiliser, équiper et faire connaître. Nous sommes en train également, de mettre en place une charte du randonneur" explique Sylvie Courderc, de l'office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises
-
Vélo-train
- Par Thierry LEDRU
- Le 22/08/2025
Partir en train avec son vélo pour un raid de plusieurs jours : c'est galère. Et ça serait pourtant l'idéal pour des vacances à faible empreinte carbone.
Mais le nombre de places est beaucoup trop faible.
Il est nécessaire de réserver longtemps à l'avance ce qui signifie deux choses : on ne peut pas tenir compte des conditions météo et pire que tout, la date de retour est prévue et il est donc impératif d'être là. On ne change as de date avec la SNCF. Donc, il faut rouler sous la pluie, il ne faut pas avoir de problèmes mécaniques ou physiques et il faut organiser son trajet en fonction de ce billet retour. Aucune liberté "d'escapade" imprévue.
On me dira que ça n'est pas insurmontable. Non, effectivement mais ça n'est pas l'ambiance dans laquelle on a envie de rouler.
Dans notre périple en Bretagne, on a vu un nombre conséquent de cyclos, bien plus que les années précédentes. Les vélos électriques ont amené de nouveaux pratiquants. On ne peut que s'en réjouir. Mais les trains ne suivent pas. Et c'est pour tout le monde le même problème : ça n'est pas le raid à vélo en lui-même qui est difficile mais c'est son organisation.
Pour notre part, on est allé en Bretagne avec le fourgon et on l'a laissé chez des amis. Et comme on ne fait plus que des circuits en boucle, on ne prend plus le train. Notre expérience de la GTMC ( grande traversée du Massif Central de Clermont-Ferrand à Sète avec les VTT) nous a vaccinés. Une galère monumentale pour réussir à revenir à Clermont récupérer le fourgon. Plus jamais ça.
Ici, en Ardèche, il n'y a même plus de gare...
Quand j'étais adolescent, je prenais le train à Quimper et je pouvais aller n'importe où. Mais les petites lignes ferment les unes après les autres. Donc, pour partir avec un vélo, il faut rejoindre une grande ville. Eh bien, faire du vélo dans une grande ville, il faut être sacrément motivé...On l'a vu encore une fois en traversant Saint-Brieuc. Quel calvaire. C'est ce qui nous a décidé à faire la dernière étape de nuit pour traverser Lorient sereinement. Franchement, les cyclo qui roulent en ville tous les jours pour aller bosser, je leur tire mon chapeau (ou mon casque plutôt)
Accueil » Politique cyclable » Réglementation » Train + vélo c’est 8 minimum, a décidé le gouvernement
par Isabelle Lesens | Jan 20, 2021 | Réglementation | 18 commentaires
Le décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs est paru au Journal officiel de ce matin 20 janvier 2021.
HUIT
Par ce décret il est décidé qu’il y aura
Huit emplacements pour vélos si le service est librement organisé ;
Huit emplacements pour vélos si le service est d’intérêt national ;
Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d’intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l’unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n’est pas supérieur à huit.
Huit emplacements pour vélos si le service d’intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d’exploitation d’un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;
Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l’unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n’est pas supérieur à huit.
En clair il est décidé qu’il y aura un minimum de 8 emplacements de vélo dans la plupart des trains de voyageurs en France, y compris trains trans-frontaliers, mais ni train internationaux ni trains urbains. Cela s’applique en particulier aux trains d’équilibre du territoire conventionnés par l’Etat, aux services librement organisés comme les TGV et aux services d’intérêt régional (TER)1.
8 c’est le nombre qui était demandé par les associations françaises comme par la députée européenne Karima Delli qui s’est beaucoup battue sur ce sujet depuis 2018.
Pas n’importe comment et plutôt bien
Et comme mieux vaut écrire que laisser interpréter, il est précisé aussi que
Les emplacements pour vélos permettent d’entreposer des vélos non démontés sans qu’il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.
Les emplacements pour vélos peuvent être modulables pour permettre d’autres usages lorsqu’ils ne sont pas occupés par des vélos.
Les emplacements pour vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l’extérieur et à l’intérieur du matériel roulant.
Ce sera gratuit ou payant suivant les décisions des exploitants. On ne dit rien sur la facilité d’accès, heureusement les personnes en fauteuil gagnent eux aussi à ce qu’on facilite ceci. A noter que la question des stationnements des vélos en gare reste presque entière.
Pas tout de suite ni tout le temps mais quelquefois même plus tôt que ce qu’exige le décret
Il s’agit des trains de voyageurs « neufs ou rénovés » pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021 ou dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date. Ceux qui veulent éviter d’être obligés doivent donc passer leur marché avant le 15 mars.
Le ministère souligne que « la SNCF s’est néanmoins engagée à intégrer, dans son programme « TGV du futur » lancé en 2016, un minimum de 4 emplacements vélos » par train, ce qui est la même chose que les 4 par train (voitures 1 et 11) que nous avions souvent. La SNCF n’est donc pas contrainte à équiper les 100 nouvelles rames commandées, mais elle a prévu de le faire avec 6 places pour vélos, croit savoir l’association CycloTransEurope2
Il y a pas mal de réserves dont on espère qu’elles ne seront pas trop utilisées, ruinant les vacances des clients, comme on l’a vu l’année dernière.
« Eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu’il définit, l’accès des vélos à bord des trains. Cela concerne surtout les TER semble-t-il.
Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l’exploitant peut restreindre ou refuser l’accès des vélos à bord des trains.
L’exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord. Cela risque de concerner les tandem, les vélos couchés et les vélo-cargos.
L’accès des vélos peut être refusé à l’embarquement dès lors qu’il n’y a plus d’emplacement vélo disponible à bord du train.
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l’article D. 1272-5 lorsqu’une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise. Dans ce cas, l’exploitant ou l’autorité organisatrice de transport transmet au ministre chargé des transports une demande de dérogation permettant d’en apprécier les justifications.
Certains feront mieux
Ces obligations ne concernent pas que les entreprises publiques (entreprise ferroviaire ou autre entité assurant directement ou à la demande de l’autorité organisatrice de transport l’exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs), c’est à dire la SNCF, mais aussi toutes les lignes « librement organisées », c’est-à-dire hors SNCF.
Rien n’empêche personne d’en faire plus, comme déjà dans certaines régions touristiques comme le Centre-Val de Loire qui a prévu 9 emplacements par rame, soit au moins 27 vélos par train de trois voitures, ou les entreprises qui vont profiter de la mise en concurrence comme Railcoop, qui exploitera à partir de l’été 20223 la ligne Bordeaux-Lyon, fermée en 2014, avec arrêts à Libourne, Périgueux, Limoges, Saint-Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés et Roanne4.
en conclusion
Déjà en novembre 2018 le parlement européen avait voté dans ce sens, mais le conseil européen (les gouvernements) avait réduit à 4 et la France n’avait pas joué le plus beau rôle. Maintenant le seul problème, remarque le collectif d’associations Mon vélo dans le train, c’est que cela ne deviendra effectivement concret qu’à l’occasion de renouvellement … ce qui fait qu’on ne verrait l’effet concret de ce décret que vers 2030… Le collectif espère aussi que les « exceptions » ne seront pas trop utilisées. On peut aussi espérer que les régions s’empareront de leur nouveau droit à devenir propriétaire de leurs « petites lignes » car on se rend compte qu’elle comprennent mieux leur intérêt direct dans cette affaire. (décret d’application de l’article 172 de la loi d’orientation des mobilités, JO du 31 décembre 2020)
Malgré tout il faudrait être un grave pessimiste pour ne pas applaudir à la satisfaction d’une demande qui traîne depuis les années 80, lorsque Jacques Essel organisait des voyages revendicatifs avec retour par le train, entre Paris et Chartres.
Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs:
L’historique de l’affaire est dans Vélos dans les trains, les progrès se font attendre, de juillet 2020. On attendait le décret pour septembre. Au moins maintenant savons-nous que l’Europe n’aura pas à nous forcer la main.
On peut relire aussi Les trains transporteront tous des vélos, de octobre 2018, où l’on voit les forces en présence.Pour les autocars, voir l’article du 22 février 21 : Bientôt 5 vélos par autocar de longue distance
18 Commentaires
Le plus ancien
Olivier Louchard
4 années
On l’attendait avec impatience et, au final, je suis assez déçu par ce décret qui offre de nombreuses échappatoires dans lesquelles vont s’engouffrer les exploitants. Par exemple, en région bordelaise, les lignes TER en période de vacances et les WE qui desservent la pointe du Médoc ou le Bassin sont saturées et on peut parier que le « Eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu’il définit, l’accès des vélos à bord des trains » tourne à plein régime.
Répondre
fred02840
4 années
« Train + vélo c’est 8 minimum , a décidé le gouvernement ». Un titre à la formulation ambiguë : ne serait-ce pas plutôt : « Train + vélo c’est 8 au maximum , a décidé le gouvernement » ? Puisque, comme on le lit, le nombre de vélos admis ne peut être supérieur à huit.
Répondre
Auteur
4 années
En réponse à fred02840
Non, je vous assure. C’est « pas plus de 8 minimum » d’obligé, le gouvernement s’engage à ce que le minimum exigé ne soit pas plus que 8. Il n’y a pas de limite haute à ce qui est autorisé.
Répondre
Thomas Tours
4 années
Les futures levées d’options des Régiolis et Regio2N seront-elles considérées comme des nouveaux avis de marché?
Car avec seulement 370 commandes de Régiolis sur un marché global de 1000, et 480 Régio2N pour 870, ça peut retarder fortement l’application.Répondre
promeneur
4 années
Cela n’est pas à la hauteur du problème pour ce qui est des trains RER et TER, qui emmènent les gens au travail. Il suffit d’emprunter ceux-ci pour constater que :
– beaucoup de gens pratiquent le transport vélo+train pour aller au travail et utilisent le vélo pour rejoindre la gare ou pour finir le trajet.
– que ça déborde de partout, qu’on ne peut plus circuler dans la rame.
Il faut un wagon entier, sans places assises, réservé aux cyclistes avec des très grandes portes pour faciliter les entrée-sorties.
Les régions qui décident des aménagements sont ignorantes de ce problème alors que ça fait une dizaine d’année qu’il existe.Répondre
Auteur
4 années
En réponse à promeneur
Un wagon entier nu, absolument, ou une moitié. On peut y mettre des strapontins. J’en ai vu au Danemark et aussi une fois en France (je ne sais plus où). Ce sont des espaces polyvalents, vraiment très bien.
Un message depuis Rouen : pour info en ce moment (hiver + mauvais temps + activités covidées) dans mon train Rouen<>Paris omnibus matin et soir entre 10 et 15 vélos. Le printemps sera chaud (sans compter l’augmentation faramineuse depuis 1 an ou 2 des usagers en grosse trottinette électrique (qui prennent aussi de la place) + des vae (qui prennent de la place car impossibles à accrocher aux « crochets ») …Répondre
Dehousse
4 années
L’intérieur d’un avion est re-configurable selon les besoins. Pourquoi les concepteurs de trains les rendent si peu adaptables ? La solution de wagons mi-cycles / mi-passagers, autrement dit mi-plate-forme / mi-sièges, et large ouverture, est à étudier d’urgence.
Répondre
Jerome
4 années
Ce décret est en effet une bonne nouvelle. Merci d’avoir précisé qu’il n’y a pas de limite haute car le texte peut être interprété d’une autre manière.
Mon observation et ma pratique quotidienne me font abonder dans le sens de « promeneur » plus haut. Sur les lignes TER certains contextes nécessitent aujourd’hui des wagons dédiés au vélo. C’est le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes autour de Lyon. Certaines lignes journalières utilisées par les travailleurs ou écoliers sont saturées niveau vélo aux heures de pointes. Également les week-end et en période estivale la randonnée vélo (avec aller ou retour en TER) a en 2020 connu un accroissement impressionnant qui est venu confirmer la progression régulière des années précédentes. Dans de tels exemple si l’on veut continuer de développer le vélo + train notamment pour le tourisme ou le travail, les wagons dédiés semblent indispensables.Répondre
Thomas Tours
4 années
Heureux destinataire des infolettres de CycloTransEurope, j’ai reçu hier leur courriel de réjouissement. Ils indiquent en information post-liminaire « le 20 janvier 2021 la SNCF rend public qu’elle proposera au minimum 6 emplacements vélo dans les TGV-M (100 rames à partir de 2024) et qu’elle étudie d’aller jusqu’à 8 places vélos. » La mentalité semble bien évoluer dans le bon sens. Mais je n’ai pas retrouvé la source officielle de la SNCF [ni ici, où l’information a été reprise.].
La prochaine évolution nécessaire est la prise en compte des vélos dit spéciaux (cargos de différents types, tandems, tricycles, vélos couchés).Répondre
-
Seul le peuple sauve le peuple.
- Par Thierry LEDRU
- Le 22/08/2025
Les pyromanes ne sont pas les causes principales de ces incendies gigantesques. Ceux-là ne sont que des boucs-émissaires.
L'exode rural vers les villes et donc l'arrêt de "l'entretien" des zones naturelles a favorisé l'expansion d'une végétation sauvage. On pourrait se réjouir que la nature reprenne des territoires abandonnés par les hommes mais il n'en reste pas moins que ceux qui restent se retrouvent "encerclés" par des zones immenses dans lesquelles le feu est libre de progresser. L'activité rurale d'autrefois limitait et contrôlait la végétation. Mais cette vie rurale n'était pas assez "rentable", il était plus bénéfique de développer l'élevage industriel, de le concentrer et toutes les petites exploitations familiales ont disparu. Il ne reste dans ces zones que le tourisme et quelques réfractaires à ce "progrès". Les chèvres qui éliminaient les broussailles ne sont pas rentables, les petites exploitations de vignes ont été arrachées et les moyens alloués à la prévention n'ont cessé de diminuer.
Les pyromanes sont politiques.
Il ne reste que le peuple pour se sauver lui-même.
« Ils nous ont complètement abandonnés » : l’Espagne débordée par des feux incontrôlables
https://reporterre.net/Ils-nous-ont-completement-abandonnes-l-Espagne-debordee-par-des-feux-incontrolables

La vague d’incendies qui ravagent l’Espagne depuis début août suscite la colère contre les autorités, débordées, dans un pays pourtant habitué aux feux de forêt.
Madrid (Espagne), correspondance
« Je n’ai jamais vu un feu comme celui-là », dit au bout du fil Eva Maria Valez Fernandez, une habitante de Molinaseca, en Castille-et-León. Cette région du nord-ouest de l’Espagne est l’une des plus touchées par la vague de gigantesques incendies qui affecte le pays depuis début août.
Des milliers de personnes ont dû être évacuées, des villages entiers sont partis en fumée et des sites historiques comme Las Médulas, une zone d’anciennes mines d’or romaines classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ont été calcinés.
« Ça fait dix jours que cet incendie ravage tout, ça me terrifie. Je vois le feu qui avance, mais aujourd’hui [le 18 août] je n’ai entendu aucun avion ou hélicoptère. Où sont-ils ? Ils nous ont complètement abandonnés », se désole Eva. Des images de citoyens luttant contre les flammes avec des moyens du bord, comme des pelles ou des tuyaux d’arrosage, circulent de plus en plus avec à chaque fois le même slogan : « Solo el pueblo salva al pueblo » (« Seul le peuple sauve le peuple »).

Des habitants aident à éteindre un incendie à Veiga das Meas, dans la municipalité de Vilardevós, le 16 août 2025. © Miguel Riopa / AFP
Les autorités sont débordées par l’intensité et la multiplication des départs de feux ces derniers jours. Plus de 343 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l’année en Espagne, selon les dernières données du Système européen d’information sur les incendies de forêt (Effis). Soit environ 490 000 terrains de football. Un triste record historique pour le pays, battant celui de 2022, où 306 000 hectares étaient partis en fumée.
Pendant que les incendies font toujours rage dans les régions d’Estrémadure, de Galice et de Castille-et-León, et ont coûté la vie à au moins quatre personnes, dont un pompier, les attaques politiques fusent de toute part. Les gouvernements régionaux de droite et le gouvernement central de gauche se renvoient la balle sur les moyens déployés.
« Il faut arrêter ces attaques politiques. On doit déclencher le niveau 3 [permettant une mobilisation plus importante des ressources] et appeler l’armée en renfort, le temps presse », s’inquiète Eva, qui redoute de devoir évacuer dans les prochaines heures.
Des centaines de personnes ont manifesté le 18 août pour demander la démission du gouvernement régional de Castille-et-León et réclamer l’intervention du gouvernement central dans la lutte contre les incendies. Le gouvernement régional a exclu cette possibilité.
Des conditions propices
L’Espagne a connu un mois d’août extrêmement chaud avec une vague de chaleur de plus de deux semaines et des températures allant jusqu’à 45 °C. L’agence météorologique espagnole (Aemet) avance même que le mois d’août est en passe de devenir le mois d’août le plus chaud de l’histoire en Espagne, comme ce fut le cas pour le mois de juin. À cela s’ajoutent des vents forts et une végétation très dense suite à un printemps très pluvieux.
« Cette combinaison de facteurs crée une sorte de cocktail explosif, explique Cristina Santín, scientifique spécialiste des incendies. On voit maintenant des feux de sixième génération. Ils sont immenses et dépassent nos capacités d’extinction. On ne peut donc pas les contrôler, il faut simplement attendre que le temps change, que le vent tourne ou que le feu atteigne un endroit où il n’y a plus de combustible. »
« Peu de zones végétales peuvent faire barrière aux incendies »
La chercheuse souligne aussi que jusqu’au milieu du XXe siècle, les espaces ruraux formaient une mosaïque de zones montagneuses, de vastes forêts, de terres agricoles et de villages, mais que l’exode rural vers les grandes villes a fait augmenter les risques. « En retrouvant sa liberté, la nature a créé une étendue plus uniforme de combustible végétal, de sorte que peu de zones peuvent faire barrière aux incendies », explique Cristina Santín.
Face à la multiplication des incendies et des services débordés, l’Espagne a fait appel, pour la première fois, au mécanisme de protection civile de l’Union européenne. La France y a notamment répondu en envoyant deux Canadair le 14 août.
Boucs émissaires
« La prévention n’a pas été la pierre angulaire de nos politiques et nous en payons maintenant les conséquences, juge Víctor Resco de Dios, professeur d’ingénierie forestière à l’université de Lérida. Les changements climatiques sont là pour rester et aggraver le problème. On doit consacrer davantage de temps et de ressources à la gestion et à la prévention des incendies. » En visite dans des régions sinistrées le 17 août, le Premier ministre espagnol a annoncé la création d’un « pacte national face à l’urgence climatique ».
Les autorités espagnoles suspectent que la majorité des incendies déclenchés ces dernières semaines soient d’origine humaine, intentionnelle ou non. Au moins 31 personnes ont été arrêtées depuis le début du mois de juin et près d’une centaine d’autres sont sous enquête, selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur espagnol.
« En se concentrant uniquement sur les causes de ces incendies, on manque notre but, explique Víctor Resco de Dios. La prévention des incendies est l’une des tâches que les autorités sont censées accomplir, dans le cadre de leurs compétences. Or, faute de le faire, ils cherchent des boucs émissaires. »
-
Le rêve de l'écrivain
- Par Thierry LEDRU
- Le 21/08/2025
"J'écris pour qui, tombant dans mon livre, y tomberait comme dans un trou, et n'en sortirait plus. "
Georges BATAILLE
Peut-être est-ce parce que j'ai conscience que les lecteurs et lectrices parviendront toujours à sortir de mes livres que je n'ai plus le goût d'écrire.
Peut-être aussi parce qu'il y a d'autres urgences, d'autres douleurs, d'autres passions, d'autres désirs, d'autres instants plus intenses encore que l'écriture.
Peut-être aussi parce que je ne sais pas grand-chose de ce que les lecteurs et lectrices pensent de mes livres. Et que ce que j'en pense ne me suffit plus.
-
Accident ischémique transitoire
- Par Thierry LEDRU
- Le 20/08/2025
Je ne sais plus quand c'est arrivé. Je devais avoir environ quarante ans. Le trouble principal a pris la forme d'une diplopie binoculaire, sans que ça soit exactement ça. Très troublant et désagréable. Quand je tendais mon bras devant mes yeux, je voyais deux mains et elles étaient à trois kilomètres. Impossible de les fixer. Un vertige très puissant.
Un caillot de sang s'est baladé dans les tuyaux.
Mon médecin généraliste m'a envoyé passer un examen. Rien n'a été décelé. Il aurait fallu passer des examens plus approfondis mais j'ai laissé tomber. J'ai lu quelques documents sur le phénomène. Et puis, je ne m'en suis plus occupé.
Mes parents ont tous les deux été victimes d'un AVC à un an d'intervalle. Et quand je vois dans quel état ils sont aujourd'hui (tous les deux en fauteuil roulant, mon père aveugle, démence sénile, perte totale d'interactions sociales, ils ne savent plus qui je suis, ma mère appelle la sienne à longueur de journée, grabataire etc...), je me dis qu'il ne faut surtout pas que j'arrête la montagne, le vélo, le trail, le ski de rando, le skating, tout ce qui fait pulser mon coeur et en espérant qu'un jour, tout va lâcher d'un coup sec.
Mourir debout, dehors, là-haut, en pleine conscience, que je puisse au moins profiter de ce moment unique. Peu importe l'âge auquel ça arriverait. Peu importe les conditions. Mais mourir debout. C'est tout ce que je souhaite. Et vivre totalement d'ici-là.
Qu'un médecin vienne me dire que je dois relâcher, que je suis un client à risques et patati et patata et je lui répondrai que c'est mon choix. Je n'ai aucunement le projet de durer le plus longtemps possible.
Je me souviens de cette femme de 84 ans, retrouvée morte en montagne, dans un secteur peu fréquenté. Elle était partie seule, sans prévenir personne. La famille a fini par s'inquiéter et des recherches ont été lancées. Deux randonneurs ont finalement trouvé le corps, près d'un lac d'altitude.
Evidemment, les donneurs de leçons s'en sont donnés à coeur joie : "On ne va pas en montagne, tout seul, la montagne c'est dangereux, encore une facture salée pour les secours, on devrait faire payer la famille" et patati et patata...Les hyènes sont moins puantes.
Cette femme connaissait très bien la montagne. Elle n'est pas tombée. Elle s'est éteinte. Elle est montée au plus haut, là où ses forces pouvaient encore l'amener. Il faut imaginer le paysage sur lequel elle a fermé les yeux.
Je ne me souhaite rien d'autre que ça.
/regions/2025/08/21/2025-08-21-15-09-58-ariejo-o-moun-pais-coup-de-gueule-facebook-68a71aec4d10e965398452.png)










