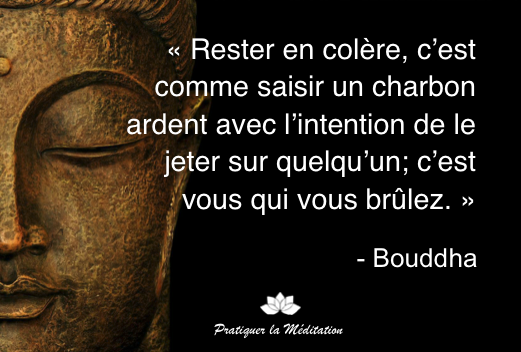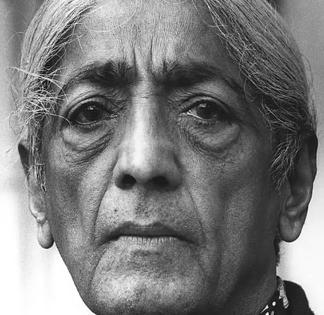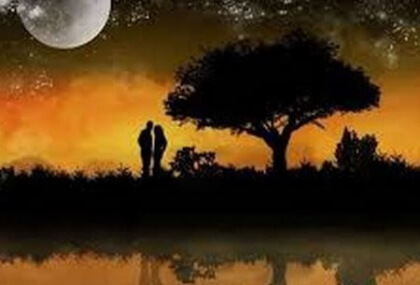Je est un jeu de miroir
10 février 2019

« Comme dans le miroir, la forme et le reflet se répondent. Vous n’êtes pas le reflet, mais le reflet est vous » (Maitre Tozan).
Cette citation de Maître Tozan est la meilleure illustration de ce qu’est l’ego. Celui qui regarde, c’est celui qui EST. Mais il ne sait pas QUI il est. Il ne peut voir son visage, ni même la majeure partie de son corps. Il a besoin du reflet pour prendre forme à ses yeux. Même si le reflet n’a aucune existence propre, il va s’identifier à lui, il va mettre des mots sur ce qu’il voit : jeune, vieux, grand, petit, blond, brun, beau, laid, gai, triste…, et dira « ça, c’est moi ». Pourtant, s’il veut attraper ce « moi », il ne touchera que la surface réfléchissante du miroir. Ce reflet, c’est l’ego.
L’ego n’est pas la conscience d’être
Nous héritons de notre conscience d’être et de la conscience de notre individualité, avec la vie. Cette conscience est constitutive de notre personne. Elle n’a pas besoin d’être pensée. Cette conscience d’être n’est pas l’ego. L’ego est ce qui pense cette conscience. C’est par la pensée que nous nous délimitons, que nous définissons un dedans et un dehors, un moi et un autre, que nous séparons les choses et mettons un nom dessus… L’ego se construit sur ce que nous pensons être.
L’ego a besoin du miroir
L’ego a besoin du miroir pour savoir qu’il existe. Pourtant rien ne relie le visage dans le miroir à celui qui le regarde. C’est par la pensée, le raisonnement, la déduction, que nous comprenons très jeunes que ce reflet est le nôtre, et que nous nous identifions à notre reflet, c’est-à-dire à l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes.
On peut dire cela autrement : l’ego, en tant que sujet – celui qui regarde – a besoin de devenir l’objet de son observation pour exister. Cette séparation de soi est comme une déchirure, une source de souffrance. Nous détruisons notre unité naturelle pour entretenir une relation dualiste, conflictuelle entre celui qui est et celui qu’on veut ou qu’on croit être, entre notre perception du monde et le monde tel qu’on l’imagine et le désire.
C’est par la pensée que l’ego existe
Dans cette relation ni l’objet ni le sujet – qui n’existe que par sa relation à l’objet – , n’ont d’existence propre. Ce sont ce qu’on appelle des bonnos, ces constructions mentales que se substitue dans notre conscience à la réalité.
L’ego n’a donc aucune existence propre, aucune substance originelle. Il n’existe que tant que la pensée le fait exister et c’est la pensée qui en reliant entre eux des souvenirs disparates et souvent déformés, des sensations, des émotions, des idées, crée l’illusion d’une continuité et d’une permanence qui va nous permettre de dire : « je suis ceci ou je suis comme cela » » de façon catégorique et définitive. Nous gardons une image figée de nous-mêmes comme une photographie, illusion de permanence, alors que ce que nous vivons réellement change sans cesse, change nos traits, nos idées, nos sentiments, au grès des évènements, des rencontres, du temps qui passe…
Méditer, c’est passer de la conscience de soi à la conscience en soi.
Alors qui suis-je ? Celui qui voit ? Surement. Mais si je demande qui est celui qui voit, je serai bien obligé de répondre « moi », c’est-à-dire le reflet de celui qui regarde. L’œil ne peut pas se regarder lui-même.
Méditer, c’est passer de la conscience de soi à la conscience en soi. Passer de celui que je regarde dans le miroir, à celui qui voit. Et au-delà, être la vision elle-même, être la perception du monde sans le filtre de la pensée. Sortir de l’illusion de la relation sujet-objet et faire l’expérience de la présence du monde en nous.
CONSCIENCEDÉVELOPPEMENT PERSONNELEGOESPRITIMPERMANENCEMÉDITATIONPSYCHOLOGIERELAXATIONSAGESSEUNITÉZEN