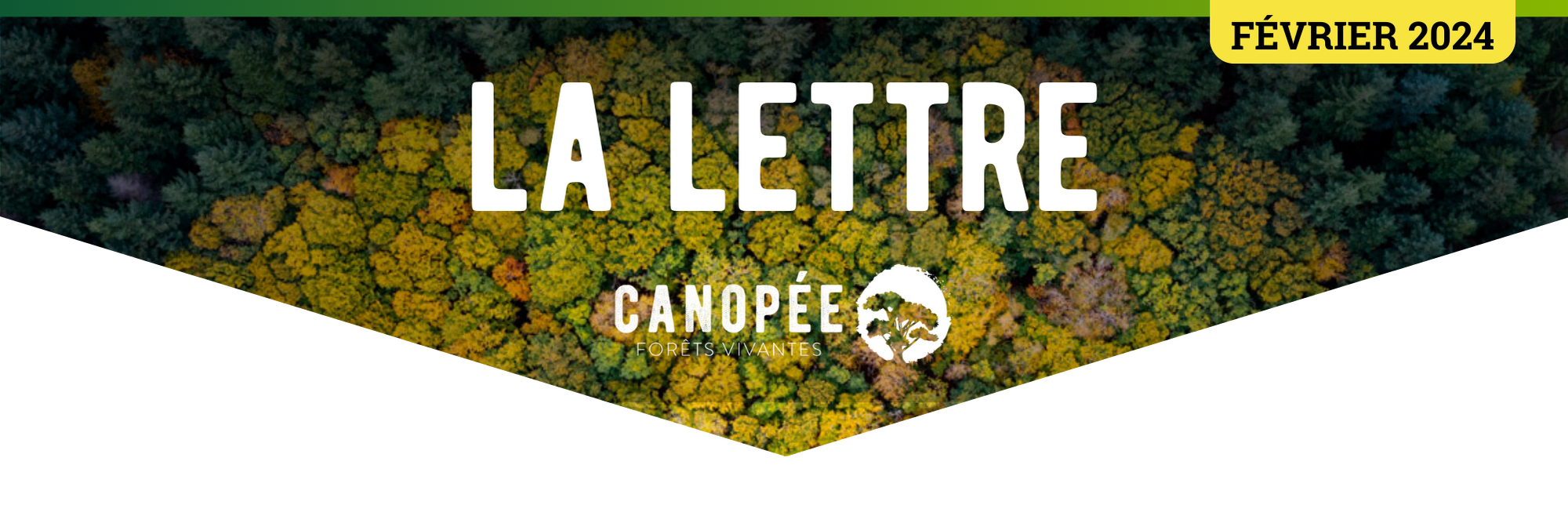Blog
-
Importation d'abeilles.
- Par Thierry LEDRU
- Le 26/02/2024
Regardez les dates de ces deux articles...J'ai cherché des informations plus récentes sans rien trouver. Non pas que la situation se soit améliorée, c'est fortement improbable. Quand je lis que des abeilles sont importées depuis l'Australie par avion, comment pourrait-on suggérer que ça s'améliore ?
Biodiversité
Les abeilles menacées par la production d'amandes en Californie
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/les-abeilles-menacees-par-la-production-d-amandes-en-californie_105277
Par Morgane Le Poaizard le 04.10.2016 à 09h00, mis à jour le 04.10.2016 à 09h00 Lecture 4 min.
Depuis 2007, la production d’amandes, qui a explosé en Californie, requiert un nombre toujours plus important de pollinisateurs. Un rythme que les abeilles états-uniennes ne peuvent tenir.

Les abeilles fertilisent les amandiers en Californie.
© Vaclav Salek/AP/SIPA
BOUM. Pour le meeting annuel de la Société américaine de géologie le 27 septembre 2016, Kelly Watson, professeur assistant de géosciences à l’Eastern Kentucky University et son étudiante Larissa Watkins, ont présenté les résultats de leur étude d’imagerie aérienne réalisée grâce au Programme National d’Imagerie de l’Agriculture (NAIP), en Californie. Entre 2007 et 2015, elles ont observé la superficie des terrains cultivés et se sont particulièrement penchées sur la culture d’amandes. La production de ce produit a connu un véritable boum depuis 2007 à cause d’une forte demande et d’une montée du prix des amandes. Or cette effervescence a des conséquences sur les abeilles pollinisatrices puisqu’elles sont importées chaque année dans la Central Valley pour féconder les fleurs d’amandiers.
Un marché florissant aux conséquences redoutables
Selon les auteurs, la consommation mondiale d’amandes a haussé de 200% depuis 2005 et les prix ont augmenté d’1 dollar par livre (soit 0,45 kg) pour atteindre un pic de 5 dollars la livre en 2014. Or la Californie répond à 80% de la demande mondiale d’amandes. Le boum de la production d’amandes est particulièrement visible sur les imageries aérienne : l’étude révèle qu’entre 2007 et 2014, la superficie des terrains d’amandiers a augmenté de 14%, or ces cultures ont pris la place de champs de maïs, de coton ou de tomates. Ces derniers utilisaient moins d’eau que les amandiers, ce qui a provoqué une augmentation annuelle de l’irrigation globale de 27% entre 2007 et 2014, malgré la sécheresse historique que connaît l’état. « Si vous regardez les terrains exploités, plus de 16.000 ont été classés comme terrains humides pour les amandes », s’alarme le professeur Watson.
70% de nos abeilles apprivoisées aux USA vont polliniser les amandes en Californie."
« La prochaine chose que nous voulons pointer du doigt est ce que signifie l’augmentation de la culture d’amandes pour la demande de pollinisateurs », explique Watson. Les fleurs d’amandiers californiens sont presque toutes auto-incompatibles (elles ne peuvent pas se féconder toutes seules), elles ont donc besoin d’insectes pollinisateurs pour produire des amandes. La culture d’amandes est par conséquent dépendante de la pollinisation par les abeilles domestiques. Or la Californie ne possèdent pas assez d’abeilles, et les Etats-Unis encore moins. Alors comment permettre aux cultures de se développer ? Les apiculteurs semblent avoir trouvé un moyen de répondre à cette demande : ils louent leurs abeilles aux agriculteurs à travers tous les états. Ainsi 60% des abeilles "commerciales", soit 1.6 million de colonies d’abeilles états-uniennes, sont importées en Californie chaque année. Les Apis mellifera, abeilles domestiques européennes, visitent plus de 800.000 parcelles chaque année, de Sacramento à Los Angeles. Leur circuit débute en février avec les amandes californiennes pour finir en hiver en Floride avec le poivre brésilien.

Les abeilles sont transportées aux quatre coins du pays pour polliniser les cultures. © Dooley John / SIPA
DÉTRESSE. Le transport de ces insectes leur cause énormément de stress et les pics de chaleur affectent les reines. Les abeilles se restreignent à un régime de nectar d’amandiers au lieu de se délecter d’un mélange de fleurs aux protéines diverses. Elles sont potentiellement exposées aux pesticides, aux nuisibles, aux fongicides et autres produits chimiques qui affaiblissent leur système immunitaire. Les pollinisateurs deviennent les hôtes de virus qui les font voler plus lentement, agir de façon insensée ou mourir prématurément. « Si vous cherchez ce qui cause le déclin des abeilles, l’agriculture industrielle tient certainement un rôle majeur. » affirme Watson.
Certains cultivateurs tentent de trouver des alternatives à la pollinisation. Une espèce d’amandier, l’Independance, éviterait tous ces transports d’abeilles à travers les états. Il s’agit d’un croisement d’amandier et de pêcher auto-fertile, vendu exclusivement par Dave Wilson Nursery, le laboratoire qui a développé l'espèce. Mais qu’en est-il du rendement et de la qualité du fruit obtenu ?
https://www.lesechos.fr/2011/04/la-californie-malade-de-ses-abeilles-1089619
Publié le 14 avr. 2011 à 01:01Mis à jour le 6 août 2019 à 00:00
Pour la première fois, une enquête scientifique, portant sur tout le territoire américain, démontre l'inquiétant déclin des abeilles pollinisatrices. Un enjeu crucial pour les cultivateurs d'amandes californiens, gros exportateurs.
La période de pollinisation des amandiers vient tout juste de se terminer et la Californie s'inquiète pour ses abeilles.
Il faut dire que, ici, l'enjeu est de taille. Depuis cinq ans, le Golden State investit massivement dans les amandiers, après avoir volontairement abandonné ou négligé plusieurs autres cultures agricoles traditionnelles - fruits et légumes, notamment -, devenues moins rentables à cause de l'augmentation du coût des fertilisants. Avec plus de 320.000 hectares de vergers d'amandiers plantés dans tout l'Etat, la Californie produit 80 % du marché mondial. Désormais, les amandes représentent la principale exportation agricole californienne, devant le vin et les fruits et légumes. Paradoxe économique, une part croissante de sa production va désormais vers la... Chine. Depuis peu, les Californiens embauchent même des acteurs vedettes de l'empire du Milieu pour vanter les mérites de l'amande locale.
Mais si cette industrie ne connaît pas la crise, surfant sur un marché loin d'être saturé - surtout en Asie -, un danger menace néanmoins les 6.000 cultivateurs de la région. La récolte dépend en effet de millions d'abeilles pour la pollinisation des amandiers. Sans elles, pas de fertilisation. Or les producteurs californiens ne trouvent plus assez d'insectes sur place pour polliniser leurs centaines de milliers d'hectares. A tel point qu'ils louent désormais des abeilles en dehors des Etats-Unis (certaines viennent maintenant d'Australie) pendant la période de fertilisation. Et cela leur coûte de plus en plus cher...
Un phénomène mondial
Au-delà de l'aspect purement financier, les difficultés rencontrées par les producteurs locaux illustrent un phénomène mondial, de plus en plus inquiétant. « Si le nombre d'abeilles continue de diminuer en Californie, c'est l'ensemble de cette filière qui est menacée, car elle dépendra des réserves d'abeilles disponibles dans d'autres pays, or il est bien possible que la population des abeilles soit globalement en train de diminuer dans le monde », explique le docteur Sydney Cameron, entomologiste à l'université Urbana Champain de l'Illinois.Cette scientifique sait de quoi elle parle. Spécialisée dans l'étude des abeilles, elle vient de rendre publique une enquête qui, pour la première fois, a étudié sur l'ensemble du territoire américain les raisons pour lesquelles le nombre des abeilles est en train de diminuer outre-Atlantique. Publiée dans la revue de l'Académie nationale des sciences, cette étude tire un véritable signal d'alarme. « Nous n'avons étudié en profondeur que huit des cinquante espèces de bourdons vivant aux Etats-Unis, mais la moitié d'entre eux sont sérieusement en danger », assure-t-elle. Dans certains cas, la presque totalité d'une race d'abeilles a disparu, le nombre des autres ayant diminué de 23 à 87 % ! L'étude a duré trois ans, sur plus de 400 sites répartis sur l'ensemble du pays, en constituant des bases de données sur des dizaines de milliers de ruches et en les comparant, quand c'était possible, à des statistiques plus anciennes.
Les conséquences de la disparition éventuelle des bourdons seraient considérables. Si cette race d'abeilles est celle qui produit du miel, son rôle primordial est la pollinisation des fleurs et - plus important encore pour l'espèce humaine -celle d'une grande majorité de fruits et de légumes. Sans ces abeilles qui assurent la reproduction des végétaux, c'est la disparition assurée d'au moins la moitié des aliments d'origine végétale qui composent notre assiette. L'enjeu avait été perçu par Albert Einstein lui-même, assurant que « si l'abeille venait à disparaître, l'humanité ne pourrait lui survivre que quelques années ».
Car c'est tout l'écosystème de la planète qui serait alors menacé. Les forêts tropicales, la végétation de nombreuses régions côtières, toutes les fleurs sauvages, même les plantes de régions désertiques seraient en danger s'il n'y avait plus d'abeilles pour assurer cette pollinisation, assure Sydney Cameron.
L'inquiétude n'est pas nouvelle. Les premières diminutions d'abeilles observées en Amérique remontent au début des années 1990. Mais c'est la première fois qu'une étude réellement scientifique vient la confirmer dans les faits. « Le problème est que, comme c'est la première fois que nous réalisons une étude si globale aux Etats-Unis, nous manquons d'éléments pour savoir si ce phénomène est ancien ou pas. Si c'est seulement le début, c'est particulièrement inquiétant, car le phénomène de diminution que nous avons observé est particulièrement rapide », poursuit la scientifique.
Pour l'équipe du docteur Cameron, il ne fait guère de doute que la diminution significative des abeilles pollinisatrices s'accompagne d'une baisse des abeilles sauvages. Mais, pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les espèces les plus menacées, ni dans quelles proportions. D'autres études ont donc été lancées, aux Etats-Unis mais aussi ailleurs dans le monde, depuis 2007. Leurs résultats devraient être connus prochainement.
En attendant de savoir « combien » d'insectes ont disparu, on peut déjà parler des causes de leur disparition. Parmi les raisons avancées dans l'enquête américaine, celles liées à l'activité humaine sont évidemment placées en première ligne. Si l'emploi de pesticides dans l'agriculture est à l'évidence néfaste, il y a bien d'autres facteurs. Par exemple la monoculture intensive (en particulier de cultures qui n'ont pas besoin de pollinisation) réduit sensiblement la biodiversité, donc la végétation sauvage dont les abeilles ont besoin pour se reproduire et vivre dans un environnement qui leur convient. Sydney Cameron n'écarte pas non plus le réchauffement climatique comme facteur aggravant, même si là non plus aucune étude scientifique n'a encore fourni de conclusions incontestables. Le résultat cumulé de ces facteurs se traduit par ce que les scientifiques appellent le « colony collapse disorder », qui voit les abeilles quitter leur nid, pour ne jamais y revenir. « Le problème avec la diminution rapide du nombre des abeilles c'est qu'il y a un effet de seuil, au-delà duquel on ne pourra plus rien faire. Et l'on ne sait pas si l'on en est proche ou pas », résume la spécialiste. Quoi qu'il en soit, certains scientifiques américains estiment que la situation empire. « La situation s'est aggravée ces quatre dernières années », assure Jeff Pettis, directeur du Bee Research Laboratory, au ministère américain de l'Agriculture.
Engouement citoyen
En Californie, en tout cas, on n'attend pas le résultat de nouvelles études sur le sujet pour se mobiliser. Et les initiatives en tout genre se multiplient. Par exemple celle du docteur Gretchen LeBuhn, spécialiste des abeilles au département de biologie à la San Francisco State University. Il y a presque deux ans maintenant, elle a lancé le Great Sunflower Project (GSP), dont l'ambition est de constituer un outil scientifique d'observation en mobilisant la population. N'importe qui peut donc devenir membre de ce projet en acceptant des graines d'une variété spéciale de tournesol, envoyées par les responsables du GSP. Il faut alors observer le manège des abeilles autour de cette fleur (choisie parce qu'elle attire particulièrement les abeilles pollinisatrices) pendant au moins quinze minutes, plusieurs fois par semaine. « D'un point de vue scientifique, ce que l'on cherche à faire, c'est d'obtenir la carte la plus complète possible des Etats-Unis pour savoir où fonctionne la pollinisation et où elle ne fonctionne pas, ou mal », explique Gretchen LeBuhn. Aujourd'hui, plus de 100.000 personnes ont accepté de planter des tournesols dans leur jardin, y compris en zone urbaine ou suburbaine, dont une majorité se trouvent en Californie. « Les données que nous avons recueillies nous permettent maintenant de disposer d'éléments pour savoir, par exemple, si les abeilles sont sensibles à un type d'urbanisation ou à la densité de la population. On peut aussi relier ces informations aux facteurs environnementaux pour déterminer quels liens il peut y avoir. » Les données sont également suffisamment nombreuses pour identifier les endroits où la recolonisation est la plus nécessaire et ces endroits font donc l'objet d'incitations plus fortes pour trouver des volontaires.Maintenant qu'il a prouvé qu'il pouvait susciter un réel engouement citoyen, le Great Sunflower Project aimerait se donner une dimension réellement planétaire. « Il ne faut pas s'y tromper, confirme en effet Gretchen LeBuhn, la majorité de ceux qui acceptent de participer au projet suit également nos conseils pour améliorer la survie de cette espèce. Notamment en ce qui concerne l'amélioration de leur environnement d'habitation, afin qu'elles puissent mieux se reproduire. » High-tech oblige dans le Golden State, l'initiative est relayée sur les réseaux sociaux, notamment sur Flickr, où les participants échangent des photos de leurs jardins pollinisateurs pour obtenir en retour des conseils d'autres membres du projet.
Certaines entreprises industrielles californiennes sont également très actives pour aider à résoudre le problème des abeilles. C'est le cas du glacier Häagen-Dazs, installé au nord de la Silicon Valley, sensibilisé au problème, puisque 40 % des ingrédients qui composent ses parfums ont besoin d'abeilles pollinisatrices. Depuis deux ans, le groupe finance des programmes de recherche universitaire. Il a même fait installer un immense jardin, sur le campus Davis de l'université de Californie, composé de fleurs qui attirent les abeilles afin de mieux les étudier. Plus original, l'entreprise encourage, sur son site Web, les internautes à exploiter eux-mêmes des jardins susceptibles de plaire aux abeilles. Elle assure également reverser la totalité du chiffre d'affaires généré par son magasin virtuel HelpTheHoneyBees.com aux recherches scientifiques, ainsi qu'une partie des revenus générés par sa glace au miel d'abeilles. Sponsor du Pollinator Partnership (une association à but non lucratif de San Francisco, créée il y a quinze ans pour protéger tous les animaux pollinisateurs), Häagen-Dazs joue même un rôle de lobbyiste à Washington sur ce sujet, en réunissant régulièrement des parlementaires pour les pousser à agir.
Le Congrès sensibilisé
Pour quel résultat ? Le Congrès semble désormais prendre très au sérieux l'alarmante diminution du nombre des abeilles américaines. Un comité, formé d'élus républicains et démocrates, s'est ainsi formé l'année dernière. Il s'est fixé pour objectif d'attribuer un financement important pour réaliser de nouvelles recherches sur les causes de la mortalité des abeilles et tenter d'y remédier. Plusieurs dizaines de millions de dollars devraient ainsi être débloqués dans la prochaine « Farm Bill », qui sera votée en 2012. « Pour l'instant, nous ne connaissons même pas l'état exact de la situation, reconnaît Laurie Adams, directrice du Pollinator Partnership. Nous espérons que ces financements permettront enfin de dresser un véritable état des lieux et ensuite pouvoir agir. »Michel Ktitareff, À PALO ALTO
-
Une alerte de plus : le phosphore
- Par Thierry LEDRU
- Le 23/02/2024
Une situation qui concerne encore une fois le milieu agricole : dépendance à une ressource exportée, détérioration de la biodiversité, gaspillage, régime alimentaire carné... De la nécessité de revoir le système agricole intensif...
Phosphore : faut-il craindre une pénurie ?
Par Sophie Gosselin et David Gé Bartoli , publié le 10 janvier 2022
https://www.socialter.fr/article/le-phosphore-de-l-or-pour-un-tas-de-fumier

Élément indispensable à toute vie mais pouvant avoir des conséquences désastreuses sur les écosystèmes, le phosphore a participé à l’essor de l’agriculture industrielle de l’après-guerre en étant utilisé massivement dans les engrais de synthèse. Alors que la demande mondiale en roches phosphatées n’a jamais été aussi forte, les craintes sur le caractère plus ou moins durable de cette ressource amènent à reconsidérer les usages que nous en faisons.
Les lecteurs versés dans la science-fiction le connaissent principalement comme l’inventeur des trois lois de la robotique ou de la « psychohistoire », concept au cœur de la saga Fondation, actuellement adaptée en série par Apple TV+. Mais Isaac Asimov, accessoirement docteur en biochimie, a également fait de la vulgarisation scientifique son terrain de jeu littéraire. Dans un essai publié en 1959, l’écrivain américain souligne l’importance du « P » figurant sur la droite du tableau de Mendeleïev. Ce « P », la lettre symbolisant le phosphore, n’est rien moins que le « goulot d’étranglement de la vie ». Supprimez-le et le moindre être vivant aura toutes les peines du monde à exister sur notre planète. « Nous pouvons remplacer le charbon par l’énergie nucléaire, le bois par le plastique, la viande par la levure et la solitude par l’amitié. Pour le phosphore, il n’y a ni substitut ni remplaçant », insiste Isaac Asimov.
Des animaux à la moindre molécule d’ADN en passant par les enzymes et les parois de bactéries cellulaires, il y a donc du phosphore partout dans la nature, mais seulement sous une forme oxydée (phosphate). Le phosphore compte pour environ 1 % de la masse corporelle d’un humain, l’essentiel se nichant dans nos tissus osseux et nos dents. « Peu importe ce que nous mangeons, cette nourriture provient plus ou moins directement des plantes et les plantes croissent grâce au phosphore », ajoute Stuart White, directeur de l’Institut des futurs durables à l’université de technologie de Sydney. Pour stimuler cette croissance et leurs rendements, les agriculteurs enrichissent leurs sols en phosphore avec des fertilisants pouvant également contenir de l’azote (N) et du potassium (K), autres nutriments essentiels. Cette ubiquité apparente ne doit pas occulter le fait que le stock de phosphore disponible sur Terre n’est pas illimité mais fini, ce qui confère à cette ressource un caractère d’autant plus précieux.
Le raté en or d’un alchimiste
Quand il fait par hasard la découverte de cet élément vers 1669, à Hambourg, Hennig Brandt est en quête d’un bien encore plus précieux : la pierre philosophale, censée transformer n’importe quel métal en or. Une nuit, l’alchimiste allemand pense être parvenu à ses fins après avoir distillé de l’urine humaine. La forme solide résultant de cette expérience intrigue Brandt par la lumière vert pâle qui en émane. C’est du phosphore. Passé à la postérité, Brandt était-il vraiment le premier à mettre au jour l’élément ? Dans son stimulant livre retraçant l’histoire du phosphore, John Emsley remarque qu’il était peut-être déjà connu des Romains dans l’Antiquité et que le secret de sa fabrication a pu se perdre avec le temps. Avec son caractère hautement inflammable, surtout sous sa forme blanche, particulièrement instable, le phosphore va hériter du surnom peu flatteur d’« élément du diable ». Le phosphore blanc sert par exemple aux bombes incendiaires qui s’abattent sur plusieurs villes allemandes ciblées par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale dont Hambourg, là-même où Brandt fit sa grande découverte près de trois siècles plus tôt.
Des millénaires avant de l’exploiter pour semer la mort, l’humanité a tiré parti du phosphore pour cultiver le vivant, quand bien même elle ignorait tout de l’identité du bienfaiteur. D’abord grâce au feu et aux cendres contenant du phosphore utilisable par les plantes, puis en recouvrant les champs d’excréments animaux ou humains. Comme le mettra en évidence l’expérience de Brandt, les déchets produits par notre corps recèlent de ce « P » si convoité. Les paysans chinois en avaient déjà conscience il y a des milliers d’années de cela. « Grâce à l’engrais humain, la terre en Chine est encore aussi jeune qu’au temps d’Abraham », observe Victor Hugo dans le chapitre « La terre appauvrie par la mer » des Misérables,où l’écrivain se lamente de voir cet « or fumier […] balayé à l’abîme » à Paris et en France. C’est qu’au XIXe siècle, l’urbanisation commence à priver les paysans d’un fertilisant humain échouant désormais dans les cours d’eau. Dès lors, où trouver le phosphore ? Une première piste mène aux zones d’accumulation de guano, comme les îles Chincha, au Pérou, ou Nauru, autre bout de terre du Pacifique, au siècle suivant. Depuis, le stock s’est épuisé à Nauru et l’île, dont le PIB par habitant est le plus élevé du monde dans les années 1990, est maintenant exsangue.
Des ressources inégalement réparties
Au XXe siècle et jusqu’à nos jours, l’écrasante majorité du phosphate est tirée de l’extraction minière. « Tel qu’il est exploité aujourd’hui, le phosphore est une ressource fossile, comme les hydrocarbures, explique Fabien Esculier, chercheur au Laboratoire eau environnement et systèmes urbains (Leesu) à l’École des Ponts Paris Tech. Des conditions géologiques ont favorisé la sédimentation d’organismes et cela a créé au bout de plusieurs millions d’années une couche très riche en phosphore. » Les zones avec de fortes concentrations sont loin d’être également réparties sur la surface du globe. Pour la plupart, elles se trouvent en Afrique du Nord, en Chine, aux États-Unis, en Russie. Selon le dernier rapport annuel de l’Institut d’études géologiques américain (USGS), les seules réserves en roches phosphatées du Maroc et du Sahara occidental s’élèveraient à 50 milliards de tonnes, soit 70 % du total mondial. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la production de ces roches a été multipliée par six et, en 2020, elle a atteint 223 millions de tonnes, dont 90 millions rien qu’en Chine.
« Une partie de ce phosphore est utilisée comme détergent et une autre comme additif chimique pour la nourriture, mais 80 % du phosphore extrait est utilisé pour les fertilisants chimiques », souligne Bruno Ringeval, chercheur à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) de Bordeaux. Ces engrais de synthèse, employés en masse, ont contribué à façonner l’agriculture moderne post-Seconde Guerre mondiale... et ses excès. En France et dans d’autres pays industrialisés, leur utilisation a atteint son pic dans les années 1970-1980 avant d’accuser une baisse. Julien Némery, chercheur à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE) de Grenoble, en détaille l’une des raisons : « Pendant longtemps, l’idée reçue dans le monde agricole était que plus on mettait de fertilisants, plus on produisait. Après des décennies d’essais, l’Inrae a montré que cette idée était fausse. Il n’y a pas besoin de mettre cinq fois plus d’engrais que nécessaire pour avoir un rendement cinq fois plus élevé. »
L’autre raison expliquant cette diminution est la prise de conscience des problèmes environnementaux provoqués par le recours immodéré aux engrais phosphatés. Si les sols peuvent stocker une partie du surplus de phosphore, une autre partie terminera sa course dans les cours d’eau, du fait de l’érosion et du lessivage des sols par la pluie. En se cumulant avec le phosphore contenu dans les rejets d’eaux usées peu ou non traitées, ce surplus accentue les phénomènes d’eutrophisation, avec prolifération des algues vertes à la clé. Mais cette perturbation du cycle du phosphore peut avoir des conséquences bien plus graves, comme une désoxygénation des écosystèmes aquatiques et océaniques, fatale pour la vie marine. « Des événements anoxiques [épuisement d’un milieu aquatique en dioxygène, ndlr] ont déjà lieu dans de nombreux endroits, par exemple en mer Baltique. Une partie des scientifiques n’exclut pas des changements profonds des équilibres biogéochimiques des grands cycles marins menant potentiellement à des anoxies plus fortes », alerte Fabien Esculier. Le risque de voir ces phénomènes se multiplier est encore plus élevé en Chine, en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud, où la demande en engrais phosphatés a explosé. Cette soif s’explique notamment par une montée en puissance de l’agriculture intensive dans ces régions, ainsi que la part de plus en plus grande occupée dans les régimes alimentaires locaux par les produits d’origine animale qui, rappelle Stuart White, « requièrent cinq à dix fois plus de phosphore que leur équivalent végétal ayant les mêmes caractéristiques nutritionnelles ».
Le pic à l’horizon ?
Avec toujours plus d’êtres humains à nourrir sur notre planète (près de 10 milliards en 2050 selon les projections démographiques de l’ONU établies il y a deux ans), autre facteur faisant grimper la demande en phosphore, une pénurie est-elle à prévoir ? Déjà, dans un message datant de mai 1938, c’est en président inquiet que Franklin Roosevelt demandait aux élus du Congrès de se pencher sur les ressources en phosphore des États-Unis pour assurer « des approvisionnements continus et suffisants […] au prix le plus bas ». Le sujet suscite toutefois un intérêt croissant depuis une dizaine d’années et les travaux menés par Dana Cordell et Stuart White. Dans un article publié en 2009, les deux chercheurs australiens ont situé le pic de production mondiale du phosphore dans un futur très proche, aux alentours de 2030. « Quand nous avons mené ces travaux, nous nous sommes basés sur les informations alors disponibles, souligne Stuart White. Peu après, le Centre international de développement des engrais (IFDC) a corrigé les chiffres des réserves, avec une réévaluation à la hausse vertigineuse pour le Maroc et le Sahara occidental. » Même après avoir refait ses calculs, le duo est parvenu à la conclusion que le pic sera passé au cours du XXIe siècle. Pour l’IFDC, qui n’intègre pas de hausse de la demande en phosphore dans ses estimations, les réserves sont amplement suffisantes pour plusieurs centaines d’années. « Il n’y a pas de pénurie imminente de roches phosphatées », assure pour sa part l’Institut d’études géologiques américain dans son dernier rapport.
Indépendance et changement de régime
Au-delà de ces résultats divergents, Bruno Ringeval souligne la difficulté de l’exercice sans une connaissance approfondie de la nature du phosphore disponible. « Il y a des réserves dont la qualité est plus faible, où l’extraction est plus compliquée et plus chère », précise-t-il. Sans parler des considérations géostratégiques compliquant l’accès à la ressource : « Même le phosphore existant peut ne pas être disponible parce que le pays le produisant ne veut pas l’exporter ou augmente ses prix. » En septembre dernier, la Chine a par exemple décidé de geler toutes ses exportations de phosphate au moins jusqu’en juin 2022, contribuant à une hausse du prix des engrais chimiques depuis le début d’année. À plus long terme, l’exploitation des immenses réserves de phosphate au Sahara occidental pose également question. Ce territoire, au statut juridique indéterminé pour l’ONU, est au cœur des tensions entre le Maroc, qui en contrôle effectivement la majeure partie, et l’Algérie, soutien du Front Polisario qui revendique l’indépendance du Sahara occidental.
Même en écartant l’hypothèse de la pénurie, devenir de moins en moins dépendant de l’extraction de roches phosphatées est donc crucial pour les régions ne disposant pas de mines, comme la France et les autres membres de l’Union européenne (UE). En 2014, l’UE a ainsi placé les roches phosphatées comme matière première critique pour son approvisionnement. Quelles seraient les alternatives ? Pour Fabien Esculier, la première des priorités est d’avoir une « logique de sobriété dans les usages », et donc de réduire la quantité de phosphore consommée. « Dans les sociétés occidentales, les habitants mangent beaucoup plus de phosphore que ce dont ils ont besoin, explique le chercheur. En France, le régime alimentaire comprend globalement deux tiers de protéines d’origine animale et un tiers d’origine végétale. Inverser ces proportions aurait un impact très fort sur les produits phosphorés. »
L’autre enjeu est celui d’avoir un cycle du phosphore plus vertueux, effectuant plusieurs boucles et non une seule ligne droite aboutissant au fond des océans. Le principal levier pour y parvenir, c’est un recyclage accru des excrétions animales ou humaines. Pour les secondes, outre la récupération des boues d’épuration où le phosphore est précipité, cela peut passer par une séparation à la source de l’urine et des matières fécales. « En France, il y a toujours eu des voix pour dire qu’il faut retourner les excréments au sol, note Fabien Esculier, qui a consacré une thèse à ce sujet. Elles ont juste été très peu audibles et marginalisées après la Seconde Guerre mondiale. » Ce retour aux pratiques les plus classiques de l’humanité pour valoriser davantage encore notre « or fumier » sonnerait comme une belle revanche pour Victor Hugo, qui écrivait également ceci dans Les Misérables : « Vous êtes maîtres de perdre cette richesse, et de me trouver ridicule par-dessus le marché. Ce sera là le chef-d’œuvre de votre ignorance. »
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
-
Maisons d’édition écolos
- Par Thierry LEDRU
- Le 23/02/2024
Ces maisons d’édition écolos qui bousculent les codes
https://reporterre.net/Ces-maisons-d-edition-bousculent-les-codes-pour-faire-du-bien-a-la-planete?

Relocalisation de l’impression, encres végétales, impression à l’unité... Certaines maisons d’édition françaises tentent, à leur échelle, de proposer une industrie du livre plus écolo.
Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), reportage
À Cournon-d’Auvergne, Hervé Meiffren attend devant la médiathèque qui se trouve à côté de chez lui, deux petits cartons sous les bras. « C’est un tiers de notre stock », dit-il, amusé. En fin d’année 2023, cet ancien commercial s’est lancé dans l’aventure de l’édition avec son fils de 26 ans, Yoann Meiffren. Ensemble, ils ont monté Cornaline, une maison d’édition, autour d’un engagement pour l’environnement et d’un principe fort : « Pas de livres au pilon. »
13 % de la production de livres a été détruite en 2021-2022, selon le dernier rapport du Syndicat national de l’édition. Cela représenterait plus de 60 millions d’ouvrages qui sont ensuite pour la majorité recyclés en carton d’emballage ou en papier hygiénique.
« On ne se retrouvait pas dans la manière de faire actuelle, surtout au niveau de la surproduction », raconte Hervé. C’est pour cela que leur première publication, La Connerie humaine, n’a été tirée qu’à 600 exemplaires. « Six petits cartons ! » dit l’autoentrepreneur, qui garde ce maigre stock chez lui. Un engagement qui peut s’avérer parfois difficile à tenir face à l’industrie de l’impression qui baisse le prix pour plus de tirages. « On m’en a proposé 1 200 pour moins cher, mais ce n’était pas notre mentalité, j’ai refusé. »

Les éditions Cornaline ne réalisent que de petits tirages qui tiennent dans quelques petites boîtes en carton. © Clément Moussière / Reporterre
« Vous pensez vraiment que les clients ne peuvent pas attendre 2 ou 3 semaines pour avoir un bouquin ? » dit Hervé Meiffren, agacé et le regard posé sur La Connerie humaine, une BD d’humour satirique. C’est aussi la réflexion de Christophe Lahondès, fondateur du groupe d’édition nîmois Nombre 7, qui imprime ses ouvrages à l’unité, à la demande. « Ça me semble être du bon sens, je ne vais pas faire couper des arbres pour que [les livres] restent dans des cartons et finissent à la poubelle. »
Papier recyclé, encre végétale...
Chaque année, 1 livre sur 5 est renvoyé chez son éditeur par le libraire. Pour éviter cela, Cornaline refuse les retours. Et ce, quoiqu’il en coûte. « On nous a déjà refusé une séance de dédicaces parce qu’on ne reprend pas les bouquins. » L’apprenti éditeur lève les yeux au ciel. Mais quand retour il y a, des alternatives au pilon existent.
Sandrine Roudaut, qui a fondé La Mer salée, une maison d’édition située près de Nantes (Loire-Atlantique), préfère en faire don à des publics dits « sensibles ». Pour elle, « il faut surtout faire de la pédagogie auprès des libraires et des lecteurs sur la qualité des livres, car, parfois, on nous renvoie des ouvrages à peine cornés ».
Elle n’est pas seule à porter cette réflexion. À La Cabane bleue, une maison d’édition jeunesse régulièrement citée comme exemple pour ses agissements environnementaux, Angela Léry s’interroge : « N’est-ce pas superflu de vouloir un objet parfait ? » Comme La Mer salée, sa maison d’édition a supprimé le pelliculage en plastique qui recouvre la plupart des couvertures. « Il est utilisé pour que le livre brille et ne s’abîme pas, mais c’est une question d’éducation, affirme Angela Léry. Nos livres parlent de la beauté de la nature, ça nous guide dans nos engagements. »

La transparence sur les pratiques de La Mer salée est une des valeurs fondamentales de la maison d’édition. © Clément Moussière / Reporterre
Avant de cofonder La Cabane bleue, Angela et son amie Sarah étaient éditrices dans d’autres groupes : « On ne se sentait pas alignées avec les maisons dans lesquelles on travaillait. » Pour leur projet, elles sont parties « des incohérences » et d’un constat : « L’objet même du livre n’est pas écolo. »
Aujourd’hui, l’empreinte carbone moyenne d’un ouvrage acheté en librairie est estimée à environ 2 kg, dont la majorité provient de la fabrication. La production de pâte à papier par exemple est très gourmande en ressources et le plus souvent importée, notamment du Brésil.

Alicia Cuerva utilise du papier de récupération pour décorer les gardes des livres édités par Cosette Cartonera. © Clément Moussière / Reporterre
Alors avant de se lancer, les éditrices de La Cabane bleue ont commencé par écrire sur une feuille tous les matériaux qui composent le livre, afin de réfléchir à chaque élément. Et c’est comme cela qu’elles ont décidé de se tourner vers du papier certifié FSC (assurant la légalité du bois et la gestion durable de l’exploitation) et/ou du papier recyclé, et ont découvert l’existence de l’encre végétale. Ces encres utilisent des ressources naturellement renouvelables comme le colza, contrairement aux encres minérales issues en général de la pétrochimie.
« Ce n’est pas encore 100 % parfait, mais on utilise aussi un profil de couleurs peu gourmand en encre [par exemple le violet requiert davantage d’encre qu’un simple rouge], idem pour les typographies, un noir à 80 %, énumère Angela. Ce sont des choix que l’on peut faire à partir du moment où l’on veut faire mieux. »
Imprimerie à 750 mètres de l’atelier
En plus de cela, ces petites mains du changement ont travaillé sur les dimensions des bouquins pour adopter des formats standards qui évitent le gâchis de papier. « Parfois on n’y pense pas, mais même pour les envois par la poste il y a des standards d’enveloppes en carton », dit Sandrine Roudaut.
À la fin de ses bouquins, La Mer salée édite un colophon « pour sensibiliser à [sa] démarche pour l’environnement ». Il s’agit d’une page sur laquelle sont par exemple indiqués les matériaux utilisés, la provenance des produits et le fait que la maison d’édition ait décidé de tout faire dans un périmètre de 100 km.
« L’une des grosses difficultés, c’est de tout faire fabriquer au local, en France, et au même endroit, pour réduire le coût carbone du transport », explique Angela Lévy. Un point de vue partagé par Alicia Cuerva, créatrice de Cosette Cartonera, qui a trouvé une imprimerie à seulement 750 m de son petit atelier, dans le centre-ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). « Il me suffit de prendre mon vélo pour aller chercher mes pages », dit l’éditrice en rigolant.

La majorité du stock des éditions Cosette Cartonera tient sur cette étagère du petit atelier. © Clément Moussière / Reporterre
Ce n’est pas le cas de tous les éditeurs, certains préférant imprimer en Europe de l’Est ou en Asie pour des questions budgétaires. « Impensable » pour cette amoureuse de la nature. Derrière son bureau « de récup’ » en bois, elle s’affaisse, concentrée, à la fabrication de sa prochaine publication. Ici, les livres sont le résultat de ses mains d’artisanes. Couverture en carton, dos en calendrier périmé et reliure à la main.
Elle a créé sa maison d’édition au retour d’un long voyage en Amérique latine, et tout, dans son atelier, rappelle cela : de la musique aux décorations de toucans. Là-bas, elle s’est inspirée des « cartoneras ». Un mouvement de maisons d’édition né en Argentine, en réaction à la crise des années 2000, qui récupèrent du carton usagé pour en faire des couvertures de livres. Pour cette passionnée de l’artisanat « faire un livre en carton, à la main, c’est un engagement qui interroge et qui oblige à limiter la production. Dans le secteur, il y a un tabou, on ne fait plus rien à échelle humaine ».
Pour beaucoup, la volonté de mieux faire pour l’environnement s’accompagne d’une réflexion éthique. C’est pourquoi ces maisons d’édition ont aussi décidé de se pencher sur la rémunération des auteurs. « Ça va de pair », explique Sandrine Roudaut, de La Mer salée. Un avis partagé par Christophe Lahondès : « Avoir peu de publications et des tirages en nombre limité nous permet de valoriser davantage les textes publiés et d’accorder plus de reconnaissance aux auteurs. »
« C’est souvent la question économique qui entre en conflit avec l’écologie, l’éthique et conditionne les choix, s’exaspère Sandrine Roudaut. Nous, sur les valeurs on ne négocie pas, c’est sur le modèle économique qu’on essaye de voir. » Les textes qu’ils publient parlent d’utopies, de modes de vie plus sobres et joyeux. « On veut nourrir la foi en l’humanité, le contenu de nos livres aussi est politique », dit-elle.
De manière générale, ces maisons d’édition prônent plus de sobriété. Hervé Meiffren pense qu’« il faut réfléchir à décroître et trouver un équilibre pour arrêter de mettre l’argent au cœur des décisions ». Toutes et tous s’accordent à dire qu’ils ne peuvent pas « tout révolutionner, mais, peut-être, inspirer un peu ». Depuis 2019, l’association Pour une écologie du livre fédère éditeurs, auteurs et libraires pour diffuser ces idées.
-
Vasectomie : état des lieux
- Par Thierry LEDRU
- Le 21/02/2024
Que c'est long en France pour que les mentalités changent...Que c'est long...Cette médecine toute puissante, elle a dans son comportement des relents archaïques...J'avais déjà écrit un article sur le sujet, c'était en 2020:
J'avais 37 ans quand j'ai décidé de demander une vasectomie. Nous avions trois enfants et Nathalie souffrait de la contraception chimique, physiquement et psychologiquement. Il était clair pour moi que la solution la plus simple, c'était l'opération chirurgicale. Je n'aurais pas imaginé que ça serait aussi compliqué.
La gynécologue s'y est catégoriquement opposée et son aval était indispensable. Elle considérait qu'il était impossible de présager de l'avenir et que plusieurs situations inattendues pouvaient survenir et nous amener à regretter notre choix : la perte d'un enfant par exemple. Comme s'il était juste, sain, et raisonné de concevoir un enfant pour en remplacer un autre... ou une séparation du couple et une nouvelle compagne qui voudrait un enfant avec moi. Sauf qu'à 37 ans, je ne voulais pas d'un bébé, d'un jeune enfant, et tout ce qu'implique le rôle de père. Je l'avais vécu, j'en étais comblé et heureux et c'est une étape de ma vie qui était achevée. Je rétorquais également qu'une nouvelle compagne aurait probablement elle aussi un ou des enfants et n'en souhaiterait pas forcément un autre.
Rien à faire, elle ne voulait pas nous donner son accord.
Je me suis donc tourné vers mon médecin généraliste, il nous a rencontrés, séparément, il nous a écoutés, et il a jugé que nous étions conscients et lucides sur l'aspect quasiment irrémédiable de l'intervention. Il m'a conseillé malgré tout de procéder à une congélation de mon sperme. Ce que j'ai refusé puisque ça serait en opposition avec mes arguments. Je ne voulais plus d'enfants, ni naturellement, ni par insémination. Malgré son parcours hospitalier dans la région grenobloise, il ne connaissait pas de chirurgien. C'était une intervention très rare selon lui. On était en 1999. Finalement, après quelques recherches, un chirurgien a accepté de m'opérer. Une anesthésie locale suffit. Il faut au préalable se raser très soigneusement toute la partie génitale, une infirmière est venue vérifier que c'était fait et je suis parti au bloc. J'ai été isolé visuellement par une toile et le chirurgien et une assistante ont procédé à l'opération. Dans mon souvenir, ça n'a pas dû prendre plus de trente minutes et je suis rentré chez moi. Il faut passer un spermogramme deux semaines après l'opération. Il n'y a aucune différence de consistance dans le contenu séminal. Il ne manque que les spermatozoïdes. Et même si ça avait le cas, je n'y aurais attaché aucune importance.
Affaire réglée.
Quant aux réticences sur la masculinité ou la virilité, je ne me sentais aucunement concerné. La seule chose qui m'importait, c'était le bien-être de Nathalie. Si la virilité tenait à la présence de spermatozoïdes dans l'éjaculation, ça serait vraiment, vraiment juste pitoyable...A mon sens, la virilité, c'est de prendre soin de sa compagne. Coûte que coûte.
Il reste un point important et qui relève de l'absence de connaissance chez les hommes.
Il est parfaitement possible de parvenir à l'orgasme sans éjaculer. Avec ou sans spermatozoïdes mais il semble que beaucoup d'hommes imaginent qu'une vasectomie va les priver de l'éjaculation...
Et avant de l'avoir expérimenté, il est impossible d'imaginer la puissance de cet orgasme et le bonheur spirituel et physique que cette pratique procure à l'homme. Et à la femme, étant donné que la capacité à conserver l'érection contribue bien évidemment au plaisir féminin. La conscience des muscles pelviens, le contrôle du souffle, l'abandon de l'idée de l'éjaculation comme une nécessité dans la quête de l'orgasme. Le tantrisme est la voie...
La lecture de "KUNDALINI" serait une première approche pour ceux que ça intéresse.
Life 18/02/2024 09:00 Actualisé le 18/02/2024 15:31
Une vasectomie avant 25 ans ? Ces hommes racontent leur parcours médical semé d’embûches
Faire une vasectomie quand on est jeune et sans enfants peut être compliqué, la faute à un corps médical qui a parfois du mal à accepter ce choix.
Par Mathieu Alfonsi

Inti St Clair / Getty Images/Tetra images RF
Les jeunes hommes qui souhaitent faire une vasectomie font souvent face au refus des chirurgiens.
CONTRACEPTION - « J’ai essuyé le refus de trois urologues consécutifs. » Lorsqu’Émilien entame les démarches pour faire une vasectomie alors qu’il n’a pas encore 25 ans, il se heurte aux réticences du corps médical. En cause ? Il est « trop jeune » pour se priver de la possibilité d’avoir des enfants. « On me disait que j’en voudrais plus tard. Comme je n’avais pas de maladie et que j’étais en bonne santé, il n’y avait aucune raison que je n’en veuille pas. »
Lire aussi
La vasectomie, futur moyen de contraception privilégié aux États-Unis?
La vasectomie est considérée comme une contraception définitive, bien qu’elle puisse être réversible dans certains cas. Elle consiste à bloquer les spermatozoïdes via une ligature des canaux déférents qui les transportent depuis les testicules. Et elle gagne en popularité : selon une étude de l’Assurance maladie et de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, publiée lundi 12 février, le nombre de vasectomies pratiquées en France a été multiplié par quinze entre 2010 et 2022.
Un intérêt croissant qui n’empêche pas certains jeunes hommes de rencontrer des difficultés pour faire cette opération. Cela a été le cas d’Émilien, mais aussi de Thomas*, un ouvrier agricole originaire du Rhône-Alpes. Tous deux ont fait une vasectomie avant l’âge de 25 ans et se sont confrontés aux nombreux refus des médecins. Pour Le HuffPost, ils racontent leur parcours semé d’embûches jusqu’à la vasectomie.
« J’avais l’impression que mon corps n’était plus le mien »
Deux principales raisons ont poussé ces jeunes hommes à opter pour la vasectomie : ils ne voulaient pas d’enfant et souhaitaient partager la charge de la contraception avec leur compagne. « Je ne voyais pas de raison de ne pas le faire. Au pire, l’opération inverse existe même si elle n’est pas sûre à 100 %, et il y a aussi l’adoption », raconte Émilien. Après quelques mois de réflexions, il décide de sauter le pas.
La procédure est en apparence assez simple : Émilien doit d’abord prendre un premier rendez-vous avec un urologue, qui lui expliquera en quoi consiste l’opération et recueillera son consentement. Puis, il doit fixer une date pour procéder à la vasectomie, au minimum quatre mois plus tard. Mais, dans le cas d’Émilien, c’est dès le premier rendez-vous que les difficultés surviennent.
« Les urologues essayaient de me faire changer d’avis, et me disaient qu’ils ne faisaient pas de vasectomie avant 30 ou 35 ans. Je me disais : s’ils savent qu’ils ne feront pas l’opération, puisque j’ai 24 ans, pourquoi acceptent-ils le rendez-vous ? J’avais l’impression de perdre mon temps et mon argent », détaille le boulanger.
Les chirurgiens ont le droit de ne pas procéder à l’opération, au nom de la clause de conscience, selon laquelle un médecin peut refuser certains actes médicaux s’ils sont contraires à ses valeurs morales. « Ce qui arrive souvent », déplore Gersende Marceau, spécialiste de la contraception masculine au planning familial, que nous avons contactée.
Émilien parviendra finalement à faire sa vasectomie, avec le quatrième professionnel qu’il rencontre. Mais il confie avoir ressenti beaucoup d’énervement : « J’avais l’impression que mon corps n’était plus le mien et que la société devait décider pour moi. Alors que je suis le seul concerné. »
Rendez-vous chez le psychologue
Pour Thomas, les difficultés ont commencé avant même les rendez-vous chez l’urologue. Cet ouvrier agricole de 25 ans doit d’abord obtenir une ordonnance d’une médecin généraliste. Cette dernière lui donne, mais lui lance au passage qu’il sera « responsable de la baisse de la population dans le monde », avant d’enchaîner avec : « Vous ne viendrez pas vous plaindre quand vous aurez le SIDA. » Thomas suppose que la généraliste pensait qu’il voulait « faire une vasectomie pour coucher à gauche et à droite sans protection ». « Ce qui n’est pas du tout le cas », précise-t-il. Quoi qu’il en soit, le ton est donné.
Il prend alors un premier rendez-vous avec une urologue de sa ville, qui se passe à merveille. Il fixe une date, quatre mois plus tard, pour procéder à l’opération. Mais l’urologue se rétracte entre-temps, estimant que Thomas est trop jeune et changera d’avis au sujet des enfants.
Il s’adresse alors à un second professionnel qui accepte de faire l’opération. À une condition : il doit d’abord consulter un psychologue, afin de discuter de son choix de ne pas congeler son sperme. Mais le rendez-vous avec ce psy tourne au vinaigre : « Il a commencé à me dire que je faisais n’importe quoi. Il m’a fait un profil psychologique pour me déstabiliser et avait un discours très moralisateur. C’était très malsain. Et j’avais encore moins envie de congeler mon sperme. »
Si l’urologue doit vérifier que le patient est bien en capacité de prendre, par lui-même, la décision de faire une vasectomie, il ne peut pas exiger une expertise psychologique. « C’est illégal », rappelle Gersende Marceau, selon la loi du 4 juillet 2001. Mais Thomas souligne : « Si je ne faisais pas le rendez-vous avec le psy, il pouvait toujours activer sa clause de conscience. »
Une méthode pas contraignante
Suite à ces expériences, les deux jeunes hommes déplorent que les médecins aient tenté d’influencer leur choix et de décider à leur place. « Je me suis senti un peu envahi dans mon intimité à cause de toutes ces personnes qui ont partagé leur opinion, alors que ça ne les concerne pas, explique Thomas. Une personne de 22 ans qui veut faire un enfant, tout le monde va la soutenir, alors qu’une personne de 22 ans qui n’en veut pas, ça devient un problème de société. »
Malgré ces nombreuses embûches, les deux jeunes hommes ont fait leur vasectomie, et ne regrettent rien. Ils assurent que cette méthode n’est pas pas contraignante. « Je ne sens aucune différence par rapport à avant. Il n’y a pas de cicatrice, et rien n’a changé dans ma manière d’éjaculer et dans mes rapports sexuels », détaille Émilien.
Ce qui n’empêche pas la vasectomie de souffrir d’idées reçues. « Ça fait peur à plein de mecs virils qu’on leur touche les testicules. Certains pensant qu’on ne peut plus ressentir du plaisir ou avoir d’érection » explique Thomas, qui assure, pour ceux qui en doutent, « ne pas avoir perdu [sa] virilité avec une vasectomie ».
-
"N'écrivez pas..."
- Par Thierry LEDRU
- Le 20/02/2024
"Alors vous voulez être écrivain ? (So you want to be a writer ?)
Si cela ne sort pas de vous comme une explosion
en dépit de tout,
n’écrivez pas.
si cela ne vient pas sans sollicitation de
votre cœur et votre esprit et votre bouche
et vos tripes,
n’écrivez pas.
s’il vous faut vous asseoir des heures
à fixer votre écran d’ordinateur
ou plié en deux sur votre machine à écrire
à chercher les mots,
n’écrivez pas.
si vous le faites pour l’argent ou la gloire,
n’écrivez pas.
si vous le faites parce que vous voulez
mettre des femmes dans votre lit,
n’écrivez pas.
s’il vous faut rester assis là
réécrivant encore et encore,
n’écrivez pas.
si c’est déjà difficile rien que d’y penser,
n’écrivez pas.
si vous essayez d’imiter l’écriture de quelqu’un d’autre,
oubliez.
si vous devez attendre que cela rugisse hors de vous,
alors attendez patiemment.
mais si cela ne rugit jamais hors de vous,
alors faites autre chose.
s’il vous faut le lire à votre femme
ou votre compagne ou à votre compagnon
ou vos parents ou qui que ce soit,
vous n’êtes pas prêt.
ne soyez pas comme tant d’écrivains,
ne soyez pas comme ces milliers de
gens qui se targuent d’être écrivains,
ne soyez pas superficiel et ennuyeux et
prétentieux, ne vous consumez pas d’un amour narcissique.
les librairies du monde ont
baillé jusqu’à s’assoupir d’écrivains
comme ceux-là.
n’en rajoutez pas.
n’écrivez pas.
à moins que cela ne sorte
de votre âme comme une fusée,
à moins que rester muet
ne vous rende fou ou
suicidaire ou assassin.
n’écrivez pas.
à moins que le soleil en vous
ne vous brûle les tripes,
n’écrivez pas.
quand le moment viendra,
et si vous avez été choisi,
cela se fera
tout seul et cela continuera
jusqu’à votre mort ou jusqu’à ce que cela meurt en vous.
il n’y a pas d’autre manière
et il n’y en a jamais eu d’autre."
Charles Bukowski
-
Protection des forêts
- Par Thierry LEDRU
- Le 18/02/2024

Bonjour Thierry ,
Ce mois-ci, j’ai pas mal de bonnes nouvelles à vous partager.Pression maximale sur Alliance Forêts Bois
Commençons par le nerf de la guerre : depuis plusieurs mois, nous sommes engagés dans un bras de fer pour dénoncer les mauvaises pratiques d’Alliance Forêt Bois… et nos efforts commencent à porter leurs fruits. Si vous nous rejoignez, je vous invite à découvrir ici l’ensemble de la campagne. Ce que nous reprochons à cette entreprise : de trop nombreuses coupes rases de forêts de feuillus pour les remplacer par des plantations de résineux. Pour tenter de contrer notre campagne, Alliance Forêts Bois essaye de faire diversion en communiquant sur l’écologie - mais ils ne trompent personne : dans l’Indre et la Vienne, nous avons découvert une fois de plus des chantiers désastreux et nous les avons révélés au grand jour avec cette vidéo à partager :
Ce qui les énerve beaucoup, c’est que nous interpellons leurs financeurs pour dénoncer ce double discours. Après une première vague de départs, Alliance Forêts Bois vient de perdre un contrat de plusieurs millions d’euros avec Air France, qui cherchait un partenaire pour planter des arbres. Grâce à votre mobilisation, Orange nous a également annoncé qu’ils ne signeraient pas de nouveau contrat avec Alliance Forêts Bois en 2024. Ces départs ne sont que la partie visible de l’iceberg : la pression est maximale pour que cette entreprise change ses pratiques. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que nous ne relâcherons pas nos efforts, sans un engagement clair de leur part.
Dans la Creuse, la résistance s'organise
Il y a quelques jours, nous étions plus de 400 personnes réunies à Guéret, pour une conférence-débat sur le projet d’installation d’une nouvelle usine de granulés. Vous pouvez retrouver ici la vidéo de cette conférence. Si nous sommes particulièrement inquiets, c’est parce que l’entreprise qui porte ce projet, Biosyl, a déjà un lourd passif : dans la Nièvre, nous avons découvert sur son parc à bois des arbres entiers, dont des chênes centenaires, issus de coupes rases dans le Morvan. Face caméra, le directeur s’était engagé à mettre fin au scandale avant de se rétracter en nous envoyant un courrier.
Canopée a donc décidé de venir en soutien aux associations locales pour contrer ce projet en finançant notamment un recours en justice contre la décision d’autorisation du projet par la préfète. Si vous voulez nous aider, vous pouvez faire un don pour financer les frais d’avocats ou signer et partager la pétition.
Le projet Biosyl a d'ailleurs alimenté le débat de l'émission Dimanche en Politique diffusée sur France 3 Limousin (diffusion tv dimanche 18 février), à laquelle nous avons participé avec trois autres invités autour de la question : la forêt est-elle un bien privé ou un bien commun ? Un débat autour de l'exploitation de la forêt limousine à visionner ici :
Enfin une loi pour la forêt
La chape de plomb qui verrouille toute forme de débat autour de la forêt est en train de craquer. Partout des voix s’élèvent pour demander plus de transparence et plus de discussion. Car, si la forêt française appartient à 75% à des propriétaires privés, elle nous concerne tous. Pour répondre aux nombreuses demandes d’élus locaux qui aimeraient pouvoir mieux encadrer les coupes rases sur leur territoire grâce aux documents d’urbanisme, nous avons organisé une conférence à Sabres avec un spécialiste du sujet.
Mais la bonne nouvelle vient surtout du côté des députés. Notre long travail de mobilisation commence à porter ses fruits avec deux propositions de lois sur la forêt, l’une transpartisane et l’autre issue de la majorité. Comme le montrent nos analyses, les deux portent des ambitions différentes mais vont dans le bon sens. Les lobbies sont déchainés pour éviter qu’elles soient mises au débat dans l’hémicycle. Nous allons donc avoir besoin de vous.
Nous avons mis en place un outil très simple pour interpeller votre député.e par mail, téléphone ou sur les réseaux sociaux en moins de 5 minutes. Nous savons maintenant que ces interpellations peuvent vraiment faire mouche. C’est par ici
Il y a encore beaucoup de choses dans les tuyaux, donc surveillez les réseaux sociaux et vos emails dans les prochains jours. Le 26 février, Hugo Clément proposera un nouvel épisode de Sur le Front, intitulé La face cachée des forêts françaises, un documentaire qui risque de faire beaucoup de bruit…
En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Si vous appréciez notre travail, notre indépendance et notre liberté de ton, vous pouvez nous soutenir avec un don ponctuel ou régulier (et en plus, c’est défiscalisé à 66%). Et si vous ne l’appréciez pas, je vous embrasse quand même.
-
Des arbres qui tuent
- Par Thierry LEDRU
- Le 16/02/2024
Quand j'avais seize ans, mon frère, Christian, qui en avait dix-neuf, a eu un accident de voiture. Sa voiture s'est encastrée dans un poteau en béton d'EDF, dans un virage. De chaque côté, c'était un champ de blé. Tout s'est "joué" à quelques mètres. Le poteau était au milieu du virage.
L'accident a eu lieu à 23h19, Sa montre était brisée.C'est un instituteur qui l'a trouvé à 2h30, il rentrait d'un repas chez des amis. Les pompiers ont mis 1 heure pour le désincarcérer.
Poitrine enfoncée, mâchoire brisée, une cheville écrasée sous une pédale, deux vertèbres brisées, le toit de la voiture était plié et avait ouvert son crâne. Les gendarmes ont téléphoné. Mes parents m'ont réveillé. On est allé à l'hôpital. On nous a dit qu'il était cliniquement mort. C'était un 27 juin, jour d'anniversaire de ma mère. Je suis resté avec lui, dans sa chambre, pendant tout l'été et j'ai manqué la rentrée des classes en septembre.
Il s'en est sorti. Marqué à vie, moi aussi. J'ai tout écrit trente ans plus tard, un roman qui n'est pas publié. Mon frère est mort vingt ans plus tard d'une rupture d'anévrisme.
Faut-il donc déplacer tous les poteaux susceptibles d'engendrer des accidents gravissimes ?
Faut-il raser les maisons qui bordent les routes ?
Les arbres sont-ils responsables ?
La question est tellement absurde que j'ai du mal à l'écrire.
Abattage massif de 4000 arbres en Haute-Marne :
"les arbres qui tuent n’ont plus leur place au bord de nos routes !"
Les collisions avec des arbres sont à l'origine de 10% des accidents mortels sur les routes. • © CD 52
Écrit par Géraldine Dreyer
Publié le 10/02/2024 à 08h00
Le conseil départemental de Haute-Marne annonce un plan massif d’abattage d’arbres le long de ses axes routiers les plus fréquentés. Un diagnostic est en cours pour identifier les plus dangereux, au nom de la sécurité routière.
La Quotidienne des Régions
Tous les jours à 13h, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions.
votre adresse e-mail
France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "La Quotidienne des Régions". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité
C’est un constat : les personnes trouvant la mort après avoir percuté un arbre représentent 10% des tués sur la route. Une réalité qui incite le conseil départemental de Haute-Marne à lancer un plan d’abattage massif au bord des axes les plus fréquentés. Sur les 750 kilomètres concernés, des milliers d’arbres vont faire l’objet d’un diagnostic pour identifier ceux qui sont malades et dangereux.
Le nombre précis d’arbres qui seront effectivement abattus n’est donc pas encore défini. Mais il s’élèvera à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Peut-être bien 4 000, avec une coupe nette annoncée sur la D1 entre Rimoncourt et Nogent. Car c’est sur cette portion de route que le 18 décembre dernier, un homme a percuté un arbre et perdu la vie après un choc très violent. Certains tronçons de la D16 ou encore de la D119 seront concernés par ces abattages.
S’il faut couper massivement des arbres pour garantir la sécurité de nos habitants et des usagers de la route, nous n’hésiterons pas.
Nicolas Lacroix, Président du Conseil départemental de Haute-Marne
Le conseil départemental met en avant la sécurité des habitants sur son réseau routier. "S’il faut couper massivement des arbres pour garantir la sécurité de nos habitants et des usagers de la route, nous n’hésiterons pas. Les arbres qui tuent n’ont plus leur place au bord de nos routes", affirme dans un communiqué le président du département de Haute-Marne, Nicolas Lacroix (LR).
Pour autant, l’abattage massif d’arbres en bord de route est un sujet clivant. Une association nationale se mobilise régulièrement contre ces coupes franches en bord de route. D'aucuns avancent aussi l'idée que l'alignement d'arbres rendrait le tracé plus "lisible" pour les automobilistes et qu'il créerait un "effet de paroi" qui fait lever le pied.
Des arbres plantés pour absorber la poussière
Le débat n'est pas clos. Le conseil départemental de Haute-Marne assure que la présence de ces arbres provoque sur certains tronçons des déformations de la chaussée. Avec pour conséquence des surcoûts d'entretien pour le département. Des arbres qui aujourd'hui ne constitueraient plus qu'un problème pour les collectivités.
On en oublierait que ces arbres ont été plantés voilà parfois plus d'un siècle pour rendre service à l'homme. Ils devaient aider à réduire la poussière soulevée par les véhicules. Une nécessité qui a disparu au début du 20e siècle avec l'apparition des rubans d'asphalte.
Cet abattage massif sera accompagné de mesures compensatoires pour "préserver la biodiversité", précise le département, avec notamment la plantation de haies.