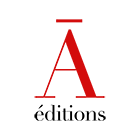Blog
-
En soins palliatifs
- Par Thierry LEDRU
- Le 11/03/2025
Voilà l'expression qui m'est venue lorsque j'ai entendu parler du plan du gouvernement présenté par la ministre de l'écologie. Je ne dis pas que les mesures annoncées sont inutiles, bien que très insuffisantes mais elles valident surtout l'idée que le gouvernement, comme ceux de tous les pays industrialisés, ont acté le fait que nous n'échapperons pas à une hausse importante des températures.
"Ce plan doit préparer la France à vivre dans un monde à +4°C d'ici 2100 afin de protéger la population."
A + 4 degrés, on ne protège plus personne, on compte les morts.
Ce qui signifie une hausse de plus ou moins 2 degrés dans 25 ans, à quelques années près. Ce qui me sidère, c'est qu'il n'est jamais question de décroissance. Tous les gouvernements rêvent de croissance pour éponger des dettes astronomiques et tous les grands groupes pétroliers investissent par milliards dans la quête effrénée de pétrole. Et l'UE prévoit de débloquer 800 milliards pour l'armement. Et la France est censée organiser en 2030 des JO d'hiver "écologiques".
Bon, c'est clair. On est entré dans la phase des soins palliatifs. On ne sauvera pas le malade. La fièvre continuera à grimper. Et ça n'est pas la prochaine COP ou autres grandes messes sous l'emprise des lobbies qui y changeront quelque chose ni les plans successifs de "transition écologique". Tous ceux qui s'intéressent au problème savent pertinemment que nos modèles de sociétés consuméristes ne sont plus viables.
Crise climatique : le gouvernement livre son Plan national d'adaptation et laisse les associations sceptiques
La version finale, présentée lundi, comporte quelques nuances par rapport à la première mouture dévoilée à l'automne. Ce troisième plan met l'accent sur la mise en œuvre d'une cinquantaine de mesures au niveau local, d'ores et déjà jugées insuffisantes par certains experts du climat.
/2021/12/14/61b8b9946b6b4_louis-san.png)
Article rédigé par Louis San
France Télévisions
Publié le 10/03/2025 18:31
Temps de lecture : 5min
/2025/03/10/080-hl-xbouzas-2664444-67cee4b55bc27850794348.jpg)
La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 12 février 2025. (XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / AFP)
La copie a été revue. Avec plus d'un an de retard, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a présenté, lundi 10 mars, la version finale de la troisième édition du Plan national d'adaptation au changement climatique (Pnacc). Ce plan doit préparer la France à vivre dans un monde à +4°C d'ici 2100 afin de protéger la population.
Cette nouvelle mouture du Pnacc a été légèrement modifiée par rapport à la première, dévoilée en octobre 2024. Le ministère a souligné qu'elle était le fruit de plusieurs mois de concertation avec "toutes les parties prenantes", Etat, collectivités territoriales, acteurs économiques, citoyens. Au total, ils ont produit 6 000 contributions, dont 176 "cahiers d'acteurs".
L'un des priorités du plan est de réaliser une cartographie des vulnérabilités, avec une attention soutenue pour les établissements de santé, les infrastructures de transport ou de sécurité. L'accent est mis sur les territoires et secteurs les plus menacés comme le littoral, les montagnes, les forêts et l'agriculture. Parmi les mesures, le renforcement des protections pour les travailleurs exposés aux canicules, différentes études pour mieux adapter transports et exploitations agricoles ou encore une protection des principaux sites culturels français (tour Eiffel, mont Saint-Michel...).
Le confort d'été mieux intégré au DPE
Une autre mesure concerne la rénovation énergétique, afin d'adapter "les logements aux fortes chaleurs et pas seulement au froid". Il est prévu que le confort d'été soit mieux pris en compte dans le calcul du diagnostic de performance énergétique, le décrié DPE. Concrètement, "un travail sera lancé pour étudier la possibilité d'intégrer des gestes de confort d'été au dispositif MaPrimeRénov'", précise le ministère. Des mesures pour encourager le secteur bancaire à financer l'adaptation sont également mises en avant. Sous la houlette d'Agnès Pannier-Runacher et du ministre de l'Economie, Eric Lombard, une mission "sur le rôle du système bancaire dans la prévention des risques sera réalisée" au premier semestre 2026.
Le gouvernement a aussi insisté sur la place que doit prendre la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique (Tracc), c'est-à-dire le fameux scénario qui projette la France à +4°C d'ici la fin du siècle, en passant par un palier à +2,7°C en 2050. La démarche pour "donner une valeur juridique" à la Tracc doit connaître un coup d'accélérateur. Alors que l'exécutif voulait l'intégrer "progressivement" dans les textes publics, il affirme maintenant que la réflexion doit être achevée d'ici la fin de l'année.
Si certaines avancées sont enregistrées dans cette version finale du plan, des reculs sont également à signaler. Le Monde(Nouvelle fenêtre) rapporte ainsi que les entreprises du transport et de l'énergie ne seront plus obligées d'"instaurer progressivement" des plans d'adaptation, mais seront seulement incitées à le faire.
Flou sur le financement
La question du financement reste le point le plus épineux de ce plan. Adèle Tanguy, chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), a salué sur le réseau social BlueSky(Nouvelle fenêtre) la mise en place d'une mission d'adaptation réunissant les agences de l'Etat, comme l'Ademe (l'agence de la Transition écologique), le Cerema (le Centre d'études et d'expertise sur les risques) et les agences de l'eau. Mais l'experte rappelle que ces agences disposent de "budgets diminués" et font face "à beaucoup de défiance politique, ce qui crée de l’incertitude". En effet, l'Ademe a été violemment critiquée, en janvier, par des figures de droite.
"Il est essentiel que l'adaptation soit dotée de moyens à la hauteur des enjeux", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, disant avoir augmenté les enveloppes "à hauteur de 40%". Une affirmation "à nuancer", estime l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE), car en dépit des allégations, "les crédits dédiés à l'adaptation se maintiennent mais n'augmentent pas".
Autre voix critique, Oxfam juge le Pnacc "inopérant", pointant un manque "de gouvernance adaptée et de moyens budgétaires pour sa mise en œuvre". Condamnant un "brouillon inabouti", l'ONG écrit qu'il "prévoit de financer les politiques d’adaptation avec des fonds qu’il vient tout juste de supprimer, comme la coupe dans le Fonds vert" décidée pour le budget 2025. Oxfam accuse ainsi le gouvernement de "financer l'adaptation au détriment de la lutte contre le changement climatique". "Le changement climatique est un risque certain", a estimé de son côté Anne Bringault, directrice des programmes pour le Réseau action climat(Nouvelle fenêtre). Et de mettre en garde : "Il est plus que temps de le prendre réellement en compte dans les politiques publiques."
-
Une nature consciente
- Par Thierry LEDRU
- Le 10/03/2025

Loin de moi l'idée prétentieuse que je m'oppose aux écrits de Camus mais il n'en reste pas moins que je n'aime pas dans cette citation le fait de considérer que le "monde" puisse se défaire s'il ne s'agit que de l'humanité et je suppose qu'il en était ainsi dans la pensée de Camus. Je n'ai pas souvenir dans mes nombreuses lectures de ses écrits que la nature elle-même ait tenu une place prépondérante. L'humanité oui, bien entendu. Les descriptions de la nature aussi mais pas dans le sens de sa nécessité. Juste de son impact. Il suffit de penser à "L'étranger" et au soleil, à la chaleur, à l'océan.
Ce monde qui se défait n'est donc pas juste la masse humaine mais bien l'entièreté de la vie. C'est elle que nous regardons souffrir. C'est elle qui se défait avec une ampleur que Camus n'aurait pu imaginer.
C'est pour cette raison que dans la dystopie en cours d'écriture, la nature devient un être réel, une entité intelligente, consciente, un personnage à part entière et comme l'humanité s'est engagée dans une voie destructrice, elle accompagne le mouvement, par mimétisme non par colère ou désir de vengeance. Juste parce que l'humanité représente une masse intelligente et qu'elle en vient à imiter ses comportements.
L'humanité souffrante, au lieu de se montrer solidaire et bienveillante envers l'ensemble du groupe humain, s'est dispersée, fragmentée, nourrie par des idées nationalistes, des suprématies, des désirs de puissance, de domination. Le chaos déclenché par des individus puissants, aux idées extrémistes, a plongé l'humanité toute entière dans une dévastation. Et la nature, si longtemps meurtrie, si impitoyablement martyrisée par les volontés d'exploitation s'engage elle aussi dans le chaos.
Les phénomènes naturels d'ampleur ne sont plus des effets de l'activité humaine mais des phénomènes intentionnels.
Je sais que cette idée remonte à loin dans ma vie. J'étais adolescent quand j'ai commencé à me demander si la nature ressentait l'amour que j'éprouvais pour elle et si elle s'en réjouissait. Il m'arrivait également de m'interroger sur ce qu'elle pouvait éprouver devant l'avidité destructrice des hommes. Est-ce qu'il était envisageable de penser qu'un jour peut-être elle ne le supporterait plus. Je n'imaginais pas pour autant une révolte de sa part mais bien plutôt un accompagnement. Puisque les hommes s'entretuent, elle se joint au mouvement. Dans une accélération du processus.
Un ancien texte écrit en 2012
L’AMOUR DE LA NATURE
Le titre évoque bien entendu, en première pensée, l'idée que l'homme peut aimer la Nature.
Mais la Nature éprouve-t-elle de l'Amour pour nous, pour tous les êtres, les végétaux, tout ce qu'elle crée ?
Y a-t-il en elle une émotion, un sentiment, un bonheur ?
Bien entendu, au premier abord, la proposition paraît absurde. Pour que cela soit, il faudrait une conscience et par conséquent un organe émetteur, un "cerveau", une entité extrêmement évoluée...
La Nature ne peut pas être assez évoluée pour ça.
Non, c'est cette phrase qui est absurde en fait. Rien de connu n'est plus évolué que la Nature. Nous en sommes un élément, performant c'est un fait, mais devant la richesse infinie de la Nature, rien ne dit que nous en sommes le point ultime au point d'être plus évolués qu'elle alors que nous en sommes issus. Cela signifierait qu'une des créations serait plus perfectionnée que l'entité créatrice elle-même... Que nous aurions conscience de l'élément qui nous a créés alors que ce créateur en serait dénué...
Il semblerait par conséquent que la performance humaine nous ait amenés à penser que rien ne serait plus conscient que l'être humain au point que la Nature dont nous sommes issus ne possèderait pas cette conscience. Comme s'il nous était insupportable d'imaginer une entité supérieure.
Et je ne parle évidemment pas d'un Dieu issu de la conscience des hommes.
Je parle uniquement de la Nature.
Mais si la Nature est effectivement dotée de cette conscience, cela suppose qu'il y a en elle une intelligence et par conséquent une intention quant à sa création. Nous sommes des êtres dotés d'intelligence et de conscience et nous nous engageons dans des voies précises avec une intention, un projet, une projection temporelle. C'est cela qui a permis l'évolution de notre espèce et nous ne pouvons pas regretter les temps préhistoriques. Nous vivons dans une sécurité bien supérieure à celle de Lucy, de Toumaï, des Gaulois, des serfs, des sans culottes, des Poilus, de nos grands-parents...Impossible de le nier. Malgré tout...
Bien, nous avons donc évolué en fonction d'une intention, celle d'améliorer le quotidien de chaque individu. Le nôtre d'abord. En travaillant à notre survie individuelle, nous avons contribué à celle de l'ensemble.
Pouvons-nous dès lors envisager que la Nature, dans l'hypothèse d'une conscience et d'une intelligence, agit différemment que la création la plus évoluée de son œuvre ? Il nous est bien nécessaire de considérer que cette Nature a un projet. Ou alors nous devons rejeter toute idée d'intelligence de sa part. Ce qui reviendrait à dire que nous sommes une entité disparate issue d'un fabuleux hasard...Hum...
Bien. Quel projet ? Voilà LA question... Ce projet nous est-il accessible dès lors que nous adoptons une attitude hautaine, dès lors que nous ne sommes plus dans un statut de création respectueuse mais que nous nous attribuons le rôle de maître supérieur ? Dès lors que nous considérons la Nature comme une entité hasardeuse, comment pourrions-nous accéder à ce projet alors que nous ne voyons dans notre évolution que le résultat de nos efforts et non une osmose constructive entre l'oeuvre créatrice ?
Si dans une classe, un élève en vient à penser qu'il est plus performant que le maître, il finira obligatoirement par fabriquer en lui un projet qui ne sera plus celui de ce maître...Je reconnais que parfois, c'est préférable pour les élèves au vu de certains professeurs...
Mais pour l’humanité ? Avons-nous bien fait de nous extraire ainsi d'une fusion nourricière en décidant que nos performances millénaires suffisaient à nourrir notre évolution ? Quelle évolution ?
Médicale, culturelle, technologique, matérielle. Oui, c'est indéniable.
Est-ce suffisant ?
Qu'en est-il de cet Amour dont je parlais ? Lorsque j'aime la Nature, le sait-elle ? N'y a-t-il de ma part qu'une opportunité que je saisis, la plénitude de la contemplation, le bonheur de la marche en montagne, l'émerveillement devant la neige qui tombe, ou cette joie infinie en moi transmute-t-elle dans le corps immense de la Nature ? Est-ce que je lui suis relié en tant que créature naturelle au point de lui faire ressentir ce que je vis lorsque je l'aime ?
On pourrait craindre si c'est le cas qu'elle ressente depuis un certain temps une animosité quasi générale et non un amour infini...Inutile de rappeler certains passages de la Bible par exemple. Ça remonte à loin tout ça...Et ça ne s'arrange guère...
Se pourrait-il dès lors que cette intention, ce projet de la Nature se soit révélé inconsidéré et que nous ayons échappé à son contrôle ? Mais a-t-elle instauré un contrôle ou sommes-nous une expérience libre de toutes entraves ? Le risque me paraît monstrueux...Se peut-il que cette intelligence humaine se soit retournée contre le créateur lui-même ou cela fait-il partie d'un projet qui nous échappe totalement étant donné qu'il semble se retourner contre l'expérimentateur lui-même ?
L'expérimenté se révolte et délaisse toute forme d'amour. Il brise ses chaînes ou ce qu'il imagine être des entraves, il s'élève sur le piédestal de son progrès, il réduit la création à une marchandise... Et cela ferait partie d'un projet ? Alors cela voudrait dire que la raison de la Nature est au-delà de la raison humaine. Et que nous ne pouvons pas la comprendre.
Ou bien que tout ceci n'était qu'une élucubration de plus et que nous ne sommes qu'un hasard fortuit au milieu d'un capharnaüm intersidéral.
Tant pis si c'est le cas. Je continuerai béatement à aimer la Nature en imaginant qu'elle m'aime en retour.
-
Les revenus de la guerre.
- Par Thierry LEDRU
- Le 09/03/2025
"La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. " ¨Paul Valéry
Artiste, écrivain, Philosophe, Poète (1871 - 1945)
"Il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre. Et nous gagnons.
Warren Buffet (milliardaire américain)

Sur les marchés financiers, les entreprises du secteur de la défense profitent du contexte géopolitique actuel. Lundi, les investisseurs se sont en effet rués à la bourse sur les actions des entreprises européennes d’armement.
/2023/07/07/64a7df4c5fe71_placeholder-36b69ec8.png)
/2024/03/04/emmanuel-cugny-65e6021ef3340792811771.png)
Article rédigé par franceinfo, Emmanuel Cugny
Radio France
Publié le 18/02/2025 08:27 Mis à jour le 18/02/2025 08:28
Temps de lecture : 2min
/2025/02/18/rafale-67b434d47ae75904742910.jpg)
Dassault Aviation, avec son célèbre avion de combat Rafale, a gagné 6%. (YASUYOSHI CHIBA / AFP)
Le souhait de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de lever les contraintes budgétaires pour permettre aux États-membres de financer la Défense a été entendue par les investisseurs. Ces derniers se sont en effet rués, à la bourse, sur les actions des entreprises européennes d’armement. Les indices boursiers en ont eux-mêmes profité : lundi 17 février, la bourse de Paris a gagné un peu plus de 0,13% avec un indice CAC40 arrimé au-dessus de 8 000 points. Progression proche de 0,1% de l’indice DAX à Francfort. Londres a gagné 0,2% grâce à cet appétit pour les valeurs de la Défense.
En France le groupe de hautes technologies Thales a gagné près de 6%, Safran (spécialisé dans l’aéronautique et le militaire) : +2%, Dassault Aviation (avec son célèbre avion de combat Rafale) a gagné 6%. Ces valeurs ont même atteint leur plus haut historique. La musique est la même ailleurs en Europe. L’action du constructeur aéronautique suédois Saab a flambé de 11%, l’allemand Rheinmetall de 9% à la Bourse de Francfort, etc.
Nouvel effet Donald Trump
Les déclarations d’Ursula von der Leyen en faveur d’une plus grande liberté budgétaire au niveau européen s’ajoutent aux positions exprimées très clairement par le président américain. Donald Trump met la pression sur les pays de l’Alliance atlantique pour qu’ils augmentent leur participation financière à l’effort de Défense de l’Otan jusqu’à 5% de leur PIB, leur richesse nationale. Quelque 5% pour l’heure, seule la Pologne en est la plus proche. Les autres tournent entre 2 et 3% de leur PIB.
Une perspective de hausse des budgets publics pour la Défense sous-entend une montée en puissance de la production industrielle d’armements et d’équipements militaire. Et il n’y a pas que la bourse. Une autre idée est de créer des obligations communes, des titres de dette émis par les États, pour financer nos efforts de Défense. L’équivalent des obligations vertes pour l’environnement. Nous sommes là dans un autre genre de beauté, mais les investissements nécessaires sont estimés à 3 000 milliards de dollars supplémentaires sur les dix prochaines années pour les puissances européennes.
-
Le mal absolu.
- Par Thierry LEDRU
- Le 05/03/2025
Je sais que ce roman, écrit, il y a plus de dix ans, contenait les idées que je développe dans la dystopie en cours.
"Les héros sont tous morts", "Tous, sauf elle", "Le désert des Barbares", "Terre sans hommes", sont la continuité de ces lignes, mais poussées à l'extrême.
L'humanité est mortifère.
Quelques individus sont portés par l'amour de la vie.

Il serpenta entre les arbres, hors de tout objectif et de toute conscience réelle. Ce fut une fuite sans but. La douleur était en lui, les terreurs l’habitaient. Et il souffrait davantage encore de ne pas maîtriser ces assauts morbides, de ne pas parvenir au contrôle de soi et de devoir, pour trouver une certaine paix, consumer ses forces dans des défis déraisonnés.
Il atteignit un nouveau sommet, simple colline déboisée, ouverte sur les horizons. Dans la dernière montée, un vertige l’avait ébloui. Il décida de manger. Espérant surtout y trouver l’absence de pensées dont il avait besoin.
Face à lui s’étendaient des pentes boisées, vastes mers de couleurs superbes sur lesquelles les rayons solaires, variant leurs inclinaisons et leurs intensités, jouaient pendant des heures. Il devina, sous le secret des frondaisons, les itinéraires répétés des animaux, leurs parcours ancestraux, incessamment agressés par des hommes envahisseurs. Il sentit l’angoisse pesante des espèces encerclées, les cris suppliants des arbres abattus, les râles étouffés d’une terre labourée, toutes ces souffrances quotidiennes qui resserraient impitoyablement sur des êtres fragiles leurs étreintes mortelles. Il aperçut au loin une brume étrange, surplombant une vallée invisible. Était-ce une vapeur échappée d’un lac ou la pollution d’une ville ? Embryon de pluie ou haleine putride. C’est de nos âmes que s’élevait ce poison. L’empreinte des hommes sur la Terre. Le cerf, au fond des bois, percevait le parfum pestilentiel des fumées d’usine, le ronflement des moteurs, le vacarme des avions, le hurlement aigu des tronçonneuses, les appels des chasseurs vers les meutes excitées des chiens. Même le parfum âcre de sa sueur agressait les narines des animaux aux abois. L’homme n’était toujours qu’une menace, que le complice cynique de la mort. Le dégoût. Il n’était qu’un humain. Les fumées de son fourgon, les routes dont il profitait, les champs sulfatés pour les récoltes forcées dont il se nourrissait, les bétails engraissés pour des populations obèses, les mers vidées par les filets dérivants, les centrales nucléaires pour des électricités gaspillées, les forêts vierges rasées pour des meubles coûteux, les fleuves agonisants sous les rejets nitratés, les décharges sauvages et les dépotoirs engorgés. On immergeait dans les fosses marines des containers de déchets radioactifs comme on jetait par les fenêtres des voitures un paquet de cigarettes. Le geste était le même. C’est la mort qu’on propageait.
Le dégoût.
Il ne voyait pas d’issue et sentait combien ses réflexions le conduisaient à une impasse. Si les animaux vivaient dans la peur permanente, la planète elle-même ressentait-elle cette angoisse ? Représentions-nous désormais le mal absolu ?
Sa simple présence éveillait dans les arbres des frissons inquiets et les gens incrédules mettaient cela sur le compte du vent. Un pigeon passa devant lui. Son vol était puissant et rapide. Était-ce une fuite, la recherche désespérée d’un dernier refuge ? On trouvait jusque dans les mers australes des traces de dérivés chimiques. Où pouvait-il aller ? Les feuilles des arbres, autour de lui, le regardaient avec des yeux terrifiés, des hordes d’insectes affolés fuyaient devant ses pas aveugles, les nuages empoisonnés pleuraient des larmes acides.
Les hommes avaient propagé la mort. Ils étaient son plus fidèle allié. L’humanité comme l’étendard de la grande faucheuse.
Le dégoût.
La violence du dégoût.
Il se leva et prit le chemin du retour. Un court instant, des désirs de suicide. Il en gardait sur les lèvres un goût sucré, presque bon, l’anéantissement salvateur de la culpabilité et l’impression d’un geste enfin à soi.
Il ne devait pas rester seul. Il en mourrait. C’était certain.
Tête baissée, il parcourut les bois, la mort aux trousses et c’est ce sentiment effroyable de la fin à venir que les hommes étouffaient sous des agitations frénétiques. Ne pas savoir, ne pas écouter ni sentir. Rien. Vivre dans l’aveuglement, juste pour se supporter. Nous étions la mort et nous le savions. Mais nous maintenions avec obstination l’interdiction de le dire.
Il finit par courir espérant que la violence de l’effort empêcherait toute intrusion raisonnée.
Arrêter de penser et ne penser qu’à cela.
C’était donc cela le rôle du sport. Juste le complice d’une dictature complexe. L’opium du peuple, un de plus.
Ne pas penser. Courir. Etouffer le dégoût sous des épuisements musculaires.
« Arrête de penser ! » cria-t-il dans le silence craintif des bois. Des sanglots échappés bloquaient ses souffles dans la gorge serrée.
« Arrête de penser, gémit-il, arrête. »
A l’orée d’une clairière, il se figea. Il ne se souvenait pas de cet espace dégagé. Il regarda autour de lui et ne reconnut rien. Au premier instant, il se dit qu’il était perdu mais l’absurdité de cette conclusion le frappa. Parmi les hommes, il était perdu. C’est ici qu’il était quelque part mais il n’y trouvait pas les repères inculqués et se sentait totalement égaré.
Avant de s’effondrer, il fonça, droit devant.
Ce n’est pas le temps qui s’égrena mais la répétition mécanique de ses foulées, la force de ses respirations, l’usure de ses muscles, le choc dans son crâne des pas retombés, les crachats de salive qui suintaient aux coins des lèvres et les larmes salées qui coulaient de son corps comme un pus honteux.
Honteux.
C’est ainsi qu’il déboucha sur une route. Il reconnut l’accès au lac. Il était descendu trop bas. Il remonta le ruban goudronné sans diminuer la longueur de ses foulées, comme poursuivi par l’horreur du monde humain et il songea à ces milliards de kilomètres balafrant la planète, cicatrices sans cesse entretenues, élargies, renforcées, reliées entre elles par des réseaux de plus en plus étendus. Il crut devenir fou et comprit qu’il découvrait la vraie raison. Les fous, de leurs côtés, traçaient de nouvelles routes pour rejoindre plus rapidement leurs semblables.
Le parking, le fourgon. Il courut encore, s’engouffra, ferma la porte et sauta fébrilement sur la boîte de cannabis. Anesthésier les flots de pensées sous des brouillards parfumés, étouffer fébrilement des consciences insupportables."
-
Podcast : "Dernières limites"
- Par Thierry LEDRU
- Le 03/03/2025
Personnellement, malgré tout ce qui se passe sur le plan guerrier, économique, politique, sanitaire, les Trump, Poutine, Zelensky et autres combats des chefs, rien n'y fait.
Il n'y a que les "limites planétaires" qui me motivent à lire, lire, écouter, écouter, réfléchir.
https://podcast.ausha.co/dernieres-limites/bande-annonce
"ll y a 50 ans paraissait un rapport scientifique qui fit l’effet d’une bombe. Le rapport Meadows évaluait pour la première fois l’impact de l’activité humaine sur notre planète. Sa conclusion : continuer la croissance, qui va de paire avec une consommation toujours plus grande des ressources planétaires, aboutirait inévitablement à un “crash” au cours du XXIème siècle.
Dans ce podcast, la journaliste Audrey Boehly mène l’enquête 50 ans après en interrogeant des experts et des scientifiques : a-t-on dépassé les limites planétaires ? Quelles sont les solutions pour bâtir un avenir où l’activité humaine n’épuiserait pas les ressources de notre seule planète ?

Dernières limites

Bande-annonce
03min |25/02/2022
Écouter
Description
50 ans après la parution du rapport Meadows, la journaliste Audrey Boehly mène l’enquête en interrogeant des experts et des scientifiques : a-t-on dépassé les limites planétaires ? Quelles sont les solutions pour bâtir un avenir où l’activité humaine n’épuiserait pas les ressources de notre seule planète ?
Dernières Limites est un podcast pensé et écrit par Audrey Boehly. La réalisation et la musique sont d’Emma Chevallier, l’illustration de Chloé Nicolay et la production Saga sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine abritée par la Fondation de l’Université Paris Dauphine - PSL.
Retrouvez tous les épisodes de notre série :
PROLOGUE : 50 ANS APRÈS | DENNIS MEADOWS
Dennis Meadows, coauteur du rapport Les limites à la croissance. Version doublée en français.#1 MEADOWS : UN RAPPORT EXPLOSIF | GAËL GIRAUD
Gaël Giraud est économiste, directeur du programme Justice environnementale de Georgetown University, directeur de recherche au CNRS et ancien chef économiste de l'AFD.
#2 COMMENT NOURRIR LE MONDE | MARC DUFUMIER
Marc Dufumier est agronome, professeur honoraire à AgroParisTech, et expert auprès de la FAO (organisation des nations unis pour l’alimentation et l’agriculture).
#3 DE L’EAU DOUCE POUR TOUS ? | FLORENCE HABETS
Florence Habets est hydrogéologue et hydroclimatologue, directrice de recherche et enseignante à l’Ecole Normale Supérieure.
#4 LA MER DANS NOS FILETS | PHILIPPE CURY
Philippe Cury est directeur de recherche à l'IRD, directeur du Consortium européen Euromarine et spécialiste de l'approche écosystémique des pêches.
#5 POUR UN CHÂTEAU DE SABLE | ERIC CHAUMILLON
Eric Chaumillon est professeur à l'université de La Rochelle en géologie littorale et spécialiste des littoraux et des ressources en sable.
#6 BIODIVERSITÉ EN DANGER | SANDRA LAVOREL
Sandra Lavorel est écologue, directrice de recherche, membre de l'Académie des sciences, présidente de l'Évaluation nationale des écosystèmes français et contributrice à l’IPBES.
#7 ENERGIE : L'OVERDOSE | MATTHIEU AUZANNEAU
Matthieu Auzanneau est directeur de The Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique, auteur de Pétrole : le déclin est proche et du blog du Monde Oil Man.
#8 MINERAIS : CREUSER, MAIS JUSQU'OÙ ? | PHILIPPE BIHOUIX
Philippe Bihouix est ingénieur centralien, auteur de Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi pour la société et de L'âge des low-tech.
#9 LE CLIMAT EN SURCHAUFFE | VALÉRIE MASSON DELMOTTEValérie Masson Delmotte est paléoclimatologue, chercheuse senior au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE) au sein du CEA et co-présidente du GIEC.
#10 A-T-ON DÉPASSÉ LES LIMITES ? | AURÉLIEN BOUTAUD
Aurélien Boutaud est docteur en sciences de la Terre et de l’environnement, chercheur associé au CNRS et co-auteur des ouvrages Les limites planétaires et L’empreinte écologique.
#11 MIGRATIONS ET GÉOPOLITIQUE | FRANÇOIS GEMENNE
François Gemenne est spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, professeur à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’Université libre de Bruxelles.
#12 VIVRE AUTREMENT | DOMINIQUE MÉDADominique Méda est philosophe et sociologue, directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales de Paris Dauphine et présidente de l’Institut Veblen.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
-
"Manifeste pour une terre vivante"
- Par Thierry LEDRU
- Le 26/02/2025
""Si la théorie officielle sur le réchauffement climatique d’origine anthropique est correcte, alors la priorité la plus urgente est de protéger et de restaurer le sol, l'eau et les écosystèmes dans le monde entier.
Si la théorie officielle sur le réchauffement climatique d’origine anthropique est erronée, alors la priorité la plus urgente est de protéger et de restaurer le sol, l'eau et les écosystèmes dans le monde entier.""
Charles Eisenstein
Manifeste
pour une Terre VivanteÉveiller notre conscience pour préserver la planète
de Charles Eisenstein
Préface d'Olivier Clerc
Traduit de l’anglais par Isabelle Wynn
Encore un livre sur l’écologie ?… Détrompez-vous ! Celui-ci n’est comparable à aucun autre : il est véritablement unique en son genre, parce qu’il met en évidence la cause profonde du dérèglement climatique et de la destruction de la nature, qui n’est probablement pas celle que vous imaginez… Charles Eisenstein propose en effet une approche novatrice face au changement climatique et à la disparition de la biodiversité. Il préconise une refonte totale de notre vision, de nos stratégies et de nos buts dans notre démarche pour restaurer l’équilibre écologique de la Terre. Son approche remet en question les paradigmes traditionnels et invite à repenser fondamentalement notre relation avec l’environnement. Et notamment, passer de l’histoire de la séparation à celle de l’inter-être…
En éclairant les dimensions culturelles, spirituelles et sociales de la crise écologique, l’auteur nous pousse à reconsidérer notre relation avec la nature et à envisager des solutions systémiques et holistiques. Il traite le changement climatique non seulement comme un problème scientifique ou technologique, mais aussi comme une crise de notre relation avec la Terre et avec nous-mêmes.
Selon lui, la vision dominante, focalisée sur la réduction des émissions de carbone, est insuffisante pour résoudre les crises environnementales actuelles. Le livre démontre qu’il ne faut pas réduire le développement durable à l’environnement, l’environnement au climat, et le climat au carbone. Il soutient une approche holistique qui intègre les défis sociaux, éthiques et physiques, tout en tenant compte des impacts sur la biodiversité.
Il plaide pour que nous ayons une vision plus large de la situation, au-delà de notre approche incomplète et à courte vue. Les rivières, les forêts et les créatures du monde naturel et matériel sont sacrées et précieuses en tant que telles, et pas seulement pour les crédits carbone ou la prévention de l’extinction d’une espèce par rapport à une autre. Après tout, lorsqu’on demande à quelqu’un pourquoi il est devenu écologiste, il est probable qu’il mentionne la rivière dans laquelle il jouait, l’océan qu’il découvrait, les animaux sauvages qu’il observait ou les arbres auxquels il grimpait lorsqu’il était enfant.
Ce recentrage sur une catastrophe imminente et sur notre destin inévitable permet de cultiver des liens émotionnels et psychologiques significatifs et de proposer des mesures concrètes et réalisables pour prendre soin de la Terre. En nous libérant d’une mentalité de guerre et en ayant une vue d’ensemble de la façon dont tout, de la réforme des prisons à la sauvegarde des baleines, peut contribuer à la santé écologique de notre planète, nous résistons aux postures réflexes de solutions faciles et de blâme et nous tournons vers le lieu profond de l’engagement éclairé.
NOUVEAU
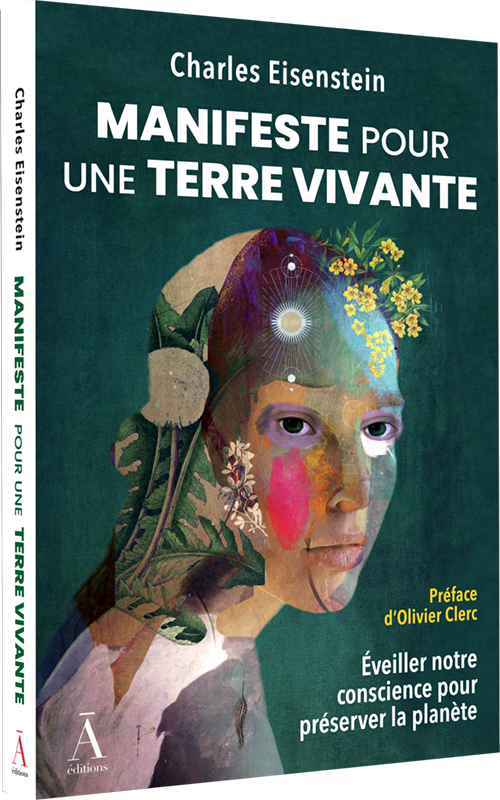
Publié par Les Éditions du non-A
Livre broché de 360 p — ISBN : 978-2-493605-14-6
Prix : 22,90 €
En vente sur
Un regard totalement nouveau sur l’état de la Terre !
Le livre propose une vision différente du changement climatique, loin des discours anxiogènes
L’auteur propose une analyse équilibrée et non moralisatrice
Il évite le piège des solutions simplistes et offre une perspective plus humaine pour une reconnexion spirituelle avec la nature
Une approche qui parle à tous, sceptiques ou convaincus
Les concepts complexes sont expliqués simplement, avec des exemples concrets et vécus
Il propose des solutions pratiques et réalisables sans expertise technique
C’est un message d’espoir au delà des discours catastrophistes, avec une vision positive du changement
Nature et culture, une seule aventure !
Lire un extrait du livre
DearFlip: Loading PDF 100% ...
Si vous avez des projets, des idées, contactez-nous !

-
Juste une question de hasard.
- Par Thierry LEDRU
- Le 24/02/2025
Cette sensation, parfois, que rien ne nous appartient, que notre vie n'est qu'une succession de hasards quand on imagine une succession de décisions rationnelles, lucides, préméditées et que nous n'avons pour seul pouvoir que celui de gérer au mieux les montagnes russes que ce hasard diffuse.

Les jours suivants, il fut frappé par la célérité avec laquelle tout s’enchaîna. Comme un dénouement en accéléré. Une barque dans un courant puissant, sans rame, sans gouvernail, juste emportée dans une direction inconnue. Il avait descendu l’embarcation jusqu’à l’eau, croyant dès lors être maître du parcours à venir. Incroyable cette prétention humaine. Il se promit d’être plus vigilant, plus honnête avec lui-même. Il sentait bien, lorsque la clairvoyance l’envahissait, que rien ne lui appartenait vraiment. La vie n’était qu’une succession de réactions en chaîne et comme une boule de flipper constamment renvoyée aux quatre coins du jeu, l’individu, pour ne pas sombrer dans la folie se persuadait que le chemin était choisi. Espérant simplement que le maître de la partie aurait suffisamment de classe et d’adresse pour que les coups s’éternisent. Que ce maître s’assoupisse un instant et c’était la catastrophe. Tilt, game over et le tour était passé. Au suivant. Quelle dérision ! Naître dans un beau jeu, bien décoré, offrant de multiples épreuves, vibrer follement à chaque accélération, s’efforcer de toute son énergie à éviter la sortie, voilà les seuls bonheurs de cette existence. Il trouva qu’il avait eu la chance d’être tombé dans une belle partie, que son parcours jusqu’ici lui avait offert quelques satisfactions, puis la grande découverte, le grand amour et qu’il lui restait à sortir le grand jeu, usant pleinement de ses expériences pour atteindre le jackpot ! Il n’en était pas loin. Tout s’accélérait. Il faudrait rester lucide. Le meneur de jeu ne supporterait aucune faiblesse. Mais est-ce qu’il y avait réellement un meneur de jeu ? Ce n’était pas lui en tout cas, trop de paramètres lui échappaient. Alors qui ? Dieu ? Il n’y croyait pas. Celui-là n’avait été inventé que pour combler l’absence d’explication et permettre surtout aux instigateurs du mensonge de s’enrichir. Il suffisait de regarder le Vatican. Le hasard alors ? Oui, peut-être, juste le hasard. À chaque décision, plusieurs directions se dessinaient et selon la météo, l’humeur du moment, les rencontres sur le chemin, autant de circonstances incontrôlées, l’une ou l’autre de ces possibilités seraient mises en avant et les autres délaissées. Cette solution appellerait d’autres dénouements, d’autres options à venir et dans ce perpétuel imbroglio, l’individu s’efforcerait de se rassurer en affirmant jour après jour, que telle décision était la bonne ! Vaste supercherie. Rien ne nous appartenait et rien n’était écrit. Dieu n’y était pour rien et l’homme non plus. L’homme peut-être un peu plus, tout de même. Parfois, ne prenait-il pas certaines décisions, totalement inattendues, bousculant l’ordre logique des choses en cours, des décisions laissant les proches ou même la communauté entière totalement abasourdis ? Il chercha un exemple et pensa à Bernard Moitessier dans la course en solitaire autour du monde, qui décide de continuer, alors qu’il était en tête, et de ne pas rentrer au port, « pour sauver son âme ». Ça, c’était grand ! Il ne devait cette décision à personne d’autre que lui. Il n’y avait pas eu de hasard. C’était un acte pleinement volontaire, au-delà de la raison, quelque chose qu’il avait construit en réaction à une vie en société qu’il rejetait, à des valeurs qu’il ne reconnaissait pas. Oui, mais alors, il n’avait fait que réagir à une situation qui ne lui convenait pas. Tous ses actes avaient été déterminés par une mise en scène extrêmement compliquée dans laquelle il avait essayé de glisser une petite part de volonté, sa décision n’était pas neutre, elle lui avait été imposée, ses actes avaient été déterminés par la lutte qu’il avait engagée contre des concepts qu’il haïssait.
C’était effrayant.
Il se sentit comme une plume aux vents. Les réflexions s’enchaînaient à une vitesse étourdissante.
Notre vie ne nous appartenait pas et elle n’appartenait d’ailleurs à personne, l’essentiel, finalement, étant d’en être conscient et de gérer ce drame du mieux possible. Ni dieu, ni maître, ni rien du tout. Qu’une boule de flipper lancée, par hasard, dans une partie que personne ne contrôle, et où chaque péripétie entraînera d’autres péripéties, nullement choisies, justes subies, et dont la boule essayera de se sortir du mieux possible ou plutôt, avec le moins de mal possible, et avec parfois le sentiment prétentieux d’avoir pris une décision supérieure, d’avoir atteint le plus haut degré de conscience. Non, c’était affreux, un cauchemar. Il devait essayer de contrôler le jeu ! Au moins une fois, dans une circonstance, juste une, quelles qu’en soient les conséquences, mais qu’il puisse se dire, avant la fin, « ça c’est à moi. » Même s’il ne s’agissait que d’une réaction contre un système, qu’une révolte contre la dictature permanente des jours qui défilent hors de toute maîtrise, il devait au moins une fois montrer son opposition. Ce serait certainement dérisoire par rapport à toutes les années de soumission mais ce serait enfin un acte relativement personnel.
Il songea à sa rencontre avec Birgitt et Yolanda. Tout était du hasard. Depuis son départ de l’école, le passage au lac Charpal, l’arrivée dans les Landes. Pourquoi là et pas un peu plus loin ? Seul l’instant où il était parvenu à leur adresser la parole, à leur donner envie de s’arrêter, avait marqué le sceau de sa volonté. Quelques secondes. Il lui avait fallu pratiquement un an de dérives pour y parvenir.
-
Anaïs Quemener
- Par Thierry LEDRU
- Le 22/02/2025
Le cancer du sein est une terrible épreuve et le parcours de cette femme est porteur de vie.
Je sais à quel point le sport est salvateur. Aussi difficile que soit la reprise, aussi laborieuse que soit chaque séance quand on a dû tout arrêter, il est tellement puissant de ressentir cette vie en soi que la pratique d'un sport relève de la thérapie.
Rescapée d'un cancer, aide-soignante de nuit et championne de France de marathon, Anaïs Quemener est la star d'un docu génial
Article mis à jour le 10/10/23 15:09
Depuis le 10 octobre 2023, le documentaire "Anaïs" est disponible sur SalomonTV. Un film inspirant et émouvant, qui retrace le parcours de la marathonienne Anaïs Quemener
Tout juste deux semaines après avoir réalisé 2h29'01 au marathon de Berlin, Anaïs Quemener est montée sur la troisième marche du podium des 20 kilomètres de Paris le dimanche 8 octobre 2023. Mais où est-ce que cette coureuse aux paillettes aux coins des yeux et au sourire contagieux va-t-elle puiser son énergie ? Dans Anaïs, un documentaire disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de son sponsor Salomon depuis le 10 octobre, la talentueuse réalisatrice Hélène Hadjiyianni tente de nous apporter une réponse. Elle a suivi cette athlète le jour et aide-soignante la nuit durant trois mois, lors de sa préparation pour le marathon de Paris 2023. Une plongée intime, émouvante et passionnante au cœur de la vie d'Anaïs Quemener et de sa "meute", son club de cœur mais aussi sa famille, et qui retrace le parcours d'une passionnée que même un cancer du sein découvert à l'âge de 23 ans n'aura pas empêché de chausser ses baskets pour aller courir. Interview.
Journal des Femmes : Comment votre passion pour l'athlétisme a commencé ?
Anaïs Quemener : J'ai toujours vu ma famille courir : mon père, mes grands-pères avant lui... J'ai baigné dans cette culture du sport, du dépassement de soi. C'était naturel de me diriger vers la course à pied. J'ai intégré un club à 9 ans. À cet âge, on fait tout : du lancer de balles, du saut en longueur, du 1000 m, du cross. Mon père était déjà entraîneur et cette passion a perduré parce qu'on ne m'a jamais forcée. J'allais courir pour m'amuser, retrouver mes copain-ine-s. Il n'y avait aucune contrainte. À l'adolescence, j'en ai aussi fait un peu. Mais j'en avais un peu marre de me lever tôt le dimanche matin pour m'entraîner ou faire des compétitions. Pourtant, au final, ça m'a jamais vraiment lâché.Pourquoi avoir décidé de vous lancer sur marathon ?
Ça s'est fait naturellement : j'ai commencé par le cross, le 1000 m, le 3000 m, le 10 km… La distance m'a toujours fait rêver. Quand j'étais plus jeune, on regardait les marathons à la télévision, les championnats du monde, d'Europe. Malgré le décalage horaire, on se levait à 2 ou 3 heures du matin pour suivre les courses. C'était presque un passage obligatoire, je savais que j'allais y venir. J'ai fait mon premier marathon à 21 ans et j'ai adoré. Dès que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai eu envie de recommencer. Et pourtant, au départ, c'était un pari avec mes copain-ine-s du club. Nous nous étions inscrits un mois plus tôt pour participer au marathon de Rotterdam.Que ressentez-vous lorsque vous courez ?
C'est compliqué à expliquer, parce que c'est un sentiment qui me prend aux tripes. C'est le feu. C'est le feu dans tout mon corps. J'adore courir, je n'attends que ça. Quand je prends le départ d'une course, quand j'accroche un dossard, je me mets dans ma bulle et je n'ai qu'une hâte : courir.
Anaïs Quemener lors du Marathon de Berlin 2023 © Margaux Le Map / Salomon
À quoi ressemble l'une de vos semaines d'entrainements en période de préparation marathon ?
Je cours beaucoup. Le mois précédent le marathon de Berlin, je parcourais entre 180 et 190 kilomètres par semaine. Ce qui correspond à 20 heures d'entraînement environ. Si mon emploi du temps me le permettais, j'essayais de faire du bi-quotidien : un footing le matin et une séance le soir. Et si ce n'était pas possible, j'allais au travail et j'en revenais en courant pour augmenter mon kilométrage un peu plus facilement. Je suis très heureuse, car tout s'est bien passé, je ne me suis pas blessée, ce n'était que du plaisir.Avec une telle intensité, vous devez avoir une très bonne hygiène de vie ?
On ne peut pas vraiment dire ça (rires). Le sommeil, je peux m'améliorer, l'alimentation aussi même si j'ai fait des efforts depuis le marathon de Paris. Je vois une nutritionniste désormais, mais avant c'était pizza à gogo. J'en ai encore mangé une l'avant-veille du marathon de Berlin. Quand tu cours 190 kilomètres par semaine, il faut aussi savoir se faire plaisir. Mais je sais que la nutrition a son importance, je l'ai appris par la force des choses sur mes courses. Je mets des choses en place petit à petit avec ma nutritionniste. Ce sont des petits détails qui peuvent faire toute la différence.Vous avez eu un cancer du sein à l'âge de 23 ans. Comment l'avez-vous découvert ?
Tout bêtement, en prenant ma douche. J'ai senti une boule dans mon sein. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'avais 23 ans, je faisais du sport, je me sentais en forme. Il n'y avait pas de raison ! J'ai quand même pris rendez-vous avec ma gynécologue, qui m'a dit que c'était hormonal après un examen assez expéditif. Environ six mois plus tard, alors que je travaillais aux urgences, j'ai demandé à une autre médecin de regarder. Elle m'a prescrit un bilan qui est revenu parfait. Mais un an plus tard, la boule était toujours là et elle commençait à grossir et déformer mon sein. Si c'était un kyste, je voulais le faire enlever. On m'a prescrit une ponction, une biopsie et une échographie mammaire au mois de juin. Les résultats ont mis du temps à arriver. Ils sont tombés début août, la veille de l'anniversaire de mon père. J'ai compris tout de suite en voyant la tête du médecin. Je lui ai demandé si c'était un cancer, il m'a répondu "Oui" ,mais il m'a dit qu'il n'allait pas me laisser comme ça. Et j'ai tout de suite rencontré l'oncologue qui m'a suivi. Je me dis souvent que si je n'étais pas tombé sur lui, je n'aurais pas vécu les choses de la même manière. Il me faisait rire. Quand j'arrivais dans son cabinet, il me disait "Mais qu'est-ce que tu fais là toi, tu pourrais être ma petite fille !" Je répondais que je n'avais rien demandé à personne. Quoi qu'il arrive, ces rendez-vous étaient toujours des bons moments.Combien de temps a duré le traitement ?
J'ai fait huit mois de chimiothérapie, puis deux mois de radiothérapie et ensuite je me suis fait opérer avec une ablation du premier sein, puis le deuxième car mon cancer était génétique. J'ai eu plusieurs opérations de reconstruction qui n'ont pas fonctionnées et j'ai finalement tout retiré en 2019. Je me sens beaucoup mieux comme ça, je n'ai pas de douleurs et je peux dormir sur le ventre ! Et mentalement, c'est important de ne plus avoir de corps étranger en moi. J'étais une jeune adulte lorsque j'ai eu ce cancer. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et ce qui est marrant, c'est que je me sens beaucoup plus féminine aujourd'hui que lorsque j'avais mes seins.Comment le sport vous a aidé dans cette période compliquée ? Votre oncologue vous a-t-il toujours soutenu dans votre pratique ?
À moitié. Il m'a toujours encouragé à courir, mais pas forcément en compétition. Et moi, je voulais faire de la compétition. On a un peu filouté avec mon père, en allant voir un autre médecin qui me connaissait bien et qui a accepté de me rédiger un certificat médical pour pratiquer la course en compétition, tout en me disant de faire très attention, d'être à l'écoute de mon corps. En sortant du cabinet, je voulais déjà m'inscrire à un 10 km. Je faisais déjà beaucoup de sport avant la maladie. Je ne pouvais imaginer ne pas en faire pendant le traitement. Je ne pouvais déjà plus travailler ! Lorsque je me rendais au club, pendant une heure, j'oubliais que j'étais malade.Vous êtes aujourd'hui marraine de l'association Cassiopeea qui soutient la pratique sportive pour les malades du cancer...
Quand je suis tombée malade, j'ai voulu rencontrer des gens comme moi, qui étaient malades mais qui avaient aussi envie de faire du sport. Plusieurs associations proposaient du yoga, du stretching… Ce sont de supers activités, mais ce n'est pas mon truc, je voulais me dépasser. J'ai alors fait la rencontre de la présidente de l'association Cassiopeea. Elle avait déjà participé au Marathon des sables. Son profil m'a parlé. J'étais encore sous chimiothérapie lorsqu'on a fait connaissance. J'ai pu discuter avec elle des traitements, elle a répondu à toute mes questions dans une grande bienveillance. Et lorsque j'ai gagné le titre de championne de France de marathon en 2016, elle m'a proposé de devenir marraine. J'ai évidemment accepté. On accompagne les malades mais aussi les aidants qui sont trop souvent oubliés.Vous êtes aujourd'hui encore aide-soignante de nuit. N'avez-vous eu jamais envie de vous lancer dans une carrière d'athlète à temps plein ?
Mon métier de soignante est clairement une vocation. J'adore ce que je fais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerai avoir un peu plus de temps à consacrer au sport. Je ne me posais pas la question avant. La course à pied n'est pas vraiment un sport qui paye. Mais depuis le marathon de Berlin, j'ai des opportunités qui se présentent et je me sens plus légitime. J'ai demandé un aménagement de temps à mon employeur. Je ne sais pas si cela va être accepté, mais ma demande a été entendue. C'est le moment ou jamais. Mais je me pose aussi des questions : est-ce que le plaisir que j'éprouve à courir restera le même ? J'ai trouvé un équilibre aujourd'hui. Si j'augmente ma charge d'entraînement, est-ce que je ne risque pas de me blesser ? C'est un vrai cheminement.Vous venez de réaliser 2h 29min01' au marathon de Berlin. Comment s'est passée votre course ?
Je suis hyper chanceuse, car j'ai couru avec Ricardo et Mustapha, deux garçons de mon club qui ont à peu près le même niveau que moi et pendant 36 km, on était ensemble. C'est précieux, parce qu'on a pu partager la préparation ensemble, les entraînements mais aussi le quotidien. Je n'ai pas réussi à avoir de dossard élite, ce qui m'aurait permis de partir dans un sas préférentiel et de m'échauffer jusqu'au dernier moment. Donc les cinq premiers kilomètres, on a un peu slalomé entre les gens. Au 10ème kilomètre, on avait 20 secondes d'avance, puis 30 secondes au semi et ça a commencé à m’inquiéter. C'est devenu difficile pour moi au 35ème kilomètre, mais j'ai serré les dents, le plus dur était fait. Je me suis laissé distancer par les garçons, mais nous sommes tous les trois arrivés en une minute de temps.Vous vous retrouvez à un peu plus de deux minutes des minimas olympiques. Est-ce un objectif pour vous ?
Oui, mais pas forcément pour ceux de Paris. C'est dans moins d'un an, ça me paraît compliqué. Et je ne veux pas faire que du marathon. Je veux continuer le cross, la piste, les 10 km, le semi-marathon. Pour moi, c'est le plaisir avant tout, je ne suis pas une athlète professionnelle. Je vais tout de même tenter de faire descendre mon record personnel sur marathon à Valence. Les minimas seront durs à aller chercher mais je n'ai rien à perdre à essayer.Qu'est-ce que représentent les Jeux olympiques pour vous ?
Un rêve de petite fille. C'est un graal de pouvoir y participer, même en tant que spectatrice. Mais mon plus grand rêve, c'est de rester en bonne santé et de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Et ça, ça n'a pas de prix.Sarah Duverger Mis à jour le 10/10/23 15:09
Tous les liens suivants relatent des histoires de femmes à travers le sport.
Bios
Marie-Amélie Le Fur, l'athlète paralympique française aux 9 médailles
Oksana Masters : d'un orphelinat ukrainien aux podiums internationaux, un destin hors norme
Sandrine Martinet, la parajudokate française au mental d'acier
Charlotte Bonnet, une nageuse de conviction au chevet des plages marseillaises
Qui est Mélanie de Jesus dos Santos, l'espoir olympique de la gymnastique française ?
J'ai 22 ans, je suis golfeuse amatrice et j'ai participé à une grande compétition internationale
Rencontre avec Samantha Davies, la navigatrice qui fait rimer solidarité et performance
Je m'appelle Isabeau Courdurier, j'ai 29 ans et je suis championne du monde d'enduro VTT
Sandrine Martinet : "Être mère et sportive de haut niveau, c'est possible"
Anne-Sophie Bernadi : à la rencontre de la voix du biathlon
Mélina Robert-Michon, lanceuse de disque, 44 ans et deux enfants : " Le sport a changé ma vie "
Annie Londonderry tour du monde
À la rencontre de Julie Iemmolo, la jeune Française spécialiste du triathlon longue distance
Gaëtane Thiney : "Le football, c'est toute ma vie"
Voici l'incroyable histoire de Nadia Nadim, la joueuse de foot danoise qui a fui les Talibans