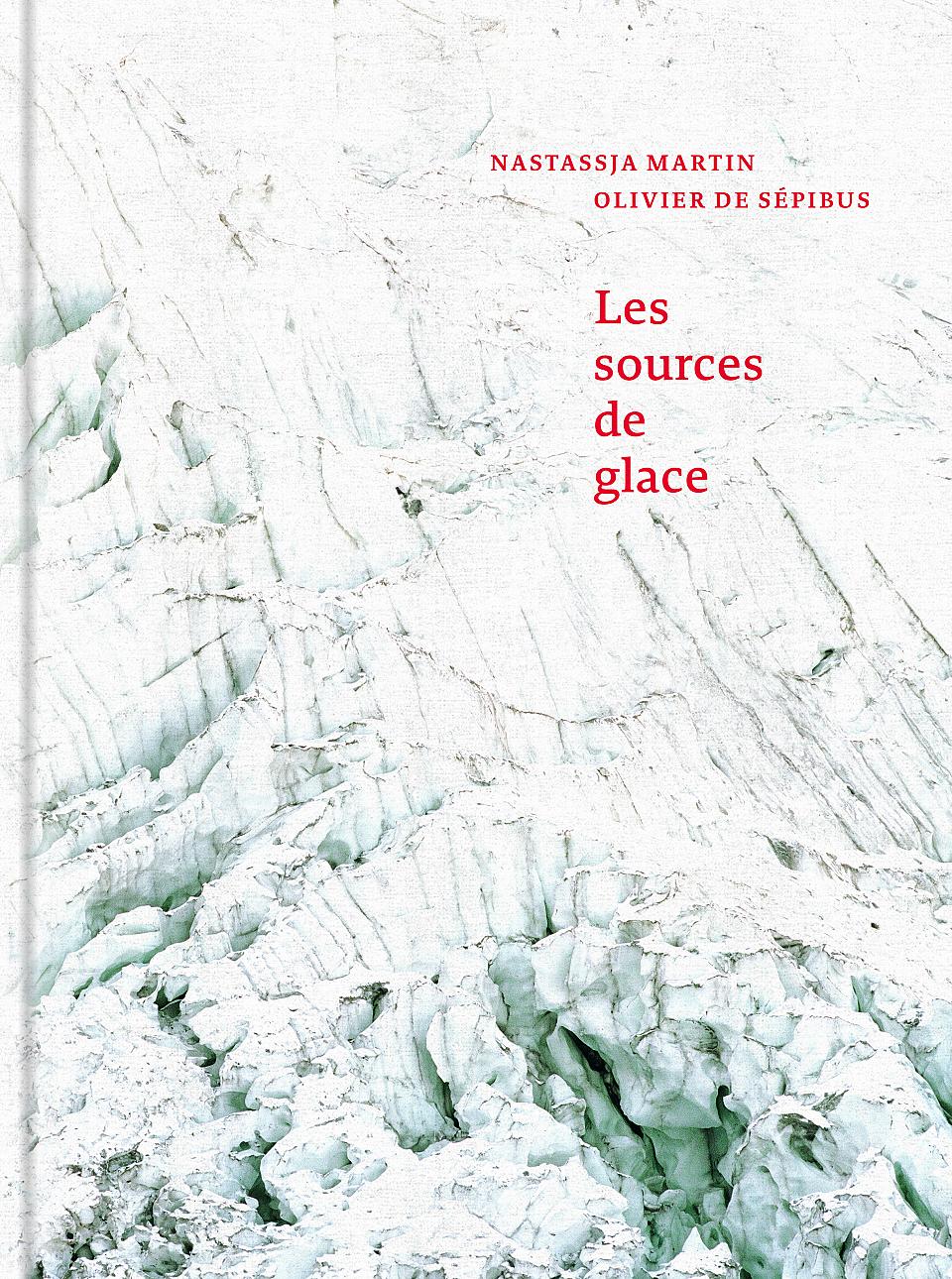Rééduquer le regard.
- Par Thierry LEDRU
- Le 25/07/2025
- 0 commentaire
Totalement en phase avec les propos. Il s'agit de changer raidalement notre regard sur le Vivant et non continuer à se l'attribuer dans des schémas économiques.
Indépendant | ø pub | Accès libre
https://basta.media/les-montagnes-sont-des-lieux-ou-encore-possible-resister-a-appropriation-capitaliste-Nastassja-Martin
Nastassja Martin : « Les montagnes, ces franges qui ont su résister à l’appropriation capitaliste »
Pour espérer répondre à la crise écologique, il faut repenser nos imaginaires, notre lien à la nature en général, aux montagnes et aux glaciers en particulier. Ce à quoi invite l’anthropologue Nastassja Martin avec « Les Sources des glaces ». Entretien.
par Barnabé Binctin
25 juillet 2025 à 09h30 Temps de lecture : 13 min.

Nastassja Martin, anthropologue, spécialiste du Grand Nord. © Mathieu Génon
Basta! : Dans Les Sources de glace (Paulsen, 2025), que vous publiez avec le photographe Olivier de Sépibus, vous invitez à renouveler en profondeur notre regard sur les glaciers. Vous y écrivez : « Voilà le gouffre : nos idées sur le monde ne sont plus tenables, ne sont plus vivables, comme les montagnes et leurs glaciers, elles ne tiennent plus debout. […] L’image qui préside à nos imaginaires de la montagne se disloque. » Que voulez-vous dire par là ?
Nastassja Martin : On peut partir de l’actualité récente : le 28 mai dernier, un glacier s’est effondré en Suisse, et a inondé un village entier. Cette catastrophe nous rappelle que parler d’ « effondrement » n’est pas une métaphore, et que des événements d’une telle amplitude sont de plus en plus probables. D’où la nécessité de repenser nos relations à ces entités, et la terminologie que nous utilisons pour les comprendre.
La modernité nous a enfermés dans une lecture qui ne nous permet plus de comprendre les transformations actuelles. Plus encore qu’un problème d’imaginaire, c’est un problème conceptuel, issu de la méthodologie naturaliste qui a forgé notre manière de percevoir le monde : en Occident, nous avons complètement désanimé ce type d’entités, ainsi que les relations que nous pouvons entretenir avec elles. Nous considérons les glaciers comme des milieux abiotiques [où la vie serait impossible, ndlr], ou comme des objets composant un « paysage », privés de toute puissance d’agir.
L’anthropologue Nastassja Martin vient de publier Les Sources de glace, avec le photographe Olivier de Sépibus (Paulsen), où elle nous invite à renouveler en profondeur notre regard sur les glaciers. Elle avait publié Croire aux fauves, chez Verticales, en 2019.
Pourtant le changement climatique devrait bouleverser profondément cette perspective, puisque ce sont bien ces entités-là qui se lèvent et menacent nos vies humaines. Les glaciers qui fondent, les montagnes qui s’effondrent, les rivières en crue, les tornades : ce sont aujourd’hui des éléments qui deviennent littéralement acteurs des transformations de nos milieux.
Il nous faut donc, en quelque sorte, rééduquer notre regard pour pouvoir penser différemment les glaciers, et c’est autour de cet enjeu que l’on s’est rencontrés avec Olivier. Ce sont toujours des mots et des images qui sous-tendent nos relations au monde, raison pour laquelle nous voulions réfléchir à un nouvel imagier – lui dans le travail de la photographie et moi à travers l’écriture – qui soit plus à même de répondre aux métamorphoses en cours.
Vous pointez notamment la responsabilité de l’art pictural de la Renaissance dans cette « objectivation de la nature ».
Je prolonge l’hypothèse formulée par [l’anthropologue] Philippe Descola dans Les Formes du visible (Seuil, 2021), selon laquelle notre vision scientifique du monde, aujourd’hui, serait bien plus un effet de peinture que le résultat d’une approche philosophique. C’est à mon sens une question centrale que de se demander si c’est bien la construction de cette réalité picturale qui a façonné nos épistémologies, et non l’inverse.
Sur le même sujet
Lorsque l’on s’intéresse à l’histoire de l’art du XVe et du XVIe siècle, on se rend compte que bon nombre de peintres, des Flandres jusqu’à Florence – Campin, Van Eyck, Dürer, Fra Angelico –, ont façonné le concept même de « paysage », la nature visuellement confinée dans un monde extérieur aux humains. Et on a fini par systématiser ce point de vue, cette perspective sur les choses. Cette extériorisation a entraîné une forme de réductionnisme des attachements pluriels que l’on peut entretenir avec, entre autres, les montagnes et les glaciers.
Par exemple, on se réfère aujourd’hui principalement aux glaciers comme à des ressources et à des stocks d’eau, aux fonctions essentielles dans le cycle de la vie. On parle de gain de neige en amont, de perte d’eau en aval, de services écosystémiques, de bilans négatifs ou positifs. S’il faut évidemment continuer de se doter de moyens pour mesurer l’évolution de ces glaciers, on constate néanmoins que le champ lexical des sciences de l’écologie a été largement infiltré par les mots du discours économique.
Or ces mots produisent des effets sur nos imaginaires, sur nos façons de penser les glaciers. Ils nous coupent de la possibilité de s’y relier autrement et, de fait, le principe même d’animation de ces entités reste quasi-impensable dans notre société.
On en Agro
La newsletter qui révèle l’envers de notre alimentation. Les enquêtes et actus sur l’agro-industrie, et les initiatives de celles et ceux qui lui résistent.
Mon adresse email :
En m’inscrivant j’accepte la politique de confidentialité et les conditions générales d’utilisation de Basta!
Comment faudrait-il alors appréhender les glaciers, si on ne doit plus les voir comme des ressources, ni même seulement comme une fonction dans le cycle de la vie ?
C’est une très bonne question, à laquelle je ne peux justement pas répondre : non pas parce que je n’en ai pas envie, mais parce que c’est un devoir de laisser la réponse en suspens. Nous savons être normatifs, nous avons quantifié, mesuré, évalué, décrit et défini telle ou telle ressource, tel ou tel stock. Et pourtant, toutes ces entités que nous pensions connaître se disloquent à grand fracas et de manière accélérée. Les forces qui sont à l’œuvre nous dépassent, et continueront de nous dépasser malgré ce qu’en disent les adeptes du techno-solutionnisme.
Le Dôme du Goûter (4304 m), sur le massif du Mont-Blanc, 2022.
© Olivier de Sépibus
Nous avons aujourd’hui un problème de méthode : si nous restons coincés dans notre épistémologie habituelle, nous ne pourrons pas répondre à la crise autrement que par du conservationnisme ou de la géo-ingénierie. Re-pluraliser nos modes de relation aux glaciers passe par un travail d’ethnographie, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir documenter toutes les manières différentes de se relier à ces entités – j’utilise ce terme, mais il n’y a pas une seule et bonne manière de les nommer.
Quand vous discutez avec des bergers, des chasseurs, des guides de haute montagne, des grimpeurs, des naturalistes, et que vous leur demandez de décrire leurs attachements à la montagne, vous obtenez des réponses inattendues, bien loin du discours naturaliste classique. C’est toute une constellation qui se dessine, qui ne se résume pas à l’objectivation froide de la montagne.
« Le champ lexical des sciences de l’écologie a été largement infiltré par les mots du discours économique »
Il y a de nombreuses manières de dialoguer avec les glaciers. Elles résonnent souvent avec des formes d’animisme, qui n’est certainement pas un mode de pensée circonscrit aux peuples autochtones vivant de l’autre côté de la planète, dans les lointaines forêts, toundras ou déserts. Le problème, c’est que ces voix-là ne sont plus écoutées dans les plans de gestion, qu’ils soient « aménagistes » ou conservationnistes.
Et vous, à titre personnel, quel rapport entretenez-vous avec la montagne ?
J’y habite, pour commencer. Je pratique l’alpinisme, le ski de randonnée, l’escalade ; j’aime ce rapport physique à la verticalité. Cela a presque à voir avec une pratique thérapeutique, il y a quelque chose de l’ordre d’un élan vital. Je crois que la montagne est le seul endroit où je peux retrouver ces idées d’ « engagement » et de solidarité qui caractérisent les relations que j’ai pu nouer avec les Even [un peuple nomade d’éleveurs de rennes, ndlr], dans le cadre de mon travail d’anthropologue, au Kamtchatka [péninsule située en Extrême-Orient russe, ndlr]. La notion de risque y est permanente et quasi-quotidienne dans leurs vies. Y faire face demande de tisser de forts liens de dépendance choisie entre humains.
La cordée en montagne, c’est pareil : c’est un micro-collectif en mouvement qui apprend à se faire confiance, à compter l’un sur l’autre pour avancer ensemble sur un terrain instable. Lorsqu’on évolue sur un glacier plein de crevasses et de séracs ou sur une face remplie de cailloux branlants, la question de l’incertitude redevient totale, primordiale. La montagne est un endroit qui nous confronte à nos vulnérabilités et à nos limites.
On a beau mettre dans nos gestes toute la puissance dont on dispose, on a beau tenter de tout garder sous contrôle, la montagne risque toujours de nous déborder, de nous surprendre, de nous faire chuter. Il reste toujours une part d’inconnu, même quand les voyants sont au vert et que les conditions paraissent bonnes.
Quand on entre en relation avec la montagne de manière physique, sur le terrain – je veux dire, pas de façon contemplative, en la dessinant ou en l’observant depuis sa chaise – on sent bien qu’il y a quelque chose qui pulse, qui gronde. On comprend que c’est une puissance élémentaire – on peut aussi la nommer ainsi – avec son propre rythme. Ce n’est pas un endroit « sécurisé » fait par et pour les humains. Or, c’est une possibilité de relation à l’altérité dont la modernité a fini par nous priver au fil du temps, et qui ne subsiste que marginalement sur certains territoires peu anthropisés.
« La montagne est l’un de ces déserts pour exilés » écrivez-vous. Vous utilisez aussi plusieurs fois le terme de « refuge ». Pour fuir ou se protéger de quoi, exactement ?
Les montagnes, comme les toundras, les steppes ou certaines forêts font encore partie de ces franges qui ont su résister plus longtemps à l’appropriation capitaliste, à la domestication, à la mise en disponibilité de chaque partie du monde. Ce sont des lieux où il est encore possible de vivre sous d’autres normes. Cela rejoint tout mon travail d’anthropologue : mes recherches visent à montrer qu’il existe encore des manières d’être au monde, certes minoritaires, qui résistent à un schéma de pensée dominant.
Vedretta di Fellaria, au dessus de la vallée d’Engadine, l’une des plus haute vallée d’Europe (2400 m) à la frontière entre la Suisse et l’Italie.
© Olivier de Sépibus
La tragédie actuelle, c’est que ces poches sont de plus en plus rares, elles se réduisent comme peau de chagrin. Je le vois tous les jours sur le canton de La Grave (Hautes-Alpes), où j’habite : il suffit de changer de versant de montagne pour tomber sur la station de ski des Deux Alpes. Tout l’inverse de la montagne « refuge » : un endroit parfaitement lissé, balisé et sécurisé pour que le touriste CSP+ puisse venir (se) « dépenser » de la façon la plus confortable possible.
On a même installé des escalators dans les téléphériques, on s’y déplace désormais comme dans des aéroports. On est là en présence d’une montagne complètement objectivée, convertie en formidable parc d’attractions grandeur nature, c’est-à-dire en ressource au sens parfaitement économique du terme.
Lors du One Planet - Polar Summit, premier sommet consacré aux glaciers et aux pôles en novembre 2023, Emmanuel Macron s’était engagé à placer 100 % des glaciers français « sous protection forte d’ici 2030 ». Vous n’y croyez pas ?
C’est un engagement important, même si on sait que dans les faits, ça risque d’être plus compliqué. Et puis tout dépend de la manière dont ça va être mis en place. J’avais noté une phrase qui m’avait alertée : en décembre 2023, quelques jours après cette annonce, le sénateur [écologiste] Guillaume Gontard avait proposé un premier engagement très concret à travers la protection du glacier de la Girose [à La Grave, ndlr].
Le gouvernement lui avait répondu qu’il allait y avoir – je cite – « le lancement imminent d’une initiative, co-pilotée par les préfets de région et les présidents de région concernés, ancrée sur les territoires, pour que chacun puisse s’approprier les enjeux de ces nouveaux espaces à haute valeur ajoutée de biodiversité »…
Rien ne va dans cette formulation, si l’on regarde attentivement les termes : on est encore dans un vocabulaire très économiciste, avec l’idée qu’émergeraient de nouvelles ressources à travers la question du dérèglement climatique, et qu’on va pouvoir en faire quelque chose, que ce soit dans une logique d’aménagement ou de conservation. On en revient à notre point de départ : la formulation du problème. S’il est impossible de formuler le problème autrement, que va-t-on bien pouvoir changer ? Rien. Nous n’allons que reproduire les mêmes logiques, sous des formes peut-être renouvelées, mais avec un fond identique.
Faudrait-il envisager de donner des droits aux glaciers, dans le même mouvement de personnalisation juridique qui concerne déjà des fleuves ou des forêts à travers le monde ?
C’est une question sur laquelle j’aimerais me pencher, prochainement. On a vu les effets positifs que cela a pu produire à différents endroits, avec le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande ou ailleurs en Amérique du Sud. C’est un outil juridique qui peut être très intéressant, même s’il soulève de nombreuses questions. Dans le droit roman-germanique, une entité sujet de droit est également soumise à des devoirs : quels seraient-ils pour un glacier, ou une montagne ?
Si c’est pour finir par penser ces devoirs sous la forme de « services écosystémiques » rendus par les entités – comme la captation de carbone pour une forêt, ou, imaginons, le stock d’eau potable pour un glacier – le risque est de retomber dans une logique économicisante, où l’on attribue un prix et une valeur monétaire à chaque chose. Soit toute la logique du capitalisme vert… Il faut y réfléchir sérieusement, pour que le remède ne se révèle pas pire que le mal.
Votre texte est empreint d’un certain pessimisme, à l’image de cette question que vous posez : « Pourquoi vouloir agencer de faibles mots autour des montagnes qui s’effondrent quand tout hurle autour ? » Comme si vous doutiez de votre posture de chercheuse, et du sens de votre travail…
Bien sûr que je doute, sinon je ne serais pas une bonne chercheuse. Et bien sûr que je me pose la question du sens que cela peut encore avoir dans la conjoncture actuelle. Il y a de la fatigue, la tentation de la stupéfaction, voire de l’aphasie devant l’incroyable emballement de la machine. Parler des glaciers quand tous les matins, à la radio, on compte les morts à Gaza et en Ukraine, vraiment ? Oui, parfois, on se dit qu’il vaudrait mieux se taire. Pourtant, justement, je pense que résister à la pétrification, c’est aussi croire aux formes de vitalité qui subsistent ça et là, malgré la violence, la guerre, la mort, malgré toute l’absurdité et l’ignominie des processus de destruction en cours.
À l’écriture, je me suis beaucoup inspirée de René Char, dont j’ai repris plusieurs vers pour scander le texte. C’est le poète de la résistance par excellence, les agencements de mots parmi les plus forts qu’il ait pu écrire l’ont été pendant l’horreur absolue de la Seconde Guerre mondiale, vers 1943-1944. Sa poésie devint l’aiguillon du désir de rester vivant.
« Parler des glaciers quand tous les matins, on compte les morts à Gaza et en Ukraine, vraiment ? »
Les chercheurs, eux aussi, à l’instar de René Char, doivent mettre au travail leur réflexivité, et repenser les idées et les concepts qu’ils manient pour saisir le monde. La posture d’extériorité et d’objectivité présumée des chercheurs est devenue obsolète. Réajuster nos mots et reformuler nos épistémologies peut nous aider à répondre collectivement aux processus d’effondrement en cours.
Mais que peut encore « l’épistémologie », aujourd’hui, à l’heure du règne de Cyril Hanouna, des fake news et de la post-vérité ?
Je pense qu’il y a un gros travail de réflexion à mener sur les dispositifs que l’on met en place, aujourd’hui, pour produire de la recherche, partager des savoirs et créer du commun en dehors d’une petite sphère de happy few. L’enjeu n’est plus uniquement de faire venir des étudiants à l’université pour écouter des séminaires de professeurs tout à fait brillants. On sent bien que les lieux classiques du savoir scientifique sont en perte de vitesse, les gens n’y croient plus, il y a de moins en moins de débouchés et de perspectives puisque les financements vont ailleurs.
C’est pour ça qu’il y a trois ans, avec la journaliste et éditrice Anne de Malleray, on avait organisé l’événement Un refuge pour la pensée, sur le canton de la Grave. L’idée c’était de faire se déplacer les chercheurs pour les mettre un peu les pieds dans la boue, si j’ose dire, et les confronter aux habitants, aux habitantes et aux problématiques locales, telles qu’elles sont vécues au quotidien sur le territoire. Et en même temps, de permettre à ces habitants de discuter avec tous ces gens qui, même s’ils n’ont pas nécessairement la même relation incarnée aux problématiques qui traversent le territoire, ont néanmoins passé leur vie à réfléchir à ces questions de tourisme en montagne, de pastoralisme, de glaciers, etc.
Toutes ces questions sur l’habitabilité de la Terre ne peuvent plus être formulées uniquement par des chercheurs, car cela reviendrait à se complaire dans un « extractivisme scientifique » du savoir.
« La posture d’extériorité et d’objectivité présumée des chercheurs est devenue obsolète »
Ces questions doivent se construire avec et sur les territoires, par tous les gens qui sont directement traversés par ces problématiques. La rhétorique de la « co-construction des savoirs » est un peu mise à toutes les sauces aujourd’hui, mais rares sont ceux qui le font vraiment. L’enjeu est pourtant bel et bien que la normativité n’émane pas toujours des mêmes cercles et des mêmes personnes.
Vous vous êtes beaucoup engagée au sein du collectif La Grave autrement, qui s’oppose au projet d’extension d’un téléphérique sur le glacier de la Girose. En octobre 2023, une ZAD – la plus haute d’Europe, à 3 400 mètres d’altitude ! – s’y était même organisée pour alerter contre « l’exploitation et l’artificialisation des montagnes ». Est-ce aussi à travers ce genre d’actions militantes que l’on peut aujourd’hui parvenir à « murmurer d’autres possibles chez nos contemporains », pour reprendre votre formule de conclusion ?
Sur le même sujet
« Devenir un refuge climatique » : les pistes d’une station pour sortir de la dépendance au ski 
On se pose tous la question des meilleurs leviers. Les ZAD en font certainement partie. Il faut multiplier les collectifs citoyens qui se ressaisissent des questions politiques, économiques, sociales qui traversent leur territoire. Parce qu’ils ont bien compris que pour produire du commun, on ne peut pas se contenter de déléguer l’aménagement de son territoire à de grandes entreprises, et la protection ou la conservation aux instances de gestion étatique. On a besoin de reprendre le dialogue, tout simplement. Je ne vois pas d’autres manières, en réalité.
Les nouveaux récits communs, la construction de nouvelles « cosmopolitiques » ne peuvent être que le résultat de la rencontre et des échanges au sein de ces collections citoyens, entre les habitants, les chercheurs, les militants. Parfois, je me dis qu’on a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs : à quoi bon tenir de grands discours sur le réenchantement du vivant et remettre au goût du jour des manières animistes de se relier aux non-humains si l’on n’est pas déjà capable de dialoguer entre humains et de partager les attachements multiples aux entités qui composent nos mondes ?
Cet article est gratuit mais...
...il ne coûte pas rien. Chacune de nos enquêtes ou reportages équivaut à plusieurs jours de travail. Pourtant, nous n’avons ni riche mécène ni publicité. Ce miracle est possible grâce au soutien de 5000 personnes par an. Vous aussi, soutenez un média radicalement indépendant et porteur de nouvelles voix.
Auteurs / autrices

Journaliste, orienté écologie (et) politique, avec quelques tropismes assumés autour de la montagne, de l’Inde, ou du football. Pour Basta, je réalise notamment des enquêtes et des grands entretiens. Après avoir co-fondé Reporterre, je collabore désormais avec le groupe So Press (Society, So Foot, So Film, etc.) et Le Parisien Magazine, dans le cadre de reportages en France et à l’étranger.
Ajouter un commentaire